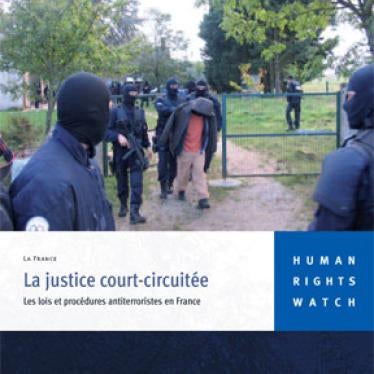Human Rights Watch, association internationale de défense des droits humains, salue le travail crucial de réflexion que le Comité que vous présidez a entrepris sur la réforme du code pénal et du code de procédure pénale. Nous saisissons cette occasion pour soumettre à votre attention nos recommandations. Dans notre rapport La justice court-circuitée : Les lois et procédures antiterroristes en France, publié en juillet 2008, nous analysons l'approche adoptée par la justice pénale française pour lutter contre le terrorisme. En nous fondant sur les résultats de cette enquête approfondie, nous souhaitons exposer brièvement ici les réformes clés que nous jugeons nécessaires pour mettre les lois antiterroristes françaises en conformité avec le droit international relatif aux droits humains. Nous abordons notamment les questions traitées dans le rapport d'étape du Comité ainsi que celles sur lesquelles nous pensons que le Comité devrait se pencher en poursuivant son étude.
Human Rights Watch est convaincue qu'une utilisation efficace du système de justice pénale constitue le meilleur moyen de contrer le terrorisme, tout en sauvegardant l'Etat de droit. Le devoir qui incombe à la France de protéger sa population contre les actes de terrorisme va de pair avec l'obligation, que lui imposent les droits européen et international relatifs aux droits humains, de veiller à ce que les mesures adoptées pour réprimer le terrorisme soient compatibles avec les protections coexistantes des droits humains, y compris les droits de ceux considérés comme représentant une menace. Notre enquête indique que les lois et les procédures antiterroristes françaises sapent le droit à un procès équitable des personnes poursuivies pour terrorisme.
Selon nous, la définition large du délit d' « association de malfaiteurs en relation avec une entreprise terroriste » manque de précision juridique, donnant lieu à des arrestations, des périodes de détention provisoire prolongées et des condamnations fondées sur des éléments de preuve ténus. Le manque de garanties adéquates au cours de la garde à vue nuit au droit à une défense efficace des détenus, à un moment clé de la procédure, et les expose à des mauvais traitements. L'utilisation dans les enquêtes et les procès pour terrorisme de données fournies par les services de renseignement, y compris d'informations obtenues de pays tiers où la torture est une pratique courante, soulève des préoccupations particulières notamment quand à l'usage de preuves obtenues sous la torture dans le cadre de procédures judiciaires en France. Nous développons en détail ces préoccupations ci-dessous.
Human Rights Watch ne se prononce pas sur la proposition de supprimer les juges d'instruction et de confier les enquêtes pénales au ministère public, ni sur la création d'un nouveau « juge de l'enquête et des libertés » (JEL) chargé de superviser le travail du ministère public. Le droit international relatif aux droits humains ne comporte pas de dispositions spécifiques à cet égard. Cependant, s'il est difficile d'en évaluer l'impact à ce stade, nous ne sommes pas convaincus qu'un changement de cette nature puisse répondre à nos préoccupations, essentielles en ce qui concerne la détention provisoire et le recours aux données des services de renseignement, y compris l'usage d'informations obtenues de pays tiers où la torture est une pratique courante, dans les enquêtes et les procédures judiciaires. Nous observons également une inquiétude largement partagée quant au manque d'indépendance du ministère public et au risque potentiel d'interférence de la part de l'exécutif dans les affaires sensibles ou controversées. Si le droit international n'impose pas l'indépendance institutionnelle des procureurs, des garanties suffisantes doivent être mises en place afin que les procureurs puissent mener leurs instructions de manière impartiale et objective.
La France est à la pointe pour faire avancer le respect du droit international en matière de droits humains, ainsi que pour élargir ses limites, dans le monde entier. Elle est également devenue une référence en matière d'antiterrorisme. Elle peut encore mieux faire preuve de son autorité dans ces deux domaines en garantissant que ses politiques et sa législation antiterroristes soient pleinement en accord avec la totalité de ses obligations en matière de droits humains. C'est pourquoi nous vous recommandons vivement de saisir cette occasion pour prendre en compte nos recommandations au moment de réformer le code pénal et le code de procédure pénale.
Cette contribution soumet à l'attention du Comité de réflexion sur les codes pénal et de procédure pénale l'analyse et les recommandations de Human Rights Watch, dans le cadre de son étude sur la réforme du code pénal et du code de procédure pénale. Se basant sur les résultats de notre enquête concernant l'approche adoptée par la justice pénale française pour lutter contre le terrorisme, cette contribution expose les réformes clés que nous jugeons nécessaires pour mettre les lois antiterroristes françaises en conformité avec le droit international relatif aux droits humains. Elle aborde notamment les questions traitées dans le rapport d'étape du Comité ainsi que celles sur lesquels nous pensons que le Comité devrait se pencher dans la suite de son étude.
Synthèse des recommandations
Recommandation n°1 - Affiner la définition du délit d' « association de malfaiteurs en relation avec une entreprise terroriste » donnée par l'article 421-2-1 du code pénal de façon à :
- Dresser une liste non exhaustive des types de comportement susceptibles d'entraîner une sanction pénale; et
- Énoncer clairement que l'intention de participer à une association de malfaiteurs en relation avec une entreprise terroriste doit être pleinement démontrée au-delà de tout doute raisonnable.
Recommandation n°2- Introduire les amendements nécessaires dans le code de procédure pénale afin d'améliorer les protections lors de la garde à vue :
- Donner accès à un avocat dès le début de la garde à vue et pendant toute la période de garde à vue ;
- Autoriser les suspects à s'entretenir avec un avocat en privé sans limite de temps ;
- Reconnaître aux suspects le droit d'exiger de n'être interrogés par la police qu'en présence d'un avocat ;
- Garantir à l'avocat d'un suspect un accès à des informations suffisantes sur les preuves à charge afin qu'il puisse assurer une assistance juridique efficace ;
- Garantir que les suspects se voient notifiés leur droit de garder le silence;
- Accorder aux suspects le droit de demander un examen médical par un médecin de leur choix ; et
- Assurer un enregistrement vidéo et audio de tous les interrogatoires.
Recommandation n°3 - Prévenir la détention provisoire prolongée injustifiée :
- Confirmer la procédure de renouvellement périodique de la détention provisoire, et garantir au détenu l'assistance d'un avocat lors de l'audience;
- Veiller à ce que ce soit toujours le même juge compétent en la matière qui soit chargé du dossier d'un accusé déterminé afin qu'il examine chaque décision relative à la prolongation de la détention et aux appels concernant la mise en liberté provisoire ;
- Veiller à ce que le juge ait suffisamment de temps pour examiner le fonds du dossier et prendre des décisions solidement étayées en ce qui concerne le placement en détention provisoire et sa prolongation.
- Veiller à ce que les décisions relatives à la détention provisoire soient prises par un collège de juges.
Recommandation n°4- Garantir que des éléments de preuve obtenus sous la torture ne seront pas utilisés dans le cadre d'une procédure judiciaire :
- Introduire des amendements dans le Code de procédure pénale établissant de manière explicite que les preuves obtenues sous la torture ou au moyen de mauvais traitements, quelque soit leur provenance, ne sont recevables à aucune étape de la procédure pénale et de l'instruction par les juges et les procureurs.
- Imposer aux juges d'instruction - ou aux JEL si la réforme mentionnée plus haut est mise en œuvre - l'obligation statutaire d'établir si les informations des services de renseignement ont été obtenues sous la torture.
Analyse détaillée et Recommandations
Recommandation n°1 - Affiner la définition du délit d' « association de malfaiteurs en relation avec une entreprise terroriste » donnée par l'article 421-2-1 du code pénal de façon à :
- Dresser une liste non exhaustive des types de comportement susceptibles d'entraîner une sanction pénale; et
- Énoncer clairement que l'intention de participer à une association de malfaiteurs en relation avec une entreprise terroriste doit être pleinement démontrée au-delà de tout doute raisonnable.
Dans l'intention de contribuer à votre analyse de la réforme du code pénal, nous souhaitons attirer votre attention sur nos préoccupations concernant le délit d' « association de malfaiteurs en relation avec une entreprise terroriste ». Notre enquête indique que ce délit manque de précision juridique. Le principe bien établi de légalité, consacré dans l'article 7 de la Convention européenne des Droits de l'Homme, exige que le droit pénal soit suffisamment clair et bien défini pour que les personnes soient capables d'adapter leur conduite de façon à éviter toute infraction et pour que l'interprétation judiciaire créative des tribunaux soit d'une portée limitée.[1]
L'article 421-2-1 du Code pénal définit l' « association de malfaiteurs en relation avec une entreprise terroriste » comme « le fait de participer à un groupement formé ou à une entente établie en vue de la préparation, caractérisée par un ou plusieurs faits matériels, d'un des actes de terrorisme mentionnés aux articles précédents ». Les éléments du crime développés dans la jurisprudence sont notamment les suivants : l'existence d'un groupement de plusieurs personnes unies dans l'intention de perpétrer un acte criminel collectif ; chaque membre doit avoir pleinement conscience de cette intention et du fait qu'il s'agit d'une entreprise criminelle ; et cette intention doit être démontrée par un ou plusieurs faits matériels. Il n'est pas nécessaire que l'un des participants accomplisse une action concrète pour mettre à exécution un acte terroriste.
La lettre de la loi comme la jurisprudence permettent une interprétation étendue du délit. Le manque de précision dans la loi empêche de voir clairement quel comportement est susceptible de donner lieu à une sanction criminelle et les libertés d'expression et d'association qui constitueraient normalement des droits protégés en vertu du droit international des droits humains-quelle que soit leur nature offensive- peuvent être utilisées comme preuve d'intention criminelle. Les forces de l'ordre disposent d'une trop grande latitude pour agir de façon arbitraire, et les décisions d'arrêter des suspects et d'ouvrir une instruction officielle à leur sujet se fondent sur des critères peu exigeants en matière de preuve et sur une approche qui favorise la possibilité d'opérer de grands coups de filet. La plupart des enquêtes portant sur des activités terroristes islamistes présumées en France sont basées sur la cartographie de réseaux de contacts. Cela a pu aboutir à l'arrestation et la mise en examen de proches parents, d'amis, de voisins, de membres de la même mosquée, de collègues de travail, ou de personnes qui fréquentent un restaurant déterminé. De même, il semble y avoir une trop grande marge de manœuvre pour engager une action en justice à l'encontre de personnes qui partagent des vues extrémistes et peuvent même exprimer leur soutien à des formes violentes de djihad, par exemple, mais qui n'ont pas distinctement fait la démarche de s'engager sur la voie de la violence terroriste.
Dans une communication datée d'avril 2006 au gouvernement français, le Rapporteur spécial des Nations Unies sur la protection des droits humains et la lutte contre le terrorisme, Martin Scheinin, a exprimé des inquiétudes concernant la définition élargie des délits liés au terrorisme dans le Code pénal.[2]
Des juridictions étrangères ont jeté le doute sur les éléments de preuve à la base de certaines condamnations pour association de malfaiteurs. En 2002, un tribunal allemand a par exemple refusé d'extrader Abdallah Kinai, un Algérien bénéficiant du statut de réfugié en Allemagne, vers la France pour qu'il y complète une peine d'emprisonnement de cinq ans, invoquant un manque de motifs légaux. En ce qui concerne l'appartenance présumée de Kinai à une association de malfaiteurs visant à commettre des actes de terrorisme, la Cour a établi qu' « il est impossible de déterminer, à partir des documents fournis par les autorités françaises, si le réseau prétendument dirigé par les accusés remplit même les critères d'une organisation criminelle ou terroriste (...) il n'existe aucune allégation précise qui permettrait à la Cour de déterminer la structure organisationnelle de ce réseau ».[3]
Recommandation n°2 - Améliorer les protections lors de la garde à vue
Le manque de protections suffisantes lors des gardes à vue dans des affaires de terrorisme est incompatible avec le droit international des droits humains. Notre enquête indique que la combinaison de toutes les limitations touchant les droits des suspects en garde à vue dans les affaires de terrorisme crée une situation où les détenus se voient privés du droit à une défense effective à un moment crucial et sont exposés au risque de mauvais traitements interdits. Nous sommes conscients que certaines de ces limitations s'appliquent à tous les suspects placés en garde à vue ; nos recommandations concernant l'amélioration des protections ont vocation à s'appliquer à tous les régimes de garde à vue policière.
Dans les affaires de terrorisme, le droit français prévoit un délai de garde à vue parmi les plus longs d'Europe continentale. Selon les termes du Code de procédure pénale (CPP), les personnes soupçonnées de terrorisme peuvent rester en garde à vue pendant un délai maximum de six jours avant d'être amenées devant un juge. Dans la pratique, le délai moyen de garde à vue dans les enquêtes sur le terrorisme est de quatre jours.
- Donner accès à un avocat dès le début de la garde à vue, le droit de s'entretenir avec un avocat en privé et sans limites de temps, et garantir à l'avocat un accès à des informations suffisantes afin qu'il puisse assurer une assistance juridique efficace
Les personnes soupçonnées de terrorisme ont un accès sévèrement restreint à une assistance juridique. Conformément à l'article 63 du CPP, les personnes soupçonnées de terrorisme n'ont accès à un avocat qu'après une période de 72 heures, soit trois jours, en détention provisoire. Si le juge prolonge la garde à vue de 24 heures avant la fin de la 72e heure, le premier entretien avec un avocat est repoussé jusqu'après la 96e heure, soit après quatre jours de garde à vue. Dans ce cas, la personne gardée à vue pourrait voir un avocat pour la deuxième fois 24 heures plus tard, soit après cinq jours de garde à vue. Chaque visite est limitée à 30 minutes et l'avocat n'a accès à aucune information détaillée relative aux charges qui pèsent contre son client.
Le temps limité dont disposent les avocats pour s'entretenir avec leurs clients et pour prendre connaissance de l'enquête et des charges qui pèsent contre eux réduit gravement la capacité de ces avocats à défendre efficacement leurs clients à un stade crucial de la procédure.
D'après la Cour Européenne des Droits de l'Homme, les avocats d'individus privés de leur liberté doivent avoir accès à des informations suffisantes pour pouvoir contester efficacement la légalité de la détention. [4] Si les affaires dont il est question concernaient des procédures d'habeas corpus pour des personnes placées en détention provisoire, Human Rights Watch considère que le principe de « l'égalité des armes » s'applique aux situations de garde à vue. La Cour met régulièrement l'accent sur le fait que la Convention européenne garantit « des droits non pas théoriques ou illusoires, mais concrets et effectifs ; la remarque vaut spécialement pour ceux de la défense eu égard au rôle éminent que le droit à un procès équitable, dont ils dérivent, joue dans une société démocratique ».[5]
Le droit de toutes les personnes accusées d'un crime à être assistées par un avocat constitue une garantie procédurale fondamentale. L'article 14 du Pacte international relatif aux droits civils et politiques (PIDCP) et l'article 6 de la Convention européenne précisent que toute personne accusée d'une infraction pénale a le droit « de se défendre elle-même ou d'avoir l'assistance d'un défenseur de son choix » ou, s'il y a lieu, de se voir attribuer d'office un défenseur, sans frais. Le Comité des droits de l'homme de l'ONU et la Cour européenne des Droits de l'Homme ont considéré que ces dispositions étaient applicables aux périodes précédant le procès, notamment à la période de garde à vue.[6] Dans ses observations finales sur le respect par la France de ses engagements aux termes du PIDCP, le Comité des droits de l'homme de l'ONU a vivement recommandé à la France en 1997 et plus récemment en 2008 de garantir un accès rapide à un avocat aux suspects de terrorisme placés en garde à vue.[7]
Les Principes de base de l'ONU relatifs au rôle du barreau exigent que toute personne arrêtée ou détenue puisse s'entretenir avec un avocat et le consulter « sans retard, sans aucune censure ni interception et en toute discrétion ».[8] Un livre vert daté de 2003 de la Commission européenne sur les garanties procédurales accordées aux suspects et aux personnes mises en cause dans des procédures pénales se fait l'écho de ces normes, en confirmant que le droit à la représentation en justice « naît dès l'instant où une personne est mise en état d'arrestation ».[9]
L'accès rapide à un avocat pendant la garde à vue, dans des conditions sérieuses, constitue également une protection fondamentale contre la torture et les mauvais traitements interdits. Le Comité européen pour la prévention de la torture (CPT), un organe des droits humains du Conseil de l'Europe qui fait autorité, a, dans tous ses rapports à dater de 1996, appelé la France à permettre aux détenus d'avoir accès à un avocat dès le début de la garde à vue.[10]
- Garantir le droit d'être interrogé par la police en présence d'un avocat et le droit de se voir notifier son droit à garder le silence
Le cadre actuel des interrogatoires de police nuit gravement au droit à une défense efficace à un moment clé de la procédure. Les détenus en garde à vue, quelle que soit la nature de l'infraction dont ils sont soupçonnés, sont interrogés sans la présence d'un avocat et ne se voient pas informés de leur droit de garder le silence. Les déclarations faites au cours de la garde à vue sont résumées dans une déclaration officielle versée au dossier, qu'elle ait été signée ou non par le suspect, et peut être utilisée contre lui au procès. Bien que le rapport final de la police doive mentionner la durée de tous les interrogatoires, il n'existe aucune règle fixant une limite de temps pour ces interrogatoires ni le temps de repos dont doit bénéficier un détenu entre les interrogatoires.
Si le droit international relatif aux droits humains n'exige pas de façon explicite la présence d'un avocat au cours de l'interrogatoire, il est de plus en plus admis que ce droit est d'une importance cruciale pour garantir l'équité et la justice au cours de la procédure pénale et en particulier pendant l'instruction. Les codes de procédure pénale récemment adoptés par des pays du Conseil de l'Europe comme l'Estonie, la Lettonie et la Lituanie se font l'écho de ce consensus. L'interrogatoire en présence d'un avocat est aussi la norme dans de nombreux pays de l'Union européenne, dont l'Allemagne, l'Espagne, l'Italie, la Pologne et le Royaume-Uni, et représente un exemple de bonne pratique au niveau européen. Le Livre vert de la Commission européenne sur les garanties procédurales accordées aux suspects et aux personnes mises en cause dans des procédures pénales dans les pays de l'Union européenne, publié en 2003, stipule que les suspects devraient avoir le droit de se faire assister d'un avocat « pendant tout le déroulement des interrogatoires ».[11]
La Cour européenne des Droits de l'Homme a jugé dans différentes affaires que le droit à un procès équitable exige que les suspects bénéficient de l'assistance d'un avocat dès les premiers stades de l'interrogatoire de la police « alors que les droits de la défense peuvent fort bien subir une atteinte irréparable ».[12] Dans l'affaire Magee c. Royaume-Uni, la Cour a jugé que le Royaume-Uni avait violé l'article 6 de la CEDH parce que Magee s'était vu privé de l'accès à un avocat pendant 48 heures d'interrogatoire, alors qu'il était détenu dans des conditions très similaires à celles appliquées lors des gardes à vue pour terrorisme en France. Pendant ces 48 heures, Magee s'est vu refusé tout contact avec d'autres personnes que ses interrogateurs et un médecin légiste, et a subi un interrogatoire intensif. La Cour a jugé que les « conditions de détention du requérant et le fait qu'il ait été coupé de l'extérieur étaient conçus pour exercer une coercition psychologique » et que l'équité de la procédure exigeait qu'il ait accès à un avocat dans les premiers stades de l'interrogatoire « pour contrebalancer l'atmosphère intimidante destinée à vaincre sa volonté et à le faire passer aux aveux devant les personnes qui l'interrogeaient ».[13] Dans l'affaire Averill c. Royaume-Uni, la Cour a jugé qu'une privation similaire de l'accès à un avocat pendant les premières 24 heures d'interrogatoire de police « doit tout de même être jugé également être considérée incompatible avec les droits garantis par l'article 6».[14]
Le Comité européen pour la prévention de la torture (CPT) a déclaré dans son rapport de 2000 qu'en France, « le droit à l'accès à un avocat doit aussi comprendre le droit pour une personne privée de liberté, de bénéficier de la présence d'un avocat pendant tout interrogatoire mené par la police/gendarmerie ».[15]
Le fait que les détenus ne soient pas informés de leur droit à garder le silence au cours des interrogatoires de police nuit encore davantage à leur droit à une défense efficace. Selon notre enquête, la notification aux personnes gardées à vue de leur droit à garder le silence a été introduite dans le Code de procédure pénale français en 2000, mais elle a été supprimée en 2003 suite aux pressions intenses exercées par les forces de l'ordre. Le Commissaire aux droits de l'homme du Conseil de l'Europe de l'époque, Alvaro Gil-Robles, a critiqué « le fort dommageable recul [de la France] sur ce point, car il n'est jamais bon d'occulter des droits prévus par la législation ».[16]
Le droit de garder le silence afin d'éviter de s'incriminer dans le cadre d'une procédure pénale est une norme internationale généralement reconnue. La Cour Européenne des Droits de l'Homme a interprété l'article 6 de la Convention européenne comme comprenant le droit de garder le silence, considéré comme intimement lié au principe de la présomption d'innocence. En conséquence, le Livre vert de la Commission européenne de 2003 sur les garanties procédurales a souligné que tout suspect devait être informé de « son droit ... de garder le silence ..., des conséquences d'éventuels aveux et de l'importance accordée à ses réponses au cours de procédures ultérieures ».[17]
Nous observons que la Cour d'Appel de Paris a récemment interprété le manquement à informer les suspects de leur droit à garder le silence comme une violation du droit à une défense efficace. Le jugement avait alors annulé la condamnation de cinq ancien détenus du centre de détention de Guantánamo pour association de malfaiteurs en relation avec une entreprise terroriste, entre autres parce que les accusés avaient été interrogés par des enquêteurs de la Direction de la Surveillance du Territoire (DST) dans la prison américaine, « sans que leur soit donnés connaissance de leur droit au silence » et alors qu'ils avaient été « amenés à croire nécessaires ces déclarations pour obtenir leur rapatriement en France et qu'ils n'étaient pas ainsi en mesure de se rendre compte qu'elles pourraient être utilisées contre eux. »[18]
- Donner aux suspects le droit d'être examiné par un médecin de leur choix et assurer un enregistrement vidéo et audio de tous les interrogatoires
Il est du devoir des autorités de protéger les personnes placées en garde à vue contre la torture et les mauvais traitements. La Cour Européenne des Droits de l'Homme a mis l'accent sur la nature absolue de l'interdiction de la torture et des peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants aux termes de l'article 3 de la CEDH. Dans l'affaire Tomasi c. France, qui impliquait un citoyen français accusé d'avoir participé à un attentat terroriste en Corse, la Cour a souligné que « les nécessités de l'enquête et les indéniables difficultés de la lutte contre (...) le terrorisme ne sauraient conduire à limiter la protection due à l'intégrité physique de la personne ».[19]
Comme mentionné précédemment, la présence d'un avocat dès le début de la garde à vue, y compris pendant les interrogatoires, est une garantie fondamentale contre les mauvais traitements interdits. Des examens médicaux réalisés dans un délai raisonnable par des médecins compétents et impartiaux représentent une autre protection importante. C'est pourquoi nous estimons que les suspects devraient avoir le droit de demander un examen médical par un médecin de leur propre choix. Le CPT a exhorté la France à de nombreuses reprises à instaurer un tel droit, tout en admettant que ce deuxième examen puisse avoir lieu en présence d'un médecin légiste désigné par l'administration.[20]
Nous saluons la recommandation du Comité dans son rapport d'étape, précisant que tout interrogatoire doit faire l'objet d'un enregistrement audio et vidéo, quelle que soit la nature de l'infraction. Nous vous incitons à maintenir cette recommandation dans votre rapport final, et à préciser de façon explicite que les interrogatoires de personnes suspectées de terrorisme ne doivent plus faire exception à cette exigence.
Recommandation n°3 - Prévenir la détention provisoire prolongée injustifiée :
- Confirmer la procédure de renouvellement périodique de la détention provisoire, et garantir au détenu l'assistance d'un avocat lors de l'audience;
- Veiller à ce que ce soit toujours le même juge compétent en la matière qui soit chargé du dossier d'un accusé déterminé afin qu'il examine chaque décision relative à la prolongation de la détention et aux appels concernant la mise en liberté provisoire ;
- Veiller à ce que le juge ait suffisamment de temps pour examiner le fond du dossier et prendre des décisions solidement étayées en ce qui concerne le placement en détention provisoire et sa prolongation.
- Veiller à ce que les décisions relatives à la détention provisoire soient prises par un collège de juges.
Les personnes faisant l'objet d'une enquête officielle dans les affaires de terrorisme peuvent être placées en détention provisoire de façon prolongée. L'association de malfaiteurs en relation avec une entreprise terroriste, un délit passible de jusqu'à 10 ans de prison, donne lieu à un maximum de trois ans en détention provisoire (période extensible de quatre mois supplémentaires par la chambre de l'instruction dans des cas exceptionnels). Les crimes de terrorisme, passibles de plus de dix ans de prison, donnent lieu à quatre années d'emprisonnement (période extensible de deux périodes de quatre mois par la chambre d'instruction dans des circonstances exceptionnelles).
Notre enquête indique qu'il existe une forte présomption en faveur du placement en détention provisoire dans les affaires impliquant une suspicion d'association de malfaiteurs en relation avec une entreprise terroriste, même quand les preuves d'infraction sont minces. Ce constat semble lié à la définition très large du délit, à la longueur et à la complexité des enquêtes liées au terrorisme, ainsi qu'à une tendance à la prudence de la part des juges de la liberté et de la détention (JLD) qui sont actuellement responsables des décisions de placement en détention provisoire. Si les JLD sont censés faire reposer leurs décisions sur le fond du dossier, dans les faits ils semblent se fonder sur les seuls critères de la détention provisoire et suivre les recommandations du procureur et du juge d'instruction. Le fait qu'il n'existe aucune garantie de continuité au niveau du JLD en charge d'un dossier pose un autre problème, puisqu'aucune règle ni ligne directrice n'est appliquée pour veiller à ce que ce soit le JLD qui a placé quelqu'un en détention la première fois qui décide du renouvellement ou de la remise en liberté.
Dans ses récentes observations finales sur le respect par la France de ses obligations aux termes du Pacte International des droits civils et politiques, le Comité des droits de l'homme des Nations Unies s'est inquiété de la détention provisoire prolongée de suspects de terrorisme, concluant que « la pratique institutionnalisée d'une détention prolongée aux fins d'enquête... est difficilement conciliable avec le droit garanti dans le Pacte d'être jugé dans un délai raisonnable ».[21] Le Comité a recommandé que la France limite la détention provisoire et renforce le rôle des JLD.
Dans votre rapport d'étape, le Comité formule des recommandations concernant la procédure pour ordonner le placement en détention provisoire, ainsi que la durée de cette détention. Elle propose de retirer cette fonction aux JLD pour la confier aux JEL qui seraient nouvellement créés. Elle recommande de réduire la durée maximale de la détention provisoire à une année dans les cas de délits passibles de cinq à dix ans de prison, à deux ans pour les crimes, et à trois ans dans les affaires de terrorisme et de crime organisé. Nous saluons la proposition du Comité visant à ce que les décisions de placement en détention provisoire soient prises par un collège de juges, y compris les JEL. Mais la réforme proposée est fragilisée dès le départ par l'introduction par l'inclusion d'une clause discrétionnaire qui permet au JEL de prendre seul la décision.
Selon Human Rights Watch, toute réforme devrait s'attaquer aux manquements fondamentaux du système actuel de placement en détention provisoire. Pour permettre aux JEL de remplir correctement leurs fonctions, nous pensons qu'il faut agir pour garantir leur pleine indépendance et l'autonomie de leurs décisions, sans qu'il puisse y avoir de pression de la part des procureurs. Il faut également clarifier la responsabilité d'étudier le fond du dossier qui incombe aux JEL et garantir qu'ils aient suffisamment de temps pour le faire avant de prendre la décision initiale de placement.
Bien que nous saluions la recommandation du Comité selon laquelle les détenus ont le droit d'exiger d'être remis en liberté quand l'enquête n'avance pas pendant une période de trois mois, nous craignons que l'élimination de la révision périodique obligatoire de la décision de placement en détention réduise de façon significative les possibilités pour les détenus et leurs avocats de contester efficacement cette dernière. Actuellement, le JLD doit avoir une audience avec le détenu (bien que l'assistance d'un avocat ne soit pas un droit statutaire lors de ces audiences) à chaque fois que la détention provisoire est renouvelée. Le JLD ne tient pas d'audience pour examiner les demandes de remise en liberté, que les détenus peuvent déposer à tout moment. Avec la suppression du renouvellement périodique de la détention, il devient prévisible que le JEL ne reverra plus le ou la détenu(e) ou son avocat après la première audience au cours de laquelle la détention provisoire est ordonnée.
Nous observons également que si un maximum de trois années de détention pour les crimes de terrorisme représente une réduction par rapport aux quatre ans en vigueur actuellement, la réforme ne changerait rien au maximum appliqué aujourd'hui au délit d'association de malfaiteurs en relation avec une entreprise terroriste. Selon nous, la proposition ne répond pas au problème crucial de la durée excessive de la détention préalable à la condamnation dans les affaires de terrorisme, d'autant plus que la plupart des suspects d'atteinte à la sécurité nationale sont détenus sous le coup d'une accusation d'association de malfaiteurs en relation avec une entreprise terroriste.
Recommandation n°4 - Garantir que des éléments de preuve obtenus sous la torture ne seront pas utilisés dans le cadre d'une procédure judiciaire :
- Introduire des amendements dans le Code de procédure pénale établissant de manière explicite que les preuves obtenues sous la torture ou au moyen de mauvais traitements, quelle que soit leur provenance, ne sont recevables à aucune étape de la procédure pénale et de l'instruction par les juges et les procureurs.
- Imposer aux juges d'instruction - ou aux JEL si la réforme mentionnée plus haut est mise en œuvre - l'obligation statutaire d'établir si les informations des services de renseignement ont été obtenues sous la torture.
Human Rights Watch constate avec inquiétude que les procédures pénales dans les affaires de terrorisme manquent de sauvegardes suffisantes pour garantir que les preuves obtenues sous la torture ou au moyen de mauvais traitements interdits ne soient utilisées à aucune étape de la procédure judiciaire en France. Les données émanant des services de renseignement, y compris les informations provenant de pays tiers, sont souvent au cœur des enquêtes sur le terrorisme. Si les données fournies par ces services jouent un rôle légitime au niveau de l'efficacité des poursuites liées aux délits de terrorisme, les autorités ont le devoir d'exclure toute information quand il existe un risque réel qu'elle ait été obtenue sous la torture.
L'interdiction absolue de la torture aux termes du droit international ne souffre pas d'exceptions ni de dérogations et s'étend à l'utilisation des informations obtenues sous la torture dans le cadre de procédures légales. L'article 15 de la Convention contre la torture dispose que toute déclaration dont il est établi qu'elle a été obtenue par la torture ne peut être invoquée comme un élément de preuve dans une procédure, si ce n'est contre la personne accusée de torture pour établir qu'une déclaration a été faite. L'utilisation d'éléments de preuve obtenus sous la torture ou au moyen de mauvais traitements est interdite non seulement parce qu'ils ne sont pas fiables mais parce que, selon la Cour Européenne des Droits de l'Homme, cette utilisation « ne ferait que légitimer indirectement le type de conduite moralement répréhensible que les auteurs de l'article 3 de la Convention [européenne des Droits de l'Homme] ont cherché à interdire ».[22]
Les personnes soumises à des mauvais traitements interdits dans un pays tiers et poursuivies ensuite en France ont l'opportunité de contester l'utilisation de ces preuves, parfois avec succès. Par contre, si la victime n'est pas l'un des accusés, la marge de manœuvre pour contester les informations susceptibles d'avoir été obtenues illégalement est très réduite.
Notre enquête pointe une vérification insuffisante par la justice des données émanant des services de renseignement dans les enquêtes liées au terrorisme. Dans les faits, les services de sécurité fournissent aux juges d'instruction des informations obtenues en usant des méthodes du renseignement, y compris en coopérant avec des pays tiers. Les juges d'instruction sont alors libres d'ordonner sur la base de ces données tout acte d'instruction qu'ils jugent nécessaires, y compris des arrestations, et ce sans exercer aucun contrôle sur la légitimité des méthodes utilisées pour obtenir ces informations.
Nous prenons en considération le fait que la procédure pénale en France exige que soient rassemblés des éléments de preuves concordants grâce aux actes d'instruction ordonnés par la justice et aux déclarations faites par l'accusé aux représentants du pouvoir judiciaire. Nous restons cependant préoccupés quant aux informations recueillies dans le cadre de commissions rogatoires internationales, quand des juges français se rendent dans d'autres pays pour participer ou assister en tant qu'observateurs à des interrogatoires. Les informations obtenues dans ce cadre jouissent au procès d'une légitimité considérable, indépendamment des conditions d'incarcération et de traitement du détenu avant et après la commission rogatoire. Nous ajoutons que dans la décision de justice précédemment mentionnée et qui concernait les cinq anciens détenus du centre de détention de Guantánamo, la Cour d'Appel de Paris a annulé la condamnation prononcée par le Tribunal de grande instance de Paris, en dépit du fait que les accusés avaient réitérés auprès des juges d'instruction les déclarations faites aux agents de la DST à Guantánamo, entre autres parce que ces déclarations avaient initialement été faites « dans un état psychologique particulier ».
Nous notons que la réforme proposée ferait passer le contrôle de l'instruction des mains du juge d'instruction à celles du procureur. Cependant, il paraît difficile d'affirmer que cette réforme pourra améliorer la transparence et le contrôle sur les données provenant des services de renseignement sans que soient mises en place des sauvegardes supplémentaires, parmi lesquelles l'obligation explicite d'établir si ces données ont été obtenues sous la torture.
Cette contribution soumet à l'attention du Comité de réflexion sur les codes pénal et de procédure pénale l'analyse et les recommandations de Human Rights Watch, dans le cadre de son étude sur la réforme du code pénal et du code de procédure pénale. Se basant sur les résultats de notre enquête concernant l'approche adoptée par la justice pénale française pour lutter contre le terrorisme, cette contribution expose les réformes clés que nous jugeons nécessaires pour mettre les lois antiterroristes françaises en conformité avec le droit international relatif aux droits humains. Elle aborde notamment les questions traitées dans le rapport d'étape du Comité ainsi que celles sur lesquels nous pensons que le Comité devrait se pencher dans la suite de son étude.
Synthèse des recommandations
Recommandation n°1 - Affiner la définition du délit d' « association de malfaiteurs en relation avec une entreprise terroriste » donnée par l'article 421-2-1 du code pénal de façon à :
- Dresser une liste non exhaustive des types de comportement susceptibles d'entraîner une sanction pénale; et
- Énoncer clairement que l'intention de participer à une association de malfaiteurs en relation avec une entreprise terroriste doit être pleinement démontrée au-delà de tout doute raisonnable.
Recommandation n°2- Introduire les amendements nécessaires dans le code de procédure pénale afin d'améliorer les protections lors de la garde à vue :
- Donner accès à un avocat dès le début de la garde à vue et pendant toute la période de garde à vue ;
- Autoriser les suspects à s'entretenir avec un avocat en privé sans limite de temps ;
- Reconnaître aux suspects le droit d'exiger de n'être interrogés par la police qu'en présence d'un avocat ;
- Garantir à l'avocat d'un suspect un accès à des informations suffisantes sur les preuves à charge afin qu'il puisse assurer une assistance juridique efficace ;
- Garantir que les suspects se voient notifiés leur droit de garder le silence;
- Accorder aux suspects le droit de demander un examen médical par un médecin de leur choix ; et
- Assurer un enregistrement vidéo et audio de tous les interrogatoires.
Recommandation n°3 - Prévenir la détention provisoire prolongée injustifiée :
- Confirmer la procédure de renouvellement périodique de la détention provisoire, et garantir au détenu l'assistance d'un avocat lors de l'audience;
- Veiller à ce que ce soit toujours le même juge compétent en la matière qui soit chargé du dossier d'un accusé déterminé afin qu'il examine chaque décision relative à la prolongation de la détention et aux appels concernant la mise en liberté provisoire ;
- Veiller à ce que le juge ait suffisamment de temps pour examiner le fonds du dossier et prendre des décisions solidement étayées en ce qui concerne le placement en détention provisoire et sa prolongation.
- Veiller à ce que les décisions relatives à la détention provisoire soient prises par un collège de juges.
Recommandation n°4- Garantir que des éléments de preuve obtenus sous la torture ne seront pas utilisés dans le cadre d'une procédure judiciaire :
- Introduire des amendements dans le Code de procédure pénale établissant de manière explicite que les preuves obtenues sous la torture ou au moyen de mauvais traitements, quelque soit leur provenance, ne sont recevables à aucune étape de la procédure pénale et de l'instruction par les juges et les procureurs.
- Imposer aux juges d'instruction - ou aux JEL si la réforme mentionnée plus haut est mise en œuvre - l'obligation statutaire d'établir si les informations des services de renseignement ont été obtenues sous la torture.
Analyse détaillée et Recommandations
Recommandation n°1 - Affiner la définition du délit d' « association de malfaiteurs en relation avec une entreprise terroriste » donnée par l'article 421-2-1 du code pénal de façon à :
- Dresser une liste non exhaustive des types de comportement susceptibles d'entraîner une sanction pénale; et
- Énoncer clairement que l'intention de participer à une association de malfaiteurs en relation avec une entreprise terroriste doit être pleinement démontrée au-delà de tout doute raisonnable.
Dans l'intention de contribuer à votre analyse de la réforme du code pénal, nous souhaitons attirer votre attention sur nos préoccupations concernant le délit d' « association de malfaiteurs en relation avec une entreprise terroriste ». Notre enquête indique que ce délit manque de précision juridique. Le principe bien établi de légalité, consacré dans l'article 7 de la Convention européenne des Droits de l'Homme, exige que le droit pénal soit suffisamment clair et bien défini pour que les personnes soient capables d'adapter leur conduite de façon à éviter toute infraction et pour que l'interprétation judiciaire créative des tribunaux soit d'une portée limitée.[23]
L'article 421-2-1 du Code pénal définit l' « association de malfaiteurs en relation avec une entreprise terroriste » comme « le fait de participer à un groupement formé ou à une entente établie en vue de la préparation, caractérisée par un ou plusieurs faits matériels, d'un des actes de terrorisme mentionnés aux articles précédents ». Les éléments du crime développés dans la jurisprudence sont notamment les suivants : l'existence d'un groupement de plusieurs personnes unies dans l'intention de perpétrer un acte criminel collectif ; chaque membre doit avoir pleinement conscience de cette intention et du fait qu'il s'agit d'une entreprise criminelle ; et cette intention doit être démontrée par un ou plusieurs faits matériels. Il n'est pas nécessaire que l'un des participants accomplisse une action concrète pour mettre à exécution un acte terroriste.
La lettre de la loi comme la jurisprudence permettent une interprétation étendue du délit. Le manque de précision dans la loi empêche de voir clairement quel comportement est susceptible de donner lieu à une sanction criminelle et les libertés d'expression et d'association qui constitueraient normalement des droits protégés en vertu du droit international des droits humains-quelle que soit leur nature offensive- peuvent être utilisées comme preuve d'intention criminelle. Les forces de l'ordre disposent d'une trop grande latitude pour agir de façon arbitraire, et les décisions d'arrêter des suspects et d'ouvrir une instruction officielle à leur sujet se fondent sur des critères peu exigeants en matière de preuve et sur une approche qui favorise la possibilité d'opérer de grands coups de filet. La plupart des enquêtes portant sur des activités terroristes islamistes présumées en France sont basées sur la cartographie de réseaux de contacts. Cela a pu aboutir à l'arrestation et la mise en examen de proches parents, d'amis, de voisins, de membres de la même mosquée, de collègues de travail, ou de personnes qui fréquentent un restaurant déterminé. De même, il semble y avoir une trop grande marge de manœuvre pour engager une action en justice à l'encontre de personnes qui partagent des vues extrémistes et peuvent même exprimer leur soutien à des formes violentes de djihad, par exemple, mais qui n'ont pas distinctement fait la démarche de s'engager sur la voie de la violence terroriste.
Dans une communication datée d'avril 2006 au gouvernement français, le Rapporteur spécial des Nations Unies sur la protection des droits humains et la lutte contre le terrorisme, Martin Scheinin, a exprimé des inquiétudes concernant la définition élargie des délits liés au terrorisme dans le Code pénal.[24]
Des juridictions étrangères ont jeté le doute sur les éléments de preuve à la base de certaines condamnations pour association de malfaiteurs. En 2002, un tribunal allemand a par exemple refusé d'extrader Abdallah Kinai, un Algérien bénéficiant du statut de réfugié en Allemagne, vers la France pour qu'il y complète une peine d'emprisonnement de cinq ans, invoquant un manque de motifs légaux. En ce qui concerne l'appartenance présumée de Kinai à une association de malfaiteurs visant à commettre des actes de terrorisme, la Cour a établi qu' « il est impossible de déterminer, à partir des documents fournis par les autorités françaises, si le réseau prétendument dirigé par les accusés remplit même les critères d'une organisation criminelle ou terroriste (...) il n'existe aucune allégation précise qui permettrait à la Cour de déterminer la structure organisationnelle de ce réseau ».[25]
Recommandation n°2 - Améliorer les protections lors de la garde à vue
Le manque de protections suffisantes lors des gardes à vue dans des affaires de terrorisme est incompatible avec le droit international des droits humains. Notre enquête indique que la combinaison de toutes les limitations touchant les droits des suspects en garde à vue dans les affaires de terrorisme crée une situation où les détenus se voient privés du droit à une défense effective à un moment crucial et sont exposés au risque de mauvais traitements interdits. Nous sommes conscients que certaines de ces limitations s'appliquent à tous les suspects placés en garde à vue ; nos recommandations concernant l'amélioration des protections ont vocation à s'appliquer à tous les régimes de garde à vue policière.
Dans les affaires de terrorisme, le droit français prévoit un délai de garde à vue parmi les plus longs d'Europe continentale. Selon les termes du Code de procédure pénale (CPP), les personnes soupçonnées de terrorisme peuvent rester en garde à vue pendant un délai maximum de six jours avant d'être amenées devant un juge. Dans la pratique, le délai moyen de garde à vue dans les enquêtes sur le terrorisme est de quatre jours.
- Donner accès à un avocat dès le début de la garde à vue, le droit de s'entretenir avec un avocat en privé et sans limites de temps, et garantir à l'avocat un accès à des informations suffisantes afin qu'il puisse assurer une assistance juridique efficace
Les personnes soupçonnées de terrorisme ont un accès sévèrement restreint à une assistance juridique. Conformément à l'article 63 du CPP, les personnes soupçonnées de terrorisme n'ont accès à un avocat qu'après une période de 72 heures, soit trois jours, en détention provisoire. Si le juge prolonge la garde à vue de 24 heures avant la fin de la 72e heure, le premier entretien avec un avocat est repoussé jusqu'après la 96e heure, soit après quatre jours de garde à vue. Dans ce cas, la personne gardée à vue pourrait voir un avocat pour la deuxième fois 24 heures plus tard, soit après cinq jours de garde à vue. Chaque visite est limitée à 30 minutes et l'avocat n'a accès à aucune information détaillée relative aux charges qui pèsent contre son client.
Le temps limité dont disposent les avocats pour s'entretenir avec leurs clients et pour prendre connaissance de l'enquête et des charges qui pèsent contre eux réduit gravement la capacité de ces avocats à défendre efficacement leurs clients à un stade crucial de la procédure.
D'après la Cour Européenne des Droits de l'Homme, les avocats d'individus privés de leur liberté doivent avoir accès à des informations suffisantes pour pouvoir contester efficacement la légalité de la détention.[26] Si les affaires dont il est question concernaient des procédures d'habeas corpus pour des personnes placées en détention provisoire, Human Rights Watch considère que le principe de « l'égalité des armes » s'applique aux situations de garde à vue. La Cour met régulièrement l'accent sur le fait que la Convention européenne garantit « des droits non pas théoriques ou illusoires, mais concrets et effectifs ; la remarque vaut spécialement pour ceux de la défense eu égard au rôle éminent que le droit à un procès équitable, dont ils dérivent, joue dans une société démocratique».[27]
Le droit de toutes les personnes accusées d'un crime à être assistées par un avocat constitue une garantie procédurale fondamentale. L'article 14 du Pacte international relatif aux droits civils et politiques (PIDCP) et l'article 6 de la Convention européenne précisent que toute personne accusée d'une infraction pénale a le droit « de se défendre elle-même ou d'avoir l'assistance d'un défenseur de son choix » ou, s'il y a lieu, de se voir attribuer d'office un défenseur, sans frais. Le Comité des droits de l'homme de l'ONU et la Cour européenne des Droits de l'Homme ont considéré que ces dispositions étaient applicables aux périodes précédant le procès, notamment à la période de garde à vue.[28] Dans ses observations finales sur le respect par la France de ses engagements aux termes du PIDCP, le Comité des droits de l'homme de l'ONU a vivement recommandé à la France en 1997 et plus récemment en 2008 de garantir un accès rapide à un avocat aux suspects de terrorisme placés en garde à vue.[29]
Les Principes de base de l'ONU relatifs au rôle du barreau exigent que toute personne arrêtée ou détenue puisse s'entretenir avec un avocat et le consulter « sans retard, sans aucune censure ni interception et en toute discrétion ».[30] Un livre vert daté de 2003 de la Commission européenne sur les garanties procédurales accordées aux suspects et aux personnes mises en cause dans des procédures pénales se fait l'écho de ces normes, en confirmant que le droit à la représentation en justice « naît dès l'instant où une personne est mise en état d'arrestation ».[31]
L'accès rapide à un avocat pendant la garde à vue, dans des conditions sérieuses, constitue également une protection fondamentale contre la torture et les mauvais traitements interdits. Le Comité européen pour la prévention de la torture (CPT), un organe des droits humains du Conseil de l'Europe qui fait autorité, a, dans tous ses rapports à dater de 1996, appelé la France à permettre aux détenus d'avoir accès à un avocat dès le début de la garde à vue.[32]
- Garantir le droit d'être interrogé par la police en présence d'un avocat et le droit de se voir notifier son droit à garder le silence
Le cadre actuel des interrogatoires de police nuit gravement au droit à une défense efficace à un moment clé de la procédure. Les détenus en garde à vue, quelle que soit la nature de l'infraction dont ils sont soupçonnés, sont interrogés sans la présence d'un avocat et ne se voient pas informés de leur droit de garder le silence. Les déclarations faites au cours de la garde à vue sont résumées dans une déclaration officielle versée au dossier, qu'elle ait été signée ou non par le suspect, et peut être utilisée contre lui au procès. Bien que le rapport final de la police doive mentionner la durée de tous les interrogatoires, il n'existe aucune règle fixant une limite de temps pour ces interrogatoires ni le temps de repos dont doit bénéficier un détenu entre les interrogatoires.
Si le droit international relatif aux droits humains n'exige pas de façon explicite la présence d'un avocat au cours de l'interrogatoire, il est de plus en plus admis que ce droit est d'une importance cruciale pour garantir l'équité et la justice au cours de la procédure pénale et en particulier pendant l'instruction. Les codes de procédure pénale récemment adoptés par des pays du Conseil de l'Europe comme l'Estonie, la Lettonie et la Lituanie se font l'écho de ce consensus. L'interrogatoire en présence d'un avocat est aussi la norme dans de nombreux pays de l'Union européenne, dont l'Allemagne, l'Espagne, l'Italie, la Pologne et le Royaume-Uni, et représente un exemple de bonne pratique au niveau européen. Le Livre vert de la Commission européenne sur les garanties procédurales accordées aux suspects et aux personnes mises en cause dans des procédures pénales dans les pays de l'Union européenne, publié en 2003, stipule que les suspects devraient avoir le droit de se faire assister d'un avocat « pendant tout le déroulement des interrogatoires ».[33]
La Cour européenne des Droits de l'Homme a jugé dans différentes affaires que le droit à un procès équitable exige que les suspects bénéficient de l'assistance d'un avocat dès les premiers stades de l'interrogatoire de la police « alors que les droits de la défense peuvent fort bien subir une atteinte irréparable ».[34] Dans l'affaire Magee c. Royaume-Uni, la Cour a jugé que le Royaume-Uni avait violé l'article 6 de la CEDH parce que Magee s'était vu privé de l'accès à un avocat pendant 48 heures d'interrogatoire, alors qu'il était détenu dans des conditions très similaires à celles appliquées lors des gardes à vue pour terrorisme en France. Pendant ces 48 heures, Magee s'est vu refusé tout contact avec d'autres personnes que ses interrogateurs et un médecin légiste, et a subi un interrogatoire intensif. La Cour a jugé que les « conditions de détention du requérant et le fait qu'il ait été coupé de l'extérieur étaient conçus pour exercer une coercition psychologique » et que l'équité de la procédure exigeait qu'il ait accès à un avocat dans les premiers stades de l'interrogatoire « pour contrebalancer l'atmosphère intimidante destinée à vaincre sa volonté et à le faire passer aux aveux devant les personnes qui l'interrogeaient ».[35] Dans l'affaire Averill c. Royaume-Uni, la Cour a jugé qu'une privation similaire de l'accès à un avocat pendant les premières 24 heures d'interrogatoire de police « doit tout de même être jugé également être considérée incompatible avec les droits garantis par l'article 6».[36]
Le Comité européen pour la prévention de la torture (CPT) a déclaré dans son rapport de 2000 qu'en France, « le droit à l'accès à un avocat doit aussi comprendre le droit pour une personne privée de liberté, de bénéficier de la présence d'un avocat pendant tout interrogatoire mené par la police/gendarmerie ».[37]
Le fait que les détenus ne soient pas informés de leur droit à garder le silence au cours des interrogatoires de police nuit encore davantage à leur droit à une défense efficace. Selon notre enquête, la notification aux personnes gardées à vue de leur droit à garder le silence a été introduite dans le Code de procédure pénale français en 2000, mais elle a été supprimée en 2003 suite aux pressions intenses exercées par les forces de l'ordre. Le Commissaire aux droits de l'homme du Conseil de l'Europe de l'époque, Alvaro Gil-Robles, a critiqué « le fort dommageable recul [de la France] sur ce point, car il n'est jamais bon d'occulter des droits prévus par la législation ».[38]
Le droit de garder le silence afin d'éviter de s'incriminer dans le cadre d'une procédure pénale est une norme internationale généralement reconnue. La Cour Européenne des Droits de l'Homme a interprété l'article 6 de la Convention européenne comme comprenant le droit de garder le silence, considéré comme intimement lié au principe de la présomption d'innocence. En conséquence, le Livre vert de la Commission européenne de 2003 sur les garanties procédurales a souligné que tout suspect devait être informé de « son droit ... de garder le silence ..., des conséquences d'éventuels aveux et de l'importance accordée à ses réponses au cours de procédures ultérieures ».[39]
Nous observons que la Cour d'Appel de Paris a récemment interprété le manquement à informer les suspects de leur droit à garder le silence comme une violation du droit à une défense efficace. Le jugement avait alors annulé la condamnation de cinq ancien détenus du centre de détention de Guantánamo pour association de malfaiteurs en relation avec une entreprise terroriste, entre autres parce que les accusés avaient été interrogés par des enquêteurs de la Direction de la Surveillance du Territoire (DST) dans la prison américaine, « sans que leur soit donnés connaissance de leur droit au silence » et alors qu'ils avaient été « amenés à croire nécessaires ces déclarations pour obtenir leur rapatriement en France et qu'ils n'étaient pas ainsi en mesure de se rendre compte qu'elles pourraient être utilisées contre eux. »[40]
- Donner aux suspects le droit d'être examiné par un médecin de leur choix et assurer un enregistrement vidéo et audio de tous les interrogatoires
Il est du devoir des autorités de protéger les personnes placées en garde à vue contre la torture et les mauvais traitements. La Cour Européenne des Droits de l'Homme a mis l'accent sur la nature absolue de l'interdiction de la torture et des peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants aux termes de l'article 3 de la CEDH. Dans l'affaire Tomasi c. France, qui impliquait un citoyen français accusé d'avoir participé à un attentat terroriste en Corse, la Cour a souligné que « les nécessités de l'enquête et les indéniables difficultés de la lutte contre (...) le terrorisme ne sauraient conduire à limiter la protection due à l'intégrité physique de la personne ».[41]
Comme mentionné précédemment, la présence d'un avocat dès le début de la garde à vue, y compris pendant les interrogatoires, est une garantie fondamentale contre les mauvais traitements interdits. Des examens médicaux réalisés dans un délai raisonnable par des médecins compétents et impartiaux représentent une autre protection importante. C'est pourquoi nous estimons que les suspects devraient avoir le droit de demander un examen médical par un médecin de leur propre choix. Le CPT a exhorté la France à de nombreuses reprises à instaurer un tel droit, tout en admettant que ce deuxième examen puisse avoir lieu en présence d'un médecin légiste désigné par l'administration.[42]
Nous saluons la recommandation du Comité dans son rapport d'étape, précisant que tout interrogatoire doit faire l'objet d'un enregistrement audio et vidéo, quelle que soit la nature de l'infraction. Nous vous incitons à maintenir cette recommandation dans votre rapport final, et à préciser de façon explicite que les interrogatoires de personnes suspectées de terrorisme ne doivent plus faire exception à cette exigence.
Recommandation n°3 - Prévenir la détention provisoire prolongée injustifiée :
- Confirmer la procédure de renouvellement périodique de la détention provisoire, et garantir au détenu l'assistance d'un avocat lors de l'audience;
- Veiller à ce que ce soit toujours le même juge compétent en la matière qui soit chargé du dossier d'un accusé déterminé afin qu'il examine chaque décision relative à la prolongation de la détention et aux appels concernant la mise en liberté provisoire ;
- Veiller à ce que le juge ait suffisamment de temps pour examiner le fond du dossier et prendre des décisions solidement étayées en ce qui concerne le placement en détention provisoire et sa prolongation.
- Veiller à ce que les décisions relatives à la détention provisoire soient prises par un collège de juges.
Les personnes faisant l'objet d'une enquête officielle dans les affaires de terrorisme peuvent être placées en détention provisoire de façon prolongée. L'association de malfaiteurs en relation avec une entreprise terroriste, un délit passible de jusqu'à 10 ans de prison, donne lieu à un maximum de trois ans en détention provisoire (période extensible de quatre mois supplémentaires par la chambre de l'instruction dans des cas exceptionnels). Les crimes de terrorisme, passibles de plus de dix ans de prison, donnent lieu à quatre années d'emprisonnement (période extensible de deux périodes de quatre mois par la chambre d'instruction dans des circonstances exceptionnelles).
Notre enquête indique qu'il existe une forte présomption en faveur du placement en détention provisoire dans les affaires impliquant une suspicion d'association de malfaiteurs en relation avec une entreprise terroriste, même quand les preuves d'infraction sont minces. Ce constat semble lié à la définition très large du délit, à la longueur et à la complexité des enquêtes liées au terrorisme, ainsi qu'à une tendance à la prudence de la part des juges de la liberté et de la détention (JLD) qui sont actuellement responsables des décisions de placement en détention provisoire. Si les JLD sont censés faire reposer leurs décisions sur le fond du dossier, dans les faits ils semblent se fonder sur les seuls critères de la détention provisoire et suivre les recommandations du procureur et du juge d'instruction. Le fait qu'il n'existe aucune garantie de continuité au niveau du JLD en charge d'un dossier pose un autre problème, puisqu'aucune règle ni ligne directrice n'est appliquée pour veiller à ce que ce soit le JLD qui a placé quelqu'un en détention la première fois qui décide du renouvellement ou de la remise en liberté.
Dans ses récentes observations finales sur le respect par la France de ses obligations aux termes du Pacte International des droits civils et politiques, le Comité des droits de l'homme des Nations Unies s'est inquiété de la détention provisoire prolongée de suspects de terrorisme, concluant que « la pratique institutionnalisée d'une détention prolongée aux fins d'enquête... est difficilement conciliable avec le droit garanti dans le Pacte d'être jugé dans un délai raisonnable ».[43] Le Comité a recommandé que la France limite la détention provisoire et renforce le rôle des JLD.
Dans votre rapport d'étape, le Comité formule des recommandations concernant la procédure pour ordonner le placement en détention provisoire, ainsi que la durée de cette détention. Elle propose de retirer cette fonction aux JLD pour la confier aux JEL qui seraient nouvellement créés. Elle recommande de réduire la durée maximale de la détention provisoire à une année dans les cas de délits passibles de cinq à dix ans de prison, à deux ans pour les crimes, et à trois ans dans les affaires de terrorisme et de crime organisé. Nous saluons la proposition du Comité visant à ce que les décisions de placement en détention provisoire soient prises par un collège de juges, y compris les JEL. Mais la réforme proposée est fragilisée dès le départ par l'introduction par l'inclusion d'une clause discrétionnaire qui permet au JEL de prendre seul la décision.
Selon Human Rights Watch, toute réforme devrait s'attaquer aux manquements fondamentaux du système actuel de placement en détention provisoire. Pour permettre aux JEL de remplir correctement leurs fonctions, nous pensons qu'il faut agir pour garantir leur pleine indépendance et l'autonomie de leurs décisions, sans qu'il puisse y avoir de pression de la part des procureurs. Il faut également clarifier la responsabilité d'étudier le fond du dossier qui incombe aux JEL et garantir qu'ils aient suffisamment de temps pour le faire avant de prendre la décision initiale de placement.
Bien que nous saluions la recommandation du Comité selon laquelle les détenus ont le droit d'exiger d'être remis en liberté quand l'enquête n'avance pas pendant une période de trois mois, nous craignons que l'élimination de la révision périodique obligatoire de la décision de placement en détention réduise de façon significative les possibilités pour les détenus et leurs avocats de contester efficacement cette dernière. Actuellement, le JLD doit avoir une audience avec le détenu (bien que l'assistance d'un avocat ne soit pas un droit statutaire lors de ces audiences) à chaque fois que la détention provisoire est renouvelée. Le JLD ne tient pas d'audience pour examiner les demandes de remise en liberté, que les détenus peuvent déposer à tout moment. Avec la suppression du renouvellement périodique de la détention, il devient prévisible que le JEL ne reverra plus le ou la détenu(e) ou son avocat après la première audience au cours de laquelle la détention provisoire est ordonnée.
Nous observons également que si un maximum de trois années de détention pour les crimes de terrorisme représente une réduction par rapport aux quatre ans en vigueur actuellement, la réforme ne changerait rien au maximum appliqué aujourd'hui au délit d'association de malfaiteurs en relation avec une entreprise terroriste. Selon nous, la proposition ne répond pas au problème crucial de la durée excessive de la détention préalable à la condamnation dans les affaires de terrorisme, d'autant plus que la plupart des suspects d'atteinte à la sécurité nationale sont détenus sous le coup d'une accusation d'association de malfaiteurs en relation avec une entreprise terroriste.
Recommandation n°4 - Garantir que des éléments de preuve obtenus sous la torture ne seront pas utilisés dans le cadre d'une procédure judiciaire :
- Introduire des amendements dans le Code de procédure pénale établissant de manière explicite que les preuves obtenues sous la torture ou au moyen de mauvais traitements, quelle que soit leur provenance, ne sont recevables à aucune étape de la procédure pénale et de l'instruction par les juges et les procureurs.
- Imposer aux juges d'instruction - ou aux JEL si la réforme mentionnée plus haut est mise en œuvre - l'obligation statutaire d'établir si les informations des services de renseignement ont été obtenues sous la torture.
Human Rights Watch constate avec inquiétude que les procédures pénales dans les affaires de terrorisme manquent de sauvegardes suffisantes pour garantir que les preuves obtenues sous la torture ou au moyen de mauvais traitements interdits ne soient utilisées à aucune étape de la procédure judiciaire en France. Les données émanant des services de renseignement, y compris les informations provenant de pays tiers, sont souvent au cœur des enquêtes sur le terrorisme. Si les données fournies par ces services jouent un rôle légitime au niveau de l'efficacité des poursuites liées aux délits de terrorisme, les autorités ont le devoir d'exclure toute information quand il existe un risque réel qu'elle ait été obtenue sous la torture.
L'interdiction absolue de la torture aux termes du droit international ne souffre pas d'exceptions ni de dérogations et s'étend à l'utilisation des informations obtenues sous la torture dans le cadre de procédures légales. L'article 15 de la Convention contre la torture dispose que toute déclaration dont il est établi qu'elle a été obtenue par la torture ne peut être invoquée comme un élément de preuve dans une procédure, si ce n'est contre la personne accusée de torture pour établir qu'une déclaration a été faite. L'utilisation d'éléments de preuve obtenus sous la torture ou au moyen de mauvais traitements est interdite non seulement parce qu'ils ne sont pas fiables mais parce que, selon la Cour Européenne des Droits de l'Homme, cette utilisation « ne ferait que légitimer indirectement le type de conduite moralement répréhensible que les auteurs de l'article 3 de la Convention [européenne des Droits de l'Homme] ont cherché à interdire ».[44]
Les personnes soumises à des mauvais traitements interdits dans un pays tiers et poursuivies ensuite en France ont l'opportunité de contester l'utilisation de ces preuves, parfois avec succès. Par contre, si la victime n'est pas l'un des accusés, la marge de manœuvre pour contester les informations susceptibles d'avoir été obtenues illégalement est très réduite.
Notre enquête pointe une vérification insuffisante par la justice des données émanant des services de renseignement dans les enquêtes liées au terrorisme. Dans les faits, les services de sécurité fournissent aux juges d'instruction des informations obtenues en usant des méthodes du renseignement, y compris en coopérant avec des pays tiers. Les juges d'instruction sont alors libres d'ordonner sur la base de ces données tout acte d'instruction qu'ils jugent nécessaires, y compris des arrestations, et ce sans exercer aucun contrôle sur la légitimité des méthodes utilisées pour obtenir ces informations.
Nous prenons en considération le fait que la procédure pénale en France exige que soient rassemblés des éléments de preuves concordants grâce aux actes d'instruction ordonnés par la justice et aux déclarations faites par l'accusé aux représentants du pouvoir judiciaire. Nous restons cependant préoccupés quant aux informations recueillies dans le cadre de commissions rogatoires internationales, quand des juges français se rendent dans d'autres pays pour participer ou assister en tant qu'observateurs à des interrogatoires. Les informations obtenues dans ce cadre jouissent au procès d'une légitimité considérable, indépendamment des conditions d'incarcération et de traitement du détenu avant et après la commission rogatoire. Nous ajoutons que dans la décision de justice précédemment mentionnée et qui concernait les cinq anciens détenus du centre de détention de Guantánamo, la Cour d'Appel de Paris a annulé la condamnation prononcée par le Tribunal de grande instance de Paris, en dépit du fait que les accusés avaient réitérés auprès des juges d'instruction les déclarations faites aux agents de la DST à Guantánamo, entre autres parce que ces déclarations avaient initialement été faites « dans un état psychologique particulier ».
Nous notons que la réforme proposée ferait passer le contrôle de l'instruction des mains du juge d'instruction à celles du procureur. Cependant, il paraît difficile d'affirmer que cette réforme pourra améliorer la transparence et le contrôle sur les données provenant des services de renseignement sans que soient mises en place des sauvegardes supplémentaires, parmi lesquelles l'obligation explicite d'établir si ces données ont été obtenues sous la torture.
[1] Cour Européenne des Droits de l'Homme, Affaire Kokkinakis c. Grèce, arrêt du 25 mai 1993, Série A, n° 260-A, disponible sur www.echr.coe.int, para. 52.
[2] Rapport du Rapporteur spécial sur la promotion et la protection des droits humains et des libertés fondamentales dans la lutte contre le terrorisme, Addendum: Communications aux gouvernements, U.N. Doc A/HRC/4/26/Add.1, 15 mars 2007, para. 22.
[3] Arrêt du 7 avril 2003 de la Haute Cour régionale de Stuttgart, cité dans la plainte déposée contre la France par Abdallah Kinai à la Cour européenne des Droits de l'Homme en août 2003 pour violations des articles 5, 6, 7 et 8. Quatre ans plus tard, le 11 septembre 2007, la Cour a jugé la plainte irrecevable. Original en allemand, traduction de Human Rights Watch.
[4] Se référer par exemple à l'affaire Lamy v. Belgium, Cour Européenne des Droits de l'Homme, jugement du 30 mars 1989, Series A no. 151; et Lietzow v. Germany, no. 24479/94, ECHR 2001-I.
[5] Cour européenne des droits de l'homme, Artico c. Italy, Arrêt du 13 mai 1980, Series A no. 37, para. 33.
[6] Le Comité des droits de l'homme a jugé que la disposition de la Loi britannique de 2000 contre le terrorisme autorisant la détention de suspects pendant 48 heures sans qu'ils puissent communiquer avec un avocat était d'une « compatibilité avec les articles 9 et 14 [du PIDCP] ... sujette à caution ». CCPR/CO/73/UK, para. 19 (2001). Dans l'arrêt Imbroscia c. Suisse, la Cour a établi qu' « en ce qui concerne les affaires criminelles, l'intention première de l'article 6 est sans nul doute de garantir un procès équitable par un ‘tribunal' compétent pour se prononcer sur toute action pénale mais il ne s'ensuit pas que l'article (art.6) ne s'applique pas à toutes les étapes qui ont précédé la procédure quant au fond ». La Cour ajoute que les garanties de l'article 6(3), notamment le droit d'être assisté par un avocat, « doivent ... être respectées au stade de l'instruction dans la mesure où leur violation initiale risquerait de compromettre gravement le caractère équitable du procès ». Affaire Imbroscia c. Suisse, arrêt du 24 novembre 1993, Série A, No. 275, para. 36.
[7] Comité des droits de l'homme, Observations finales du Comité des droits de l'homme: France, 31 juillet 2008, CCPR/C/FRA/CO/4, Comité des droits de l'homme, Observations finales du Comité des droits de l'homme: France, 04/08/97, CCPR/C/79/Add.80, 4 août 1997, para. 23.
[8] Principes de base relatifs au rôle du barreau, adoptés par le Huitième Congrès des Nations Unies pour la prévention du crime et le traitement des délinquants, La Havane, 27 août au 7 septembre 1990, U.N. Doc. A/CONF.144/28/Rev.1 at 118 (1990), numéro 8.
[9] Principes de base relatifs au rôle du barreau, adoptés par le Huitième Congrès des Nations Unies pour la prévention du crime et le traitement des délinquants, La Havane, 27 août au 7 septembre 1990, U.N. Doc. A/CONF.144/28/Rev.1 at 118 (1990), numéro 8.
[10] Comité européen pour la prévention de la torture et des peines ou traitements inhumains ou dégradants (CPT), rapports de visites effectuées en 1996, 2000, 2003 et 2006. Tous les rapports du CPT sur la France sont disponibles sur www.cpt.coe.int/en/states/fra.htm.
[11] Livre vert de la Commission européenne, para. 4.3(a).
[12] Cour Européenne des Droits de l'Homme, affaire Murray c. Royaume-Uni, arrêt du 8 février 1996, Recueil d'arrêts et décisions 1996-I, para. 66. Voir aussi Averill c. Royaume-Uni, no. 36408/97, ECHR 2000-VI, para. 60 et Magee c. Royaume-Uni, no. 28135/95, ECHR 2000-VI, para. 44.
[13] Cour Européenne des Droits de l'Homme, Magee c. Royaume-Uni, para. 43.
[14] Cour Européenne des Droits de l'Homme, Averill c. Royaume-Uni, para. 60. Traduction par Human Rights Watch.
[15] CPT, Rapport au gouvernement de la République française relatif à la visite en France effectuée par le Comité européen pour la prévention de la torture et des peines ou traitements inhumains ou dégradants du 14 au 26 mai 2000, http://cpt.coe.int/documents/fr/2001-10-inf-fra.pdf para. 34.
[16] Rapport de M. Alvaro Gil-Robles, Commissaire aux droits de l'homme du Conseil de l'Europe, sur le respect effectif des droits de l'homme en France suite à sa visite du 5 au 21 septembre 2005, CommDH(2006)2, 15 février 2006, para. 44.
[17] Commission européenne, Livre vert, para. 4.3(b).
[18] Cour d'Appel de Paris, chambre 10A, no. rg 08/00786, arrêt rendu le 24/02/2009, p. 60.
[19] Cour Européenne des Droits de l'Homme, affaire Tomasi c. France, arrêt du 27 août 1992, Série A, n° 241-A, para. 115
[20] Rapports de la CPT sur des visites effectuées en France en 1996, http://www.cpt.coe.int/documents/fra/1998-07-inf-fra.pdf, para. 40 et en 2000, http://www.cpt.coe.int/documents/fra/2001-10-inf-fra.pdf, para. 35.
[21] Comité des droits de l'homme, Observations finales, juillet 2008, para. 15.
[22] Cour Européenne des Droits de l'Homme, Jalloh c. Allemagne [GC], n° 54810/00, arrêt du 11 juillet 2006, ECHR 2006-IX, para. 105.
[23] Cour Européenne des Droits de l'Homme, Affaire Kokkinakis c. Grèce, arrêt du 25 mai 1993, Série A, n° 260-A, disponible sur www.echr.coe.int, para. 52.
[24] Rapport du Rapporteur spécial sur la promotion et la protection des droits humains et des libertés fondamentales dans la lutte contre le terrorisme, Addendum: Communications aux gouvernements, U.N. Doc A/HRC/4/26/Add.1, 15 mars 2007, para. 22.
[25] Arrêt du 7 avril 2003 de la Haute Cour régionale de Stuttgart, cité dans la plainte déposée contre la France par Abdallah Kinai à la Cour européenne des Droits de l'Homme en août 2003 pour violations des articles 5, 6, 7 et 8. Quatre ans plus tard, le 11 septembre 2007, la Cour a jugé la plainte irrecevable. Original en allemand, traduction de Human Rights Watch.
[26] Se référer par exemple à l'affaire Lamy v. Belgium, Cour Européenne des Droits de l'Homme, jugement du 30 mars 1989, Series A no. 151; et Lietzow v. Germany, no. 24479/94, ECHR 2001-I.
[27] Cour européenne des droits de l'homme, Artico c. Italy, Arrêt du 13 mai 1980, Series A no. 37, para. 33.
[28] Le Comité des droits de l'homme a jugé que la disposition de la Loi britannique de 2000 contre le terrorisme autorisant la détention de suspects pendant 48 heures sans qu'ils puissent communiquer avec un avocat était d'une « compatibilité avec les articles 9 et 14 [du PIDCP] ... sujette à caution ». CCPR/CO/73/UK, para. 19 (2001). Dans l'arrêt Imbroscia c. Suisse, la Cour a établi qu' « en ce qui concerne les affaires criminelles, l'intention première de l'article 6 est sans nul doute de garantir un procès équitable par un ‘tribunal' compétent pour se prononcer sur toute action pénale mais il ne s'ensuit pas que l'article (art.6) ne s'applique pas à toutes les étapes qui ont précédé la procédure quant au fond ». La Cour ajoute que les garanties de l'article 6(3), notamment le droit d'être assisté par un avocat, « doivent ... être respectées au stade de l'instruction dans la mesure où leur violation initiale risquerait de compromettre gravement le caractère équitable du procès ». Affaire Imbroscia c. Suisse, arrêt du 24 novembre 1993, Série A, No. 275, para. 36.
[29] Comité des droits de l'homme, Observations finales du Comité des droits de l'homme: France, 31 juillet 2008, CCPR/C/FRA/CO/4, Comité des droits de l'homme, Observations finales du Comité des droits de l'homme: France, 04/08/97, CCPR/C/79/Add.80, 4 août 1997, para. 23.
[30] Principes de base relatifs au rôle du barreau, adoptés par le Huitième Congrès des Nations Unies pour la prévention du crime et le traitement des délinquants, La Havane, 27 août au 7 septembre 1990, U.N. Doc. A/CONF.144/28/Rev.1 at 118 (1990), numéro 8.
[31] Commission européenne, Livre vert de la Commission, Garanties procédurales accordées aux suspects et aux personnes mises en cause dans des procédures pénales dans l'Union européenne, COM(2003) 75, 19 février 2003, http://eur-lex.europa.eu.LexUriServ.do?uri=COM:2003:0075:FIN:EN:PDF, para. 4.3(a).
[32] Comité européen pour la prévention de la torture et des peines ou traitements inhumains ou dégradants (CPT), rapports de visites effectuées en 1996, 2000, 2003 et 2006. Tous les rapports du CPT sur la France sont disponibles sur www.cpt.coe.int/en/states/fra.htm.
[33] Livre vert de la Commission européenne, para. 4.3(a).
[34] Cour Européenne des Droits de l'Homme, affaire Murray c. Royaume-Uni, arrêt du 8 février 1996, Recueil d'arrêts et décisions 1996-I, para. 66. Voir aussi Averill c. Royaume-Uni, no. 36408/97, ECHR 2000-VI, para. 60 et Magee c. Royaume-Uni, no. 28135/95, ECHR 2000-VI, para. 44.
[35] Cour Européenne des Droits de l'Homme, Magee c. Royaume-Uni, para. 43.
[36] Cour Européenne des Droits de l'Homme, Averill c. Royaume-Uni, para. 60. Traduction par Human Rights Watch.
[37] CPT, Rapport au gouvernement de la République française relatif à la visite en France effectuée par le Comité européen pour la prévention de la torture et des peines ou traitements inhumains ou dégradants du 14 au 26 mai 2000, http://cpt.coe.int/documents/fr/2001-10-inf-fra.pdf para. 34.
[38] Rapport de M. Alvaro Gil-Robles, Commissaire aux droits de l'homme du Conseil de l'Europe, sur le respect effectif des droits de l'homme en France suite à sa visite du 5 au 21 septembre 2005, CommDH(2006)2, 15 février 2006, para. 44.
[39] Commission européenne, Livre vert, para. 4.3(b).
[40] Cour d'Appel de Paris, chambre 10A, no. rg 08/00786, arrêt rendu le 24/02/2009, p. 60.
[41] Cour Européenne des Droits de l'Homme, affaire Tomasi c. France, arrêt du 27 août 1992, Série A, n° 241-A, para. 115
[42] Rapports de la CPT sur des visites effectuées en France en 1996, http://www.cpt.coe.int/documents/fra/1998-07-inf-fra.pdf, para. 40 et en 2000, http://www.cpt.coe.int/documents/fra/2001-10-inf-fra.pdf, para. 35.
[43] Comité des droits de l'homme, Observations finales, juillet 2008, para. 15.
[44] Cour Européenne des Droits de l'Homme, Jalloh c. Allemagne [GC], n° 54810/00, arrêt du 11 juillet 2006, ECHR 2006-IX, para. 105.