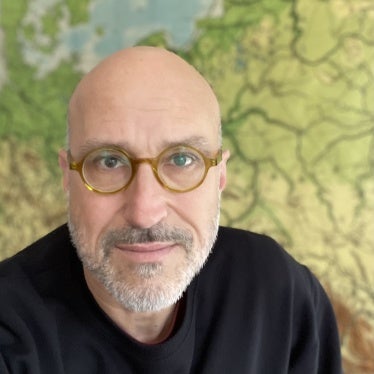Cela fait aujourd'hui vingt ans que le massacre d'Andijan a eu lieu en Ouzbékistan. Aux côtés des survivants, nous nous rappelons des victimes, mais aussi de l'impuissance de la communauté internationale au cours des années qui ont suivi.
Ce qu’il s’est passé ce jour-là a été bien documenté. La population manifestait contre le procès de plusieurs hommes d'affaires locaux très populaires. Le 13 mai, après que des hommes armés aient fait évader les hommes d’affaire de prison, un rassemblement massif a eu lieu. Les gens sont descendus dans la rue pour dénoncer les conditions économiques désastreuses et la répression dans le pays.
Les autorités ont répondu à leurs revendications en ouvrant le feu. Des centaines de personnes ont été massacrées. Certains parlent de 750, d'autres de plus. Personne n'a cru les estimations du gouvernement, qui faisait état de moins de 200 morts.
Peut-être que personne ne connaîtra jamais le nombre exact. Le gouvernement ouzbek a rejeté l’ouverture d’une enquête indépendante et, à ce jour, il nie l'ampleur réelle du massacre d'Andijan.
Ce qui est certain, c'est qu'à la suite de ces événements, les autorités ont arrêté toutes les personnes qu'elles soupçonnaient d'être liées aux manifestations ou d'avoir été témoins du massacre. Des centaines de personnes ont été contraintes de fuir le pays. Les autorités ont poursuivi leur chasse à l'étranger et, dans le pays, elles ont tyrannisé les familles de ceux qui avaient fui pendant des années.
Une répression politique s'est abattue sur le pays. Des défenseurs des droits humains et des journalistes ont été envoyés dans des prisons ouzbèkes connues pour pratiquer la torture.
L'UE et les États-Unis ont réagi rapidement au massacre, condamnant les meurtres et appelant à une enquête indépendante. Mais ils ont rapidement, honteusement rapidement, fait marche arrière.
Les sanctions ciblées de l'UE à l'encontre des principaux responsables du massacre ont été levées en 2008. Les pressions les plus fortes au sein de l'Union sont venues de l'Allemagne, disposant d'une base militaire en Ouzbékistan utilisée pour soutenir les opérations dans l'Afghanistan voisine.
Des considérations similaires ont également conduit à l'effondrement de la détermination initiale de Washington : une base militaire américaine en Ouzbékistan.
Cette « realpolitik », c'est-à-dire la volonté de collaborer avec des meurtiers de masse semble aujourd'hui non seulement immorale, mais aussi assez inutile. A l’aune de l’année 2025, avec le retour au pouvoir des talibans en Afghanistan, valait-il vraiment la peine de soutenir une dictature brutale en Ouzbékistan ?
Aujourd'hui, l'Ouzbékistan a connu quelques changements, mais dans l'ensemble, les mêmes tendances persistent. Un nouveau président a montré quelques premiers signes de réforme. Certains prisonniers politiques ont été libérés. Mais ces espoirs se sont avérés n'être qu'en grande partie un mirage.
Les autorités continuent de s'attaquer à la liberté d'expression. Elles continuent de prendre pour cible les militants et les journalistes. La torture est toujours pratiquée et les tortionnaires continuent de s’en tirer à bon compte.
La manière dont les forces de sécurité réagissent aux manifestations publiques de grande ampleur ne semble guère s'être améliorée non plus. Lorsque des manifestations ont éclaté dans la région du Karakalpakstan en 2022, les autorités ont utilisé la force létale contre les manifestants. Près d'une vingtaine de personnes ont été tuées. Puis, comme lors du massacre d'Andijan, les autorités ont accusé et puni les organisateurs présumés.
Aujourd'hui, vingt ans plus tard, nous ne nous souvenons pas du massacre d'Andijan parce qu'il appartient au passé. Nous nous en souvenons parce qu'il résonne toujours au présent.