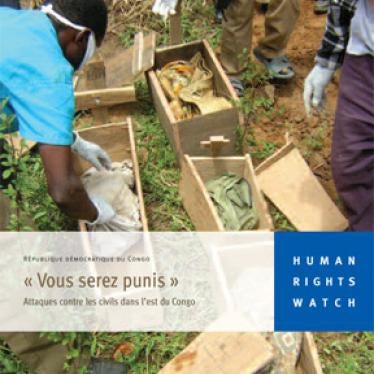(Tunis) – Le parlement tunisien devrait abandonner, ou revoir en profondeur, le projet de loi qui donnerait au gouvernement des prérogatives exorbitantes lui permettant de restreindre les droits lors des périodes d’état d’urgence, a déclaré Human Rights Watch aujourd’hui.
La législation permettrait à l’exécutif d’interdire n’importe quelle grève ou manifestation s’il estimait qu’elle menace l’ordre public, de placer sous résidence surveillée toute personne « dont les activités sont susceptibles de porter atteinte à la sécurité » et de suspendre des associations sur simple suspicion de participation à des actes préjudiciables. Le projet de loi prévoit un contrôle judiciaire insuffisant des mesures prises en vertu de ces pouvoirs.
« Les pouvoirs sans limite octroyés par ce projet de loi constitueraient un retour en arrière en ce qui concerne beaucoup de droits que les Tunisiens se battent pour protéger depuis la révolution de 2011 », a déclaré Amna Guellali, directrice du bureau de Tunisie de Human Rights Watch. « Les pouvoirs spéciaux devraient avoir une portée et une durée limitées, et être sujets à l’examen de la justice. »
La Tunisie est sous état d’urgence depuis plus de trois ans.
Le président Béji Caïd Essebsi a présenté le projet de loi au Parlement le 30 novembre 2018. La commission parlementaire des droits, des libertés et des relations extérieures a commencé à le discuter le 18 janvier 2019.
Le président Essebsi a déclaré l’état d’urgence le 24 novembre 2015 après qu’un attentat-suicide a tué 12 gardes présidentiels à Tunis. Depuis, il l’a renouvelé de façon continue, la dernière prolongation datant du 4 février.
Ces déclarations réitérées se fondent sur un décret présidentiel de 1978 qui permet au président de déclarer l’état d’urgence pour une durée maximale de 30 jours, renouvelable, en réaction à de graves perturbations de l’ordre public. Ce décret donnait à l’exécutif – en pratique, au ministère de l’Intérieur et aux gouverneurs de régions, qui font partie de ce ministère – l’autorité de suspendre certains droits. Le projet de loi actuel est destiné à se substituer au décret de 1978 pour devenir le fondement légal des périodes d’état d’urgence en Tunisie.
La note explicative jointe au texte affirme qu’il aspire à un « équilibre entre la protection de l’État et du territoire national contre les menaces internes et externes, et le besoin de respecter les droits humains et les libertés, dans le cadre du principe de proportionnalité exigé par la Constitution ».
Loin de trouver cet équilibre, toutefois, le projet de loi étendrait les larges pouvoirs dont disposent les autorités pour prendre des mesures sans approbation judiciaire préalable, afin de réduire la liberté d’expression, de réunion, d’association et de mouvement, ainsi que les droits syndicaux.
Le projet de loi définit ce qu’est un « état d’urgence » de façon plus large que ne l’autorise le droit international, qui dispose que les périodes d’état d’urgence suspendant les droits fondamentaux ne sont permises que lorsqu’une situation « menace l’existence d’une nation ». La législation permet au président d’imposer un état d’urgence, après consultation avec le chef du gouvernement et le Conseil national de sécurité, pendant six mois, renouvelable pour trois mois, lorsqu’il existe des événements « qui par leur nature s’apparentent à un ‘désastre’ » ou « un danger imminent menaçant l’ordre public et la sûreté, la sécurité des personnes et des institutions, et les intérêts vitaux et biens de l’État ». Le projet de texte n’expose pas clairement quelle est la durée maximale de l’état d’urgence, ce qui donne toute latitude à l’exécutif pour interpréter le texte de manière à le prolonger indéfiniment.
Avec ce projet de loi, les gouverneurs et le ministre de l’Intérieur conservent les pouvoirs, déjà octroyés par le décret de 1978, de bannir de certaines zones géographiques toute personne cherchant à « entraver de quelque manière que ce soit l’action des autorités publiques ». Les responsables peuvent également imposer des assignations à résidence, interdire toute manifestation ou rassemblement public s’ils l’estiment dangereux pour l’ordre public ou la sécurité, et fermer les lieux de réunion publics.
Le texte ajoute des pouvoirs spéciaux à ceux octroyés depuis 1978, permettant au ministre de l’Intérieur de placer les gens sous « contrôle administratif », ce qui leur impose de venir signer dans un poste de police trois fois par jour. Le ministre peut également confisquer un passeport ou ordonner d’intercepter des communications. Les autorités peuvent faire des perquisitions dans les endroits fréquentés par toute personne qu’elles suspectent de présenter une « menace pour la sûreté nationale », et saisir ses ordinateurs ou autres systèmes d’information, sans ordonnance judiciaire.
Le projet de loi donne également pouvoir aux autorités d’ordonner à une association de suspendre toute activité que les responsables estiment « contribuer aux activités portant atteinte à l’ordre public ou à la sûreté » ou « entraver le travail des autorités publiques ». Cette disposition passe outre la loi sur les associations de 2011, qui attribue à la justice la prérogative exclusive de suspendre une association.
Comme Human Rights Watch l’a analysé, les opérations de police effectuées en vertu de l’état d’urgence ont entraîné beaucoup d’abus, avec des conséquences désastreuses pour les personnes ciblées et leur famille.
En effet, les autorités ont placé plus de 130 personnes en résidence surveillée et restreint les déplacements de centaines d’autres, ce qui fait que beaucoup ont perdu leur emploi et sont devenus suspectes aux yeux de leurs amis et voisins.
Le Pacte international relatif aux droits civils et politiques (PIDCP), dans son article 4, autorise les États, « dans le cas où un danger public exceptionnel menace l'existence de la nation », à restreindre certains droits de façon exceptionnelle. Ces mesures ne sont possibles que « dans la stricte mesure où la situation l'exige » et doivent strictement respecter les critères de nécessité et de proportionnalité.
Le Comité des droits de l’homme, qui fait autorité pour interpréter le Pacte, a déclaré que la situation exigerait des États parties de « justifier précisément non seulement leur décision de proclamer un état d’exception, mais aussi toute mesure concrète découlant de cette proclamation ». Le comité a souligné que « les mesures [prises en vertu de l’article 4] doivent avoir un caractère exceptionnel et provisoire. » L’objectif premier de tout état d’urgence devrait être de garantir les conditions permettant un retour à l’application normale de la loi, sujette au contrôle judiciaire, a déclaré le Comité.
L’article 49 de la Constitution tunisienne dispose que toute restriction des droits humains, garantis par la Constitution, ne doit pas « porter atteinte à leur substance ». Ces restrictions « ne peuvent être établies que pour répondre aux exigences d’un État civil et démocratique, et en vue de sauvegarder les droits d’autrui ou les impératifs de la sûreté publique, de la défense nationale, de la santé publique ou de la moralité publique, tout en respectant la proportionnalité entre ces restrictions et leurs justifications ».
Toute nouvelle législation sur l’état d’urgence devrait contenir des garanties plus solides, notamment en précisant la durée maximale de l’état d’urgence lui-même mais aussi de chaque mesure. Elle devrait établir que l’objectif est de lever l’état d’urgence le plus vite possible. Enfin le texte devrait exiger qu’une haute autorité judiciaire, telle que la Cour constitutionnelle, se penche sur la validité légale de la déclaration de prolongation de l’état d’urgence.
Les autorités devraient fournir une copie de leur décision à chaque individu et organisation dont elles restreignent les droits à travers leurs pouvoirs spéciaux. Enfin la loi devrait autoriser les parties affectées à contester les mesures restrictives et à obtenir que la justice examine rapidement leur raison d’être.
Human Rights Watch a analysé en détail en quoi l’absence de notification écrite fait qu’il est difficile, pour ceux qui sont sous le coup d’une assignation à résidence ou d’une restriction de déplacement, de contester les ordonnances devant le tribunal administratif, qui examine les décisions administratives. Les règles du tribunal exigent en effet que le plaignant fournisse une copie de la décision administrative qu’il prétend contester.
Chaque renouvellement de ces ordonnances devrait être sujet au contrôle d’un tribunal, les autorités étatiques ayant l’obligation de prouver la nécessité des restrictions en cours, en tenant compte de toutes les circonstances, notamment l’accès au travail de la personne ciblée. Enfin la suspension des associations devait rester par principe une prérogative de la justice.
-------------------
Dans les médias
Tweets
Tunisie : Un projet de loi sur les pouvoirs en état d’urgence menace les droits humains https://t.co/EuTfl3L1O1
— HRW en français (@hrw_fr) 20 février 2019
#Tunisie : le projet de loi sur l'état d'urgence, un "retour en arrière" selon #HRW https://t.co/qW5mtWwOQS
— L'Orient-Le Jour (@LOrientLeJour) 20 février 2019