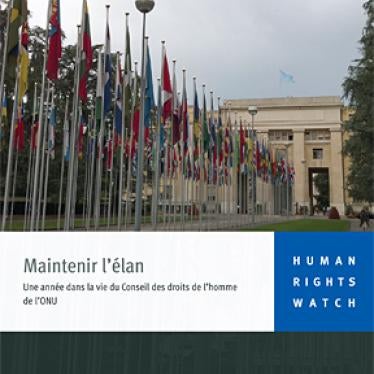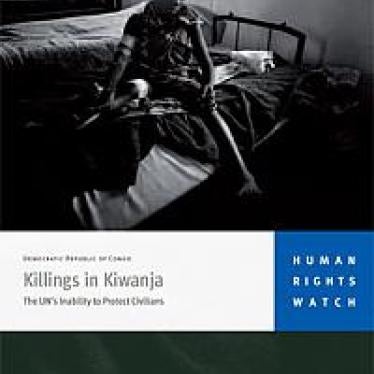Cette soumission a été préparée par Human Rights Watch en vue du troisième cycle de l’Examen périodique universel (EPU) consacré à la République centrafricaine. Elle s’appuie sur des informations issues de recherches menées depuis le deuxième cycle de l’EPU sur la République centrafricaine. La soumission couvre une période de conflit intense, pendant laquelle les civils ont fait les frais des violences perpétrées par les groupes armés. Si Human Rights Watch a rendu compte de diverses atteintes aux droits humains commises dans le pays depuis le dernier EPU, la présente soumission se concentre sur les violences sexuelles commises par deux des principales parties au conflit, la Séléka et les anti-balaka.[1]
Parmi les conclusions et recommandations tirées du deuxième cycle de l’EPU consacré à la République centrafricaine figuraient des appels à la prise de mesures renforcées pour empêcher les violences sexuelles et les attaques perpétrées par les groupes armés à l’encontre des civils, ainsi que pour améliorer l’accès des survivantes de ces violences sexuelles à un soutien essentiel en matière juridique, médicale et psychosociale. Ces conclusions et recommandations réclamaient également l’obligation de rendre compte des crimes de violences sexuelles, y compris en lançant des enquêtes opportunes et approfondies sur les violences sexuelles perpétrées par les groupes armés. Human Rights Watch a découvert que des membres de groupes armés continuaient de commettre des viols et de pratiquer l’esclavage sexuel en toute impunité, et que les survivantes souffraient toujours non seulement à cause des violences à proprement parler, mais aussi de leurs répercussions physiques, psychiques et sociales de longue durée, souvent sans avoir un accès opportun aux services essentiels.
Les violences sexuelles utilisées comme arme de guerre
Lors d’entretiens avec 296 survivantes, Human Rights Watch a documenté les violences sexuelles généralisées perpétrées contre des femmes et des filles par des combattants de la Séléka et anti-balaka entre le début de l’année 2013 et le milieu de l’année 2017. L’organisation a notamment rendu compte de cas de viols, d’esclavage sexuel, d’agressions physiques et d’enlèvements de filles et de femmes âgées de 10 à 75 ans, principalement dans la capitale, Bangui, ainsi que dans les villes d’Alindao, de Bambari, de Boda, de Kaga-Bandoro et de Mbrès et dans les environs.
Les violences sexuelles commises par les groupes armés ne sont pas seulement une conséquence indirecte des combats mais, dans de nombreux cas, il s’agit d’une tactique de guerre. Les commandants ont systématiquement toléré les violences sexuelles perpétrées par leurs forces et, dans certains cas, il semblerait qu’ils les aient ordonnées ou les aient commises eux-mêmes.
Dans de nombreux cas, les survivantes ont indiqué que leurs agresseurs se servaient de la violence sexuelle pour les punir de leur soutien présumé à l’égard de personnes de la communauté ennemie selon le clivage sectaire. Des combattants de la Séléka ont nargué les femmes et les filles en les traitant de « femmes d’anti-balaka » et les combattants anti-balaka ont accusé leurs victimes de soutenir les musulmans. Dans certains cas, les groupes armés ont utilisé les violences sexuelles pour punir des proches masculins de leurs victimes en raison d’alliances présumées. Des membres des groupes armés ont encore accentué cette stratégie d’humiliation en violant certaines femmes et filles devant leur mari, leurs enfants et d’autres membres de leur famille. Des survivantes ont également vu des combattants violer, tuer ou mutiler leur mari et d’autres proches. Dans un cas, une survivante a déclaré que des combattants l’avaient obligée à regarder pendant qu’ils violaient son mari, avant de le tuer et de la violer à son tour.
La plupart des survivantes ont expliqué que plusieurs agresseurs les avaient violées, parfois dix hommes ou plus, lors d’un seul incident. Les viols de ces femmes et de ces filles, qui ont entraîné des blessures allant de fractures et de dents cassées à des lésions internes et des traumatismes crâniens, constituent des actes de torture. La torture s’est dans certains cas accompagnée de violences supplémentaires, y compris d’un viol avec une grenade et une bouteille brisée. Les agresseurs ont aussi torturé des femmes et des filles en les fouettant, en les attachant pendant de longues périodes, en les brûlant et en les menaçant de mort.
Suite à des entretiens menés avec 257 femmes et 39 filles (âgées de 17 ans et moins), Human Rights Watch a documenté 305 cas de violences sexuelles commis par des membres de groupes armés. Certaines survivantes ont subi des violences sexuelles plusieurs fois, lors d’incidents différents. Plusieurs femmes et filles ont indiqué que les combattants les avaient violées alors qu’elles étaient enceintes.
Human Rights Watch a interrogé 44 femmes et filles victimes d’esclavage sexuel, acte consistant pour les combattants à commettre des violences sexuelles et à exercer un pouvoir de propriété sur leurs victimes. Les survivantes ont indiqué avoir été détenues avec en tout au moins 167 autres femmes et filles qui elles aussi étaient des esclaves sexuelles. Des victimes d’esclavage sexuel ont été détenues pendant des périodes allant jusqu’à 18 mois, violées à plusieurs reprises – certaines ont été prises en « épouse » par des combattants – et forcées à faire la cuisine et le ménage et à aller chercher de la nourriture ou de l’eau. Au moins neuf survivantes sont tombées enceintes alors qu’elles étaient détenues comme esclaves sexuelles, y compris des filles âgées de 14 ans et d’environ 16 ans à l’époque, et au moins cinq ont donné naissance à un enfant suite à ces viols.[2]
Du fait de la stigmatisation, du manque de signalement des cas par les survivantes ainsi que des contraintes de temps et des limites imposées aux recherches en raison de l’insécurité, les cas documentés par Human Rights Watch ne représentent probablement qu’une part infime de tous les incidents de violences sexuelles commises par les groupes armés dans le pays pendant la période examinée.[3]
Manque d’accès aux services
Seules 145 des 296 survivantes de violences sexuelles avaient eu accès à des soins médicaux post-viol en raison d’une série d’obstacles, comme l’absence d’établissements de santé, le coût du déplacement jusqu’à ces établissements et la peur de la stigmatisation et du rejet. Parmi elles, seules 83 survivantes ont confirmé qu’elles avaient révélé les violences sexuelles aux prestataires de soins de santé, permettant ainsi la réalisation de soins post-viol complets. L’incapacité des prestataires de services à assurer des soins discrets, confidentiels et adaptés a dans certains cas dissuadé les survivantes de divulguer les violences sexuelles dont elles avaient fait l’objet ou de bénéficier d’une aide.
Parmi celles qui ont révélé avoir été violées, beaucoup ont dit que les prestataires de services ne leur avaient pas proposé les soins indispensables entrant dans la prise en charge du viol, y compris une prophylaxie post-exposition (PPE) pour éviter la transmission du VIH, une contraception d’urgence, un test de dépistage du VIH et d’autres infections sexuellement transmissibles (IST) et un soutien psychosocial. Seules 41 des survivantes interrogées par Human Rights Watch ont affirmé avoir eu accès à des soins médicaux dans les 72 heures suivant le viol, délai dans lequel la PPE doit être administrée.
De nombreuses femmes et filles qui se sont rendues dans des centres de santé et ont divulgué leur viol ont fait savoir à Human Rights Watch que le personnel ne les avait pas renseignées sur les services médicaux et psychosociaux destinés aux survivantes de viol et situés à proximité. Les survivantes avaient bénéficié d’un soutien psychosocial dans seulement 66 cas. Les survivantes ont fait part de symptômes évocateurs du stress post-traumatique et de la dépression et, dans certains cas, de pensées suicidaires.
Cinquante-trois femmes et filles ont déclaré à Human Rights Watch que le coût des soins médicaux les avait empêchées d’en bénéficier. Bien qu’un fonctionnaire du ministère de la Santé ait affirmé à Human Rights Watch que les soins post-viol étaient gratuits, plusieurs survivantes qui avaient révélé avoir subi des violences sexuelles aux personnels de santé ont raconté à Human Rights Watch que les prestataires de soins leur avaient fait payer les examens, les tests ou les médicaments.[4] Même dans le cas de services réellement gratuits, les survivantes n’avaient parfois pas les moyens de se déplacer jusqu’à un établissement de santé.
Human Rights Watch a mené des entretiens avec 13 survivantes, dont trois filles, qui ont déclaré être tombées enceintes suite à un viol. Les survivantes détenues en tant qu’esclaves sexuelles ont dit avoir connaissance d’au moins cinq autres femmes et filles qui étaient tombées enceintes pendant leur captivité. Même si, en République centrafricaine, l’avortement est légal en cas de viol, des obstacles considérables subsistent pour y accéder. Une survivante de 18 ans tombée enceinte après avoir été violée par un combattant anti-balaka a déclaré qu’elle voulait se faire avorter mais qu’elle n’avait pas eu accès à des soins médicaux et ne savait pas comment s’y prendre. « Que vais-je faire de ce bébé ? », a-t-elle demandé. « Je n’en voulais pas. Qui s’occupera de lui ? Toute ma famille est morte et j’attends le bébé d’un meurtrier. »[5]
Seules 92 des 296 survivantes interrogées par Human Rights Watch ont déclaré avoir effectué un test de dépistage du VIH après avoir subi des violences sexuelles. Mais ce test était souvent peu concluant, car il n’avait pas été réalisé de manière répétée ou une fois passé le délai nécessaire pour pouvoir déterminer la présence d’une infection. Une survivante de 28 ans violée par un combattant de la Séléka en 2013 a fait écho à de nombreuses autres en disant qu’elle s’interrogeait en permanence sur sa santé : « Je me demande : “Est-ce qu’il m’a transmis le sida ? Quelle [autre] maladie ? Quel est mon état de santé ? Vais-je mourir bientôt ?” »[6]
De nombreuses survivantes ont expliqué qu’elles n’avaient pas cherché à obtenir de l’aide, notamment des soins médicaux essentiels, par peur de la stigmatisation et du rejet. Elles ont précisé que des membres de leur famille et de leur communauté leur avaient reproché de s’être fait violer et les avaient humiliées publiquement, y compris en les « pointant du doigt » ou en les traitant de tous les noms. Human Rights Watch a interrogé 38 femmes et filles qui ont déclaré avoir été abandonnées par leur mari, leur conjoint ou des membres de leur famille suite à ce viol.
Impunité et manque d’accès à la justice
Bien que le Code pénal centrafricain considère le viol et les agressions sexuelles comme des infractions pénales, aucun membre d’un groupe armé n’a été jugé pour viol pendant le conflit. Seules 11 des 296 survivantes de violences sexuelles interrogées par Human Rights Watch ont déclaré avoir tenté de porter plainte. Elles ont signalé avoir été confrontées à des facteurs dissuasifs puissants en réclamant que justice soit faite, y compris à une réponse inappropriée de la part des autorités, à des menaces de mort et à des agressions physiques pour avoir osé se manifester, et elles ont confié s’être senties intimidées et impuissantes en voyant leurs agresseurs connus se déplacer librement dans leur village ou leur ville.
Celles qui ont informé les autorités ont subi des mauvais traitements ; elles ont notamment fait l’objet de comportements visant à ce qu’elles sentent elles-mêmes coupables, ont été confrontées à l’absence de toute enquête, et dans certains cas ont été priées de présenter elles-mêmes leur agresseur afin que l’on puisse l’arrêter. Par ailleurs, les contraintes économiques et la peur de représailles ont dissuadé des survivantes de chercher à obtenir justice. Une avocate qui aide les victimes de violences sexuelles a indiqué à Human Rights Watch : « Les agresseurs sont toujours là. Ils circulent librement et les victimes ont trop peur pour les dénoncer. »[7] Dans au moins trois cas, les victimes ou des membres de leur famille ont été tués, battus ou menacés de mort après avoir directement confronté les membres du groupe armé responsable de violences sexuelles.
Parmi les autres obstacles aux enquêtes et aux poursuites en justice figurent la difficulté à identifier les auteurs de ces délits et la délivrance aléatoire de rapports médicaux attestant de signes de viol.
Cour pénale spéciale
En juin 2015, la présidente de l’époque Catherine Samba-Panza a signé une loi instaurant une Cour pénale spéciale (CPS), un tribunal temporaire chargé d’engager des enquêtes et des poursuites sur les graves violations des droits humains perpétrées dans le pays depuis 2003 « telles que définies par le Code pénal centrafricain et en vertu des obligations internationales contractées par la République centrafricaine en matière de Droit international, notamment le crime de génocide, les crimes contre l’humanité et les crimes de guerre ».[8] Les crimes contre l’humanité, tels que définis par le Code pénal centrafricain, incluent « [l]e viol, l’esclavage sexuel, la prostitution forcée, la grossesse forcée, la stérilisation forcée ou toute autre forme de violence sexuelle de gravité comparable ». [9]
Le système judiciaire national centrafricain étant faible et la CPI se limitant à poursuivre en justice les responsables haut placés des crimes les plus graves, la CPS pourrait contribuer de manière significative à lutter contre l’impunité à l’égard des violations graves commises pendant le conflit armé.[10] En rendant justice au niveau national, la CPS permet aux victimes et aux autres personnes les plus affectées par ces crimes d’accéder plus facilement à un procès et de susciter parmi elles un intérêt accru à l’égard d’une procédure ; elle peut également favoriser l’appropriation de cette démarche au niveau national et renforcer la capacité à rendre justice en cas de crimes odieux.
Si la CPS ne saurait aborder ou résoudre l’ensemble des problèmes complexes auxquels la République centrafricaine est confrontée, l’expérience montre que c’est l’absence d’obligation de rendre compte de ses actes qui exacerbe la perpétration persistante d’exactions. L’ouverture de procès équitables et crédibles sur les crimes graves peut contribuer au respect de l’État de droit, à l’élimination des cycles d’impunité bien établis et à une stabilité durable.
La CPS a réalisé des progrès importants, notamment en 2017, mais elle reste confrontée à des défis considérables. S’il a fallu plus de temps que prévu pour la rendre opérationnelle, son instauration a reposé sur des mesures importantes destinées à protéger sa crédibilité, son indépendance et son impartialité.
Depuis 2015, les victimes, les militants et les praticiens de la justice en Centrafrique ont fait savoir à maintes reprises et sans équivoque qu’il était urgent que justice soit faite pour les crimes de guerre et les crimes contre l’humanité commis au cours des 15 dernières années. Aux côtés des autorités centrafricaines, les partenaires internationaux devront apporter un soutien politique et financier pour aider la Cour à remplir son mandat.
Un défi clé pour la CPS et les tribunaux nationaux consiste à assurer une protection fiable aux témoins et aux victimes de violences sexuelles. Il n’existe actuellement aucun mécanisme de protection de ce type en République centrafricaine. Aucune victime n’a participé, que ce soit en tant que témoin ou que partie civile, à la session pénale organisée par l’ONU à Bangui en 2015, en partie pour des questions de sécurité.[11] Quatre témoins ont participé à la session pénale de 2016 en tant que parties civiles ; un seul d’entre eux a été témoin dans une affaire liée au conflit, qui impliquait des accusations d’associations de malfaiteurs.
Pour prévenir les violences sexuelles envers les femmes et les filles et aider celles qui ont souffert de ces exactions, Human Rights Watch recommande au gouvernement de la République centrafricaine de prendre les mesures suivantes :
- Délivrer un message public et sans équivoque aux responsables de la Séléka et aux dirigeants anti-balaka indiquant qu’il appliquera une tolérance zéro à l’égard des violences sexuelles et mettra tout en œuvre pour que tous les auteurs de violences sexuelles soient traduits en justice.
- Avec le soutien des agences des Nations Unies, des gouvernements donateurs et des organisations non gouvernementales, garantir la disponibilité et la fourniture de soins médicaux post-viol d’urgence essentiels, gratuits, complets et conformes au protocole national de prise en charge clinique des viols, y compris – avec le consentement éclairé de la survivante – une contraception d’urgence, une prophylaxie post-exposition pour la prévention du VIH, la prévention et le traitement d’autres infections sexuellement transmissibles, ainsi qu’un test de grossesse et un accès à ou une orientation vers un avortement sûr.
- Avec le soutien des agences des Nations Unies, des gouvernements donateurs et des organisations non gouvernementales, garantir aux survivantes de violences sexuelles l’accès à un soutien psychosocial ainsi qu’à des systèmes d’orientation vers un soutien psychosocial lorsque les soins ne sont pas disponibles sur place.
- Former la police, les gendarmes, les procureurs et les juges sur la manière appropriée de répondre aux violences sexuelles et basées sur le genre, d’enquêter sur ces cas et de lancer des poursuites judiciaires.
- Mener des activités de sensibilisation et d’évolution des comportements pour éduquer les membres de la communauté sur la manière et la nécessité pour les survivantes d’accéder rapidement aux services et pour lutter contre la stigmatisation et le rejet des survivantes.
- En coopération avec les agences de l’ONU et la mission de l’ONU, développer et mettre en œuvre de toute urgence une stratégie nationale pour lutter contre les violences sexuelles, y compris les violences sexuelles liées au conflit, et y répondre.
- En collaboration avec la mission des Nations Unies, élaborer et mettre en place une stratégie pour la protection des civils comprenant des mesures spécifiques pour protéger les femmes et les filles et limiter le risque de violences sexuelles.
- Conjointement avec la mission de l’ONU, apporter à la Cour pénale spéciale un soutien politique total pour qu’elle puisse remplir son mandat, tout en respectant son indépendance. Appuyer l’adoption rapide par le parlement centrafricain des règles de preuve et de procédure de la Cour pénale spéciale.
- Accélérer la fourniture de locaux permettant aux enquêteurs, aux magistrats et au personnel auxiliaire de la CPS de travailler, ainsi que d’un lieu de résidence aux magistrats nationaux de la CPS et à leurs familles, et accélérer les travaux de rénovation de l’ancien Tribunal de première instance pour que la Cour pénale spéciale puisse y siéger.
[1] Human Rights Watch, « Ils disaient que nous étions leurs esclaves » : Violences sexuelles perpétrées par les groupes armés en République centrafricaine, octobre 2017, https://www.hrw.org/fr/report/2017/10/05/ils-disaient-que-nous-etions-leurs-esclaves/violences-sexuelles-perpetrees-par-les
[2] Certaines survivantes n’avaient pas fait de test de grossesse au moment de leur entretien avec Human Rights Watch et n’avaient pas déterminé de manière définitive si elles étaient tombées enceintes pendant qu’elles étaient détenues comme esclaves sexuelles.
[3] Human Rights Watch a également connaissance de rapports crédibles selon lesquels des groupes armés ont commis des violences sexuelles à l’encontre d’hommes et de garçons, mais les recherches dont il est ici question se concentrent sur les violences contre les femmes et les filles.
[4] Entretien de Human Rights Watch avec un fonctionnaire du ministère de la Santé, Bangui, 26 octobre 2016.
[5] Entretien de Human Rights Watch avec une survivante, Bangui, 13 janvier 2016.
[6] Entretien de Human Rights Watch avec une survivante, Bangui, 14 janvier 2016.
[7] Entretien de Human Rights Watch avec une avocate centrafricaine, Bangui, 14 juin 2016.
[8] « Central African Republic: UN Investigators urge establishment of war crimes tribunal », communiqué de presse de l’ONU, 21 janvier 2015, http://www.un.org/apps/news/story.asp?NewsID=49863#.V_ahbigrKUl (consulté le 18 août 2017) ; Republican Pact for Peace, Reconciliation and Reconstruction in the Central African Republic, Annex I to the letter dated 15 May 2015 from the Chargé d’Affaires a.i. of the Permanent Mission of the Central African Republic to the United Nations addressed to the President of the Security Council, doc. ONU S/2015/344, http://www.refworld.org/pdfid/5587dc5e4.pdfS/2015/344 (consulté le 18 août 2017), p. 5 ; Loi Organique N° 15.003, portant création, organisation et fonctionnement de la cour pénale spéciale, art. 3, dans les archives de Human Rights Watch.
[9] Code pénal centrafricain, 2010, article 153.
[10] Voir Human Rights Watch, Meurtres impunis : Crimes de guerre, crimes contre l’humanité et la Cour pénale spéciale en République centrafricaine, juillet 2017, p. 69-86, https://www.hrw.org/fr/report/2017/07/05/meurtres-impunis/crimes-de-guerre-crimes-contre-lhumanite-et-la-cour-penale.
[11] Entretien de Human Rights Watch avec une avocate centrafricaine, Bangui, 14 juin 2016. Voir Amnesty International, « The Long Wait for Justice, Accountability in the Central African Republic », 11 janvier 2017, p. 7.