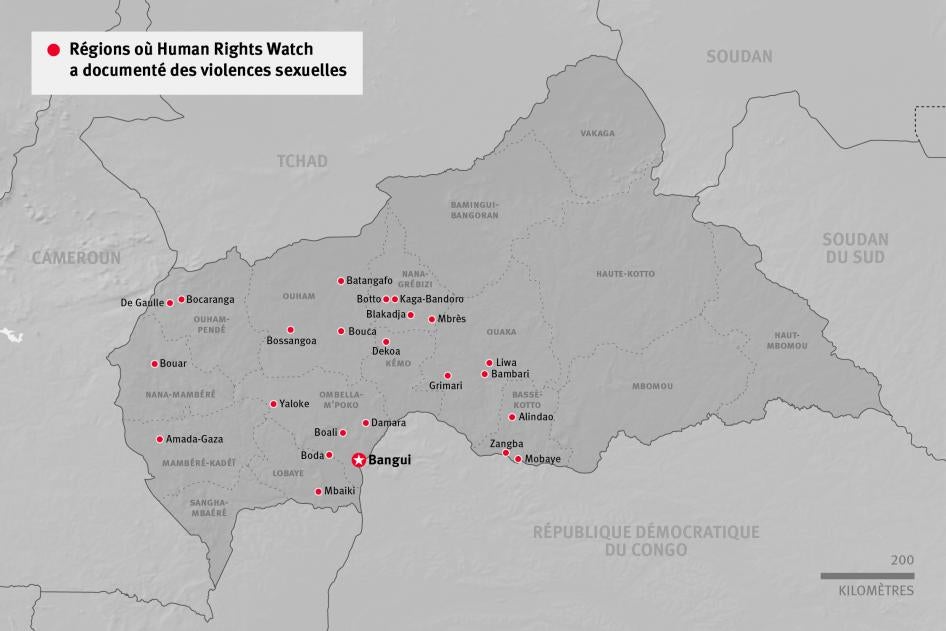Résumé
Nous sommes restées une semaine là-bas. [Les anti-balaka] nous ont violées chaque jour... Nous étions devenues leurs « femmes ». C’était nous qui préparions les repas... À tout moment, ils pouvaient avoir envie de coucher avec nous et, si nous résistions, ils menaçaient de nous tuer...
J’ai dit que j’étais la fille d’un chrétien. [Leur chef] a répondu : « Non, tu es la fille d’un musulman ». J’ai affirmé que non. Il a dit : « Ce sont tes frères qui ont tué nos frères. C’est toi qui vas payer. » ... J’avais 12 ans à l’époque.
[Après que nous nous sommes échappées,] quand je suis arrivée [à Boda], il n’y avait pas d’hôpital, rien. Plus tard, quand [une organisation d’aide] est passée ici, j’ai pu faire une analyse d’urine et une analyse de sang. À l’hôpital, je n’ai pas expliqué ce qu’il s’était passé. Je ne pouvais pas l’expliquer. J’ai dit que j’avais été capturée par les anti-balaka, pas que j’avais été violée.
–Zeinaba, 15 ans, Boda, avril 2016
J’étais avec mon mari à la maison. La Séléka est arrivée... Ils ont poussé mon mari au sol et deux ont pointé leurs fusils sur lui. Puis quatre d’entre eux se sont précipités sur moi et m’ont jetée au sol. Chacun des quatre m’a alors violée. Mon mari était dans la pièce, mais ils ne le laissaient pas bouger.
J’ai pensé à ce que ces hommes ont fait et à obtenir justice pour moi. Je veux que ces hommes soient jugés et mis en prison.
-–Marie, 30 ans, Bambari, janvier 2016
Depuis la fin de l’année 2012, la République centrafricaine est frappée par un conflit armé sanglant dans lequel les civils paient le prix fort. Les groupes armés ont, de façon éhontée, violé le droit de la guerre en toute impunité, attaquant des civils et des structures civiles et laissant derrière eux des morts, des personnes déplacées et une grande pauvreté, dans un pays qui figurait déjà parmi les plus pauvres.
Pendant ces quelque cinq années de conflit, les groupes armés s’en sont également pris aux femmes et aux filles. Les deux principales parties au conflit, à savoir la Séléka essentiellement musulmane et la milice majoritairement chrétienne et animiste connue sous le nom d’« anti-balaka », ont toutes deux pratiqué l’esclavage sexuel et commis des viols dans le pays. Human Rights Watch a documenté l’utilisation de violences sexuelles par les combattants dans le but de punir les femmes et les filles, bien souvent sur la base de critères confessionnels, y compris récemment en mai 2017.
Les violences sexuelles commises par les groupes armés ne sont pas seulement une conséquence indirecte des combats, mais, dans de nombreux cas, elles sont employées comme tactique de guerre. Les commandants ont constamment toléré les violences sexuelles perpétrées par leurs forces et il apparaît, dans certains cas, qu’ils les ont ordonnées ou les ont commises eux-mêmes.
Même si cela continue de hanter les femmes et les filles sur les plans physique, émotionnel, social et économique, les violences sexuelles, comme d’autres crimes liés aux conflits, sont jusqu’à présent restées impunies. À ce jour, aucun membre d’un groupe armé n’a été arrêté ou jugé pour avoir perpétré de l’esclavage sexuel ou des viols.
Après des années de négligence et de privation de leurs droits, des groupes rebelles essentiellement composés de combattants musulmans se sont formés à la fin de 2012 au nord-est du pays sous la bannière de la Séléka, pour lancer des attaques qui ont fait des dizaines de morts parmi les civils et au cours desquelles des maisons ont été brûlées et pillées, et des milliers de personnes déplacées. En réponse, la milice chrétienne et animiste connue sous le nom d'anti-balaka a émergé à la mi-2013 et a commencé à organiser des contre-attaques. Associant tous les musulmans à la Séléka, les anti-balaka ont mené des attaques à grande échelle contre des civils musulmans de Bangui et des régions occidentales du pays. Séléka et anti-balaka ont, l'une comme l'autre, agit en représailles et il est arrivé que les deux parties ciblent des civils en fonction de critères religieux. À la mi-2014, après avoir été expulsée de Bangui par l'Union africaine et les forces françaises, la Séléka s'est scindée en plusieurs factions. Ces groupes Séléka se sont parfois combattus ou ont formé des alliances, et il est arrivé aussi qu'ils s’allient avec des groupes anti-balaka.
S’appuyant essentiellement sur des entretiens avec 296 femmes et les filles ayant survécu aux abus, ce rapport documente les violences sexuelles généralisées perpétrées par les combattants de la Séléka et anti-balaka entre le début de l’année 2013 et le milieu de l’année 2017. Le rapport présente des cas détaillés de viol, d’esclavage sexuel, d’agression physique et d’enlèvement de femmes et de filles âgées de 10 à 75 ans, principalement dans la capitale, Bangui, ainsi que dans les villes d’Alindao, de Bambari, de Boda, de Kaga-Bandoro, de Mbrès et dans leurs environs.
Le présent rapport contient la documentation la plus exhaustive à ce jour sur les violences sexuelles généralisées envers les femmes et les filles commises par des combattants affiliés aux anti-balaka et aux différentes factions de la Séléka. Il explique en détail comment ces groupes armés ont fait subir des viols brutaux et parfois répétés à des femmes et des filles, entraînant des répercussions à long terme, y compris des maladies et des blessures, des grossesses non désirées, la stigmatisation et l’abandon et une perte de moyens de subsistance ou d’accès à l’éducation. Le rapport expose aussi les obstacles considérables qui empêchent les victimes d’accéder à des soins médicaux et psychosociaux même basiques après un viol.
La mission de maintien de la paix des Nations Unies, autorisée à avoir 12 870 soldats armés dans le pays, a pour mandat de protéger les civils, y compris des violences sexuelles, mais elle a du mal à empêcher les groupes armés de commettre des crimes à l’encontre des femmes et des filles et à répondre de manière adéquate aux cas de violences sexuelles.
C’est au gouvernement que revient la responsabilité principale de protéger les femmes et les filles des violences sexuelles, mais alors que les combats ont décimé les institutions du pays, y compris les tribunaux et les établissements de détention, les autorités manquent de capacité pour empêcher les violences sexuelles, mener des enquêtes et des poursuites à l’encontre des auteurs ou pour garantir la disponibilité de services critiques pour les victimes. Cependant, le gouvernement et les autres prestataires de services n’ont pas toujours pris toutes les mesures possibles pour fournir l’assistance nécessaire aux victimes qui ont signalé le crime.
Dans un pays où le système judiciaire est largement dysfonctionnel, avec seulement une poignée de tribunaux opérationnels, quelques avocats et juges et une capacité minimale pour enquêter sur les violences sexuelles ou arrêter les auteurs, les victimes ont peu de chance, voire aucune chance, d’obtenir réparation. Bien que le Code pénal centrafricain punisse le viol et l’agression sexuelle comme des infractions pénales, aucun membre d’un groupe armé n’a été jugé pour viol pendant le conflit. Seules 11 victimes de violences sexuelles sur les 296 interrogées par Human Rights Watch ont déclaré avoir tenté de porter plainte. Elles ont rapporté avoir été confrontées à des facteurs dissuasifs puissants lorsqu’elles ont voulu demander justice, y compris des menaces de mort et des agressions physiques pour avoir osé se manifester, et elles ont confié s’être senties intimidées et impuissantes de voir leurs agresseurs connus se déplacer librement dans leurs villages et leurs villes.
Une enquête en cours de la Cour pénale internationale (CPI) sur les crimes commis dans le pays depuis août 2012 pourrait rendre la justice dans une certaine mesure pour les crimes liés au conflit. Mais la CPI, qui enquête uniquement sur les responsables des crimes internationaux les plus graves, peut juger uniquement un petit nombre de personnes à de hauts niveaux de pouvoir.
La Cour pénale spéciale récemment instaurée – nouveau tribunal national et international hybride intégré dans le système judiciaire national – offre l’espoir d’une plus grande justice pour les crimes de guerre et les possibles crimes contre l’humanité qui affectent la République centrafricaine depuis 2003. Son succès dépend toutefois du soutien politique et financier durable de la part du gouvernement et des partenaires internationaux du pays, ainsi que de procédures efficaces pour protéger les témoins, les victimes et le personnel du tribunal.
Ce rapport formule des recommandations pour atténuer les risques pour les femmes et les filles et pour garantir aux victimes de violences sexuelles un accès à des soins médicaux essentiels, à un soutien psychosocial et à la justice. Mettre un frein aux abus de la Séléka et des anti-balaka et juger les auteurs nécessitent une approche multidimensionnelle à long terme, mais le gouvernement, les Nations Unies et les bailleurs de fonds internationaux peuvent prendre des mesures immédiates pour renforcer la protection des civils exposés au risque de violences sexuelles et pour améliorer les services aux victimes de violences sexuelles.
Le viol comme tactique de guerre
Les commandants des deux principales parties au conflit ont toléré les violences sexuelles commises par leurs forces ; dans certains cas, il apparaît qu’ils les ont ordonnées ou les ont même commises. Parfois, le viol faisait partie intégrante des attaques armées et était utilisé comme arme de guerre.
Des membres des groupes armés ont commis des viols pendant les attaques sur les villes et les villages, parfois pendant des recherches au porte-à-porte d’hommes et de garçons. Des combattants de la Séléka et anti-balaka ont aussi attaqué des femmes et des filles alors qu’elles effectuaient des tâches indispensables comme aller au marché, faire pousser ou récolter des cultures et aller et venir de l’école ou du travail. Les agresseurs ont souvent dirigé leurs attaques contre des femmes et des filles en raison de leur affiliation religieuse présumée, les combattants de la Séléka majoritairement musulmans ciblant des femmes et des filles de communautés chrétiennes, et les combattants anti-balaka visant des femmes et des filles musulmanes.
Dans de nombreux cas, les victimes ont indiqué que leurs agresseurs utilisaient les violences sexuelles comme une forme de châtiment pour le soutien perçu à ceux de l’autre camp de la division religieuse. Des combattants de la Séléka narguaient les femmes et les filles en les traitant de « femmes d’anti-balaka » et les combattants anti-balaka accusaient leurs victimes de soutenir les musulmans. Dans certains cas, les groupes armés utilisaient les violences sexuelles comme punition pour les alliances présumées de proches masculins des victimes. Dans un cas, une survivante a déclaré que les combattants l’avaient obligé à regarder pendant qu’ils violaient son mari, avant de le tuer et de la violer à son tour.
Dans la plupart des cas, les victimes ont expliqué que plusieurs agresseurs les ont violées, parfois 10 hommes ou plus, pendant un seul incident. Les viols de ces femmes et ces filles, qui ont entraîné des blessures allant de fractures et de dents cassées à des lésions internes et des traumatismes crâniens, constituent de la torture. La torture a été accentuée dans certains cas par des violences supplémentaires, y compris un viol avec une grenade et une bouteille brisée. Les agresseurs ont aussi torturé des femmes et des filles en les fouettant, en les attachant pendant de longues périodes, en les brûlant et en les menaçant de mort. Des victimes d’esclavage sexuel ont été détenues captives pendant des périodes allant jusqu’à 18 mois, ont été violées à plusieurs reprises – certaines ont été prises comme « femmes » par des combattants – et ont été obligées à cuisiner, nettoyer et chercher de la nourriture ou de l’eau.
Des membres des groupes armés ont aggravé l’humiliation en violant certaines femmes et filles devant leurs maris, leurs enfants et d’autres membres de leur famille. Des victimes ont expliqué à Human Rights Watch qu’elles ont vu les combattants violer leurs filles, leurs mères ou d’autres femmes de leur famille ou tuer et mutiler leurs maris et d’autres proches.
Suite aux entretiens avec 257 femmes et 39 filles (âgées de 17 ans et moins) Human Rights Watch a documenté 305 cas de violences sexuelles par des membres de groupes armés. Au moins 13 des femmes victimes étaient des filles au moment des faits. Certaines victimes ont subi des violences sexuelles plusieurs fois, lors d’incidents différents. Dans certains cas d’esclavage sexuel – dans lesquels les combattants commettaient des violences sexuelles et exerçaient un pouvoir de propriété sur les victimes – des femmes ou des filles ont subi de multiples viols sur une période de plusieurs jours, semaines ou mois. Dans 21 cas supplémentaires, 17 femmes et quatre filles ont raconté qu’elles avaient subi des violences de la part des groupes armés – notamment enlèvement, passages à tabac et autres abus physiques – mais n’ont pas décrit de violences sexuelles. Deux de ces femmes ont parlé à Human Rights Watch d’autres incidents de violences sexuelles qu’elles ont subies de la part de membres de groupes armés.
Le nombre d’incidents reflète ceux documentés par Human Rights Watch pendant les recherches menées aux fins de ce rapport et ne constitue pas une tentative de fournir un dossier exhaustif des incidents de violences sexuelles commises par les groupes armés en République centrafricaine pendant une période donnée. Du fait de la stigmatisation, du manque de signalement des cas par les victimes, ainsi que des contraintes de temps et des limitations des recherches dues à l’insécurité, les cas documentés dans le présent rapport ne représentent probablement qu’une fraction de tous les incidents de violences sexuelles commises par les groupes armés dans le pays pendant la période couverte. Les Nations Unies, par exemple, ont consigné plus de 2 500 cas de violences sexuelles sur l’année 2014 seulement.
Certaines victimes ont affirmé qu’elles pouvaient identifier les hommes qui avaient abusé d’elles ou qui commandaient les combattants ayant commis les abus. Ce rapport désigne cinq individus occupant des postes de commandement des groupes armés identifiés par au moins trois victimes comme ayant commis des violences sexuelles ou ayant eu des combattants sous leurs ordres et leur contrôle qui ont commis ces crimes.
Human Rights Watch a aussi entendu des rapports dignes de foi de groupes armés ayant commis des violences sexuelles envers des hommes et des garçons, mais les recherches menées pour ce rapport se concentrent sur les violences à l’encontre des femmes et des filles.
Le rapport n’aborde pas l’exploitation sexuelle et les abus, dont le viol, commis par des membres des forces de maintien de la paix des Nations Unies, dont certains cas ont été documentés précédemment par Human Rights Watch, ou par des membres de forces de maintien de la paix n’appartenant pas à l’ONU opérant en République centrafricaine.
Manque de soins
Les violences sexuelles ont bouleversé la vie de la plupart des femmes et des filles interrogées par Human Rights Watch. Seules 145 victimes de violences sexuelles sur 296 ont eu accès à des soins médicaux après un viol en raison d’une série d’obstacles, comme le manque d’établissements de santé, le coût du déplacement jusqu’à ces établissements et la peur de la stigmatisation et du rejet. Parmi elles, seules 83 victimes ont confirmé qu’elles avaient révélé les violences sexuelles aux prestataires de soins de santé, permettant ainsi la réalisation de soins complets après un viol. Dans seulement 66 cas, les victimes ont bénéficié d’un soutien psychosocial.
Human Rights Watch a interrogé des femmes et des filles qui souffrent de blessures corporelles et de maladies invalidantes. D’autres sont tombées enceintes suite au viol, portant parfois des enfants qui représentent un fardeau émotionnel et financier. Les conséquences pour la santé mentale ne sont pas moins dramatiques. Les femmes et les filles ont décrit des symptômes évocateurs du stress post-traumatique et de la dépression, y compris des pensées suicidaires, de la peur et de l’anxiété, de l’insomnie et une incapacité à réaliser les tâches quotidiennes. Incapables de continuer leur travail ou d’autres activités de subsistance, beaucoup ont expliqué avoir des difficultés à reprendre le cours de leur vie et à subvenir à leurs besoins et à ceux de leurs familles. Des filles ont parfois abandonné l’école par crainte de violences répétées, du risque de stigmatisation ou de l’insécurité continue ou suite à un déplacement.
La peur de la stigmatisation et du rejet a souvent dissuadé les femmes et les filles de révéler le viol, même à des amis proches et des membres de leur famille, et de chercher de l’aide. Le risque n’est que trop réel : des femmes et des filles ont raconté à Human Rights Watch que leurs maris ou leurs partenaires les ont abandonnées, des membres de leur famille ont rejeté la responsabilité du viol sur elles et des membres de la communauté se sont moqués d’elles après le viol.
La stigmatisation est l’un des nombreux obstacles pour accéder à des services médicaux et psychosociaux critiques. Avec une proportion considérable d’établissements de santé détruits par le conflit et l’insécurité qui restreint l’accès aux établissements restants, la disponibilité des services s’avère limitée, notamment hors des grandes villes. Lorsque des services sont disponibles, ils n’offrent pas souvent de soins après un viol confidentiels et complets ni d’orientations appropriées vers un traitement médical ou un soutien psychosocial.
Le gouvernement s’est engagé à fournir des soins de santé gratuits pour les victimes de violences sexuelles, mais certaines femmes et filles ont déclaré que les prestataires de services exigeaient un paiement pour les tests ou les traitements. D’autres ont indiqué qu’elles n’ont pas cherché de soins médicaux parce qu’elles pensaient que cela coûterait des sommes qu’elles n’avaient pas ou parce qu’elles ne pouvaient pas payer le transport jusqu’aux services.
Crimes impunis
La plupart des cas documentés dans ce rapport ne sont pas seulement des crimes au regard du droit centrafricain, mais constituent des crimes de guerre. Dans certains cas, le comportement de la Séléka et des anti-balaka peut représenter des crimes contre l’humanité. Malgré cela, aucun membre de ces groupes armés n’a visiblement été sanctionné pour avoir commis des violences sexuelles. Les agresseurs continuent à occuper des postes de pouvoir dans les groupes armés et à exercer un contrôle sur les populations civiles. Plusieurs victimes ont indiqué avoir vu leurs bourreaux se déplacer librement après avoir commis un viol.
Le gouvernement centrafricain, les gouvernements bailleurs de fonds et les Nations Unies se sont publiquement engagés à soutenir la lutte contre l’impunité pour les crimes de guerre, mais l’espoir d’une responsabilisation reste fragile, en particulier pour les violences sexuelles liées au conflit. Après cinq années de conflit, le système judiciaire national déjà défaillant se retrouve avec peu de tribunaux ou de prisons opérationnels et avec une capacité limitée parmi les juges, les avocats et le secteur de la sécurité. Dans de nombreuses régions où les groupes armés gardent le contrôle, la police nationale et les gendarmes sont entièrement absents.
Les victimes ont fait état d’un manque de confiance dans la justice et ont souvent estimé que leurs agresseurs ne feraient jamais l’objet d’enquêtes, d’arrestations ou de poursuites, et l’impunité historique pour les violences sexuelles fournit peu de preuves du contraire. Seules 11 victimes interrogées par Human Rights Watch ont déclaré avoir tenté de demander l’ouverture d’une enquête criminelle. Celles qui ont informé les autorités ont subi des mauvais traitements, y compris la culpabilisation de la victime, l’absence d’enquête et même des demandes à la victime de présenter ses agresseurs en vue de leur arrestation. Les pressions familiales, les contraintes économiques et la peur de représailles ont davantage dissuadé les victimes de chercher à obtenir justice. Dans au moins trois cas, les victimes ou des membres de leur famille qui ont directement affronté les combattants responsables des violences sexuelles ont été tués, battus ou menacés de mort. La protection des témoins et des victimes – actuellement inexistante dans le système judiciaire national – sera essentielle pour faciliter la responsabilisation. Les autres obstacles aux enquêtes et aux poursuites incluent des difficultés pour identifier les auteurs et la délivrance aléatoire de rapports médicaux attestant de signes de viol.
Le gouvernement ne dispose pas de stratégie nationale pour prévenir ou combattre les violences sexuelles, même si des consultations pour élaborer une telle stratégie avaient eu lieu au moment de la rédaction du présent rapport. En vertu du droit national, régional et international, la République centrafricaine a l’obligation de prévenir les violences sexuelles et d’y remédier, et de traduire en justice les auteurs. Même avec sa capacité limitée, le gouvernement peut et devrait prendre des mesures pour renforcer les protections à l’égard des femmes et des filles et pour améliorer l’accès aux services et à la justice pour les victimes de violences sexuelles. Les gouvernements bailleurs de fonds et les organismes internationaux apportant une aide au pays jouent aussi un rôle prépondérant dans le soutien des efforts pour améliorer la protection contre les violences sexuelles et la réponse à ces violences.
Sans mesures significatives pour éviter les violences sexuelles commises par les groupes armés, aider les victimes et mettre fin à l’impunité pour les auteurs des abus, les femmes et les filles en République centrafricaine continueront de souffrir non seulement aux mains de leurs agresseurs, mais aussi des défaillances du système pour leur apporter protection, soutien et justice.
Principales recommandations
Les recommandations complètes sont présentées à la fin de ce rapport.
Pour prévenir les violences sexuelles envers les femmes et les filles et aider celles qui ont souffert d’abus, Human Rights Watch recommande :
- Aux responsables de la Séléka et des anti-balaka de mettre fin immédiatement aux attaques à l’encontre des civils et de donner des ordres publics clairs à leurs forces respectives de cesser toute violence sexuelle – y compris harcèlement et intimidation – dans les zones sous leur contrôle.
- Au gouvernement de la République centrafricaine :
- Délivrer un message public et non équivoque aux responsables de la Séléka et des anti-balaka indiquant qu’il appliquera la tolérance zéro pour les violences sexuelles et mettra tout en œuvre pour que tous les auteurs de violences sexuelles soient traduits en justice.
- Fournir des services médicaux et psychosociaux gratuits et confidentiels aux victimes de violences sexuelles, y compris des soins médicaux complets après un viol, avec le soutien des agences des Nations Unies, des gouvernements bailleurs de fonds et des organisations non gouvernementales.
- Former la police, les gendarmes, les procureurs et les juges sur la manière de répondre aux violences sexuelles et basées sur le genre et de mener des enquêtes et des poursuites sur ces cas. Apporter un soutien constant à l’Unité mixte d’intervention rapide et de répression des violences sexuelles faites aux femmes et aux enfants (UMIRR) afin d’enquêter sur les violences sexuelles conformément aux normes des meilleures pratiques internationales. Cela inclut le recrutement de personnel féminin, la nomination et la formation de chargés de liaison compétents dans toutes les provinces et un travail pour étendre le principe de l’Unité mixte au niveau provincial.
- En coopération avec les agences de l’ONU et la mission de l’ONU, développer et mettre en œuvre de toute urgence une stratégie nationale pour lutter contre les violences sexuelles et y répondre, y compris les violences sexuelles liées au conflit.
- Élaborer et mettre en place, en collaboration avec la mission des Nations Unies (MINUSCA), une stratégie pour la protection des civils, incluant des mesures spécifiques pour protéger les femmes et les filles et pour limiter le risque de violences sexuelles.
- Conjointement avec la mission de l’ONU, accélérer la mise en place de la Cour pénale spéciale et lui apporter un soutien politique total pour qu’elle remplisse son mandat, tout en respectant son indépendance.
- À la mission des Nations Unies en République centrafricaine :
- Aider les autorités à identifier, arrêter et poursuivre en justice les auteurs de crimes de violences sexuelles commis par des groupes armés conformément au mandat de la mission.
- Encourager la formation et le financement de la police et d’autres institutions de l’État de droit, y compris des procureurs, des juges et du personnel déployé à la Cour pénale spéciale (CPS) et à l’UMIRR, sur les enquêtes et les poursuites concernant les violences sexuelles. Accorder la priorité à l’inclusion de personnel féminin dans les équipes qui travaillent sur ces affaires.
- Intégrer une protection des témoins et des victimes dans le soutien de la CPS et des autres institutions judiciaires, notamment pour les affaires sensibles comme celles impliquant des violences sexuelles, dans lesquelles les témoins ou les victimes sont confrontés à un risque de stigmatisation, de menaces, de blessures ou de mort.
- Au Conseil de sécurité de l’ONU :
- Imposer des sanctions ciblées aux commandants de la Séléka et des anti-balaka responsables d’avoir commis, ordonné ou toléré des violences sexuelles.
- Aux gouvernements bailleurs de fonds étrangers :
- Fournir des ressources supplémentaires et un soutien technique pour les services médicaux, psychosociaux et légaux essentiels pour les victimes de violences sexuelles.
- Renforcer l’aide pour les efforts visant à rétablir le système judiciaire national et à former la police, les procureurs et les juges aux enquêtes et poursuites judiciaires concernant les violences sexuelles et basées sur le genre.
- Apporter un appui politique et financier durable à la Cour pénale spéciale.
Méthodologie
Ce rapport s’appuie sur les recherches réalisées en République centrafricaine entre juillet 2015 et août 2017. Les chercheurs de Human Rights Watch ont interrogé des victimes de violences, des prestataires de services, des membres du personnel des Nations Unies, des représentants du gouvernement et des représentants des groupes armés à Bangui en décembre 2015, en janvier 2016, en avril et mai 2016 et en août 2017. Human Rights Watch a aussi mené des entretiens dans les lieux suivants : Bambari, dans la province d’Ouaka (janvier 2016), Boda, dans la province de Lobaye (avril 2016), Kaga-Bandoro, dans la province de Nana-Grébizi (mai 2016) et Bocaranga, dans la province d’Ouham-Pendé (novembre 2016). Le rapport s’appuie aussi sur des recherches effectuées par Human Rights Watch à Yaloké, dans la province d’Ombella-M’poko, et à Kaga-Bandoro en avril 2015. Les chercheurs de Human Rights Watch ont réalisé d’autres entretiens avec des prestataires de services ainsi qu’avec des représentants du gouvernement et des Nations Unies à Bangui en juillet 2015, en juin 2016, en octobre 2016 et en avril 2017. Pour des raisons de sécurité, les représentants du gouvernement, des agences des Nations Unies et des organisations non gouvernementales n’ont pas été identifiés par leur nom dans ce rapport.
Human Rights Watch met tout en œuvre pour respecter les meilleures pratiques en matière de recherches et de documentation éthiques sur les violences sexuelles. Dans tous les cas sauf neuf, les victimes ont eu la possibilité de parler avec une chercheuse et une interprète. Les chercheurs ont réalisé les entretiens en français avec une interprétation depuis le sango. Dans un cas, un membre de la communauté connu de Human Rights Watch a interprété du peul (fulani) vers le sango, qu’un interprète travaillant avec Human Rights Watch a ensuite traduit en français.
Pour des raisons de sécurité et de confidentialité, toutes les victimes sont identifiées par des pseudonymes. Human Rights Watch a pris des mesures pour contacter et rencontrer discrètement les victimes dans des cadres confidentiels, a préservé la confidentialité des détails susceptibles d’identifier les victimes et a utilisé des techniques d’entretien destinées à minimiser le risque de raviver les traumatismes. Avant chaque entretien, Human Rights Watch a instauré un processus de consentement éclairé détaillé pour s’assurer que les victimes comprenaient la nature et l’objectif de l’entretien et qu’elles pouvaient accepter ou non de parler avec les chercheurs. Human Rights Watch a informé les victimes qu’elles pouvaient clore ou interrompre l’entretien à tout moment et pouvaient refuser de répondre à des questions ou d’aborder des sujets spécifiques. Dans les cas où les victimes ont fait état d’une grande détresse ou étaient visiblement en grande détresse, les chercheurs ont parfois limité les questions sur les incidents de violences sexuelles ou ont mis un terme à l’entretien de manière anticipée. Certaines femmes et filles n’ont pas décrit d’expériences de violences sexuelles. Parmi ces personnes, certaines ont peut-être subi des violences sexuelles, mais elles ont choisi de ne pas en parler.
Dans les cas d’enfants qui ont subi des violences sexuelles, notamment de filles âgées de 10 à 14 ans, les chercheurs de Human Rights Watch ont veillé à éviter un nouveau traumatisme et n’ont pas demandé aux victimes de décrire les incidents de violences sexuelles en détail. Dans certains cas, les chercheurs ont interrogé un parent ou un autre membre de la famille de la victime ayant connaissance de l’incident plutôt que la victime ou en plus de la victime. Dans le cas d’une femme souffrant de handicap mental, le chercheur a interrogé la victime individuellement puis sa mère après avoir obtenu le consentement de la victime.
Human Rights Watch n’a pas versé de rémunération pour les entretiens, mais a pris en charge les frais de transport vers et depuis les lieux des entretiens si nécessaire. Les chercheurs ont aussi organisé l’orientation des victimes vers des services médicaux, psychosociaux et légaux lorsque c’était possible et avec leur consentement éclairé.
Dans certains cas, les victimes avaient des difficultés à préciser la date de l’agression. Ceci est probablement dû à des facteurs comme le faible niveau d’alphabétisation, l’insignifiance des dates calendaires dans la vie quotidienne et/ou le traumatisme découlant de l’incident. Dans ces cas, Human Rights Watch a cherché à déterminer la date des incidents grâce à d’autres détails fournis par la personne interrogée et par des membres de la communauté, ainsi qu’à des informations sur l’activité des groupes armés dans la région. Étant donné que certaines personnes interrogées n’ont pas pu donner leur âge exact ou préciser la date de leur agression, dans trois cas, Human Rights Watch n’a pas été en mesure de déterminer avec certitude si la victime était enfant (moins de 18 ans) ou adulte au moment des faits.
Terminologie
Dans ce rapport, le terme « enfant » renvoie à toute personne âgée de moins de 18 ans. « Fille » désigne un enfant de sexe féminin.
Human Rights Watch utilise la définition des violences sexuelles de l’Organisation mondiale de la Santé (OMS) comme « [t]out acte sexuel, tentative d’acte sexuel ou tout autre acte exercé par autrui contre la sexualité d’une personne en faisant usage de la force, quelle que soit sa relation avec la victime, dans n’importe quel contexte ».[1]
L’OMS définit le viol comme « une pénétration par la force physique ou tout autre moyen de coercition de la vulve ou de l’anus, au moyen du pénis, d’autres parties du corps ou d’un objet ».[2] Des organismes internationaux ont précisé que ce n’est pas le recours à la force physique qui permet de qualifier un acte de viol, mais plutôt de l’absence de consentement de la victime et des circonstances coercitives, que ces circonstances incluent ou non des violences physiques ou des menaces de violences physiques.[3] Human Rights Watch se conforme à la définition de viol de l’OMS, étant entendu que les circonstances de « force physique ou tout autre moyen de coercition » incluent une absence de consentement de la part de la victime ou toute forme de coercition ou de menace.
Human Rights Watch se réfère à des éléments de la définition de l’esclavage sexuel clarifiés par le Statut de Rome de la Cour pénale internationale : « L’auteur a exercé l’un quelconque ou l’ensemble des pouvoirs associés au droit de propriété sur une ou plusieurs personnes, par exemple en achetant, vendant, prêtant ou troquant ladite ou lesdites personnes concernées, ou en leur imposant une privation similaire de liberté » et « [l]’auteur a contraint ladite ou lesdites personnes à accomplir un acte ou plusieurs actes de nature sexuelle ».[4]
I. Contexte – Violences en République centrafricaine
Le conflit actuel en République centrafricaine a débuté à la fin de l’année 2012 lorsque trois groupes rebelles originaires du nord-est, se sentant lésés par des années de négligence et de mauvais traitements de la part du gouvernement du président de l’époque François Bozizé, se sont rassemblés sous la bannière de la Séléka (« alliance » dans la langue sango)[5] : la Convention des Patriotes pour la Justice et la Paix (CPJP), la Convention Patriotique de Salut du Kodro (CPSK) et l’Union des Forces Démocratiques pour le Rassemblement (UFDR).[6] De nombreux combattants de la Séléka étaient des mercenaires venus du Tchad et du Soudan. Alors que la Séléka n’a fait état d’aucune affiliation religieuse, ses combattants étaient majoritairement musulmans.
Partie du nord-est et progressant vers la capitale, Bangui, la Séléka a mené des attaques à la fin de l’année 2012 et en 2013, au cours desquelles elle a tué des dizaines de civils, incendié et pillé des maisons et entraîné le déplacement de plus de 850 000 personnes.[7]
En mars 2013, la Séléka a pris le contrôle de Bangui, renversant le président Bozizé et son gouvernement. Les forces ont attaqué et pillé des quartiers entiers, tuant et violant les civils.[8] Les responsables de la Séléka ont nié que leurs combattants aient pris pour cible des civils, malgré les preuves accablantes démontrant le contraire.[9]
En réaction aux meurtres et aux destructions généralisés, des groupes d’autodéfense locaux appelés « anti-balaka » (« anti-balles ») ont commencé à apparaître. Alors que certains groupes anti-balaka sont affiliés à d’anciens membres de l’armée nationale ou de la garde présidentielle de Bozizé ou se trouvent sous leur coordination, la plupart sont relativement autonomes, opérant dans des régions spécifiques sans lien formel avec un commandement central.
Les anti-balaka ont vite fait preuve d’un parti pris anti-musulman, assimilant tous les musulmans à des partisans de la Séléka. En août 2013, les anti-balaka ont commencé à mener des attaques contre la Séléka dans le centre du pays, ciblant les combattants de la Séléka et les civils musulmans, y compris les femmes, les enfants et les personnes âgées.[10]
En septembre 2013, le président par intérim Michel Djotodia, qui avait suspendu la constitution et s’était installé au pouvoir, a annoncé que le gouvernement avait dissous la Séléka, mais ses combattants continuaient à opérer dans le pays, les civils étant les plus durement touchés par les violences.
La Séléka s’est scindée en 2014, se divisant finalement en plusieurs groupes dont l’Union pour la Paix en Centrafrique (UPC), le Front Populaire pour la Renaissance de la Centrafrique (FPRC) et le Mouvement Patriotique pour la Centrafrique (MPC).
Au cours des années 2013 et 2014, la Séléka et les anti-balaka se sont livrés à des attaques de représailles, les deux camps prenant parfois pour cible des civils sur la base de critères religieux.[11] Au début de l’année 2014, en raison des attaques des anti-balaka, ainsi que de la pression des forces de maintien de la paix internationales présentes dans le pays (voir ci-dessous), la Séléka a renforcé ses opérations dans le centre et l’est du pays, où elle a établi des bastions et a poursuivi ses abus contre les communautés locales.
Les forces anti-balaka ont aussi commis des abus graves, notamment des massacres, à l’encontre de musulmans fuyant le sud-ouest.[12] Elles ont continué à menacer les musulmans vivant dans des enclaves protégées par l’ONU dans l’ouest tout en affrontant la Séléka dans le centre du pays.
De plus, les Peuls (ou Fulanis), un peuple musulman nomade ou semi-nomade, se sont rapprochés de la Séléka et ont parfois combattu avec les forces de la Séléka. Les anti-balaka ont pris pour cible les civils peuls en raison de cette alliance ou de leur appartenance religieuse.[13] Certains Peuls ont rejoint la Séléka et ont commis des abus, y compris le meurtre délibéré de civils et les incendies de villages.[14]
Michel Djotodia a démissionné de la présidence par intérim le 14 janvier 2014, mais les combats intenses se sont poursuivis. Les différents efforts en faveur d’accords de paix nationaux et internationaux, dont trois accords de paix majeurs en 2014 et 2015, n’ont pas permis de mettre un terme aux combats.[15]
Un gouvernement de transition a été formé en janvier 2014, dirigé par l’ancienne maire de Bangui, Catherine Samba-Panza, avec pour but principal de préparer le terrain pour des élections. Des élections présidentielles et parlementaires ont finalement eu lieu au début de l’année 2016 et Faustin-Archange Touadéra, qui a occupé la fonction de Premier ministre de 2008 à 2013, a été élu président.[16] Le transfert de pouvoir pacifique a apporté un espoir de paix, mais les causes sous-jacentes du conflit – un vide sécuritaire, l’impunité des auteurs d’abus, l’échec des efforts de désarmement et de réintégration et le manque de réconciliation véritable entre les factions belligérantes – n’ont pas été résolues. La lutte pour le contrôle des ressources a exacerbé la crise.
Huit responsables anti-balaka ont fait campagne pour obtenir des sièges au parlement lors des élections de janvier 2016. Trois ont été élus, y compris Alfred Yékatom, alias « Rombhot », un leader anti-balaka qui a été identifié comme étant responsable d’abus, dont des violences sexuelles, contre des civils et qui est un des commandants figurant sur la liste des sanctions des Nations Unies.[17]
En 2016, les groupes armés ont continué à perpétrer des violences, y compris à l’encontre des civils, notamment dans les régions centrales d’Ouaka, de Mboumou et de Haute-Kotto.[18] Les factions de la Séléka ont tenté de se réunifier en août 2016, mais l’alliance a été de courte durée.[19] Les combats entre factions de la Séléka en novembre 2016 se sont intensifiés alors que certaines factions de la Séléka se sont alliées avec des forces anti-balaka dans la province d’Ouaka en décembre 2016.[20] En 2017, les combats se sont étendus vers le sud-est jusqu’aux provinces de Haute-Kotto et Mbomou, y compris dans les villes principales de Bria, Bangassou et Zemio.
Le 19 juin 2017, le gouvernement et 13 des 14 groupes armés actifs ont signé un accord de paix sous la médiation de la Communauté de Sant’Egidio à Rome – une association proche du Vatican qui encourage le dialogue interreligieux – qui comporte un cessez-le-feu et une représentation politique pour les groupes armés. L’accord reconnaît le travail de la Cour pénale spéciale et de la Cour pénale internationale et prévoit une commission de vérité et de réconciliation.[21] Le lendemain de la signature de l’accord, près de 100 personnes auraient été tuées à Bria dans des affrontements entre des combattants anti-balaka et le FPRC.[22]
Les forces de maintien de la paix des Nations Unies ont eu du mal à protéger les civils.[23] Les combats entre différents groupes de la Séléka et les anti-balaka constituent toujours une menace sérieuse pour les civils dans le centre du pays. La Séléka opère dans le centre et l’est, entraînant de fait une partition du pays. L'UPC était basée à Bambari, dans la province de Ouaka, jusqu'au début de l'année 2017, quand la MINUSCA a exigé qu'ils quittent la ville pour éviter d'autres effusions de sang. Le groupe a ensuite établi une base à Alindao, dans la province de Basse-Kotto, d'où ils ont continué leurs attaques contre les civils de la région. Les combattants de l'UPC et les musulmans de la région ont tué au moins 136 civils lors d’une attaque qui a duré deux jours dans les quartiers de Paris-Congo et de Banguiville à Alindao, en mai 2017, après que des personnes y eurent signalé la présence de combattants anti-balaka dans les environs. Au moins 32 civils ont été tués par l'UPC en août alors qu'ils tentaient de quitter le camp de déplacés de la ville pour aller chercher de la nourriture et du bois de chauffage.[24]
Les besoins humanitaires sont dramatiques avec, selon les estimations, 50 pour cent de la population qui dépend de l’aide humanitaire et près de 2 millions de personnes confrontées à une insécurité alimentaire extrême.[25] Une recrudescence des violences entre janvier et juillet a conduit à la révision du Plan de réponse humanitaire pour 2017. Au moment de la rédaction du présent rapport, moins de 24 pour cent de l’appel humanitaire de 497 millions de dollars US pour 2017 avaient été financés. Le nombre de personnes déplacées internes a augmenté pour atteindre environ 600 000 personnes du fait des violences accrues et quelque 2,4 millions de personnes – près de la moitié de la population – dépendent de l’aide humanitaire pour survivre. En même temps, plus de 200 attaques contre les travailleurs humanitaires au cours du premier semestre 2017 ont fait de la RCA un des pays les plus dangereux pour les opérations des acteurs humanitaires et ont entravé la fourniture d’une assistance vitale.[26] Des femmes et des filles ont parlé à Human Rights Watch des violences sexuelles qu’elles ont subies alors qu’elles cherchaient des ressources ou du travail, affirmant qu’elles n’avaient pas d’autre choix que de se risquer dehors pour nourrir leurs familles.
Intervention internationale
À la fin de l’année 2013, l’Union africaine (UA), qui participe aux forces de maintien de la paix dans le pays depuis 2002, a autorisé une mission de maintien de la paix renforcée, appelée Mission internationale de soutien à la République centrafricaine, MISCA. Peu après, la France a ajouté des miltaires à ses forces limitées basées à Bangui pour aider l’UA à rétablir l’ordre.[27]
Les violences se sont poursuivies malgré les militaires de l’UA et de la France et en avril 2014, le Conseil de sécurité des Nations Unies a autorisé une nouvelle mission de maintien de la paix appelée Mission multidimensionnelle intégrée de stabilisation en République centrafricaine, désignée par son acronyme français, MINUSCA. La mission avait un mandat à plusieurs volets : protection des civils ; facilitation de l’accès humanitaire ; surveillance, enquête et établissement de rapports sur les atteintes aux droits humains et soutien de la transition politique.[28] La MINUSCA a pris le relais derrière la MISCA le 15 septembre 2014, avec un effectif de 11 820 militaires. Les troupes françaises sont restées dans le pays jusqu’en octobre 2016.
La résolution du Conseil de sécurité de l’ONU qui a instauré la MINUSCA accorde la priorité à la protection des civils face au « risque d’atteinte à l’intégrité physique », y compris les violences sexuelles.[29] Dans le cadre de son mandat en matière de droits humains, la MINUSCA a la tâche de surveiller, de mener des enquêtes et d’établir des rapports sur toutes les formes de violences sexuelles dans le conflit, d’éviter ces abus et de contribuer à identifier les auteurs et à les traduire en justice.[30] La MINUSCA est autorisée à utiliser tous les moyens nécessaires pour exécuter ses mandats dans ses zones de déploiement.[31]
La résolution appelle toutes les parties au conflit, y compris la Séléka et les anti-balaka, à « interdire expressément toute violence sexuelle et sexiste ».[32] Elle invite les autorités à garantir une enquête dans les meilleurs délais sur les abus et à « permettre aux victimes de violences sexuelles d’accéder immédiatement aux services disponibles ».[33]
En décembre 2013, le Conseil de sécurité a créé un Groupe d’experts pour suivre l’évolution de la situation en République centrafricaine, surveiller la mise en œuvre des sanctions et identifier les cibles potentielles pour des sanctions.[34] En janvier 2017, le Conseil de sécurité a révisé les critères de désignation pour inclure l’implication dans la planification, la direction ou la réalisation de violences sexuelles comme critère spécifique pour les sanctions.[35] Au moment de la rédaction du présent rapport, aucun individu ou aucune entité n’a été sanctionné pour avoir planifié, ordonné ou commis des violences sexuelles pendant la guerre civile en République centrafricaine.[36]
En mai 2017, la MINUSCA comptait 9 885 militaires et 1 806 policiers déployés dans le pays.[37]
Absence de responsabilisation
Le gouvernement du président Touadéra a hérité d’un système judiciaire national défaillant, manquant de capacité pour mener des enquêtes et des poursuites sur les crimes graves, encore moins sur les crimes de guerre et les crimes contre l’humanité commis par les groupes armés.[38] Les efforts pour reconstruire le système judiciaire ont été extrêmement lents, entravés par l’insécurité permanente – y compris dans les zones où les groupes armés gardent le contrôle – le manque d’infrastructures et de fournitures, ainsi que la capacité et la formation limitées des policiers et des fonctionnaires judiciaires. Le pays compte 198 magistrats – dont bon nombre n’ont pas repris leurs fonctions depuis la chute du gouvernement Bozizé – et 80 avocats, basés pour la plupart à Bangui.[39] Bien souvent, la police judiciaire ne mène pas d’enquêtes sur les affaires pénales.[40] Le système de détention est totalement désorganisé : alors qu’il y avait 28 centres de détention à l’échelle nationale au moment de la rédaction de ce rapport, seuls six étaient encore en fonctionnement, dont deux se situent dans la capitale.[41] Des évasions massives ont eu lieu dans plusieurs des prisons restantes.[42]
L’impunité historique pour les violences sexuelles jette une ombre sur le système judiciaire. Dans leur examen de mai 2017 des violations des droits humains dans le pays entre 2003 et 2015, les Nations Unies décrivent la République centrafricaine touchée par le conflit comme « un environnement dans lequel les auteurs de violences sexuelles bénéficient d’une impunité totale du fait du dysfonctionnement ou de l’effondrement des institutions, situation qui perdure à ce jour ».[43] Pour accélérer le traitement de certaines affaires pénales, en 1998, le procureur général a ordonné une reclassification des infractions pénales – dont le viol – pour qu’elles soient jugées devant des tribunaux civils, où les sanctions sont moins sévères que dans les tribunaux pénaux.[44] Cette ordonnance est restée en place jusqu’en mars 2016, date à laquelle le ministre de la Justice a ordonné aux juges et aux fonctionnaires des tribunaux de cesser cette pratique pour les affaires de violences sexuelles, notant avec inquiétude des taux élevés de crimes et le manque de responsabilisation.[45]
Les procédures pénales devraient avoir lieu pendant des sessions criminelles spéciales tenues deux fois par an dans une Cour d’appel sur quatre dans tout le pays.[46] Cependant, aucun procès pénal n’a eu lieu entre 2009 et 2014. Avec le soutien de la MINUSCA et du Programme des Nations Unies pour le Développement (PNUD), des sessions de la cour criminelle ont jugé des affaires pénales à Bangui en juin 2015 et en août et septembre 2016.[47] Seules trois affaires de viol – aucun perpétré par des membres de groupes armés – ont été jugées pendant les sessions criminelles de 2016.[48]
La Cour pénale internationale (CPI) a lancé une enquête sur les graves crimes commis pendant le conflit en République centrafricaine depuis 2012. Au moment de la rédaction du présent rapport, l’enquête était en cours et aucune charge n’avait été prononcée. L’enquête de la CPI offre la chance d’apporter une certaine mesure de responsabilisation pour les crimes, mais la CPI ne jugera probablement qu’un petit nombre de cas.
Une loi de 2015 établissant une Cour pénale spéciale (CPS), un tribunal national et international hybride intégré dans le système judiciaire national, apporte aussi un espoir de responsabilisation pour les crimes graves commis pendant le conflit actuel.[49] Alors qu’un procureur spécial a été nommé à la CPS en février 2017 et que des juges nationaux et internationaux ont été nommés dans les mois suivants, le tribunal est lent à devenir opérationnel ; de plus, seule la première année de la mission de cinq ans de la Cour avait été financée au moment de la rédaction de ce rapport.[50]
Violences sexuelles dans le conflit
Depuis le début du conflit en décembre 2012, la Représentante spéciale du secrétaire général des Nations Unies chargée de la question des violences sexuelles en conflit a noté des « rapports réguliers » de violences sexuelles, notamment dans les zones où les groupes armés étaient présents ou qu’ils contrôlaient.[51] Dans les rapports annuels sur les violences sexuelles en période de conflit de 2013 à 2017, le Secrétaire général de l’ONU a mis en évidence l’utilisation des violences sexuelles par les groupes armés pour terroriser et punir les civils en République centrafricaine, en indiquant que « des femmes et des filles ont été systématiquement prises pour cibles ».[52] Dans son rapport de 2016 sur les enfants et le conflit armé, il a constaté des violences sexuelles à l’encontre des filles par les groupes armés, y compris de l’esclavage sexuel, et l’impunité pour les auteurs.[53] Le rapport de 2017 a fait état d’un « recours systématique à la violence sexuelle pour des raisons ethniques ou idéologiques » en République centrafricaine, avec des incidents perpétrés par les forces de la Séléka et anti-balaka, parfois « dans le but d’humilier ou de punir la population visée ».[54]
Une Commission d’enquête internationale, chargée par le Conseil de sécurité de l’ONU en décembre 2013 de mener des enquêtes sur les violations des droits humains et du droit international humanitaire dans le conflit, a rapporté des preuves de viols, de viols collectifs et d’autres formes de violences sexuelles commis par les combattants de la Séléka et anti-balaka entre le 1er janvier 2013 et le 1er novembre 2014.[55] « La nature généralisée de ces formes de violence est incontestable », a indiqué la Commission.[56]En juillet 2017, le Groupe d’experts sur la République centrafricaine a affirmé la nature permanente du problème, précisant que les violences sexuelles et basées sur le genre constituent un « phénomène pourtant récurrent et largement répandu dans tout le pays ».[57]
Dans son rapport de 2014 sur la République centrafricaine, le comité de l’ONU qui surveille la mise en œuvre de la Convention sur l’élimination de toutes les formes de discrimination à l’égard des femmes (Comité CEDAW) a souligné l’incapacité de longue date du gouvernement à garantir la non-discrimination et à lutter contre les violences basées sur le genre comme facteurs contribuant aux violences sexuelles liées aux conflits.[58]
L’absence de collecte systématique de données a gêné les tentatives pour évaluer l’ampleur du problème. Le Fonds des Nations Unies pour la population (UNFPA), qui dirige le groupe de coordination humanitaire sur les violences basées sur le genre (le Sous-Cluster VBG) et le système de gestion des informations sur les VBG, a enregistré 11 110 cas de violences sexuelles et basées sur le genre entre janvier et décembre 2016, dont 2 313 constituaient des violences sexuelles. Des éléments armés non étatiques ont commis environ 12,5 pour cent des incidents totaux, mais les informations ne sont pas ventilées pour montrer le nombre de cas de violences sexuelles (par rapport aux autres violences basées sur le genre) perpétrées par des hommes armés.[59] Le rapport annuel de 2017 du Secrétaire général de l’ONU sur les violences sexuelles liées aux conflits indique que la MINUSCA a consigné 179 cas en 2016 commis par divers groupes armés.[60] Le Groupe d’experts a rapporté avoir reçu des informations sur 59 cas de viol dans tout le pays entre janvier et juillet 2017, mais a noté un manque de signalement persistant des violences sexuelles.[61]
Les divergences de données découlent de plusieurs facteurs, notamment l’absence de cohérence dans les définitions de « violences sexuelles liées aux conflits », la différence des méthodes de collecte et de vérification des informations et les capacités variables entre les agences de l’ONU et les organisations non gouvernementales. Dans son rapport de juillet 2016, l’experte indépendante de l’ONU sur la République centrafricaine a constaté que ces incohérences révèlent une nécessité d’accroître l’attention accordée par les autorités nationales et la communauté internationale aux violences sexuelles et basées sur le genre. Elle a exprimé ses inquiétudes sur le fait que le manque de données fiables pourrait nuire aux efforts réalisés pour fournir des services aux victimes et pour lutter contre l’impunité.[62]
Avant le Forum de Bangui sur la réconciliation, la reconstruction et la paix durable en mai 2015 – destiné à lancer des initiatives de réconciliation, de désarmement et de réaffirmation du contrôle de l’État – plus de 200 dirigeantes venues de tout le pays ont participé à une consultation organisée par le gouvernement de transition. Ces femmes ont identifié les violences sexuelles liées aux conflits comme une priorité absolue et ont appelé à la fin de l’impunité pour les auteurs ainsi qu’à un meilleur accès à la justice et aux services pour les victimes.[63] Leur première recommandation était que toutes les parties au conflit respectent les accords de paix antérieurs, afin de « mettre fin aux violations des droits humains contre la population civile, et en partiiculier aux violences sexuelles ».[64]
II. Violences sexuelles envers les femmes et les filles perpétrées par des groupes armés
Les combattants de la Séléka comme les anti-balaka ont commis des violences sexuelles généralisées dans le conflit continu qui frappe la République centrafricaine, Human Right Watch ayant documenté des cas survenus récemment, en date de mai 2017. Des femmes et des filles ont décrit à Human Rights Watch des cas d’esclavage sexuel et de viol, en général par plusieurs agresseurs, accompagnés de violences physiques et d’actes d’humiliation. Les agresseurs ont frappé les femmes et les filles, les ont attachées, les ont brûlées et les ont violées avec des objets. Lorsque des combattants anti-balaka ou de la Séléka détenaient des femmes en tant qu’esclaves sexuelles, les victimes ont indiqué que les combattants les violaient généralement de manière répétée pendant des jours ou des mois d’affilée. Les combattants ont aussi forcé des femmes et des filles à effectuer des travaux domestiques et les ont parfois considérées comme étant leurs « épouses ».
Des victimes ont raconté que les combattants ont quelquefois obligé leurs maris à regarder les viols ou que leurs enfants ont été témoins des violences. Dans certains cas, les victimes ont vu les groupes armés torturer, tuer et mutiler leurs maris ou des membres de leur famille avant ou après les violences sexuelles. Dans un cas, une victime a déclaré que les combattants ont violé son mari, l’obligeant à regarder, avant de le tuer et de la violer à son tour. Plusieurs femmes et filles ont indiqué que les combattants les ont violées alors qu’elles étaient enceintes.
Les femmes et les filles ont fréquemment rapporté que les groupes armés utilisaient les violences sexuelles comme châtiment, le plus souvent en raison d’une affiliation supposée à une faction rivale. Les auteurs des violences ciblaient souvent des femmes et des filles sur la base de leur appartenance religieuse présumée – servant de motif pour supposer un soutien aux combattants ennemis – ainsi qu’en raison d’échanges commerciaux privilégiant présumément un camp religieux ou d’allégeances prétendues de leurs maris ou de membres de leur famille.[65]
Human Rights Watch a documenté plusieurs groupements d’incidents de violences sexuelles liés à des attaques ou des périodes de violence spécifiques, ainsi que des cas isolés dans différents lieux ou lors de périodes distinctes. L’annexe à la fin de ce rapport indique le lieu, la date et le groupe armé auquel étaient affiliés les auteurs des violences sexuelles pour chaque cas documenté. Comme mentionné plus haut, étant donné le peu de signalement des violences sexuelles et l’accès limité à certaines régions, les cas documentés ici n’ont en aucune façon la prétention de former un compte rendu exhaustif de tous les incidents dans le pays, et ils ne reflètent très certainement qu’une fraction de ces agressions.[66] Les Nations Unies, par exemple, ont consigné près de 2 500 cas de violences sexuelles sur l’année 2014 seulement.[67]
Esclavage sexuel et travail forcé
Depuis le début de l’année 2013, les forces de la Séléka et anti-balaka ont violé des femmes et des filles – souvent par des viols répétés et impliquant plusieurs agresseurs –, les ont détenues captives, les ont privées de liberté et les ont forcées à faire des travaux domestiques. Selon le droit international, ces infractions constituent de l’esclavage sexuel et peuvent être considérées comme des crimes contre l’humanité et des crimes de guerre.[68] Conformément au Statut de Rome de la Cour pénale internationale, l’esclavage sexuel se produit lorsqu’un auteur commet au moins un acte de violences sexuelles et exerce un pouvoir de « propriété » ou un contrôle sur la victime par le biais de la vente, l’échange ou la privation de liberté.[69] La Rapporteuse spéciale de l’ONU sur les formes contemporaines d’esclavage a noté que, en vertu de la Convention relative à l’esclavage de 1926, le droit de propriété dans l’« esclavage » peut être exercé sur « le plan sexuel par le viol ou d’autres formes de violence sexuelle ».[70]
Human Rights Watch a interrogé 44 femmes et filles victimes d’esclavage sexuel, qui ont indiqué avoir été captives avec un total d’au moins 167 autres femmes et filles qui ont aussi fait l’objet d’esclavage sexuel. Dans deux cas, des groupes armés ont détenu des femmes et des filles pendant plus d’un an. Trente-cinq femmes et filles sur les 44 interrogées ont déclaré que plusieurs hommes les ont violées de manière répétée, parfois chaque jour. Au moins neuf victimes sont tombées enceintes pendant la période où elles ont été détenues comme esclaves sexuelles, y compris des filles âgées de 14 ans et d’environ 16 ans à l’époque, et au moins cinq ont donné naissance à des enfants suite à ces viols.[71]
Human Rights Watch a documenté des abus physiques et psychologiques chez les femmes et les filles prisonnières des combattants de la Séléka et anti-balaka, qui peuvent être assimilés à de la torture.[72] Ceci incluait des coups de fouet, le maintien des femmes et des filles attachées pendant de longues périodes, des brûlures faites avec du plastique chaud et des menaces de mort.
Esclavage sexuel par la Séléka
Human Rights Watch a interrogé au moins 18 victimes d’esclavage sexuel qui ont été capturées par les combattants de la Séléka entre la fin de l’année 2013 et le milieu de l’année 2017.[73] Quatorze incidents ont eu lieu dans et autour de Bambari, y compris huit cas pendant ou juste après une attaque sur la ville en juin 2014 (voir « Esclavage sexuel par des combattants de la Séléka à Bambari »).[74] Trois des victimes ont donné naissance à des bébés conçus alors qu’elles étaient détenues comme esclaves sexuelles.
Human Rights Watch a aussi consigné la détention par les forces de la Séléka d’une femme comme esclave sexuelle à Bangui, d’une autre près de Baoro, une autre près de Bossangoa et une autre à Kaga-Bandoro.
Les femmes et les filles soumises à l’esclavage sexuel ont décrit des violences sexuelles récurrentes et du travail forcé. Victoire, 39 ans, a indiqué à Human Rights Watch que des combattants de la Séléka l’ont conduite avec quatre autres femmes dans un camp à Bambari au milieu de l’année 2014. Elle a dit que, pendant le mois qu’elle y a passé, plusieurs combattants ont violé les femmes et le commandant des combattants l’a prise elle comme son « épouse » :
Ils [les Séléka] étaient nombreux. Chacun nous prenait à tour de rôle. Chacun nous violait chaque jour, l’un après l’autre... Le chef est venu, m’a vue, m’a prise et mise sur le côté. Après cela, il m’a violée tous les jours. Quand il ne sortait pas [du camp], il voulait faire ça trois fois par jour... [Quand] ils exigeaient des rapports sexuels d’une femme, si elle refusait, ils la frappaient, ils la battaient.[75]
Sophie, 22 ans, a raconté que deux groupes différents de combattants de la Séléka l’ont détenue comme esclave sexuelle lors d’incidents distincts. Après que la Séléka a brûlé la maison de sa famille à Bambari vers le mois de juin 2014, Sophie s’est enfuie dans la brousse avec quatre autres jeunes femmes. Elle a décrit comment les combattants de la Séléka les ont attrapées et gardées captives dans la forêt :
Ils nous donnaient du travail à faire. Parfois préparer les repas, faire la lessive. Parfois, lorsqu’on préparait les repas, ils venaient et trois d’entre eux nous violaient. Ils faisaient ça trois ou quatre fois par jour, plusieurs hommes – des hommes différents... Les cinq filles ont été violées comme ça.[76]
Les jeunes femmes se sont échappées au bout d’une semaine, mais deux mois plus tard dans un village, un autre groupe de la Séléka les a capturées. « Quatre d’entre eux m’ont attrapée et m’ont jetée au sol. Ils ont commencé à me violer à tour de rôle », a décrit Sophie. Elle a dit avoir vu les hommes de la Séléka enfoncer des morceaux de bois dans le vagin de deux jeunes femmes qui refusaient de coucher avec eux, ce qui a entraîné leur mort. Pendant trois jours, a-t-elle raconté, les combattants de la Séléka les ont violées à plusieurs reprises, elle et les autres femmes survivantes, et les ont forcées à préparer des repas et à puiser de l’eau. Elle a indiqué qu’au moins 12 combattants l’ont violée pendant cette période.[77]
Certaines femmes ont raconté à Human Rights Watch que les combattants de la Séléka s’en prenaient à elles en raison de leur religion. Denise, 20 ans, a expliqué que des combattants de la Séléka l’ont capturée en décembre 2014, alors qu’elle était allée acheter des légumes dans le quartier de Boeing à Bangui. Les hommes de la Séléka ont dit : « Tu es une femme de balaka » et ils l’ont insultée parce qu’elle était musulmane. Quatre combattants l’ont violée et l’ont attachée à un arbre, a-t-elle décrit, avant de la conduire à une enceinte dans le quartier de Ramandji où ils l’ont enfermée pendant deux jours avec 10 autres femmes qu’ils avaient capturées à Boeing et violées.[78]
La Séléka ciblait aussi des femmes et des filles en raison du soutien supposé de leurs familles aux anti-balaka. Noëlle, 25 ans, a raconté que des combattants de la Séléka ont trouvé sa famille travaillant dans ses champs à environ 25 kilomètres de Baoro sur la route de Baoro à Bangui en décembre 2013, et ont accusé son frère, qui vendait des balles, de fournir des munitions aux forces anti-balaka. « Ils nous ont attachées ma belle-sœur et moi », a-t-elle expliqué. « Ils ont commencé à nous torturer avec la crosse de leurs fusils. Ils nous ont frappées à la tête et nous ont piétinées... Les cinq qui nous ont attrapées ont commencé à me violer, tous les cinq. »[79]
Esclavage sexuel par la Séléka à Bambari
Depuis juin 2014, les multiples attaques dans et autour de Bambari, la capitale de la province d’Ouaka, ont conduit à un déplacement massif de civils et ont fait des blessés et des morts. Aux mois de juin et juillet 2014, forces rivales issues de la Séléka se partageaient le contrôle de Bambari. Ces forces allaient devenir le RPRC (Rassemblement Patriotique pour le Renouveau de Centrafrique), dirigé par le général Joseph Zoundeko, qui occupait le poste de commandant militaire de la Séléka alors unifiée en mai 2014, et l’UPC (Union pour la Paix en Centrafrique), que le général Ali Darassa Mahamant a créée en septembre 2014, se désignant lui-même comme président et général commandant.[80] L’UPC conserve le contrôle de parties de la province d’Ouaka. Les forces de l’UPC de Darassa ont, à plusieurs reprises, ciblé des civils qu’elles pensaient être alliés ou affiliés aux anti-balaka.[81]
Le 9 juin 2014, des combattants de la Séléka et de l’ethnie peule ont attaqué Liwa, un village essentiellement chrétien situé à 10 kilomètres au sud de Bambari. Des témoins et des membres des familles des victimes ont raconté à Human Rights Watch que les combattants ont tiré sur les habitants et les ont frappés à mort alors qu’ils tentaient de s’enfuir. Les 169 maisons du village ont été détruites.[82]
L’assaut contre Liwa a déclenché un cycle d’attaques de représailles dans les communautés voisines, atteignant leur paroxysme avec les attaques de la Séléka contre des quartiers chrétiens à Bambari à la fin du mois de juin 2014 qui ont fait au moins 32 morts.[83] Le 7 juillet 2014, les combattants de la Séléka ont attaqué la paroisse Saint-Joseph à Bambari, dans laquelle des milliers de personnes déplacées avaient trouvé refuge, faisant au moins 27 morts.[84]
Human Rights Watch a documenté 14 cas dans lesquels des combattants de la Séléka ont détenu des femmes comme esclaves sexuelles dans et autour de Bambari entre la fin de l’année 2013 et la fin de l’année 2015. Sept victimes ont indiqué à Human Rights Watch que des membres de la Séléka les ont capturées dans le quartier de Kidigra à Bambari pendant les attaques fin juin et début juillet 2014, et l’une d’elles a affirmé avoir été détenue par la Séléka dans ce quartier.
La Séléka a détenu les femmes, alors âgées d’environ 20 à 73 ans, pendant des périodes allant de trois jours à plus d’un an. Les victimes ont expliqué qu’au moins 89 autres femmes et filles détenues avec elles ont aussi enduré des violences sexuelles et des travaux forcés. Toutes les femmes ont été violées par plusieurs hommes, souvent de manière répétée sur plusieurs jours. Deux victimes ont décrit comment des groupes de combattants les ont violées alors qu’ils circulaient entre les bases où les femmes étaient détenues. L’une d’elles a indiqué à Human Rights Watch que lors de son premier jour de captivité, environ 15 hommes les ont violées elle et quatre autres femmes.[85]
Jeanne, 30 ans, a raconté qu’un groupe de 20 combattants de la Séléka les ont capturées elle et neuf autres femmes et filles – certaines ayant à peine 16 ans – alors qu’elles s’enfuyaient quand le quartier de Kidigra a été attaqué en juin 2014. Elle a expliqué que la Séléka l’a détenue dans une base pendant six mois :
Le premier jour, cinq Séléka m’ont violée. Nous n’avions jamais de répit – chaque jour, il y avait des viols, par des combattants différents... Nous sommes devenues leurs épouses. Chaque combattant qui arrivait à la base, c’était pour nous violer. Si nous refusions, ils nous frappaient... J’allais chercher du bois pour le feu. Je puisais de l’eau, j’allais chercher de l’eau à la rivière, je préparais les repas. Toutes les femmes faisaient ça. Toutes les femmes étaient violées chaque nuit.[86]
Cinq des femmes et des filles sont tombées enceintes, mais n’avaient pas les moyens de mettre un terme à ces grossesses, a poursuivi Jeanne. « Dans la brousse, que pouvaient-elles faire ? » a demandé Jeanne. « Elles ont dû poursuivre leur grossesse. Les Séléka n’ont pas réagi. Ils continuaient à violer les femmes enceintes. »[87]
D’autres victimes ont aussi constaté que la grossesse ne les protégeait pas des violences sexuelles. Angèle, 27 ans, est tombée enceinte et a donné naissance à un enfant du fait des viols répétés après que les combattants de la Séléka l’ont attrapée près de Bambari en juin 2014 et l’ont maintenue en esclavage sexuel pendant neuf mois avec cinq autres femmes et filles. Elle a déclaré que les hommes de la Séléka « nous considéraient comme leurs épouses ».
[À la base], nous préparions les repas. Si les repas n’étaient pas assez bien préparés, ils nous frappaient avec la crosse de leurs fusils. Ils [nous frappaient aussi avec des] fouets qu’ils utilisaient pour les chevaux... Pendant la journée, ils nous [violaient] une fois. La nuit, un autre [combattant] nous appelait. Nous pensions que c’était pour préparer le thé, mais c’était pour nous violer.[88]
Angèle a décrit avoir été violée par voie vaginale et anale par les combattants de la Séléka, qui ont continué les viols pendant sa grossesse. « Ils disaient que nous étions leurs esclaves », s’est-elle souvenue.[89]
Dans certains cas, les victimes ont dit avoir vu les combattants de la Séléka tuer les membres de leurs familles. Christine, 63 ans, a raconté que les hommes de la Séléka ont tué son mari et l’ont soumise à des sévices sexuels et physiques en juin 2014 alors que le couple s’enfuyait du quartier Kidigra à Bambari :
Ceux qui m’ont violée, je n’en connais pas le nombre exactement. J’ai essayé de crier, mais ils m’ont fermé la bouche avec les mains et ont commencé à me violer l’un après l’autre. À un moment, j’ai dit que j’étais fatiguée, mais ils s’en fichaient. Ils ont commencé à me donner des coups de poing. Lorsqu’ils ont terminé de me violer, ils m’ont enlevé le tissu [qu’ils avaient utilisé pour me bander] les yeux. Ils m’ont montré le corps de mon mari. Ils lui avaient tranché la gorge.[90]
Christine a rapporté que les combattants de la Séléka l’ont détenue pendant cinq jours avec des jeunes filles dont elle ne connaissait pas l’âge.[91]
Les filles étaient aussi soumises à de l’esclavage sexuel. Martine, 32 ans, a indiqué que les combattants de la Séléka les ont capturées elle et environ 19 autres, y compris des filles, pendant l’attaque de la paroisse Saint-Joseph en juillet 2014 et les ont détenues dans la brousse près de Bambari pendant deux semaines. « Il y avait des jeunes filles [qui avaient] 12 ans », a-t-elle décrit. « Nous avons passé une semaine avec des cordes autour des pieds et des mains... Ils nous détachaient pour avoir des rapports sexuels. Ensuite, quand ils avaient fini, ils nous attachaient à nouveau... Quatre ou cinq hommes différents [nous violaient] chaque jour. »[92]
Henriette, 50 ans, a expliqué à Human Rights Watch qu’en juin 2014, près de 15 combattants de la Séléka ont fait irruption chez elle dans le quartier de Kidigra, l’ont violée et l’ont détenue captive avec sa fille de 6 ans. « Environ 10 d’entre eux m’ont violée », a-t-elle dit. « Dans la brousse, je suis devenue leur domestique, puisant l’eau. J’y étais avec ma plus jeune fille. Ils lui ont donné des petits bidons pour qu’elle puisse rapporter de l’eau. »[93]
Human Rights Watch a aussi consigné 22 cas de viol sans esclavage sexuel commis par des combattants de la Séléka et des combattants peuls de la Séléka dans et autour de Bambari entre décembre 2013 et décembre 2015 (voir « Viols commis par la Séléka à Liwa et à Bambari »). La Séléka et l’UPC, sous le commandement de Darassa qui était leur leader local, ont conservé le contrôle de grandes parties de la province d’Ouaka, y compris Bambari, depuis le début de la crise jusqu’à janvier 2017.
En juin 2014, le général Zoundeko a affirmé à Human Rights Watch qu’aucun combattant de la Séléka n’a participé aux combats à Liwa ou à Bambari.[94]
Lors d’une rencontre en septembre 2014 avec Human Rights Watch, Ali Darassa a nié que ses hommes aient été impliqués dans tout combat autour de Bambari en juin et en juillet 2014.[95] Alors que certaines informations indiquent que Darassa n’était pas à la tête de tous les Peuls armés à Bambari à la mi-2014, plusieurs témoins de l’attaque contre l’église Saint-Joseph ont raconté à Human Rights Watch qu’ils ont reconnu parmi les assaillants des hommes qu’ils pensaient être sous les ordres de Darassa.[96] En janvier 2016, Darassa a déclaré à Human Rights Watch que tous ses combattants sont conscients que certaines actions, y compris les violences sexuelles, sont des crimes au regard du droit international et qu’ils n’ont jamais commis de viols. Il a ajouté : « Nos combattants sont connus de tous. Nous n’avons jamais reçu aucune plainte [pour viol], donc on peut dire que les combattants respectent la loi. »[97]
Esclavage sexuel par les anti-balaka
Human Rights Watch a interrogé 26 femmes et filles qui ont été détenues comme esclaves sexuelles par les anti-balaka entre décembre 2013 et avril 2016, principalement à Bangui et à Boda. Comme celles qui ont enduré l’esclavage sexuel aux mains de la Séléka, les victimes ont décrit avoir subi des viols répétés, souvent par de multiples agresseurs, ainsi que des passages à tabac, des humiliations, et avoir servi d’« épouses » pour les combattants.[98]
Les anti-balaka ont détenu cinq femmes, dont des filles d’à peine 12 ans, en tant qu’esclaves sexuelles dans et autour de Boda, à environ 100 kilomètres à l’ouest de Bangui, où les anti-balaka avaient une base bien connue près de la mission catholique (voir « Viols commis par les anti-balaka dans et autour de Boda »). Human Rights Watch a aussi documenté des cas dans lesquels les anti-balaka ont détenu six femmes et filles en tant qu’esclaves sexuelles à Bangui, deux près de Yaloké, et une autre à Bambari, et ils ont capturé trois femmes sur la rivière Oubangui entre Mobaye et Bangui, une autre sur la route de Mbaïki et une autre sur la route de Bouar près de Baoro, qu’ils ont toutes détenues comme esclaves sexuelles.[99]
La durée de la captivité des victimes allait de quelques jours à bien plus d’un an. Amira, 16 ans, a raconté que les anti-balaka l’ont détenue près de Yaloké, dans la province d’Ombella-M’poko, pendant 18 mois à partir du mois de février 2014, avec deux autres femmes musulmanes qui ont souffert d’abus similaires, dont une était enceinte à l’époque.[100] Amira a décrit comment les anti-balaka l’ont frappée à coups de fouet et de machette, la soumettant à des viols collectifs répétés et l’obligeant à faire des travaux domestiques :
Ils m’ont violée. Quatre d’entre eux. Ils ont recommencé chaque nuit, toujours les quatre mêmes... Ils m’ont aussi fait mal physiquement. Toujours avec les fouets, ils m’ont frappée. Il y avait du travail forcé. Ils m’ont fait puiser de l’eau, préparer les repas, faire la vaisselle. Ils parlaient de moi comme de leur femme.[101]
Virginie, 16 ans, et Patricia, 22 ans, ont déclaré dans des entretiens séparés que les anti-balaka les ont enlevées séparément alors qu’elles vendaient des feuilles de manioc sur un marché de Bangui en avril 2016 et les ont conduites à une base proche. Virginie a raconté que les anti-balaka l’ont détenue là pendant cinq jours, pendant lesquels ils l’ont violée, l’ont frappée à coups de fouet et lui ont donné des coups de poing lorsqu’elle pleurait :
Ils pouvaient avoir des rapports sexuels cinq fois par jour si leur commandant n’était pas là. Les trois mêmes hommes [m’ont violée] pendant la nuit. Ils l’ont aussi fait alors que je dormais profondément – une fois chacun – et [ensuite] ils m’ont laissée. Ils ont fait ça les cinq jours.[102]
Patricia a décrit que deux combattants anti-balaka l’ont violée et l’ont frappée à la base pendant deux jours. Lorsqu’elle a tenté de s’enfuir, les anti-balaka l’ont attrapée, l’ont attachée et l’ont laissée là pendant la nuit.[103]
À l’instar des combattants de la Séléka, les membres des anti-balaka ciblaient des femmes en raison de leur appartenance religieuse présumée ou de celle de leurs proches. Leila a expliqué à Human Rights Watch que les anti-balaka l’ont capturée près de Baoro en avril 2016 parce que son mari est musulman. « Ils m’ont entaillé la poitrine, ont mis un couteau sur la gorge de mon bébé et ont dit qu’ils le tueraient parce que mon mari est musulman et que le bébé est musulman », a-t-elle raconté.[104] Leila a indiqué que les anti-balaka l’ont gardée en captivité pendant deux jours avec neuf autres femmes et filles, les violant à plusieurs reprises devant les autres.[105]
Rachida, 25 ans, a déclaré que des anti-balaka l’ont prise en otage alors qu’elle sortait du quartier PK5 musulman à Bangui pour vendre des légumes en août 2015. Elle a précisé qu’ils l’ont détenue pendant trois semaines dans l’église Saint-Denis dans le troisième arrondissement vers le quartier de Kattin, la violant de manière répétée et l’accusant de fraterniser avec les musulmans :
Chaque jour, quatre hommes venaient pour avoir des rapports sexuels avec moi le matin. Puis cinq hommes à 15 h 00 et encore à 19 h 00. Le matin, quatre hommes, l’après-midi et le soir, le commandant plus quatre hommes. Ils ont dit : « Tu ressembles à une fille chrétienne. Tu vends ton sexe aux musulmans. Aujourd’hui, tu vas voir. »[106]
Rachida a indiqué que les anti-balaka détenaient quatre autres jeunes femmes avec elle à l’église et qu’ils violaient chacune d’elle trois fois par jour. Elle a raconté que les hommes ont tué une des femmes. « Ils ont creusé une tombe et l’ont placée dedans, vivante », a-t-elle décrit.[107] Au moment de son entretien avec Human Rights Watch, Rachida était enceinte suite aux viols.
De nombreuses victimes ont indiqué que, comme la Séléka, les anti-balaka considéraient les femmes et filles en captivité comme leurs « épouses ». Caroline avait environ 17 ans lorsque 15 combattants anti-balaka l’ont conduite avec quatre autres à une base dans le village de Boboua, près de Boda sur la route menant à Mbaïki, à la fin de l’année 2013, où ils gardaient déjà plus de 10 jeunes filles, et ils les ont toutes violées. « Ils ont dit que nous avons tué leurs proches, et que donc ils se marieront avec nous et nous deviendrons leurs propres femmes », s’est souvenue Caroline.[108] Human Rights Watch s’est entretenu avec onze filles qui avaient entre 13 et 17 ans lorsque des combattants anti-balaka les ont détenues comme esclaves sexuelles ; elles ont indiqué qu’au moins 20 autres filles étaient retenues captives avec elles, certaines ayant à peine 12 ans.[109] Thérèse, 14 ans, a raconté que sa jeune sœur et elle revenaient à Boda au début de l’année 2014 après la récolte du manioc lorsque des combattants anti-balaka les ont capturées, les ont conduites à leur base et les ont détenues pendant deux jours avec huit filles plus âgées. Thérèse a décrit comment les anti-balaka les ont accusées de fournir de la nourriture aux musulmans et les ont violées :
J’avais 13 ans, ma sœur en avait 12. Ils nous ont emmenées ma sœur et moi, nous ont enlevé nos vêtements, nous ont jetées au sol et ont commencé à nous violer... Ils ont dit : « Nous souffrons à cause de vous, parce que vous prenez le manioc et le vendez à la communauté musulmane – vous êtes des traîtresses ». Il y avait quatre anti-balaka. Sur les quatre, trois nous ont violées.[110]
Dans certains cas, des combattants anti-balaka semblaient détenir des femmes à des fins de servitude domestique. Dans des entretiens séparés, Joséphine, 40 ans, et Annette, 27 ans, ont expliqué que les anti-balaka les ont capturées avec une autre femme en mars 2016, alors qu’elles rentraient à Bangui par la rivière depuis le marché de Mobaye. Les anti-balaka ont arrêté leur bateau, ont exigé un paiement et ont pris leurs marchandises avant d’obliger les femmes à marcher pendant plusieurs heures dans la brousse et de les détenir pendant quatre jours. Annette a expliqué que les anti-balaka ont abusé des femmes et les ont utilisées pour les travaux domestiques :
Les hommes ont dit : « Nous vous avons amenées ici pour que vous nous prépariez les repas parce qu’ici dans la brousse, nous n’avons personne pour faire ce travail pour nous ». Lorsque nous sommes arrivées, ils ont commencé à nous frapper. Ils ont pris une corde et m’ont attaché les genoux ensemble. Ensuite ils ont commencé à me lier les mains dans le dos. Je me suis mise à crier et ils m’ont frappée au visage avec la crosse d’un fusil. Le coup a fait tomber mes deux dents de devant. J’étais choquée après le coup et un homme a arraché mes vêtements. J’ai commencé à saigner beaucoup de la bouche... [Un des hommes] a retiré la corde de mes jambes, mais mes mains étaient toujours liées dans mon dos. Puis il m’a violée.[111]
Annette, qui n’avait plus ses deux dents de devant lorsqu’elle a parlé avec Human Rights Watch, a ajouté qu’elle a aussi vu trois des combattants remplir la bouche des autres femmes avec des chiffons et les violer. Les combattants anti-balaka ont forcé les deux femmes non blessées à faire des travaux domestiques et ont violé Joséphine à plusieurs reprises. « J’étais devenue leur femme », a indiqué Joséphine. « Ils ont dit de leur propre bouche qu’il y avait longtemps qu’ils n’avaient pas eu l’occasion de violer une femme. »[112]
Human Rights Watch a documenté des cas dans lesquels plusieurs victimes ont identifié trois leaders anti-balaka connus parmi les hommes qui ont commis les violences sexuelles ou commandaient les auteurs des violences sexuelles : Rodrique Ngaïbona, alias Andilo (voir « Esclavage sexuel par les anti-balaka sous le commandement de Rodrique Ngaïbona, alias Andilo ») ; Alfred Yékatom, alias Rombhot, et François Wote.
Esclavage sexuel par les anti-balaka sous le commandement de Rodrique Ngaïbona, alias Andilo
Dans des entretiens séparés, cinq victimes ont désigné Andilo, le surnom de Rodrique Ngaïbona, comme le combattant ou le commandant des combattants qui les ont violées. Les combattants sous les ordres d’Andilo ont participé aux contre-offensives anti-balaka en 2014, y compris des affrontements actifs avec la Séléka autour de la ville natale d’Andilo, Batangafo, dans la province d’Ouham et dans le quartier Boy-Rabe à Bangui. En 2014, le Groupe d’experts des Nations Unies l’a qualifié de « chef militaire le plus énigmatique, craint et puissant des anti-Balaka ».[113] Le procureur national a émis un mandat d’arrêt à son encontre en mai 2014. Après que les Casques bleus de la MINUSCA l’ont arrêté le 17 janvier 2015, à Bouca, à environ 315 kilomètres au nord de Bangui, les hommes d’Andilo ont entrepris une série de kidnappings de personnes en vue, pour exiger sa libération.[114]
Au moment de la rédaction du présent rapport, Andilo est enfermé dans le centre de détention de Camp de Roux à Bangui, un établissement pour les détenus considérés comme extrêmement dangereux. Il n’a pas été formellement inculpé ou jugé, bien que la durée limite de la détention provisoire prévue par la loi de la République centrafricaine ait été atteinte.[115]
Quatre victimes ont raconté à Human Rights Watch qu’elles voyageaient pour vendre des marchandises au milieu de l’année 2014 lorsque des anti-balaka ont arrêté leurs véhicules au nord de Bangui.[116] Trois des quatre femmes ont expliqué qu’elles ont vu et reconnu le leader du groupe en la personne d’Andilo ; l’une d’elles a déclaré qu’elle avait été prise comme « épouse » par Andilo.
Sabine, 43 ans, voyageait avec un groupe de personnes, dont son mari, lorsque des combattants anti-balaka ont arrêté leur véhicule. Elle a raconté qu’Andilo et les autres combattants – qui désignaient Andilo comme leur « chef » – ont traité les maris des femmes de « criminels musulmans » avant de trancher la gorge de son mari et de la ligoter.[117] Trois des anti-balaka l’ont violée et l’ont conduite à leur base, a indiqué Sabine, où Andilo l’a prise pour « épouse » et l’a soumise à de l’esclavage sexuel pendant près de sept mois. Elle a expliqué :
Il m’a dit que si je n’avais pas de rapports sexuels avec lui, il me tuerait. Il l’a fait tous les jours. S’il n’était pas fatigué, c’était plusieurs fois par jour. Si je disais que j’étais fatiguée, il me frappait. Lorsqu’il partait quelque part et qu’il passait trois ou quatre jours hors de la base, je pouvais me reposer. Mais lorsqu’il revenait, [le repos] était fini. Ça a été comme cela pendant six à sept mois... Je ne pouvais rien faire d’autre que céder.[118]
Les anti-balaka ont aussi arrêté Zara et Prudence, toutes deux âgées de 28 ans, en même temps que Sabine. Prudence a déclaré avoir vu Andilo donner des ordres aux autres combattants après qu’ils ont arrêté les véhicules. Zara a indiqué qu’environ 30 combattants anti-balaka ont tenu les femmes en joue avec leurs fusils et les ont accusées de soutenir la Séléka. « Ils nous ont dit : “Toutes les marchandises que vous achetez, c’est pour les revendre à la Séléka, et lorsqu’ils auront mangé, ils viendront en force et nous tueront tous avec nos familles », a raconté Zara.[119] Prudence s’est aussi souvenue de la façon dont les anti-balaka ont allégué que les femmes nourrissaient le camp adverse, en disant que : « C’est vous qui nourrissez la Séléka ».[120]
Les combattants anti-balaka ont accusé les femmes d’avoir caché de l’argent dans leurs parties génitales, ils les ont violées et les ont brutalisées, a poursuivi Zara. Elle a montré à Human Rights Watch des cicatrices au-dessus de sa poitrine où ils l’ont brûlée et entaillée. Elle a expliqué :
Ils ont dit : « Sortez l’argent qui se trouve dans vos vagins », ils ont commencé à entailler nos corps avec un couteau. [Ils m’ont coupé] à la poitrine, aux genoux... Deux m’ont violée, l’un après l’autre, par le vagin. L’un d’eux l’a fait deux fois. Quand un d’eux est parti, j’ai perdu connaissance. Ils ont pris de l’eau et me l’ont versée dessus pour me réveiller. Je ne sais pas ce qu’il s’est passé après ça. Quand je me suis réveillée, j’étais trempée et dans la boue... Je n’avais pas la force de me lever du sol. Mon corps était trempé du sang des entailles qu’ils m’ont faites.[121]
Zara a ajouté que les anti-balaka l’ont libérée au bout de deux jours, alors que Prudence a indiqué que les combattants l’ont gardée captive pendant six mois. Prudence a précisé que, pendant sa captivité, elle a vu Andilo aller et venir à la base, et que deux combattants sous ses ordres l’ont prise pour « épouse ».[122]
Noémie, 26 ans, qui a été capturée avec Zara, Prudence et Sabine en juillet 2014 et a été détenue comme esclave sexuelle pendant sept mois, a aussi indiqué qu’elle a vu Andilo à la base et qu’il commandait les combattants anti-balaka qui la détenaient avec environ 12 autres femmes. Elle a expliqué que deux combattants anti-balaka différents l’ont violée jusqu’à trois fois par jour, un d’eux l’ayant prise pour « épouse », et l’ont torturée. « Ils me frappaient avec un fouet servant pour les vaches », a-t-elle décrit. « Le colonel a tiré un coup de feu juste devant mon visage et m’a dit d’avouer que j’allais vendre des choses à la Séléka. »[123]
Noémie a indiqué qu’elle a tenté de s’échapper à un moment, mais les combattants anti-balaka l’ont attrapée, l’ont sévèrement battue et ont fondu du plastique sur elle.[124] Elle a montré des cicatrices à Human Rights Watch qui correspondaient à des brûlures. Noémie est tombée enceinte pendant sa captivité et les anti-balaka l’ont relâchée alors qu’elle était enceinte de cinq mois. Elle ne sait pas qui est le père de sa fille, âgée de 11 mois au moment de l’entretien, et a pleuré en disant : « Lorsque je regarde ce bébé, je pense aux violences qu’ils m’ont fait subir ».[125]
Une cinquième victime a aussi expliqué qu’un combattant anti-balaka sous le commandement d’Andilo l’a prise comme « épouse » et l’a violée de manière répétée vers octobre ou novembre 2015. Béatrice, 18 ans, a raconté que le combattant a tué certains de ses proches et lui a ensuite dit : « Je vais te prendre pour femme et si tu refuses, je te tuerai ».[126]
Le combattant a violé Béatrice quatre fois en 24 heures et lui a ordonné de venir avec lui dans sa ville natale. Lorsqu’il l’a laissée dans la maison, elle s’est échappée dans la brousse. Elle est tombée enceinte suite au viol et a voulu mettre fin à cette grossesse, mais elle ne savait pas comment avorter et n’avait pas eu accès à des soins médicaux lorsqu’elle a parlé avec Human Rights Watch.[127] L’agresseur de Béatrice a plus tard fait campagne sans succès pour être député parlementaire de Bouca aux élections nationales de janvier 2016.[128]
Dans un cas, une victime a indiqué à Human Rights Watch que les combattants anti-balaka ont fait d’elle une esclave sexuelle pour se venger de l’arrestation un peu plus tôt de leur commandant, Alfred Yékatom, alias Rombhot. Caporal-chef de l’armée nationale avant le conflit, Rombhot s’est auto-promu au rang de « colonel » lorsqu’il est devenu un des principaux dirigeants anti-balaka en 2013. Le 23 juin 2014, les troupes de l’opération Sangaris ont arrêté Rombhot, mais l’ont libéré peu de temps après. Le 20 août 2015, Rombhot a été inscrit sur la liste des sanctions du Conseil de sécurité des Nations Unies pour avoir compromis la paix et la sécurité nationales en « s’engageant ou apportant [son] soutien à des actes [...] qui menacent ou violent les accords de transition [...] ou alimentent les violences. ».[129]
Une victime d’esclavage sexuel a déclaré à Human Rights Watch qu’elle et cinq autres femmes et filles ont été détenues, violées de manière répétée et forcées à travailler pendant trois jours en avril 2016 par des hommes qui ont dit être sous le commandement de Rombhot. Alice a raconté que les combattants anti-balaka ont arrêté le véhicule dans lequel elle circulait avec son mari sur la route de Mbaïki à Bangui, près de Mbaïki, la ville natale de Rombhot, où il est connu pour commander une base. « Ils ont dit qu’ils étaient des combattants de Rombhot », a indiqué Alice. « Comme Rombhot a été arrêté, [les hommes] ont dit que s’ils voyaient des personnes sur la route, ils leur feraient du mal ».[130]
Alice a expliqué que les anti-balaka l’ont conduite à une base où elle a été détenue avec cinq autres femmes et filles, certaines ayant environ 15 ans. « Ils ont dit que si j’essayais de m’enfuir, ils me tueraient », a-t-elle raconté. « J’ai été violée pendant deux jours. Le deuxième jour, deux d’entre eux ont continué à me violer. Les deux l’ont fait à tour de rôle le matin et à tour de rôle le soir. »[131] Elle a ajouté que les combattants anti-balaka ont aussi frappé les femmes et les filles avec des ceintures et les ont forcées à laver les vêtements et à cuisiner jusqu’à ce qu’elles parviennent à s’enfuir au bout de trois jours.
En janvier 2016, Rombhot a remporté les sièges parlementaires représentant Mbaïki dans la province de Lobaye. Le Groupe d’experts des Nations Unies a cité des preuves montrant que Rombhot a « intimidé les électeurs et harcelé les autres candidats dans sa circonscription », mais les autorités nationales n’ont pas mis fin à sa candidature ni invalidé les résultats des élections, parce qu’aucun mandat national n’avait été émis pour son arrestation et qu’il n’avait été inculpé d’aucun crime.[132] Malgré le fait qu’il reste sur la liste des sanctions du Comité du Conseil de sécurité de l’ONU, Rombhot a conservé ses sièges au parlement. L’ajout des violences sexuelles comme critère de désignation pour les sanctions de l’ONU en janvier 2017 pourrait fournir une justification claire pour maintenir Rombhot sur la liste des sanctions, indépendamment du fait qu’il soit perçu comme jouant un rôle constructif sur le plan politique. L’introduction de procédures de vérification pour les personnes occupant une fonction officielle pourrait le forcer à renoncer à ses sièges parlementaires et pourrait empêcher ceux qui ont participé à des violences sexuelles liées aux conflits ou ont laissé commettre de telles violences par les hommes sous leur commandement d’occuper une fonction officielle.
En avril 2015, Human Rights Watch a documenté le cas de deux sœurs peules détenues comme esclaves sexuelles pendant 14 mois en 2014-2015 par des combattants anti-balaka sous le commandement de François Wote dans le village du sud-ouest de Pondo, près de Yaloké, dans la province d’Ombella-M’poko.[133] Pendant les recherches menées pour le présent rapport, Human Rights Watch a documenté deux cas supplémentaires dans lesquels des combattants anti-balaka ont détenu une fille de 16 ans et une femme de 27 ans séparément près de Yaloké.
Amira, jeune fille peule de 16 ans, a expliqué que des anti-balaka l’ont gardée captive pendant 18 mois à partir de février 2014 environ, mais elle ne les a pas identifiés spécifiquement comme étant des hommes de Wote. Amira a décrit comment les anti-balaka l’ont frappée à coups de fouet et de machette, la blessant au dos, l’ont soumise à des viols collectifs répétés et l’ont obligée à faire des travaux domestiques. « Ils m’ont violée. Quatre d’entre eux. [I]ls ont recommencé chaque nuit, toujours les quatre mêmes », a-t-elle raconté.[134] Lorsqu’ils l’ont libérée, a-t-elle poursuivi, elle a découvert qu’elle était enceinte suite aux viols répétés.
Amira a indiqué à Human Rights Watch que les anti-balaka détenaient deux autres femmes musulmanes dans la maison, dont une était enceinte. Elle a dit qu’ils ont sévèrement battu la femme enceinte et que la femme a confié que les anti-balaka l’avaient violée elle aussi.[135]
François Wote, commandant anti-balaka à Pondo, près de Yaloké, de 2014 à mai 2015, relevait directement de Guy Wabilo, le commandant de zone de la région de Gadzi. En mai 2015, Wabilo a déclaré à Human Rights Watch qu’il savait que Wote se livrait à de l’esclavage sexuel à Pondo. « Oui, elles [les Peules] étaient là pendant 14 mois et les femmes ont été violées par François Wote », a expliqué Wabilo.[136] Wabilo a aussi indiqué que Wote était sous les ordres de Patrice-Edouard Ngaïssona, l’un des quelques Centrafricains qui ont revendiqué la direction des anti-balaka.[137]
Viols
Dans le conflit actuel, les groupes armés de la Séléka et anti-balaka ont commis des viols pendant les attaques ciblées contre les quartiers et les villages et ont utilisé le viol pour punir et terroriser les femmes et les filles alors qu’elles effectuaient des tâches quotidiennes, comme se rendre au marché et chercher de la nourriture ou du bois de chauffage. D’autres violences contre les membres de leurs familles, y compris des meurtres et des mutilations, ont accompagné les viols que Human Rights Watch a documentés, et les auteurs ont souvent perpétré les viols devant les membres des familles des victimes.
Viols commis par la Séléka
La Séléka a commis des viols généralisés à Bangui, notamment en parallèle des attaques menées en avril 2013 et en décembre 2013 et à nouveau pendant une flambée de violence entre septembre et novembre 2015, ainsi que dans et autour des villes de Bambari et de Kaga-Bandoro. Les combattants de la Séléka ont souvent perpétré des viols pendant les recherches d’hommes et de garçons, et ont utilisé les violences sexuelles comme punition pour l’allégeance supposée aux anti-balaka.
Human Rights Watch a documenté 168 cas de viol par des combattants de la Séléka et affiliés à la Séléka qui ont eu lieu entre mars 2013 et mai 2017, la plupart impliquant de multiples agresseurs. Cela inclut : 72 cas de viol par les combattants de la Séléka à Bangui (22 cas pendant la prise de pouvoir par la Séléka en décembre 2013 et 10 cas pendant l’attaque d’avril 2013 contre le quartier de Boy-Rabe) ; 21 cas dans et autour de Kaga-Bandoro ; 19 dans et autour de Bambari ; 11 à Alindao ; 7 à Mbrès ; 3 à Botto ; 2 cas à Yaloké/Pondo ; 2 à Batangafo et 2 à Bossangoa.[138] Quatre autres victimes de viol ont identifié leurs agresseurs comme des Peuls, sept les ont identifiés comme des Mbororos et trois comme des combattants musulmans.
Beaucoup de victimes ont expliqué à Human Rights Watch que les combattants de la Séléka les ont violées pendant les attaques armées contre leurs communautés. Souvent, les combattants cherchaient des hommes au cours de raids maison par maison et utilisaient le viol comme punition pour avoir prétendument soutenu ou caché des combattants anti-balaka.
Viols perpétrés par la Séléka en Basse-Kotto, 2017
Des militaires Séléka de l’UPC, sous le commandement du Gén. Ali Darassa Mahamant, ont également commis des actes de violence sexuelle contre des civils, notamment des viols d'hommes et de femmes, dans la province de Basse-Kotto lors d'attaques contre des communautés locales en mai 2017.
Le 9 mai, des combattants de l'UPC et des musulmans de la région ont attaqué Alindao en prenant pour cible les quartiers de Paris-Congo et de Banguiville. Des sources locales ont déclaré à Human Rights Watch que ces attaques s’expliquaient probablement par la présence d'anti-balakas dans ces zones. Des survivants et des témoins ont décrit comment les combattants de l'UPC ont mené des fouilles maison par maison, cherchant des hommes à tuer et, dans certains cas, des femmes ou des filles à violer. Les combattants de l'UPC et les musulmans de la région ont tué au moins 136 civils lors de l'attaque contre Alindao qui a débuté le 9 mai et a déclenché un cycle de représailles qui s’est ensuite propagé aux sous-préfectures de Zangba et de Mobaye au cours du mois de mai. D'autres attaques ont eu lieu à Alindao plus tard pendant l’année 2017. En août, des combattants ont tué au moins 32 civils qui tentaient de quitter le camp de déplacés d'Alindao pour trouver de la nourriture et du bois de chauffage.[139]
Human Rights Watch a documenté 25 cas dans lesquels des combattants Séléka de l’UPC et d’autres qui leur étaient affiliés ont violé des femmes lors d'attaques à Basse-Kotto en mai 2017, notamment une femme enceinte de cinq mois. Dans douze cas, les faits se sont déroulés dans ou autour de la ville d’Alindao, pour six d'entre eux dans ou autour de Mobaye, et pour sept autres dans ou autour de Zangba. Dans onze de ces cas, des combattants ont également tué les maris ou les enfants des survivantes et, dans un cas, ils ont tué le père et le grand-père de la survivante. Les survivantes ont déclaré à Human Rights Watch qu'elles avaient été témoins de viols perpétrés par les combattants Séléka de l’UPC sur au moins 30 autres femmes et un homme.
Les femmes interrogées par Human Rights Watch ont déclaré avoir été violées chez elles lors du raid de leurs maisons ou pendant qu'elles tentaient de fuir les violences. Dans plusieurs cas, les survivantes ont également été victimes d'autres abus, tels que la torture, ou l'assassinat de membres de leur famille. Les combattants ont violé certains survivants devant leurs enfants ou d'autres membres de leur famille.
Irène, 36 ans, était devant chez elle dans le quartier de Banguiville à Alindao, le 9 mai, quand des combattants Séléka de l’UPC ont demandé à voir son mari, qui se trouvait à l'intérieur de la maison. Les combattants lui ont tiré dans les deux jambes alors qu'il essayait de fuir. Irène a expliqué que quand leur fille de cinq ans a commencé à pleurer, les combattants de la Séléka l'avaient attachée à un poteau sur la véranda. Elle a ensuite décrit comment elle et son mari ont alors été violés et torturés :
Un [combattant] m'a prise de force et mon mari s’est adressé à lui : « C'est une pauvre femme. Epargnez-la. » L'un d’eux s’est approché et lui a dit de se taire et de se déshabiller… Puis le chef a déclaré : « Moi, je vais coucher avec son mari. » J'ai baissé la tête mais il m'a dit de la relever et de regarder. J'ai crié : « Il n'y a aucune raison de nous blesser tous les deux », mais un autre a lancé : « Ferme-là. » Ensuite, ils m'ont bâillonnée avec un morceau de tissu. Deux autres se sont approchés et m'ont pris les jambes. Ils les tenaient ouvertes. Quand le premier a fini de me violer, il a demandé à un autre d’apporter un vêtement. Il a pris [le vêtement] et l'a mis dans mon vagin pour nettoyer là où le premier homme avait été. Je n’arrivais pas à faire autre chose que crier. Cela faisait trop mal.
Ma fille pleurait. L'un d'eux a dit : « Pourquoi cet enfant pleure-t-elle comme ça? » Je les ai entendus lui tirer dessus. J'ai imploré Jésus : « Comment peux-tu permettre une chose pareille ? » J'ai juste pleuré pour mon enfant ... Je les ai entendus faire feu et ensuite tout était silencieux. Je ne l'entendais plus.
Ils ont tiré deux balles dans la tête de mon mari... Avant de me violer, je les ai vus commencer à le torturer. Ils ont pris un morceau de bois et l'ont frappé avec. Ils lui ont coupé les bras avec un couteau militaire. Ils ont écrit leur nom sur ses bras. Je me suis mise à pleurer, pleurer.[140]
Irène a déclaré que deux des combattants l'avaient violée et qu'elle avait vu celui qui semblait être leur chef violer son mari. Sa fille a aussi été tuée pendant l'attaque.
Nancy, 33 ans, a déclaré que les combattants Séléka de l’UPC l'avaient violée et avaient tué son mari lors de l'attaque du mois de mai à Alindao. Les combattants ont capturé la famille qui comprenait cinq enfants de 2 à 10 ans, alors qu'ils fuyaient dans leurs champs pour échapper à l'attaque. Nancy a déclaré que son mari les suppliait de prendre de l'argent à la place du bétail dont il avait besoin pour la culture de ses champs :
L’un d’eux [un membre du groupe armé] a lancé : « Pourquoi discutes-tu avec nous ? Pourquoi fais-tu des difficultés ? » Ils ont tiré une balle dans la nuque de mon mari. Il est tombé sur le sol. Je me suis effondrée sur lui en pleurant. Un autre [homme armé] m'a giflée. Il a commencé à dire que je savais bien pleurer. Il a dit qu'aujourd’hui ils allaient me donner des raisons de pleurer... Il m'a prise de force. J'ai résisté. Celui qui a tiré sur mon mari a dit que si je continuais à résister, ils me feraient la même chose [qu'à mon mari]. Deux d'entre eux m'ont violée ... Quand ils ont fini, ils ont dit que puisque j'aimais tant mon mari, je n'avais qu'à l'enterrer... Mes enfants étaient à côté de moi et pleuraient. Les plus jeunes avaient vu la violence ... Ces hommes m'ont déjà tuée.[141]
Nadine, 34 ans, a déclaré que les combattants peuls de la Séléka l'avaient attrapée avec ses cinq enfants âgés de 5 à 15 ans, alors qu'ils fuyaient dans leurs champs lors d'une attaque à Zangba le 21 mai. Deux combattants l'ont violée devant ses enfants :
Ils m'ont frappé et jetée sur le sol et ils ont commencé à me violer. Mon enfant [d'environ 10 ans] – il a tout vu et il a voulu m'aider. Il s’est approché de moi. Ils lui ont tiré dans les côtes. Il est mort. J'ai dû abandonner le corps de mon fils parce que d'autres groupes armés arrivaient et qu’il fallait fuir[142]
Des survivants ont déclaré à Human Rights Watch qu'ils avaient entendu des combattants Séléka de l’UPC dire qu’ils cherchaient intentionnellement à tuer des hommes et à violer des femmes. Géraldine, 50 ans, a déclaré que deux combattants de la Séléka l'avaient violée dans la brousse près de Mobaye, mais qu'un autre combattant avait refusé en expliquant : « Je ne peux pas faire ça à une vieille femme. Nous cherchons des hommes jeunes à tuer, et aussi des jeunes femmes [à violer] ». [143] Une autre survivante a déclaré que deux combattants peuls de la Séléka l'avaient violée et lui avaient dit que « si je n'étais pas une femme, ils m’auraient tuée ».[144]
Les combattants Séléka de l'UPC sont connus pour agir sous les ordres du fondateur du groupe, le général Ali Darassa, qui a dirigé les combattants pour établir leur base à Alindao, après leur départ de Bambari au début de 2017. (Voir aussi : Viols commis par la Séléka à Liwa et Bambari, 2014-2015, et Esclavage sexuel par la Séléka à Bambari.) Beaucoup des survivants qui ont subi des violences sexuelles à Alindao, Mobaye et Zangba ont décrit leurs attaquants comme des « hommes d'Ali Darassa », en partie parce qu’ils savaient que le général Darassa et ses hommes s'étaient infi"ltr"és dans la région, mais aussi parce qu'ils disaient que les combattants s'étaient présentés comme tels à leur arrivée, ou pendant les attaques.
Viols commis par la Séléka à Bangui, décembre 2013 et septembre-décembre 2015
Au début du mois de décembre 2013, un assaut des anti-balaka à grande échelle contre les forces de la Séléka à Bangui a incité la Séléka à commettre des attaques de représailles cruelles.[145] Des affrontements féroces s’en sont suivis et les deux camps ont pris pour cible les civils sur la base de critères religieux. Human Rights Watch a consigné 31 cas de viol à Bangui pendant cette période, les combattants de la Séléka étant responsables de 23 cas. Vingt-et-un de ces cas étaient des viols collectifs.
Sandrine, 18 ans, a déclaré que quatre combattants de la Séléka sont entrés chez elle dans le quartier de Lando à Bangui, le 5 décembre 2013, et l’ont accusée de cacher des combattants anti-balaka :
[Un d’eux] a dit : « Dans la brousse, les anti-balaka tuent nos proches, nos femmes, les hommes et les enfants. Nous les cherchons. Comme tu as caché tes frères, nous allons maintenant te faire du mal, cela choquera tes frères et ils se montreront »... [U]n d’eux m’a bandé les yeux avec une chemise et un autre m’a couvert la bouche avec une chemise et a dit : « Si tu fais le moindre bruit, nous te tuerons. Tu verras. » Trois d’entre eux m’ont violée.[146]
Louise, 32 ans, a expliqué que sept combattants de la Séléka sont venus chez elle dans le quartier de Fondo à Bangui, le 3 décembre 2013, et ont forcé son mari, un caporal des forces armées du gouvernement, à les regarder la violer avant de le tuer :
[Mon mari] criait : « Non, laissez ma femme tranquille. Si vous voulez me tuer, tuez-moi. » Et ils l’ont abattu. C’est pendant que j’étais violée qu’ils l’ont abattu. Avant que mon mari ne soit abattu, ils ont veillé à ce qu’il me voie en train d’être violée. Après l’avoir tué, ils ont continué à me violer. Les trois autres m’ont violée à tour de rôle. Le corps de mon mari était sur le sol.[147]
Les sept enfants de Louise – alors âgés de 8 à 19 ans – ont été témoins du viol.[148]
Human Rights Watch a aussi documenté 36 cas de viol et 2 tentatives de viol par des membres de groupes armés à Bangui en 2015. (Les combattants de la Séléka étaient responsables de 16 incidents de viol et les combattants anti-balaka de 20.)
Trente-quatre de ces incidents ont eu lieu entre septembre et décembre 2015 pendant et immédiatement après les nouveaux affrontements entre la Séléka et les anti-balaka, déclenchés par le meurtre d’un chauffeur de moto-taxi musulman de 17 ans. La police de l’ONU dans le cadre de la MINUSCA n’a pas été en mesure d’endiguer les violences, qui ont fait environ 100 morts, dont au moins 31 civils.[149] Des violences ont de nouveau éclaté entre le 20 octobre et le 13 novembre 2015, lorsque des combattants anti-balaka ont tué deux représentants de l’UPC-Séléka en visite dans la capitale, conduisant à des attaques de vengeance entre les groupes d’auto-défense musulmans et les anti-balaka, qui ont entraîné la mort d’au moins 15 civils. Globalement, la vague de violences a déplacé près de 35 000 personnes.[150] Human Rights Watch a consigné 10 cas de viol par les forces de la Séléka à Bangui qui ont eu lieu entre septembre et décembre 2015, dont la plupart ont été commis par plusieurs agresseurs et ont souvent visé des femmes sur la base de motifs religieux.
Nathalie, 29 ans, a raconté que des combattants de la Séléka l’ont agressée dans le 3e arrondissement de Bangui alors qu’elle cherchait des légumes à vendre vers la mi-novembre 2015. Les combattants ont voulu punir son mari, qu’ils ont accusé de transmettre des informations sur la Séléka aux anti-balaka :
Un d’eux a dit : « C’est la femme de celui que nous cherchons depuis longtemps – nous allons l’attraper et faire souffrir [son mari]. » Six d’entre eux sont venus vers moi... Lorsque je suis tombée, deux m’ont maintenu les bras au sol. Un autre m’a violée, puis un deuxième, puis un troisième. Ensuite un quatrième a dit qu’il allait prendre sa part.[151]
Une autre victime a rappelé que les combattants de la Séléka cherchaient des femmes dans le but de les violer. Bernadette, 22 ans, et sa sœur aînée âgée de 25 ans ont indiqué à Human Rights Watch dans des entretiens séparés que des combattants de la Séléka les ont violées à la fin du mois de septembre 2015 alors qu’elles revenaient d’un camp de déplacés pour récupérer des vêtements chez elles dans le quartier de Sara à Bangui. Bernadette, qui souffre de handicap mental, a expliqué que trois combattants de la Séléka l’ont conduite à l’intérieur de la maison, où deux d’entre eux l’ont violée, en disant : « Ce que nous sommes venus chercher dans le quartier, c’est ce que nous avons déjà ».[152]
Viols commis par la Séléka à Boy-Rabe
Certaines des pires violences commises par la Séléka en 2013 – y compris des violences sexuelles – ont eu lieu dans le quartier de Boy-Rabe à Bangui, que la Séléka percevait comme un bastion du soutien à l’ancien président Bozizé et donc allié des forces anti-balaka.[153] Le ministre de la Sécurité publique d’alors et ex-général de la Séléka Noureddine Adam a déclaré à Human Rights Watch que les attaques de la Séléka dans le quartier faisaient partie d’« opérations de désarmement organisées ».[154]
Human Rights Watch a documenté 22 cas de viol par les combattants de la Séléka à Boy-Rabe entre mars et décembre 2013 : 7 de ces cas ont eu lieu pendant une attaque d’avril dans le quartier ; 12 cas ont eu lieu en novembre et en décembre alors que les anti-balaka progressaient vers la ville et trois cas ont eu lieu au milieu de l’année 2013.
Les combattants de la Séléka ont souvent perpétré des viols alors qu’ils cherchaient des hommes et des garçons, et ont utilisé le viol comme punition pour l’allégeance supposée aux anti-balaka.
Mathilde, 21 ans, a raconté qu’elle était chez elle en avril 2013 avec son mari et ses jeunes fils, alors âgés de quatre mois et deux ans, lorsque des combattants de la Séléka ont attaqué le quartier. Elle a décrit ce qu’il s’est passé lorsque la Séléka a approché :
Mon mari a quitté la maison. Il voulait s’enfuir. Ils lui ont tiré dessus directement et il est mort. Je me suis mise à pleurer et pleurer... Deux [Séléka] sont entrés dans la maison. Ils m’ont dit de me déshabiller, qu’ils allaient me violer. J’ai commencé à me débattre. Ils m’ont dit que si je ne me déshabillais pas – ils ont armé leurs fusils pour me tirer dessus... Les deux m’ont violée l’un après l’autre.[155]
La Séléka a continué à terroriser le quartier dans les jours qui ont suivi les attaques d’avril. Susanne, 25 ans, a expliqué que six combattants de la Séléka l’ont arrêtée à un point de contrôle alors qu’elle retournait à Boy-Rabe depuis le quartier de La Kouanga :
J’ai été conduite dans un bâtiment de la gendarmerie. Arrivée là, j’ai vu un combattant de la Séléka en train de violer une femme dans une pièce. Des hommes la tenaient en joue alors qu’elle était violée. Le chef m’a conduite dans la même salle où la fille était violée [et] en même temps, il m’a violée. Une fois que le chef m’a violée, un autre homme est venu me violer.[156]
Les groupes anti-balaka ont intensifié leurs attaques contre les positions de la Séléka hors de la capitale en novembre 2013. À leur tour, les combattants de la Séléka ont pris Boy-Rabe pour cible, car ils considéraient ses habitants comme des sympathisants des anti-balaka. Comme l’a indiqué une victime à Human Rights Watch : « S’ils trouvaient des hommes, ils les tuaient. Les femmes qui résistaient [au viol] étaient tuées elles aussi. »[157]
Restée sur place avec sa sœur malade, Chantal, 30 ans, a raconté que les combattants de la Séléka sont entrés dans sa maison en novembre 2013 et l’ont accusée de cacher des combattants avant de la violer :
Ils ont dit : « Il y a des frères militaires ici avec vous. » Nous avons répondu : « Nous n’avons aucun frère militaire. » Ils ont dit que je mentais... [Un d’eux] a pointé un fusil vers ma tête [et] il m’a dit qu’il me tuerait si je pleurais. Un d’eux m’a prise de force... Après, un autre est venu et m’a violée. Et un autre.[158]
Jocelyne, 14 ans, a relaté comment cinq combattants de la Séléka sont venus à la maison de sa famille à Boy-Rabe, le 5 décembre 2013, et ont menacé de tirer s’ils n’ouvraient pas la porte :
Mon père a ouvert la porte et ils l’ont abattu immédiatement. Ils ont vu mon frère et lui ont demandé : « Tu veux courir ? » Mais juste après qu’ils ont dit ça, ils l’ont abattu, lui aussi. J’étais juste à côté de lui. Ils m’ont ensuite regardée et m’ont ordonné : « Enlève tes vêtements ». J’ai dit non. Ils ont tiré en l’air et l’un d’eux a déchiré mes vêtements. Deux d’entre eux m’ont violée. Lorsqu’ils sont partis, je suis restée à côté des corps de mon frère et de mon père, en pleurant.[159]
Alors sous le contrôle de la Séléka entre mars 2013 et février 2014, le colonel Zacharia Santiago, connu localement sous le nom de « Colonel Kondo », commandait les combattants à Boy-Rabe.[160] En mai 2016, Santiago a déclaré à Human Rights Watch qu’il a été « envoyé par la Séléka pour mettre de l’ordre à Boy-Rabe » et qu’il commandait la zone au moment de l’offensive d’avril. Santiago a nié que ses forces aient commis des viols ou d’autres crimes. « J’ai été formé en tant que commando sur bien des aspects, y compris le droit international », a-t-il affirmé. « Je connais mes hommes et ils ont respecté et suivi mes ordres. Ils n’ont pas violé de femmes. »[161] Santiago a indiqué à Human Rights Watch qu’alors qu’il contrôlait Boy-Rabe, il relevait directement des généraux Mahamat Alkatim, Moussa Assimeh et Oumar Sodium.[162] Santiago a quitté Bangui au début de l’année 2014. Au moment de la rédaction de ce rapport, il assume la fonction de chef des opérations pour une faction de la Séléka, le FPRC, basé hors de Kaga-Bandoro.
Viols commis par la Séléka à Liwa et à Bambari, 2014-2015
Des victimes ont raconté des expériences similaires de violences sexuelles perpétrées par des combattants de la Séléka pendant les attaques dans et près de Bambari en 2014. Le 9 juin 2014, des combattants de la Séléka et de l’ethnie peule ont attaqué Liwa, un village majoritairement chrétien situé à 10 kilomètres au sud de Bambari, et ont détruit la totalité des 169 maisons du village. L'assaut contre Liwa a déclenché un cycle d'attaques de représailles particulièrement brutal dans les communautés voisines, qui s'est achevé avec les attaques de la Séléka contre des quartiers chrétiens de Bambari à la fin du mois de juin. Le 7 juillet, ils ont attaqué la paroisse de Saint-Joseph, où des milliers de déplacés avaient trouvé refuge.[163] Human Rights Watch a documenté neuf cas de viol par des combattants de la Séléka et alliés de la Séléka pendant les attaques de Liwa et de Bambari en juin et en juillet 2014. Les civils font les frais de ces violences, ainsi que des périodes d’insécurité continues. Human Rights Watch a consigné huit cas de viol par des combattants de la Séléka qui ont eu lieu à Bambari en 2015.
Pendant l’attaque du village de Liwa, Julie, 20 ans, a raconté que des combattants de la Séléka ont encerclé sa maison et y ont mis le feu. Lorsque son mari a tenté de fuir, les hommes de la Séléka lui ont tiré deux fois dans la poitrine. Julie a expliqué qu’elle était trop effrayée pour résister alors que cinq combattants de la Séléka l’ont violée l’un après l’autre à côté du corps de son mari. « Si je pleurais ou disais un mot, ils me tueraient. Quoi qu’ils me fassent, je devais rester silencieuse. » Après le viol, a-t-elle dit, « j’ai pensé que j’étais déjà morte ».[164]
Agathe, 50 ans, a indiqué que trois combattants de la Séléka l’ont violée alors qu’elle n’avait pas la force de s’enfuir pendant l’attaque de l’église Saint-Joseph. Les combattants lui ont dit qu’ils ripostaient à l’assaut des anti-balaka du 23 juin 2014 contre la communauté peule dans le village voisin d’Ardondjobdi, à côté de Liwa, qui a fait au moins 20 morts. « [Les Séléka] ont dit [que] nous étions toutes des femmes des anti-balaka », a-t-elle raconté. Elle s’est souvenue que les combattants de la Séléka ont continué à dire : « À Liwa [Ardondjobdi], les anti-balaka ont tué toutes les femmes et tous les hommes, donc nous ne pouvons pas simplement vous laisser partir ».[165]
Les combattants de la Séléka ont aussi employé des tactiques d’humiliation. Claudette, 22 ans, a raconté qu’elle rentrait à un camp de déplacés à Bambari appelé le « camp Sangaris » en décembre 2015 lorsque trois combattants de la Séléka l’ont attrapée en hurlant : « Nous tenons la femme du balaka ! Aujourd’hui, nous allons avoir des relations sexuelles avec la femme du balaka ! » Après qu’ils l’ont violée, a-t-elle décrit : « Ils m’ont saisie par les bras et les jambes et m’ont jetée hors de l’enceinte. J’étais totalement nue. Les gens me regardaient. »[166]
Quatre femmes ont raconté à Human Rights Watch que leurs violeurs étaient des hommes sous les ordres du général Ali Darassa Mahamant. Elles ont affirmé cela parce que Darassa contrôlait Bambari à l’époque, et les combattants portaient des uniformes militaires, comme le font les membres de l’UPC. Les victimes ont été violées pendant des attaques militaires menées par des combattants de Darassa, y compris les attaques contre Liwa et l’église Saint-Joseph, le quartier d’Akpé et à une barrière contrôlée par l’UPC près de Saint-Christophe à Bambari.[167] Darassa, qui a créé l’UPC-Séléka et s’en est autodésigné leader, a déclaré à Human Rights Watch que ses hommes n’étaient pas impliqués dans les combats autour de Bambari en juin et en juillet 2014, ni dans des viols à aucun moment.[168] (Voir « Esclavage sexuel par la Séléka à Bambari ».)
Viols commis par la Séléka dans la province de Nana-Grébizi
Les routes entre Kaga-Bandoro et Botto et entre Kaga-Bandoro et Mbrès, ainsi que la ville de Mbrès elle-même, ont été le théâtre de nombreuses attaques lancées par les groupes armés, notamment depuis décembre 2014.[169] Les forces de la Séléka contrôlent la ville de Kaga-Bandoro, capitale de la province, depuis le début du conflit en 2013. Human Rights Watch a documenté 42 cas de viol commis par des combattants de la Séléka et alliés de la Séléka qui ont eu lieu dans et autour des villes de Kaga-Bandoro, Mbrès et Botto dans la province de Nana-Grebizi entre début 2013 et avril 2016. Human Rights Watch a aussi reçu des informations fiables sur huit cas supplémentaires de viol commis par des combattants de la Séléka à Kaga-Bandoro entre mars et mai 2017, y compris le viol de deux hommes et d’une fille.[170]
Dix-neuf femmes ont raconté à Human Rights Watch que des combattants de la Séléka ou alliés les ont violées dans et autour de Kaga-Bandoro entre mars 2013 et avril 2016. Dans certains cas, les victimes ont déclaré que le viol était clairement utilisé comme une punition. Elisabeth, 24 ans, a indiqué que lorsque plusieurs combattants de la Séléka se sont présentés chez eux à Kaga-Bandoro vers avril 2015, son mari s’est enfui. « Lorsqu’il a fui, ils ont dit qu’ils allaient se venger sur moi », a décrit Elisabeth. « Un d’eux a pointé son fusil derrière mon oreille... Il a commencé à me violer. Il l’a fait deux fois. Ma fille aînée [de 5 ans] a été piétinée, avec des chaussures militaires. Ils l’ont piétinée. Après, je l’ai prise sur mes genoux, mais elle était déjà morte. »[171]
La Séléka a parfois recouru à des tactiques pour causer douleur et humiliation. Lorraine, 30 ans, et sa famille récoltaient du manioc dans le village de Kpokpo, près de Kaga-Bandoro, vers avril 2015 lorsque des combattants de la Séléka sont venus et ont menacé de les tuer elle ou sa fille, qui avait environ huit ans. Elle s’est souvenue :
Ils m’ont jetée de force sur le sol. L’un d’eux a mis son doigt dans mon vagin. Il voulait arracher mon clitoris... Celui qui a mis le doigt m’a laissée et est parti dans la brousse pour chercher [ma fille]. [Un autre] a commencé à me violer jusqu’à ce que je sois épuisée... Du sang s’est mis à sortir de mon vagin... Aujourd’hui encore, lorsque je vais aux toilettes, l’urine est mélangée à du sang.[172]
Dans au moins trois cas, la Séléka a demandé aux femmes de choisir entre le viol et la mort. Des combattants de la Séléka ont agressé Édith, 44 ans, dans ses champs près de Kaga-Bandoro en novembre 2015. « L’un des Séléka m’a demandé : “Tu veux vivre ou mourir ?” », a-t-elle raconté. « J’ai fait signe que je ne voulais pas mourir. Trois d’entre eux ont enlevé leur pantalon et ont eu des rapports sexuels avec moi. Après, ils n’ont rien dit. Ils ont juste souri, ils m’ont frappée et sont partis. »[173]
Des combattants de la Séléka ont aussi menacé de tuer les victimes si elles informaient quiconque des viols. Carine, 28 ans, a expliqué qu’elle se rendait à pied dans ses champs à Kaga-Bandoro en juillet 2015 lorsque quatre Peuls armés l’ont violée devant sa fille de 4 ans et l’ont avertie de garder l’agression sous silence :
[Le premier] a donné son fusil à un autre et m’a violée. Ensuite, il m’a donné de l’eau. Il a dit que je devais me laver les parties génitales et revenir pour que les autres puissent me violer. Le deuxième m’a ensuite violée. Après lui, j’ai dû me laver et [puis] le troisième m’a violée... Un des hommes qui m’ont violée m’a dit : « Si tu en parles à tes proches, la prochaine fois, nous te tuerons. ».[174]
Le 16 décembre 2014, des affrontements ont éclaté entre les anti-balaka et le FPRC-Séléka dans la ville de Mbrès, à environ 77 kilomètres au sud-est de la capitale provinciale de Kaga-Bandoro. Des habitants de Mbrès ont raconté à Human Rights Watch que les combattants anti-balaka ont traversé les quartiers pour attaquer le FPRC-Séléka et, dans une contre-offensive, les combattants du FPRC s’en sont pris aux civils et aux maisons. Au moins, 107 maisons ont été brûlées et 29 civils ont été tués sur deux jours.[175]
Human Rights Watch a interrogé six femmes et filles qui ont indiqué avoir été violées par des combattants de la Séléka pendant l’attaque de décembre 2014 contre Mbrès. Sylvie, 23 ans, a raconté que des combattants de la Séléka sont venus chez elle et ont exigé de voir son mari, en disant qu’ils savaient qu’il possédait une moto et des vaches. Lorsqu’un combattant a tiré en l’air, Sylvie a expliqué que sa fille est entrée dans la pièce :
Lorsque les Séléka l’ont vue, deux d’entre eux l’ont jetée au sol. J’ai dit : « Il vaut mieux que vous me violiez moi plutôt que ma fille ». Mais les deux hommes l’ont violée. Elle avait neuf ou dix ans. J’étais là, à regarder. [Les Séléka] ont dit : « Comme tu ne nous montreras pas la moto et les vaches, nous allons te violer aussi. » Ils m’ont violée l’un après l’autre.[176]
Les forces de la Séléka de Kaga-Bandoro ont attaqué à plusieurs reprises le village de Botto, situé à 40 kilomètres de Kaga-Bandoro, entre décembre 2013 et le milieu de l’année 2015.[177] En février 2015, la Séléka s’était divisée et les combattants présents dans la zone étaient des membres du FPRC-Séléka.[178] Human Rights Watch a documenté quatre cas de viol perpétrés par des combattants du FPRC-Séléka et peuls pendant les attaques contre Botto.
Solange, 34 ans, a raconté qu’elle était enceinte de deux mois quand cinq combattants de la Séléka l’ont trouvée alors qu’elle se cachait dans la brousse avec son fils de trois ans pendant une attaque contre Botto vers février 2015. Deux des combattants l’ont violée, a-t-elle dit, et plus tard, elle a fait une fausse couche.[179] Une autre victime, Jaqueline, 45 ans, a expliqué qu’elle était enceinte de trois ou quatre mois lorsque trois combattants peuls l’ont violée dans les champs près de Botto en décembre 2014, et qu’elle a perdu l’enfant plus tard le même jour.[180]
En mai 2016, Human Rights Watch a interrogé le coordinateur général du FPRC à Botto, Moussa Maloud, sur les allégations de viols par le FPRC-Séléka. Maloud a répondu à Human Rights Watch que les combattants du FPRC n’ont pas commis d’attaques contre des civils :
Si nous découvrons que quelqu’un a commis un viol, nous punirons cet individu et nous le conduirons à la MINUSCA. Si quelqu’un est accusé, nous mènerons une enquête. Mais à ce jour, aucun [membre du] FPRC n’a été accusé. Ces cas dont vous parlez, y a-t-il des rapports médicaux ? Si oui, j’aimerais bien les voir, parce que ces cas n’existent pas.[181]
Viols commis par les anti-balaka
À l’instar de la Séléka, les combattants anti-balaka ont commis des viols pendant les attaques contre les communautés et ont pris pour cible des femmes et des filles alors qu’elles effectuaient des tâches quotidiennes pour subvenir aux besoins de leurs familles et aux leurs. Human Rights Watch a documenté 74 cas de viol par les combattants anti-balaka, qui ont eu lieu principalement à Boda et à Bangui entre décembre 2013 et décembre 2015. Vingt-trois des victimes interrogées par Human Rights Watch étaient des enfants (de moins de 18 ans) au moment du viol et 44 des incidents impliquaient plusieurs violeurs.
Trente-trois victimes ont indiqué à Human Rights Watch que les anti-balaka les ont ciblées pour des raisons religieuses, en précisant, par exemple que les anti-balaka les ont violées après les avoir qualifiées de femmes ou « concubines » musulmanes, ou les avoir accusées d’être des « traîtresses » parce qu’elles vendaient des marchandises aux musulmans.[182]
Viols commis par les anti-balaka à Bangui
Human Rights Watch a documenté 35 cas de viol par les combattants anti-balaka à Bangui, y compris de quatre filles âgées de 11 à 17 ans. Les viols ont principalement eu lieu entre la fin de l’année 2013 et le début de l’année 2014, lorsque des combattants anti-balaka ont lancé des attaques de grande ampleur contre les forces de la Séléka dans la capitale et entre septembre et décembre 2015, pendant et immédiatement après les flambées de violences interreligieuses.
Human Rights Watch a interrogé six victimes qui ont expliqué que les anti-balaka les ont violées pendant une vague d’attaques contre Bangui qui a démarré en décembre 2013. Des violences physiques, y compris des meurtres et des mutilations, ont accompagné plusieurs des viols. Des combattants anti-balaka sont arrivés à la maison de Marie-Claire dans le quartier de Fondo à Bangui à la fin du mois de décembre 2013 et ont accusé son mari d’appartenir à la Séléka. Elle a expliqué :
[U]n d’eux a dit à mon mari de s’allonger sur le sol. Il a répondu non, qu’il ne voulait pas. Un d’eux lui a coupé l’oreille [et] aussi un doigt à la première phalange... Ils lui ont presque tranché le bras – il ne tenait que par un morceau de peau. [Ils ont fait] ça devant moi. Ensuite, ils lui ont tiré une balle dans la tête et il est tombé au sol. Les trois m’ont violée... l’un après l’autre. [183]
Marie-Claire, 24 ans, était enceinte de deux mois à ce moment, mais comme les autres victimes, elle a précisé que cela n’a pas dissuadé ses agresseurs. « Je leur ai dit que j’étais enceinte », s’est-elle souvenue. « Ils ont dit que ce n’était pas leur problème – que je le veuille ou non, ils allaient me violer. »[184]
Les combattants anti-balaka ont utilisé des tactiques pour infliger des douleurs supplémentaires et de l’humiliation, en commettant des viols avec des objets et devant des membres des familles des victimes. Natifa, 35 ans, a décrit qu’en février 2014, un groupe d’anti-balaka est venu chez elle dans le quartier Combattants à Bangui, en criant : « Où est-elle ? Où est-elle ? La femme musulmane, nous sommes venus à cause d’elle. »[185] Elle a raconté que les anti-balaka ont prétendu que son mari gardait des fusils et l’ont conduite dans une maison qu’ils utilisaient comme base, où ils l’ont violée plusieurs fois, y compris avec une grenade :
[Le commandant] a ordonné à ses hommes de me conduire dans la maison. Ils ont commencé à me torturer. Un d’eux avait une grenade dans sa main. Il m’a dit de me déshabiller. Il a placé la grenade dans mes parties génitales. L’un d’eux a dit : « Pourquoi est-ce que tu fais ça ? Si ça explose, nous allons tous mourir. »[186]
Natifa a expliqué que quatre des hommes l’ont violée et ont continué à la frapper. « [I]ls m’ont frappée avec des bâtons, des ceintures – j’ai des cicatrices sur la peau », a-t-elle dit. « Même sur les parties génitales – j’ai eu des problèmes pour m’asseoir [après]. »[187]
Ayant fui les violences, Joséphine, 28 ans, a expliqué qu’elle revenait pour récupérer des affaires dans sa maison à Bangui en octobre 2014 lorsque des anti-balaka l’ont attrapée dans le quartier de Fondo. Elle a décrit comment les anti-balaka l’ont violée avec une bouteille dans une maison à l’intérieur d’une enceinte :
Il y avait une bouteille de bière Castel. Ils l’ont cassée et l’ont enfoncée dans mon vagin. Lorsqu’ils l’ont enfoncée, le sang a coulé et j’ai perdu connaissance... Après [qu’ils ont terminé], ils sont allés dans le quartier et ont dit : « Nous avons arrêté une femme de musulmans ».[188]
Les anti-balaka ont pris pour cible des femmes musulmanes dans une forme de vengeance contre la Séléka. Estelle, 44 ans, a expliqué qu’elle était enceinte de trois mois lorsque des combattants anti-balaka ont encerclé le quartier de Malimaka à Bangui en janvier 2014. Estelle a raconté que les combattants ont mis un couteau sur la gorge de son mari, un musulman converti, et l’ont traîné dehors. Ils ont menacé de la tuer, puis ils l’ont attachée et l’ont violée, bien qu’elle ait signalé qu’elle était enceinte. « Ils étaient cinq sur moi. Le premier me violait et les autres disaient : “Dépêche-toi, nous attendons notre tour aussi” », s’est-elle souvenue. « Pendant le troisième viol, j’ai perdu connaissance. »[189]
Les agresseurs d’Estelle ont répété plusieurs fois qu’ils la violaient en raison de sa religion :
[Un d’eux] a dit : « C’est [à cause de ce] que la Séléka nous a fait – nous n’épargnerons aucun musulman. » Ils ont dit qu’ils allaient commencer par découper mon fils en morceaux devant moi... Ils ont dit : « Les femmes musulmanes en ont trop fait. Nous avons trouvé un vagin musulman aujourd’hui et nous en avons profité. »[190]
Estelle a fait une fausse couche après l’agression.
Les combattants anti-balaka ont aussi blessé et même tué des membres des familles des victimes parallèlement aux violences sexuelles. Nalia, 38 ans, a décrit comment les anti-balaka sont venus chez elle dans le quartier PK10 à Bangui en février 2014 et lui ont dit : « Nous sommes venus à cause des musulmans ». Les anti-balaka les ont attrapés elle et son fils de 14 ans, en disant : « Puisque tu es un petit musulman, nous allons t’emmener avec ta mère ». Lorsque son fils a résisté, a-t-elle raconté, les anti-balaka lui ont tiré dans le dos.[191] Les combattants ont conduit Nalia à une base proche, où quatre d’entre eux l’ont violée. « Ils m’ont tout pris. Ils ont tué mon fils de 14 ans », a-t-elle conclu. « Ils ont tout pillé dans ma maison. Je n’ai plus rien. »[192]
Human Rights Watch a aussi documenté 18 cas de viol par des combattants anti-balaka qui ont eu lieu entre septembre et décembre 2015, pendant et immédiatement après les flambées de violences sectaires qui ont éclaté suite au meurtre d’un chauffeur de moto-taxi musulman. (Voir : Viols commis par la Séléka à Bangui)
Des combattants anti-balaka ont agressé des femmes en guise de punition pour l’appartenance religieuse de leurs maris ou des membres de leur famille. Clarice, 20 ans, a indiqué que six membres des anti-balaka l’ont violée pendant six heures à Bangui en octobre 2015, en disant qu’ils envoyaient un message à son père musulman. « Un d’eux a dit : “C’est intentionnel”. Il a ajouté qu’ils m’avaient violée pour que mon père l’entende », a-t-elle raconté.[193]
Les anti-balaka accusaient les victimes de fournir de la nourriture ou des provisions à la Séléka. Vivienne, 20 ans, et six autres femmes allaient acheter des légumes dans le quartier de Boeing à Bangui vers décembre 2014 lorsqu’elles sont tombées sur un groupe d’au moins sept anti-balaka. Elle a expliqué que les combattants ont violé toutes les femmes à tour de rôle :
Ils ont dit : « C’est là que vous allez, c’est pour acheter des légumes pour que les musulmans mangent, ensuite ils viennent nous tuer. Nous allons vous violer pour que vos maris musulmans sachent que vous êtes déjà mortes. » Cela a duré deux heures ; quatre d’entre eux m’ont violée.[194]
Sur les 19 incidents de violences sexuelles documentés par Human Rights Watch qui sont survenus à Bangui entre septembre et décembre 2015, neuf ont eu lieu dans ou près du camp de déplacés de M’poko.[195] Créé en décembre 2013 lorsque des dizaines de milliers de civils ont cherché refuge autour de l’aéroport international de M’poko alors que la Séléka et les anti-balaka s’affrontaient pour le contrôle de Bangui, le camp abritait environ 20 000 personnes suite aux nouveaux combats en septembre et en octobre 2015. Les combattants anti-balaka contrôlaient largement le camp et la police militaire centrafricaine n’entrait pas dans le camp à l’époque en raison de l’insécurité. Le gouvernement a démantelé le camp de M’poko entre décembre 2016 et janvier 2017 et a invité les habitants à retourner dans leurs maisons. Human Rights Watch a documenté huit incidents de viol et une tentative de viol, ainsi que dix incidents d’enlèvement et d’agression physique, qui ont eu lieu entre septembre et décembre 2015 dans et autour du camp de M’poko.[196]
Michelle, 23 ans, a raconté qu’elle retournait au camp de M’poko après avoir acheté du bois de chauffage en novembre 2015 lorsque trois anti-balaka venant du camp ont demandé de l’argent. Lorsqu’elle leur a répondu qu’elle n’avait que 500 francs CFA (environ 0,82 dollar US), un combattant anti-balaka l’a jetée au sol et a commencé à la violer. Le commandant a dit à ses hommes : « C’est de la marchandise que nous avons ici – profitez-en », s’est souvenue Michelle, avant d’ajouter que deux autres combattants l’ont aussi violée. « Lorsqu’ils ont fini de me violer, je ne pouvais plus marcher. »[197]
Corinne, 27 ans, a raconté qu’elle allait du camp de M’poko au quartier de Cinq Kilo pour trouver de la nourriture en novembre 2015 lorsque des anti-balaka armés de fusils et de machettes l’ont accusée de chercher des marchandises à vendre aux musulmans :
Ils se sont approchés avec leurs machettes et m’ont dit : « Si tu ne dis pas la vérité, nous te tuerons. » J’ai répondu : « Non, je ne vends pas de choses aux musulmans ». Trois d’entre eux m’ont ensuite brutalisée. J’ai été violée... Je ne suis pas retournée dans [le quartier] parce que j’ai peur d’être violée à nouveau.[198]
Six victimes qui ont été enlevées, détenues pour obtenir une rançon et brutalisées physiquement et verbalement dans et autour du camp de M’poko ont identifié Emar Nganafeї parmi leurs agresseurs ou comme le leader de leurs agresseurs. Entre la mi-2014 et janvier 2016, Nganafeї a assumé la fonction de commandant d’un groupe anti-balaka qui gérait une base dans la Zone 3 du camp de M’poko, près d’un hôpital.[199] Une victime a déclaré avoir vu Nganafeї à la base anti-balaka où les combattants l’ont gardée captive pendant 14 heures en septembre 2015 après l’avoir battue.[200] Deux autres victimes ont indiqué que Nganafeї a menacé de les tuer lorsque les anti-balaka les ont enlevées et les ont maintenues en captivité ensemble pendant 10 heures en octobre 2015 et l’une d’elles a dit que Nganafeї a pointé un pistolet vers sa tête.[201]
Viols commis par les anti-balaka dans et autour de Boda
Human Rights Watch a documenté 17 cas de viol par les combattants anti-balaka dans et autour de Boda entre novembre 2013 et mai 2015. Quinze des victimes étaient des filles, dont une âgée de 10 ans. Les victimes ont décrit comment les combattants anti-balaka les ont attaquées alors qu’elles se procuraient de la nourriture ou de l’eau en groupes et ont parfois violé plusieurs femmes ou filles. Les victimes ont expliqué que les anti-balaka ont violé neuf autres femmes et filles âgées de 10 à 19 ans qui étaient avec elles pendant les attaques ou un total de 25 femmes et filles. Dans certains cas, les filles ont raconté que les membres des anti-balaka les ont violées puis ont menacé ou ont tué des membres de leur famille qui sont allés demander des comptes au groupe armé.[202]
Les attaques des anti-balaka se sont intensifiées dans et autour de Boda en 2014. Le Groupe d’experts des Nations Unies a rapporté en octobre 2014 que les attaques menées par les forces anti-balaka ont augmenté dans la dernière partie de cette année-là et que les combattants avaient tué au moins 168 civils, dont cinq enfants.[203] Le Groupe d’experts a aussi constaté que le leader anti-balaka Patrice-Edouard Ngaïssona nommait des commandants dans la zone au milieu de l’année 2014.[204]
Les anti-balaka attaquaient souvent des femmes et des filles autour de Boda alors qu’elles cherchaient de la nourriture et d’autres éléments de première nécessité. Comme dans d’autres zones, les auteurs ciblaient des femmes et des filles en fonction de critères religieux. Marlène, 16 ans, a raconté que des combattants anti-balaka les ont attaquées elle et sa tante dans un village près de Boda en janvier 2014 alors qu’elles cherchaient des avocats à vendre. Marlène a expliqué que les anti-balaka ont tué sa tante puis ils l’ont poursuivie jusqu’à ce qu’elle tombe et se casse le bras. « Ils ont dit que si je refusais de coucher avec eux, ils allaient me tuer comme ils avaient tué [ma tante] », s’est-elle souvenue. « Ils ont dit : “Les avocats, vous allez les vendre aux musulmans. C’est pour ça que nous l’avons tuée.” »[205] L’un des combattants l’a ensuite violée, a ajouté Marlène.
Priscille, 16 ans, a expliqué à Human Rights Watch que sa famille a fui dans les champs pendant les attaques contre Boda au début de l’année 2014. Alors qu’elle retournait aux champs avec sa sœur de 10 ans après avoir vendu le manioc en ville, trois anti-balaka ont attrapé les deux filles :
Un d’eux a dit : « Tu dois enlever tes vêtements pour que nous ayons des rapports sexuels avec toi. » J’ai dit : « Je suis encore vierge. Il a répondu : « Si tu es encore vierge, alors nous te dépucellerons aujourd’hui ». Un d’eux a arraché mes vêtements et l’autre a déchiré mes sous-vêtements. Celui qui a déchiré mes sous-vêtements avait [une] machette. Un d’eux m’a attrapée à la gorge et m’a jetée au sol. Il m’a tenu la bouche fermée pendant que le premier homme me violait. J’ai commencé à saigner. Lorsque le premier homme a terminé, le deuxième homme a dit : « Je ne peux pas te laisser comme ça, je dois te violer aussi. » Donc il m’a violé lui aussi.[206]
Priscille a expliqué qu’elle n’a pas pu recevoir de soins médicaux après l’agression parce que les établissements de santé dans la zone ne fonctionnaient pas à l’époque.[207] De plus, elle n’a pas retrouvé sa sœur cadette. Priscille a raconté le viol à ses parents et son père est parti trouver les agresseurs. Lorsqu’il est tombé sur des combattants anti-balaka et leur a dit que des combattants de leur groupe avaient violé sa fille, a poursuivi Priscille, « les anti-balaka lui ont tiré dans le dos ». Son père a été tué.
Quelques heures plus tard, la sœur de Priscille âgée de 10 ans est rentrée auprès de sa famille et a raconté que les anti-balaka l’avaient emmenée dans la brousse, l’avaient attachée et l’avaient violée. « Elle est revenue au camp en pleurant, en se tenant les côtés de douleur », s’est souvenue Priscille. « Les anti-balaka ont ruiné nos vies. Ils disaient qu’ils étaient là pour attaquer les musulmans, mais ils s’en prennent à tout le monde. »[208]
Quatre victimes, interrogées séparément, ont identifié leurs agresseurs comme étant des combattants sous les ordres de Gilbert Wité. Wité commandait des troupes anti-balaka opérant depuis une base située près de l’église catholique à Boda. En avril 2016, un responsable local a indiqué à Human Rights Watch que Wité contrôlait toujours les combattants dans la zone.[209] Une des victimes a signalé que Wité était présent alors que ses combattants la violaient, et une autre a indiqué que Wité a menacé sa famille après l’agression.
Isabelle, 14 ans, a expliqué qu’elle était allée chercher de l’eau pour sa famille après qu’ils ont fui dans la brousse hors de Boda en 2014. Cinq combattants de Wité l’ont arrêtée et lui ont dit : « Si tu n’acceptes pas de coucher avec nous, nous te tuerons ».[210] Elle a raconté qu’ils l’ont giflée, qu’un des hommes l’a violée et que Wité a été témoin du viol. « Leur chef était appelé Wité – il était là », a-t-elle dit. « Il n’a pas réagi [pendant le viol]. Il est parti s’asseoir sous un arbre avec les autres. Il savait. »[211]
Camille, 15 ans, a indiqué que des combattants anti-balaka sous le commandement de Wité les ont attrapées elle et une amie alors qu’elles s’enfuyaient au début de l’année 2014 et leur ont demandé de l’argent. « Nous avons refusé, donc ils nous ont frappées, ont arraché nos vêtements et ont commencé à nous violer », a-t-elle raconté. « Chacun a choisi l’une de nous pour la violer. »[212] Camille a décrit comment sa mère est ensuite allée trouver Wité pour lui parler de l’incident :
Le lendemain, elle est allée voir Wité et a dit : « Vos hommes ont violé ma fille ». Wité a pointé son fusil vers ma mère. Elle est venue le voir à nouveau, mais il a pointé son arme vers elle une deuxième fois. Il a dit : « Si tu continues à venir me parler, je te tuerai ». Donc ma mère a abandonné.[213]
En avril 2016, le coordinateur des anti-balaka pour Boda depuis 2013, Aimé Dobo, a confirmé que les anti-balaka restaient dans les sous-préfectures de Boda, Boganagone et Boganda. Il a déclaré que les trois zones relèvent du commandement de Patrice-Edouard Ngaïssona. Dobo a indiqué à Human Rights Watch qu’il n’avait pas entendu parler de cas de viol perpétrés par les combattants anti-balaka, mais que si cela avait été le cas, il aurait imposé des sanctions : « À la coordination, nous n’avons jamais entendu parler des cas que vous évoquez. Maintenant nous les enverrions devant un tribunal, mais avant nous aurions [appliqué] une sanction traditionnelle. »[214]
Viols commis par les anti-balaka à Bambari
En 2014, les groupes anti-balaka se sont déplacés de Bangui à Bambari et se sont livrés à des combats sporadiques avec les combattants de la Séléka.[215] Human Rights Watch a documenté sept cas de viol perpétrés par des anti-balaka à Bambari entre la fin de l’année 2013 et la fin de l’année 2015.
Les forces de la Séléka et anti-balaka ont contrôlé les rives opposées de la rivière à Bambari de 2014 jusqu’en février 2017. Les femmes et les filles sur la rive contrôlée par la Séléka devaient traverser la rivière pour accéder aux marchés sur l’autre berge. Deux victimes ont indiqué avoir été violées et une autre agressée physiquement par des anti-balaka aux postes de contrôle qu’ils avaient établis aux points de franchissement de la rivière. Des anti-balaka ont violé Victoire, 40 ans, vers juillet 2014 alors qu’elle ne pouvait pas payer la somme exigée à un poste de contrôle. Elle s’est souvenue :
Ils m’ont sévèrement battue... Ils ont arraché mes vêtements et m’ont violée. Ils l’ont fait chacun à leur tour – cinq d’entre eux... Si les anti-balaka conduisent une femme [à la base], ils finissent de faire ce qu’ils veulent avec elle, [puis] ils l’emmènent sur le bord de la route, la laissent là et amènent une autre [femme].[216]
Des combattants anti-balaka ont attaqué certaines femmes pour des alliances présumées avec la Séléka. Cécile, 50 ans, a décrit que trois anti-balaka l’ont trouvée en train de récupérer un bagage chez elle dans le quartier d’Akpé à Bambari en janvier 2015 et l’ont accusée de conspirer avec la Séléka :
[Le combattant anti-balaka] a dit : « Tu as le choix parce que nous savons que tu as donné notre position aux musulmans ». Il m’a montré des balles et a poursuivi : « Soit nous te tuons, soit tu couches avec chacun de nous ». J’ai été obligée de les laisser avoir des rapports sexuels avec moi.[217]
Viols par les anti-balaka dans la province de Nana-Grébizi
De 2014 à 2016, les groupes armés ont mené de nombreuses attaques sur les routes entre Kaga-Bandoro et Botto et entre Kaga-Bandoro et Mbrès, ainsi que dans la ville de Mbrès elle-même. Human Rights Watch a documenté sept cas de viol par des combattants anti-balaka dans la région, dont cinq cas dans et autour de Mbrès entre décembre 2014 et le début de l’année 2015. Trois de ces incidents ont eu lieu dans ou près de Blakadja, un village situé à environ 20 kilomètres de Mbrès, où Franco Yagbegue, aussi connu sous le nom de Pelé, assumait la fonction de commandant de zone dans la structure anti-balaka coordonnée par Maxime Mokom. Human Rights Watch a précédemment documenté des attaques menées par Pelé et ses combattants sur la route de Kaga-Bandoro-Mbrès en 2015.[218]
Catherine, 25 ans, a raconté que Pelé figurait parmi les hommes qui l’ont violée lorsque des anti-balaka l’ont arrêtée dans la brousse en janvier 2015 près de Blakadja. Catherine a décrit comment les combattants l’ont frappée dans le dos avec un fusil et deux d’entre eux l’ont ensuite violée :
L’un a pointé son fusil sur moi. L’autre a déchiré mes vêtements et a commencé à me violer. Lorsqu’il a terminé, il s’est relevé et l’autre est venu prendre sa part... Un d’eux m’a dit de partir très loin de Mbrès. Je leur ai dit que je n’avais pas la force de marcher maintenant [après le viol]. Un d’eux s’est mis à rire [et] a dit qu’ils allaient continuer leurs violences sur moi. Ils ont enlevé leur ceinture et se sont mis à me frapper avec. Ils ont dit que c’est Dieu qui m’avait placée sur leur chemin ; ils m’ont déjà trouvée, maintenant ils vont faire ce qu’ils veulent de moi.[219]
Catherine a indiqué que l’un des anti-balaka a appelé l’autre « Pelé » et que Pelé était un des deux hommes qui l’ont violée.[220] « Lorsque Pelé a fini de me violer, il a ordonné à son combattant de venir aussi prendre sa part » a-t-elle dit.[221]
Une autre victime, Sylvie, 23 ans, a raconté à Human Rights Watch qu’elle était avec un groupe d’environ 30 personnes fuyant Mbrès après les combats de décembre 2014 quand ils sont tombés sur des combattants anti-balaka à Blakadja, qui ont alors violé les 10 femmes du groupe. Elle a expliqué qu’elle a entendu les autres combattants appeler un des anti-balaka par le nom de Pelé et qu’il faisait partie du groupe de combattants qui ont commis l’agression. « Ils ont arraché nos vêtements et chaque anti-balaka a violé une femme à tour de rôle. J’ai été violée par un anti-balaka. Il est le père de mon bébé », s’est-elle souvenue.[222] Au moment de son entretien avec Human Rights Watch, elle avait une fille d’environ un an du fait du viol.
Judith, 24 ans, a aussi indiqué que deux combattants anti-balaka l’ont violée à Blakadja en février 2015. Elle a précisé que les combattants étaient sous les ordres de Pelé, sachant qu’ils partageaient une même base et que Pelé dirigeait les anti-balaka dans la zone.[223]
Apparition de 3R et viols commis par des combattants de 3R
Un groupe armé appelé « Retour, Réclamation et Réhabilitation » ou 3R est apparu dans la province d’Ouham-Pendé à la fin de l’année 2015 et a commis divers abus, incluant des attaques contre des civils, des déplacements forcés et des violences sexuelles.[224] Sous le commandement du général autoproclamé Sidiki Abass, qui prétend protéger la population peule dans la région, 3R a mené sa plus grande attaque, sur De Gaulle dans la sous-préfecture de Koui, le 27 septembre 2016, tuant au moins 17 civils. De nombreuses personnes déplacées suite aux affrontements dans De Gaulle et les villages voisins ont fui à Bocaranga, la capitale de la province d’Ouham-Pendé.
Des personnes qui surveillent les violences sexuelles dans la zone, qui n’ont pas voulu être identifiées pour des raisons de sécurité, ont expliqué à Human Rights Watch qu’elles avaient consigné 43 cas de femmes et de filles qui ont dit avoir été violées par des combattants de 3R ; 23 de ces cas ont eu lieu pendant ou juste après l’attaque contre De Gaulle. Alors que certains des cas peuvent avoir été consignés par plusieurs personnes ou organismes, le nombre total de cas est probablement plus élevé en raison du manque de signalement des violences sexuelles.
Human Rights Watch a interrogé deux femmes et une fille qui ont déclaré avoir été violées par des combattants de 3R. Les deux femmes ont indiqué que les viols ont eu lieu pendant l’attaque du 27 septembre sur De Gaulle et que leurs enfants en ont été témoins. Agnès, 33 ans, a expliqué qu’elle s’est enfuie en courant dans les bois avec son mari et leur fils de 7 ans quand les combattants de 3R ont attaqué De Gaulle. Alors qu’ils fuyaient, son mari a reçu une balle dans la jambe et elle et son fils ont été séparés de lui :
[Mon fils et moi] marchions lorsque nous sommes tombés sur un groupe de 10 combattants du groupe de Sidiki. Deux d’entre eux m’ont violée... L’un d’eux a pointé son fusil et a dit : « Si tu n’as pas de rapports sexuels avec moi, je te tue. »... Ils m’ont violée l’un après l’autre. Mon fils était là pendant toute la durée. Ils m’ont forcée à le mettre juste sur le côté. Il pleurait.[225]
Delphine, 14 ans, a raconté qu’elle et son père fuyaient leur village après une attaque de 3R dans les jours précédant l’attaque contre De Gaulle. Ils s’approchaient de De Gaulle à l’aube lorsqu’un combattant de 3R armé d’un fusil a surgi derrière eux :
Il m’a attrapée et lorsque mon père a tenté de réagir, [il] l’a saisi à la gorge. J’ai hurlé parce que j’ai pensé qu’il allait tuer mon père. Il a lâché mon père et à la place il m’a saisie à la gorge. Il m’a jetée sur le sol et m’a frappée dans le côté avec son fusil. Il a pointé son fusil sur moi et a dit : « Si tu ne couches pas avec moi, je te tue. » Il a ensuite pointé son fusil sur mon père et a dit : « Si je ne couche pas avec ta fille, je te tue. » Mon père a dû rester sous un arbre un peu plus loin. Ensuite [le combattant] m’a violée… Lorsqu’il a fini l’acte, il est parti sans dire un mot... Parfois, je rêve que je suis violée par cet homme et qu’il va me tuer une fois qu’il a terminé.[226]
Dans un entretien le 22 novembre 2016, Sidiki a démenti toutes les allégations d’abus et a déclaré que ses combattants respectent les droits humains.[227] Trois jours plus tard, un porte-parole de 3R et le secrétaire général du groupe ont nié que les combattants aient commis des viols.[228]
Des prestataires de services à Bocaranga ont raconté à Human Rights Watch que peu de victimes de viol ont été en mesure d’accéder à des services médicaux en raison de l’insécurité. Un prestataire de service a indiqué que la plupart des victimes de violences sexuelles n’ont pas reçu de soins après le viol, y compris une prophylaxie post-exposition (PPE) pour éviter la transmission du VIH. Entre le 27 septembre et le 11 octobre 2016, des organisations apportant une assistance aux victimes de viol ont été obligées d’évacuer Bocaranga en raison des combats. Elles ont dû suspendre les services à nouveau le 2 février 2017 lorsque le groupe 3R a attaqué Bocaranga ; les affrontements entre les anti-balaka et 3R ont fait plusieurs morts parmi les civils et l’enceinte d’une ONG internationale a été endommagée par un incendie.[229] Au moment de la rédaction du présent rapport, les ONG avaient repris leur travail.
Dans son rapport à mi-parcours de juillet 2017, le Groupe d’experts sur la République centrafricaine a rapporté avoir reçu des informations sur trois cas de viol prétendument perpétrés par des combattants de 3R à Niem en mai 2017.[230]
III. Impact des violences sexuelles
Pour quasiment toutes les femmes et les filles interrogées par Human Rights Watch, l’impact des violences sexuelles subsiste longtemps après l’agression. La vie de certaines, notamment celles qui sont tombées enceintes suite au viol, a été bouleversée par les effets physiques des violences sexuelles. De nombreuses victimes ont indiqué que les effets psychologiques sont tout aussi dévastateurs, décrivant des symptômes correspondant à la dépression ou à un état de stress post-traumatique (ESPT), et dans certains cas, à des idées suicidaires. Certaines femmes peuvent avoir contracté le VIH à cause des viols ou alors qu’elles étaient détenues comme esclaves sexuelles.[231]
Comme ailleurs dans le monde, les victimes de violences sexuelles en République centrafricaine souffrent souvent de stigmatisation et de rejet par les membres de leur famille et de leur communauté. Par conséquent, beaucoup de victimes ont expliqué qu’elles n’avaient pas parlé des violences à leur famille ou à leurs proches, et qu’elles n’avaient pas cherché à obtenir de l’aide, notamment des soins médicaux essentiels.
De plus, certaines femmes et filles ont indiqué que les violences sexuelles renforçaient les obstacles créés par le conflit : après les violences, elles ont rencontré des barrières supplémentaires pour mener des activités génératrices de revenus ou pour accéder à l’éducation.
Stigmatisation et rejet
La plupart des femmes et des filles interrogées par Human Rights Watch ont exprimé leurs inquiétudes quant aux répercussions sociales des viols. Elles ont décrit des membres de leur famille et de leur communauté qui leur ont reproché d’avoir été violées et les ont publiquement humiliées, y compris en les « pointant du doigt » ou en les traitant de tous les noms. Pour éviter une telle honte, les femmes et les filles ont souvent mentionné qu’elles n’ont pas fait état des violences sexuelles subies, ce qui a eu des conséquences importantes sur leur capacité à accéder à des soins médicaux et psychosociaux essentiels après un viol. Dans 66 cas documentés par Human Rights Watch, les femmes et les filles ont spécifiquement cité la peur de la stigmatisation ou du rejet comme facteur dissuasif pour chercher de l’aide.
Stigmatisation
Les femmes et les filles ont raconté à Human Rights Watch que leurs maris, leurs proches et les membres de la communauté leur ont reproché les viols, se sont moqués d’elles et les ont humiliées après les viols.
Michelle a expliqué que trois anti-balaka l’ont violée alors qu’elle rentrait au camp de M’poko après avoir acheté du bois en novembre 2015. Lorsque Human Rights Watch l’a interrogée en mai 2016, elle a dit qu’elle avait arrêté de sortir du camp, principalement en raison des railleries des autres habitants. « Il y a un changement dans ma vie », a-t-elle raconté. « Je ne peux plus faire ce que je faisais avant, parce que si je sors, les hommes dans notre zone ne font que se moquer de mon histoire. »[232]
Ayant été testée séropositive après son viol par des combattants de la Séléka en 2013, Danielle, 40 ans, a expliqué être confrontée à une double stigmatisation. « [Mes] proches savaient pour [le viol] et j’ai été stigmatisée par eux », a-t-elle décrit. « Certaines personnes me traitent souvent comme si j’étais très malade, donc je suis stigmatisée au camp de [déplacés] aussi. J’ai même été agressée sur le site. Certaines personnes ne me laissent pas sécher mes vêtements sur le fil à linge. »[233] On ignore si Danielle a contracté le VIH suite au viol, car elle ne connaissait pas son statut VIH avant les violences sexuelles.
Geneviève a raconté à Human Rights Watch que son mari l’a publiquement humiliée lorsqu’elle a été testée séropositive après que deux combattants de la Séléka l’ont violée à Bangui en décembre 2013. « [A]près l’analyse VIH, il a circulé dans le quartier et a déclaré qu’il était innocent », a-t-elle dit au sujet de son mari. « Il a expliqué [que mon statut VIH] n’était pas sa faute et qu’il n’avait pas le virus, [même s’]il n’a pas fait le test. Nous sommes toujours ensemble, mais ce n’est plus vraiment comme avant. »[234]
Dans plusieurs cas, les victimes ont indiqué que leurs proches les ont rendues responsables des violences. Yvette, 27 ans, a décrit subir la stigmatisation à la fois en public et à la maison après que deux combattants de la Séléka l’ont violée à Kaga-Bandoro au début de l’année 2013 :
J’ai été traumatisée parce que dans les rues, les gens disaient : « La voilà, la femme qui a été violée par les Séléka ». À la maison, mon mari a dit : « Tu as accepté que les Séléka te violent. Pourquoi n’as-tu pas crié ? Prends tes affaires et pars. »[235]
Même si les parents d’Yvette et une sage-femme ont convaincu son mari de rester avec elle, elle a indiqué qu’il rappelait souvent l’incident. « Nous sommes ensemble maintenant, mais chaque fois qu’il y a un petit problème, il évoque le viol », explique-t-elle. « Il dit : “Non, va-t’en, tu es la femme des Séléka.” Lorsqu’il dit ça, parfois je passe trois ou quatre jours sans manger et nous ne parlons pas. »[236]
Beaucoup de victimes ont indiqué qu’elles ne comptaient pas sur les membres de leur famille ou les travailleurs de la santé pour préserver la confidentialité. « Vous savez, dans les familles centrafricaines, il n’y a pas de secrets », a raconté Constance, 22 ans, qui a été violée par quatre combattants de la Séléka à Bangui en décembre 2013. « Les gens vont parler, parler partout. »[237] Après qu’Élise, 20 ans, a confié à sa belle-mère que des combattants de la Séléka l’avaient violée en octobre 2015, les railleries des membres de la communauté ont eut l’effet qu’elle craignait ensuite de sortir de chez elle :
Lorsque j’en ai parlé à [ma belle-mère], elle l’a raconté aux voisins. Quand je suis allée [chez elle], ils m’ont vue partir et ils se sont mis à se moquer de moi. J’avais honte. Lorsque je suis retournée au [camp] de M’poko, je suis allée directement à la maison. J’ai pleuré. Je n’ai rien fait d’autre que pleurer. J’avais des difficultés même pour sortir de la maison.[238]
Les victimes ont souvent expliqué à Human Rights Watch que la peur de la stigmatisation ou du rejet a joué un rôle dans la décision de ne pas consulter de prestataire de santé. Marianne, 30 ans, a indiqué que le manque de confidentialité l’a dissuadée de demander des soins médicaux après qu’un combattant de la Séléka l’a violée à Mbrès vers décembre 2014. « Je ne suis pas allée à l’hôpital », a-t-elle raconté. « J’ai pensé : [si] je vais à l’hôpital, je devrai leur expliquer et ils vont parler de moi et cela va devenir une blague. »[239]
Même quand les femmes et les filles ont cherché à obtenir des soins médicaux, la peur de la stigmatisation les a parfois dissuadées de révéler le viol aux travailleurs de la santé, les empêchant de recevoir des soins complets après un viol. Après que sept combattants anti-balaka l’ont violée par voie vaginale et anale à Bangui en décembre 2015, Colette, 22 ans, a raconté : « Je ne pouvais pas marcher ni m’asseoir. J’ai mal au ventre. Je vomis constamment. » Malgré cela, Colette n’a pas révélé la cause de sa douleur lorsqu’elle s’est rendue dans un centre de santé deux jours après le viol. Elle a expliqué :
J’étais préoccupée par le fait que, si je décidais de leur en parler, ils raconteraient le secret à tous mes amis. J’avais trop peur. [Les gens] vont me pointer du doigt, [dire] que je suis une victime du groupe armé. Ils ont fait ça à d’autres – parfois lorsque les anti-balaka arrêtent et frappent une personne, les autres commencent à montrer du doigt cette personne comme la victime des anti-balaka.[240]
Étant donné que les travailleurs de la santé ne savaient rien de son viol, Colette n’a pas reçu de traitement pour éviter le VIH ou une grossesse non désirée, malgré sa visite au centre de santé dans le délai nécessaire pour que ces médicaments soient efficaces.[241]
Abandon par les proches
La peur de la divulgation découle en partie du risque de rejet auquel sont confrontées les victimes. Human Rights Watch a interrogé 38 femmes et filles qui ont déclaré avoir été abandonnées par leurs maris, leurs partenaires ou des membres de leur famille après le viol.
Claire, 36 ans, a raconté que son mari l’a quittée dans le camp de déplacés après que deux combattants anti-balaka l’ont violée à Bangui, en octobre 2015. « Il m’a abandonnée pour aller dans une autre tente », a-t-elle expliqué. « Il a dit : “Je ne veux plus de toi”. »[242]
Rebecca, 36 ans, a décrit la réaction de son mari après qu’un combattant de la Séléka l’a violée hors de Kaga-Bandoro en décembre 2014. « Lorsque je suis arrivée [à la maison], mon mari m’a dit : “Ce n’est pas la peine que nous restions ensemble. Si un Séléka viole la femme d’un homme, il ne doit pas rester avec elle” », s’est-elle souvenue.[243]
Pour de nombreuses victimes, l’abandon est autant un poids financier qu’un fardeau émotionnel. Odile a indiqué que son mari l’a quittée elle, ainsi que leurs quatre enfants, dont trois de moins de 18 ans, après que deux combattants de la Séléka l’ont violée à Bangui en décembre 2013. « Mon mari a dit qu’il ne pouvait pas supporter d’être avec moi après le viol », a-t-elle raconté. « Je lui ai écrit pour lui demander de l’argent, mais il ne m’a rien donné. Je n’ai aucune ressource financière pour mes enfants. »[244]
Dans plusieurs cas, des femmes ont déclaré que l’abandon était lié à la peur des infections sexuellement transmissibles. Prudence, 28 ans, a indiqué à Human Rights Watch que son mari l’a quittée après que des anti-balaka l’ont gardée en esclavage sexuel pendant six mois à partir de juillet 2014. « Je ne veux pas ce que tu as dans ton corps », s’est-elle souvenue des propos de son mari.[245] Rachelle, 35 ans, a raconté que son mari l’a abandonnée après qu’elle a été violée par trois combattants de la Séléka à Bangui en décembre 2013, en disant qu’elle « allait lui donner des infections ».[246]
D’autres victimes ont déclaré que des tests de dépistage du VIH positifs après les viols ont conduit leurs maris ou partenaires à les quitter. « Lorsque [les médecins] ont fait les analyses, ils ont trouvé le SIDA et c’est alors que mon mari m’a abandonnée », a décrit Hélène, 35 ans, qui a été testée séropositive après que trois combattants anti-balaka l’ont violée à Kaga-Bandoro en 2014.[247]
Traumatismes physiques et psychologiques
Presque toutes les victimes interrogées par Human Rights Watch ont indiqué souffrir d’effets physiques et psychologiques continus suite aux violences sexuelles qu’elles ont subies. Dans certains cas, ceux-ci sont invalidants, voire mortels, que ce soit en raison d’une maladie et de blessures ou d’idées suicidaires. Même lorsque les conséquences physiques et psychologiques ne sont pas évidentes, les femmes et les filles ont expliqué que les violences sexuelles ont considérablement changé leurs vies.
Blessures et maladies
Quasiment toutes les femmes et les filles interrogées par Human Rights Watch ont décrit des douleurs abdominales, pelviennes et/ou dorsales continues suite aux violences sexuelles. Des recherches ont montré des liens entre les abus sexuels, en particulier le viol, et des symptômes physiques à long terme, y compris des douleurs pelviennes et d’autres douleurs chroniques et des troubles gastro-intestinaux chez les femmes victimes de violences sexuelles.[248]
Human Rights Watch a parlé à des victimes qui ont aussi décrit des douleurs vaginales ou rectales continues, dans certains cas lors de la miction ou des règles, ainsi qu’une incapacité à uriner ou aller à la selle normalement ou à avoir des relations sexuelles. De nombreuses femmes ont fait état de saignements vaginaux pendant ou après les violences sexuelles et de pertes vaginales anormales longtemps après.[249]
Martine, 32 ans, a indiqué qu’elle a eu mal lorsqu’elle allait aux toilettes et a senti sa santé se détériorer pendant six mois après que des combattants de la Séléka l’ont gardée captive et l’ont violée chaque jour pendant deux semaines en décembre 2013. Des voisins l’ont conduite à un hôpital de Bangui vers juin 2014, où un médecin a effectué une chirurgie abdominale d’urgence. « [Le médecin] a déclaré que mes intestins étaient totalement abîmés », a-t-elle dit. « C’était lié aux violences sexuelles. »[250]
Les femmes et les filles ont décrit d’autres symptômes, y compris des difficultés pour marcher, une vision altérée, des douleurs aux mâchoires, des vertiges, une perte de poids, des maux de tête, des battements cardiaques rapides, de la fièvre et d’autres douleurs, dont certaines résultaient probablement des blessures corporelles subies pendant les agressions. Marie-Claire, 26 ans, a raconté que quatre combattants anti-balaka l’ont frappée à coups de poing et l’ont giflée alors qu’ils la violaient en décembre 2013, entraînant des problèmes de vue permanents. « Lorsqu’ils ont commencé à me violer, ils m’ont frappée très fort au visage », a-t-elle décrit. « Après, j’avais les yeux rouges. Jusqu’à maintenant, je n’y vois pas bien. Parfois c’est comme si de l’eau coulait de mes yeux. »[251]
Une victime de viol a souffert d’une blessure à la tête qui, selon sa mère et elle, a entraîné un déficit cognitif. Ornella, 21 ans, a expliqué qu’elle revenait des champs de sa famille près de Mbrès en juillet ou en août 2015 lorsque trois combattants de la Séléka l’ont agressée, l’ont battue et l’ont entaillée à coups de machettes avant de l’emmener dans la brousse où ils l’ont violée à tour de rôle. Elle a montré à Human Rights Watch des cicatrices derrière l’oreille et dans le cou où elle a dit avoir été frappée avec un morceau de bois. « J’ai toujours des vertiges », a indiqué Ornella neuf mois après son agression. « [I]ls m’ont frappée au bassin, dans le dos. J’ai mal. »[252] La mère d’Ornella, qui a trouvé sa fille calée contre un arbre après l’agression, a décrit les blessures d’Ornella. « Elle avait des entailles de couteau sur la cuisse, derrière l’oreille, sur le tibia. Ils l’avaient frappée à la tête avec [un morceau de] bois », a-t-elle dit. « Elle avait un traumatisme crânien... Avant, elle n’avait pas de problèmes. Maintenant, quand vous dites quelque chose, elle l’oublie vite. Elle ne réfléchit pas bien. »[253]
La mère d’Ornella a expliqué comment la blessure à la tête de sa fille a modifié leur vie :
Avant, elle était en bonne santé. Elle m’accompagnait aux champs, elle allait acheter des marchandises. Depuis, elle ne peut plus sortir seule. Je dois l’accompagner partout à cause de son traumatisme... Je n’ai pas les moyens de prendre soin d’elle. Que vais-je faire ?[254]
Fausses couches et complications pendant la grossesse
Les combattants de la Séléka et anti-balaka ont sciemment commis des viols sur des femmes et des filles enceintes. Vingt-six femmes et une fille ont indiqué à Human Rights Watch que des combattants les ont violées alors qu’elles étaient enceintes. Huit victimes ont expliqué qu’elles ont connu des complications pendant leur grossesse suite aux violences sexuelles, dont six ont déclaré avoir fait une fausse couche.
Zeinaba, âgée d’environ 16 ans, a indiqué qu’elle était enceinte de trois mois lorsque des combattants anti-balaka l’ont détenue pendant une semaine près de Boda en février ou en mars 2014. Les anti-balaka l’ont violée et agressée physiquement, ce qui, a-t-elle raconté, a provoqué une fausse couche :
Dans la forêt, un d’eux m’a donné un coup de pied dans le bassin. Le sang a commencé à couler... J’ai dit que j’étais enceinte. Ils ont répondu qu’ils n’en avaient rien à faire. Lorsque je suis arrivée à la base des [anti-balaka], j’avais mal au bassin. Deux jours plus tard, j’ai fait une fausse couche... Je leur ai dit que j’avais mal et que j’étais enceinte. Ils ont répondu : « Si tu donnes naissance à un garçon, nous le tuerons le lendemain ». Ils ont su quand j’ai fait la fausse couche. Il y avait du sang, il trempait mes vêtements… Ils n’ont pas réagi.[255]
Émilie, 25 ans, a aussi dit qu’elle a perdu son bébé après avoir été violée par des combattants de la Séléka à Bambari en décembre 2015. « Quand ils m’ont violée, j’étais enceinte de quatre mois », a-t-elle relaté. « À cinq mois et demi, l’enfant est né. Il était mort-né. »[256]
VIH et autres infections sexuellement transmissibles
Beaucoup de femmes et de filles ont raconté à Human Rights Watch qu’elles étaient préoccupées par la possibilité d’avoir contracté des infections sexuellement transmissibles suite aux viols, notamment le VIH. D’après l’agence de l’ONU sur le VIH et le SIDA (ONUSIDA), le taux de prévalence du VIH en 2015 chez les personnes âgées de 15 à 49 ans en République centrafricaine était de 3,7 pour cent.[257]
Quinze femmes ont raconté à Human Rights Watch qu’elles ont été testées séropositives après avoir été violées. Même si elles attribuent la contraction du VIH au viol, il est impossible de confirmer à quel moment elles ont été infectées, car leur statut VIH immédiatement avant le viol n’était pas connu. Des chercheurs ont constaté que les violences basées sur le genre, notamment les agressions sexuelles violentes, augmentent le risque d’infection par le VIH, en partie à cause de la probabilité de lésions et d’abrasions des parties génitales.[258]
Seules 92 victimes sur les 296 interrogées par Human Rights Watch ont déclaré avoir effectué un test de dépistage du VIH après avoir subi des violences sexuelles. Là encore, les tests étaient souvent peu concluants, car ils n’ont pas été réalisés de manière répétée ou après le délai nécessaire pour déterminer l’infection. Pour beaucoup de victimes, le statut VIH reste une des principales inquiétudes. Lucie, 28 ans, qui a été violée par un combattant de la Séléka à Bangui en 2013, a fait écho à de nombreuses femmes et filles quand elle a dit qu’elle se posait en permanence des questions sur sa santé : « Je me demande : “Est-ce qu’il m’a transmis le SIDA ? Quelle [autre] maladie ? Comment est ma santé ? Vais-je mourir bientôt ?” »[259]
Quatre femmes et une fille ont indiqué avoir été testées positives pour des infections sexuellement transmissibles (IST), y compris la syphilis et la gonorrhée, après les violences sexuelles. Beaucoup d’autres ont expliqué à Human Rights Watch qu’elles avaient des symptômes évocateurs d’une infection, mais qu’elles n’ont pas reçu de soins médicaux ni subi de test de dépistage d’IST.
Grossesses non désirées
Human Rights Watch s’est entretenu avec 13 victimes, dont trois filles, qui ont déclaré être tombées enceintes suite aux viols. Une autre victime a indiqué qu’elle n’avait pas eu de règles depuis les violences le mois passé et que ses règles avaient environ trois semaines de retard, mais qu’elle n’avait pas fait de test de grossesse. Les victimes détenues en tant qu’esclaves sexuelles ont dit qu’elles savaient qu’au moins cinq autres femmes et filles étaient tombées enceintes pendant leur captivité.
La plupart des victimes qui ont eu des bébés nés des viols ont raconté que les enfants leur rappellent les violences. « Mon [fils] est un enfant de la Séléka », a dit Clarice, 37 ans, qui a subi des viols répétés par plusieurs combattants de la Séléka pendant une année de captivité à Bambari qui a démarré en juin 2014.[260] « Lorsque je vois le bébé, je ne peux pas m’empêcher de me rappeler comment je suis tombée enceinte. »
Certaines victimes ont parlé à Human Rights Watch de la stigmatisation supplémentaire à laquelle elles sont confrontées en raison des grossesses issues des viols. Angèle, 27 ans, a indiqué qu’elle est tombée enceinte quand des combattants de la Séléka l’ont violée de manière répétée pendant neuf mois de captivité près de Bambari à partir d’octobre 2014 environ. Elle a expliqué comment sa famille l’a rejetée, ce qui l’a conduite à avoir des pensées suicidaires :
[Les membres de] ma famille savent [pour les viols] et ils ont dit que ce n’était pas leur problème... Ils ont dit que je me suis mise dans le pétrin et que j’ai donné naissance à un bébé sans père et que je devais retourner à Bambari pour trouver le père... J’ai passé deux mois à Bangui. Personne dans ma famille ne m’a aidée... J’ai pensé que le bébé devait mourir ou que je devais mourir avec le bébé.[261]
Évelyne avait environ 15 ans lorsqu’un combattant anti-balaka l’a violée près de Boda vers mai 2015. Elle avait un bébé de deux mois né du viol lorsque Human Rights Watch s’est entretenu avec elle en avril 2016. Sa mère et son père ont été tués pendant la crise et, depuis la naissance de son enfant, elle a indiqué que les membres de la communauté à Boda se moquent d’elle :
Quand les gens ont appris, ils ont dit : « Tu es orpheline. L’homme qui a fait ça, va-t-il assumer ses responsabilités envers toi ? »... Certains se moquent de moi et disent que je suis tombée enceinte d’un père qui n’existe pas. Je leur demande pardon.[262]
Les victimes qui ont eu un bébé suite au viol ont souvent décrit ressentir une pression financière accrue. Rachida, 25 ans, était enceinte de huit mois lorsqu’elle a été interrogée par Human Rights Watch en décembre 2015 après que cinq anti-balaka l’ont détenue comme esclave sexuelle pendant trois semaines à Bangui. Elle a expliqué qu’elle vivait sous une bâche dans un camp de déplacés dans la capitale. « Des gens me donnent un peu d’argent », a-t-elle raconté. « Le jour oùj’accoucherai, je mettrai ma vie entre les mains de Dieu. Je n’ai même pas une layette. »[263]
Même si l’avortement est légal en cas de viol en République centrafricaine, il reste des obstacles considérables pour y accéder, même pour les victimes de violences sexuelles (voir « Difficultés d’accès à l’avortement »). Béatrice, 18 ans, a indiqué à Human Rights Watch qu’un membre des anti-balaka a tué sa mère et sa tante puis l’a violée à plusieurs reprises près de Bouca vers novembre 2015. Interrogée près de trois mois plus tard, elle était enceinte suite aux viols et voulait avorter, mais elle n’a pas eu accès à des soins médicaux et ne savait pas comment faire. « Que vais-je faire avec ce bébé ? » a demandé Béatrice. « Je n’en veux pas. Qui s’occupera de lui ? Toute ma famille est morte et j’attends le bébé d’un meurtrier. »[264] Sophie, 22 ans, a réalisé qu’elle était enceinte alors qu’elle se trouvait dans un village après avoir fui l’esclavage sexuel aux mains de combattants de la Séléka à Bambari en 2014. Elle s’est souvenue :
Je me suis dit : « Si j’avais des médicaments, j’avorterais. Mais comme je n’y connais rien, je dois rester comme ça jusqu’à ce que j’accouche. » Je ne suis pas allée à l’hôpital. Je n’ai reçu aucun soin médical jusqu’à l’accouchement. Le village disposait d’un centre de santé, mais il n’y avait personne – tout le monde était parti.
Sophie a raconté qu’elle s’inquiétait de savoir comment elle subviendra aux besoins du bébé et que le viol la hantait. « Quand je vois des hommes passer, je me demande si, peut-être, ce sont les hommes qui m’ont [violée]. »[265]
Traumatisme, détresse émotionnelle et risque de suicide
Presque toutes les victimes interrogées par Human Rights Watch ont indiqué qu’elles ressentaient des symptômes correspondant au traumatisme, à la dépression et au stress post-traumatique, y compris insomnie, cauchemars, anxiété ou crises de panique, pleurs fréquents, apathie, incapacité à se concentrer et fait de revivre mentalement l’expérience traumatisante.[266] Dans certains cas, les victimes ont confié qu’elles avaient envisagé de se suicider.
Comme beaucoup de victimes interrogées par Human Rights Watch, Carole, 25 ans, a raconté que les souvenirs de son viol en 2013 par des combattants de la Séléka à Bangui la hantent. « Je le revis dans mon esprit comme un film », a-t-elle indiqué.[267] Henriette, 50 ans, qui a dit avoir été détenue par la Séléka comme esclave sexuelle pendant trois mois à partir de mai 2014 environ, a exprimé ce que beaucoup de victimes ont signalé à Human Rights Watch, en disant : « Je ne dors pas la nuit à cause des violences que j’ai vécues. Et si j’essaie de dormir, le sommeil ne vient pas. »[268]
Prudence, 28 ans, a décrit comment sa vie a changé après que des combattants anti-balaka l’ont détenue comme esclave sexuelle pendant six mois à partir de juillet 2014. « Avant, quand je n’étais pas une victime, j’étais tranquille », a-t-elle indiqué. « Je ne pense à rien d’autre que le fait d’être tombée aux mains des groupes armés. »[269]
Sabine, 43 ans, a expliqué qu’elle a vu les combattants anti-balaka trancher la gorge de son mari et qu’elle a passé presque sept mois comme « épouse » d’un commandant à partir de juillet 2014 environ. Après sa libération en février 2015, elle était trop effrayée pour sortir du quartier musulman de Bangui afin d’accéder à des soins de santé. « J’ai l’impression qu’il y a des groupes armés qui pourraient venir m’emmener à nouveau », a-t-elle indiqué. « Maintenant, je ne sais plus si on est samedi ou dimanche. Je ne sais pas quel jour on est, ni quelle est la date. »[270]
Sept victimes ont décrit avoir des pensées suicidaires. Aimée, 23 ans, a expliqué qu’un combattant de la Séléka l’a violée et a menacé de la tuer à Bangui en mars 2013. « Quand je pense à ça, je ne veux plus vivre », a-t-elle confié.[271]
Les expériences de stigmatisation ou de rejet ont exacerbé le désespoir des victimes. Zara a raconté que des combattants anti-balaka l’ont violée et torturée dans les environs de Bangui pendant deux jours en juillet 2014. Après sa libération, son mari l’a abandonnée et les membres de la communauté l’ont montrée du doigt :
Lorsque j’ai été relâchée par [les anti-balaka], je voulais me tuer et tuer aussi mes enfants. Quand je marche dans le quartier, je ne suis plus traitée comme avant... Ma vie n’a plus de sens. Lorsque je pense à tout ce qu’ils m’ont fait, les anti-balaka qui m’ont tout pris... J’ai toujours dans la tête la pensée de me tuer.[272]
Des victimes ont aussi déclaré qu’elles sont assaillies de préoccupations quant à l’état émotionnel de leurs enfants qui ont été témoins des violences qu’elles ont subies. Louise a expliqué que ses sept enfants – alors âgés de 8 à 19 ans – ont vu quatre combattants de la Séléka la violer et tuer son mari à Bangui en décembre 2013. « Ils ont tout vu », a-t-elle dit. « Deux de mes enfants ne vont pas bien dans leur tête depuis. »[273]
Le fils de cinq ans de Giselle, 28 ans, a assisté au viol de sa mère par deux combattants de la Séléka en décembre 2013. « Je continue à penser à l’acte et quand je vois mon enfant, je pense au fait qu’il était juste à côté de moi quand j’ai été violée », a-t-elle raconté.[274]
Même lorsque des femmes ont eu accès à des soins psychosociaux elles-mêmes – ce qui était peu fréquent (voir « Obstacles pour accéder aux services médicaux et psychosociaux ») – elles ont indiqué de manière cohérente que leurs enfants n’ont pas reçu de tels soins. Un psychologue travaillant avec une ONGI a exprimé des inquiétudes sur le manque de soutien psychosocial pour les enfants qui ont été témoins de violences, y compris le viol, et sur l’impact durable que cela pourrait avoir sur la société centrafricaine.[275]
Perte des moyens de subsistance et de l’accès à l’éducation
Certaines victimes ont dit que les violences sexuelles ont directement influencé leur capacité à travailler, à subvenir aux besoins de leur famille ou à aller à l’école. Souvent cela était dû à la peur, au sentiment accru de vulnérabilité face à de nouvelles violences et, par conséquent, aux restrictions de la liberté de mouvement. Dans d’autres cas, les violences sexuelles ont eu lieu en même temps que des vols, des pillages ou des déplacements forcés qui ont conduit à des pertes de moyens de subsistance et à un abandon de l’école par certaines filles. Non seulement ces limites ajoutent aux contraintes financières des victimes et de leurs familles, mais elles réduisent l’indépendance et l’auto-suffisance des femmes et des filles.
Impact sur les moyens de subsistance
Du fait des incidents de violences sexuelles, de nombreuses victimes ont peur de mener des activités quotidiennes cruciales pour leurs moyens de subsistance. Des victimes qui auparavant subvenaient à leurs besoins et à ceux de leur famille ont expliqué à Human Rights Watch que les violences ont limité leur autonomie.
Dans certains cas, des femmes ont indiqué que l’incapacité à poursuivre des activités génératrices de revenus les a rendues dépendantes d’autres personnes pour satisfaire leurs besoins essentiels. « Quand j’étais chez moi, j’avais une petite activité : je faisais des gâteaux et d’autres choses », a dit Clarice, 20 ans, de sa vie avant qu’elle ne soit violée par six combattants anti-balaka à Bangui en octobre 2015. « Depuis les violences, j’ai peur. Maintenant, je ne sors plus. C’est ma tante qui me nourrit. »[276]
Florence, 32 ans, vendait des légumes à Bangui et a expliqué qu’elle a arrêté de travailler après avoir été violée par un combattant de la Séléka alors qu’elle se rendait au marché en mars 2013. Son mari l’a abandonnée et elle n’a pas d’argent pour acheter des légumes, a-t-elle ajouté. « J’étais grande, j’étais une vendeuse », a-t-elle raconté. « Maintenant, je ne suis plus cette personne. »[277]
De nombreuses femmes qui ont parlé avec Human Rights Watch ont souligné leur nécessité d’une assistance économique autant que médicale, psychosociale et légale. Geneviève, 33 ans, a raconté qu’elle lutte pour faire vivre son mari qui ne travaille pas et pour payer les médicaments dont elle a besoin depuis son test positif au VIH après le viol. « J’étais une femme d’affaires avant tout cela, et ma vie a été ruinée », a-t-elle déclaré. « J’ai besoin d’aide pour repartir dans la vie. »[278]
Accès à l’éducation
Six filles ont indiqué que les violences sexuelles ont interrompu leur éducation, soit temporairement soit à long terme, en raison de la peur de la stigmatisation, de l’insécurité ou de nouvelles violences.
Patricia, 15 ans, était en sixième année à l’école primaire (l’équivalent de la sixième en France à peu près) lorsque deux combattants anti-balaka l’ont violée et l’ont détenue pendant deux jours à Bangui en avril 2016. Après cela, elle a dit qu’elle n’était pas retournée à l’école en raison de la stigmatisation :
Ma grand-mère a expliqué [que j’ai été violée] à son amie et je suis dans la même classe que sa petite-fille... Ils ont parlé de moi, [en disant] que j’étais la femme d’un anti-balaka et ils ont commencé à rire.[279]
Djamila et Fatima, deux sœurs âgées de 13 et 17 ans, ont indiqué qu’elles ne sont pas retournées à l’école depuis que des combattants anti-balaka les ont violées à Bangui en septembre 2015. Elles ont raconté que leur père ne leur permettait pas de retourner à leur ancienne école par crainte pour leur sécurité et que la famille n’avait pas les moyens de payer les frais de scolarité dans le camp de déplacés où ils vivaient maintenant. Djamila, 13 ans, a expliqué qu’elle et sa sœur ne quittent plus l’enceinte du camp.[280]
Évelyne, âgée de 16 ans environ, a déclaré que sa famille lui a interdit d’aller à l’école lorsqu’elle est tombée enceinte après avoir été violée par un combattant anti-balaka près de Boda vers mai 2015. « J’étais très fâchée parce que je ne pouvais pas aller à l’école », a-t-elle confié. « Ma tante a refusé. Elle a dit que je devais d’abord accoucher. »[281] Évelyne est retournée à l’école après la naissance de l’enfant, mais elle a dit qu’elle n’est plus capable de se concentrer parce qu’elle est inquiète pour le bébé qui reste à la maison.[282]
IV. Accès aux services pour les victimes de violences sexuelles
Les femmes et les filles ayant survécu à des violences sexuelles sont confrontées à d’immenses difficultés pour accéder à des services médicaux, psychosociaux et légaux après un viol en République centrafricaine. En plus de la stigmatisation et du rejet décrits plus haut, ces survivantes ne connaissent pas bien ces services et y ont un accès restreint ou pensent que les coûts associés aux services sont prohibitifs. Lorsqu’elles parviennent à accéder à ces services, ceux-ci ne sont pas toujours exhaustifs ou adaptés à leurs besoins.
Les normes internationales appellent explicitement à la fourniture de services médicaux et psychosociaux complets aux victimes de violences sexuelles dans des contextes humanitaires. La prise en charge clinique du viol devrait inclure une prophylaxie post-exposition (PPE) pour la prévention du VIH, un traitement des autres infections sexuellement transmissibles (IST) et la disponibilité d’une contraception d’urgence, le tout avec le consentement éclairé de la victime.[283] La réponse aux violences sexuelles devrait aussi comporter l’orientation vers des services psychosociaux et de santé mentale et l’accès à ceux-ci.[284] Les prestataires de services devraient proposer des soins aux victimes de violences sexuelles d’une manière bienveillante, confidentielle et qui protège les informations sensibles et devraient s’assurer aussi vite que possible que les membres de la communauté savent comment, où et pourquoi accéder aux soins après un viol.[285] Ces principes de fourniture de soins sont aussi exposés dans les Procédures opérationnelles standards pour la prévention et la réponse à la violence basée sur le genre en République centrafricaine (POS VBG), un accord élaboré par des acteurs VBG clés dans le pays et signé par le gouvernement, les ONGI, les ONG et les agences de l’ONU, y compris l’UNFPA, l’UNICEF, l’OMS et certaines divisions de la MINUSCA.[286] Human Rights Watch a constaté que les prestataires de services en République centrafricaine ne respectaient pas de manière uniforme ces directives.
Obstacles pour accéder aux services médicaux et psychosociaux
Parmi les 296 victimes de violences sexuelles interrogées pour ce rapport, moins de la moitié – 145 – avaient eu accès à des soins médicaux avant d’être interrogées par Human Rights Watch. Parmi celles-ci, seules 83 ont confirmé avoir révélé les violences sexuelles aux prestataires de soins de santé, permettant ainsi des soins médicaux après un viol complets, y compris une PPE pour la prévention du VIH et une contraception d’urgence pour éviter une grossesse non désirée. Cependant, parmi celles qui ont révélé avoir été violées, beaucoup ont dit que les prestataires de services ne leur ont pas proposé les éléments indispensables des soins après un viol, y compris une PPE, un test de dépistage du VIH et d’autres IST et un soutien psychosocial.
Les prestataires de services et les victimes ont déclaré que, parmi les victimes qui ont accédé à des soins après un viol, très peu l’ont fait immédiatement. L’ONU a rapporté que du fait que « les services de santé font défaut et que le coût des déplacements depuis les régions reculées est prohibitif », en 2016 seuls 32 pour cent des victimes de violences sexuelles en République centrafricaine ont eu accès à une assistance dans les 72 heures en 2016, délai dans lequel la PPE doit être administrée suite à une exposition au VIH, « car les services de santé font défaut et le coût des déplacements depuis les régions reculées est prohibitif ».[287] Seules 41 des victimes interrogées par Human Rights Watch ont confirmé avoir eu accès à des soins médicaux dans les 72 heures après le viol. Alors que certaines formes de contraception d’urgence peuvent être efficaces jusqu’à cinq jours maximum et que les directives nationales sur la prévention de la grossesse en cas de viol adhèrent à ce délai, certains prestataires de soins de santé en République centrafricaine ont raconté à Human Rights Watch qu’ils la prescrivent uniquement dans les 72 heures ou dans une période de trois jours après un viol.[288]
Un médecin dans une ONGI à Boda a déclaré que la peur de la honte et des représailles empêche les victimes d’accéder à des soins rapidement.[289] Des victimes et même des prestataires de services ignorent également que des interventions médicales cruciales sont disponibles, mais qu’elles doivent être réalisées dans un délai spécifique. Comme l’a fait remarquer un travailleur de la santé d’une ONGI : « Même les travailleurs de la santé ne savent pas l’importance de se présenter dans les 72 heures ».[290]
Manque de services disponibles
Les victimes sont confrontées au défi supplémentaire de naviguer dans un système de soins de santé largement détérioré. Le système de soins de santé en République centrafricaine opère à trois niveaux : périphérique ou local, comprenant les postes de santé et les centres de santé, qui servent de premier point d’accès aux soins, et les hôpitaux de district, qui servent de premier point d’orientation pour une ou plusieurs sous-préfectures ; intermédiaire ou régional, incluant les hôpitaux régionaux couvrant plusieurs districts de santé qui constituent le deuxième niveau d’orientation pour une région de santé ; et central, qui inclut les hôpitaux nationaux et les universités dans la capitale et la fourniture de soins plus spécialisés.[291] Un fonctionnaire du ministère de la Santé a expliqué à Human Rights Watch que les établissements de santé à Bangui peuvent offrir des soins après un viol, y compris une PPE, une contraception d’urgence et des antibiotiques, mais que la fourniture de ces services reste difficile hors de la capitale, où les ONG gèrent la majorité des soins après un viol.[292]
Même si le gouvernement s’est engagé en décembre 2012 à travailler avec l’ONU pour offrir « une meilleure prise en charge de base de ces personnes, y compris la gestion clinique des cas de viol et le soutien psychosocial », les dégradations des établissements de santé et l’insécurité généralisée ont conduit à une disponibilité réduite de tous les services de santé depuis 2013.[293] En 2015, l’Organisation mondiale de la Santé a rapporté que 34 pour cent des établissements de santé ont été détruits en partie ou en totalité, que la moitié des établissements de santé secondaires en fonctionnement ne pouvaient pas fournir de soins de traumatologie et que 43 pour cent du personnel des structures de santé étaient des travailleurs de santé communautaires sans formation cohérente.[294] Le ministère de la Santé a noté que seuls 10 centres de dépistage volontaire du VIH et d’IST sur 21 à l’échelle nationale étaient encore opérationnels en 2015.[295]
Même les services qui fonctionnent opèrent de manière intermittente en raison de l’insécurité. Un médecin dans un centre de santé dans le quartier PK5 de Bangui, par exemple, a expliqué que la clinique a fermé de décembre 2013 à janvier 2014 et à nouveau en mars 2014 en raison des combats. Il a indiqué que pendant ces périodes : « Il était impossible à toute personne de venir [à la clinique]. Nous ouvrons, la situation dégénère et nous fermons. »[296] Lors des périodes d’ouverture, la clinique n’était toujours pas en mesure de fournir des soins 24 heures sur 24, en mai 2016. « Nous travaillons uniquement le jour en raison de l’insécurité continue », a-t-il poursuivi. « [La nuit], la victime doit se rendre ailleurs. »[297]
Une sage-femme à l’hôpital de Kaga-Bandoro a également raconté à Human Rights Watch en mai 2016 que l’insécurité empêchait le personnel de fournir des services 24 heures sur 24, ce qui pouvait retarder les soins urgents après un viol. « Avant, lorsque des personnes se présentaient la nuit, nous sortions [de l’hôpital] », a-t-elle indiqué. « Mais maintenant, nous ne pouvons plus pour notre propre sécurité. »[298]
Certaines victimes ont déclaré que les établissements de santé n’étaient pas opérationnels au moment des viols. Mélanie, 31 ans, n’a pas reçu de soins de santé immédiatement après que deux combattants de la Séléka l’ont violée en mai 2017, parce qu’« à Alindao, il n’y avait pas d’hôpital », a-t-elle dit « Il avait été saccagé. »[299] Catherine, 25 ans, a décrit avoir essayé d’accéder à des soins de santé après avoir été violée par deux combattants anti-balaka près de Mbrès en janvier 2015. « Quand je suis arrivée au centre de santé à Blakadja, à cause de la crise, il n’y avait pas de personnel médical, pas de médicaments », s’est-elle souvenue. « Mais ils m’ont donné des comprimés pour la douleur. Je n’y ai trouvé aucun personnel, uniquement le gardien. Il m’a donné une ordonnance. »[300]
Plusieurs victimes à Boda ont indiqué à Human Rights Watch qu’elles n’ont pas pu accéder à des soins de santé après leur viol parce que l’hôpital ne fonctionnait pas. « En 2014, il y a eu un problème parce que beaucoup de femmes ont été violées », a signalé une sage-femme de l’hôpital de Boda. « Mais comme il n’y avait pas d’hôpital et qu’elles n’ont pas été informées [sur où aller], elles n’ont rien pu faire d’autre que de rester tranquilles. »[301] Le directeur de l’hôpital de Boda a confirmé que l’insécurité a entraîné la fermeture de l’hôpital entre le 29 décembre 2013 et le 30 mars 2014, et les services n’ont repris entièrement qu’à partir de juin 2014.[302]
Lorsque les établissements de santé étaient opérationnels, l’insécurité a parfois empêché des femmes et des filles d’accéder à des soins ou des services de suivi. Estelle a expliqué qu’elle était enceinte de trois mois lorsque des combattants anti-balaka l’ont violée en janvier 2014. Après le viol, elle est allée au camp de déplacés de la mosquée centrale à Bangui, où elle a fait une fausse couche. Elle a déclaré que le camp n’avait pas d’installations médicales et qu’elle ne pouvait pas partir pour se rendre à l’hôpital en raison de l’insécurité. En tant que musulmane, elle était particulièrement effrayée de se déplacer dans Bangui. « Si vous sortez [du camp de PDI] pour aller à l’hôpital, ils vous tueront », a-t-elle dit.[303]
Coûts des soins de santé après un viol
Cinquante-trois femmes et filles ont raconté à Human Rights Watch que les coûts, y compris pour les consultations, les médicaments et le transport vers et depuis les services, ont fait obstacle à leur accès à des soins médicaux. Les directives sur les violences basées sur le genre publiées par le Comité permanent interorganisations (IASC), mécanisme de coordination de l’assistance humanitaire entre agences parmi tous les acteurs clés, recommandent aux établissements de santé de proposer des services gratuits ou à prix réduit aux victimes de violences sexuelles et autres violences basées sur le genre.[304] Les POS VBG adoptées par les ministères du gouvernement, les agences de l’ONU et les ONGI pour la République centrafricaine appellent à des soins après un viol gratuits.[305] Des prestataires de soins à l’hôpital de l’Amitié, à l’hôpital communautaire, à l’hôpital Castor, à l’hôpital général et au centre de santé Mamadou Mbaïki à Bangui, et dans les hôpitaux de Bambari, Boda et Kaga-Bandoro, ont déclaré à Human Rights Watch qu’ils offrent des soins après un viol gratuitement, souvent avec le soutien d’ONGI.
Un fonctionnaire du ministère de la Santé a indiqué à Human Rights Watch que les établissements de santé offrent des soins après un viol gratuits, mais le manque de familiarité des victimes avec ces services fait obstacle à l’accès :
Nous avons mené des campagnes de sensibilisation sur les radios publiques et privées, mais malgré ça, des femmes se rendent au mauvais endroit et finissent par penser qu’elles doivent payer. Les soins sont gratuits pour les enfants jusqu’à cinq ans et pour les femmes enceintes, et certaines femmes sont déconcertées et pensent que les victimes de viol ne sont pas prises en charge, mais elles le sont. Les soins sont gratuits, elles ne vont simplement pas au bon endroit.[306]
Cependant, plusieurs victimes qui ont révélé avoir subi des violences sexuelles aux personnels de santé ont raconté à Human Rights Watch que les prestataires de soins ont demandé un paiement pour les examens, les tests ou les médicaments.
Des victimes à Kaga-Bandoro ont indiqué à Human Rights Watch que le personnel hospitalier a exigé des honoraires pour les consultations et les traitements. Lorraine, 30 ans, a décrit ce qu’il s’est passé lorsqu’elle s’est rendue à l’hôpital de Kaga-Bandoro à deux reprises, environ un an après avoir été violée par des combattants de la Séléka en avril 2015 :
Ils m’ont dit de payer les médicaments et je n’ai pas les moyens. C’était pour les injections, les sérums, les antibiotiques – 4 500 francs CFA (7,67 dollars US), 2 500 francs CFA (4,26 dollars US)... [Le médecin] a fait un examen. Il a dit que j’avais des blessures internes. Je lui ai signalé le viol. Ils n’ont pas fait de test de dépistage du VIH. Il m’a dit que pour faire un test du VIH, je devais payer 1 500 francs CFA (2,56 dollars US).[307]
Lydie, 38 ans, a raconté qu’elle a parlé avec une infirmière à l’hôpital de Kaga-Bandoro après que cinq combattants de la Séléka l’ont violée vers janvier 2013, mais elle n’a pas révélé le viol à cause des honoraires :
Ils m’ont demandé de payer pour le livret médical – 100 francs CFA (0,17 dollar US) et la consultation – 1 000 francs CFA (1,72 dollar US) et je n’avais pas les moyens... Je n’ai pas expliqué ce qu’il s’était passé parce que je n’ai pas payé la consultation. Si j’avais payé la consultation, j’aurais tout expliqué.[308]
Malgré ces témoignages de victimes, le personnel hospitalier de Kaga-Bandoro a déclaré à Human Rights Watch qu’il fournit des soins médicaux gratuits après un viol à toutes les victimes.[309]
Des victimes à Bangui ont expliqué que le personnel de différents établissements de santé a aussi demandé un paiement pour les tests ou les médicaments et, dans certains cas, n’a pas fourni de soins complets après un viol. Patricia, 15 ans, a indiqué qu’elle a signalé son viol au personnel de l’hôpital communautaire de Bangui, mais sa grand-mère a dû payer 500 francs CFA (environ 0,86 dollar US) pour les médicaments et le personnel a dit qu’elle devait payer pour faire un test de dépistage du VIH. « Je n’ai pas encore fait de test du VIH », a-t-elle raconté en mai 2016. « C’est un problème d’argent, pour [payer le] transport et payer les examens. »[310] Patricia a précisé qu’elle n’avait plus ses règles depuis les viols, mais le personnel hospitalier n’a pas procédé à un test de grossesse.[311]
La simple possibilité de devoir payer les services a dissuadé certaines victimes d’accéder à des soins médicaux. Expliquant pourquoi elle n’avait pas cherché de soins médicaux après avoir été violée par deux combattants de la Séléka à Mbrès en avril 2015, Élodie, 39 ans, a raconté : « Je ne parviens pas à manger. Si je veux acheter de la nourriture, je dois chercher du petit bois et le vendre. [L’hôpital] coûtera de l’argent. »[312]
Même lorsque les services étaient gratuits, les victimes ont parfois signalé qu’elles ne pouvaient pas payer le coût du transport vers les établissements de santé. Fleure, par exemple, a dit : « Je veux aller à l’hôpital, mais je n’ai pas d’argent. J’ai un problème pour [payer] le transport ainsi que le traitement. »[313]
Bien que des prestataires de services aient indiqué que le gouvernement a accepté de proposer des tests de dépistage du VIH gratuits pour les victimes de viol et un traitement antirétroviral (ARV) gratuit pour les patientes séropositives, quelques prestataires de soins médicaux et victimes ont fait part à Human Rights Watch d’obstacles pour y accéder.[314] Dans certains cas, des victimes ont dit qu’on leur avait demandé de payer les tests de dépistage du VIH ou qu’elles pensaient devoir payer.
Aimée, 22 ans, a signalé que les problèmes financiers l’ont empêchée de faire un test de dépistage du VIH après que trois Mbororo armés l’ont violée près de Kaga-Bandoro en décembre 2015. Son mari l’a qualifiée de « contaminée » après le viol et l’a abandonnée, mais elle a pensé que le coût d’un test de dépistage du VIH serait prohibitif. « J’ai peur parce que je n’ai pas fait d’examen pour savoir si je suis infectée » a-t-elle expliqué. « Je ferais bien le test, mais il [faudrait] que je paie 1 500 francs CFA (environ 2,29 dollars US). »[315]
Les problèmes financiers ont aussi dissuadé certaines victimes séropositives d’obtenir des soins. Agathe, 50 ans, a raconté qu’elle a été testée séropositive après que trois combattants de la Séléka l’ont violée à Bambari en juillet 2014. Elle a indiqué qu’elle s’inquiète de sa santé, mais aussi de savoir comment elle achètera des médicaments alors qu’elle peut à peine acheter de quoi manger. « Ils m’ont dit de venir au centre de dépistage du VIH pour les médicaments » a-t-elle expliqué. « J’ai répondu : “Je suis déjà en train de mourir. Pourquoi devrais-je venir me procurer des médicaments à l’hôpital ?”... [Q]uand je prendrai les médicaments, j’aurai faim. Comment vais-je manger ? »[316]
Au moins une victime a raconté qu’après une période initiale de six mois de médicaments gratuits, elle a dû commencer à payer les ARV.[317] Plusieurs victimes ont aussi mentionné que des pénuries de stock d’ARV les ont empêchées de suivre leur traitement pendant certaines périodes.
Manque de soins exhaustifs après un viol
D’après le protocole sur la prise en charge clinique du viol en République centrafricaine accepté par le ministère de la Santé, l’Organisation mondiale de la Santé (OMS), le Fonds des Nations Unies pour l’enfance (UNICEF), le Fonds des Nations Unies pour la population (UNFPA) et le Programme des Nations Unies pour le développement (PNUD), les soins médicaux pour les victimes de viol devraient inclure, avec le consentement de la patiente, un soin des plaies, un traitement de la douleur, des antibiotiques pour prévenir et traiter les infections sexuellement transmissibles, des vaccins contre le tétanos et l’hépatite B, et un dépistage du VIH. Le protocole appelle aussi au traitement avec une PPE lorsque les victimes se présentent dans les 72 heures après un viol et avec une contraception d’urgence pour celles qui arrivent dans les cinq jours (120 heures) après un viol. Le protocole existant ne fait pas mention de test de grossesse, d’accès à un avortement sûr pour les femmes enceintes du fait d’un viol ni d’orientations vers des services psychosociaux, légaux ou d’autres services d’assistance.[318]
Plusieurs femmes et filles qui ont révélé, dans les établissements de santé, avoir subi des violences sexuelles ont indiqué à Human Rights Watch que le personnel de santé n’a pas proposé de soins complets après un viol ou ne les a pas orientées ailleurs pour ces soins, incluant PPE, contraception d’urgence, examens physiques et tests de grossesse, de dépistage du VIH et d’autres infections sexuellement transmissibles.
Nicole a raconté qu’elle est allée à la clinique au camp de déplacés du monastère en décembre 2013 après qu’elle a été violée par trois combattants de la Séléka à Boy-Rabe. Elle a rapporté qu’ils lui ont donné des médicaments pour la douleur et l’inflammation, mais ils ne l’ont pas examinée, lui expliquant qu’elle devait partir rapidement parce qu’ils avaient « trop de personnes à voir ».[319]
Aurore, 50 ans, a indiqué que le personnel clinique dans le camp de déplacés de Sangaris à Bambari n’a effectué aucun examen physique après que des combattants de la Séléka les ont violées, elle et ses deux filles, en 2014 :
J’ai tout expliqué : Ils ont dit : « Nous n’avons pas d’injections pour stopper les maladies dans le corps. » Ils m’ont uniquement donné des médicaments pour le paludisme. Ils ne m’ont pas envoyée vers un autre hôpital.[320]
Le ministère de la Santé a cité l’amélioration de la réponse aux violences sexuelles parmi ses priorités dans son plan de santé de transition pour 2015-2017. Les activités ciblées incluent la fourniture d’une assistance technique pour la prise en charge globale des violences sexuelles ainsi que l’élaboration de protocoles de prise en charge des cas de violences sexuelles et l’expansion de cette prise en charge sur la base d’un programme de l’ONU.[321]
Difficulté d’accès à l’avortement
L’accès à l’avortement en République centrafricaine reste limité, y compris pour les femmes et les filles qui tombent enceintes suite à un viol. Conformément au Code pénal de 2010 et à la loi de 2006 relative à la santé de reproduction, l’interruption volontaire de grossesse est autorisée dans certaines circonstances, notamment en cas de grossesse suite à un viol ou une relation incestueuse.[322] Cependant, les lois contiennent des dispositions contradictoires et ne prévoient pas de processus clair pour l’autorisation des avortements. Le Code pénal stipule que « l’interruption thérapeutique de grossesse » peut être acceptable sur avis d’une équipe de médecins.[323] La loi relative à la santé de reproduction prévoit que « l’interruption volontaire de grossesse » doit être autorisée par « des spécialistes, un collège de médecins ou en cas de nécessité, par un médecin » et le ou les médecins doivent consigner la décision dans un rapport officiel.[324] Elle ne spécifie pas non plus exactement comment l’autorisation pour un avortement peut être accordée. Malgré la légalité de l’avortement pour les victimes de viol, le protocole de prise en charge clinique du viol convenu par le ministère de la Santé, l’OMS et les agences de l’ONU ne mentionne pas l’accès à un avortement sûr dans le cadre des soins après un viol.
Lorsque nous l’avons questionné sur la disponibilité de l’avortement pour les victimes de violences sexuelles enceintes, un fonctionnaire du ministère de la Santé a répondu :
L’avortement n’est pas légal en République centrafricaine. Nous pouvons uniquement le faire si la vie de la femme est en danger et c’est uniquement un médecin qui peut prendre cette décision. Après un acte de viol, nous essayons de convaincre la femme de garder le bébé, mais... si elle ne veut ou ne peut pas, alors un avortement peut être pratiqué. Cependant, ce n’est pas systématique. C’est pratiqué rarement et au cas par cas.[325]
La confusion entre la légalité de l’avortement et la procédure pour obtenir une autorisation existe aussi chez les professionnels de santé. Les médecins, les infirmières et les sages-femmes que Human Rights Watch a consultées n’avaient pas la même compréhension des cas où un avortement peut être pratiqué et où l’autorisation est requise pour l’effectuer. Deux gynécologues à Bangui ont déclaré que l’avortement est uniquement permissible avec l’avis de trois médecins et l’autorisation du procureur.[326] Un docteur à Kaga-Bandoro a indiqué que l’avis d’un seul médecin plus l’autorisation du procureur étaient nécessaires.[327] Deux médecins ont expliqué que l’avortement peut être autorisé jusqu’à la douzième semaine de grossesse, alors qu’un troisième a dit qu’il peut être pratiqué jusqu’à la huitième semaine de grossesse ou la dixième semaine d’aménorrhée (absence de règles).[328] Comme l’a précisé un médecin : « Le problème est que la loi actuelle n’est pas claire ».[329]
Les femmes et les filles peuvent hésiter à demander un avortement par les canaux officiels ou à obtenir des soins en cas d’avortement bâclé, en raison du risque de sanction. Une femme ou une fille qui tente de pratiquer ou pratique un avortement illégal ou consent à utiliser tout moyen pour provoquer un avortement, encourt une peine de prison de six mois à deux ans et une amende de 100 000 à 1 000 000 de francs CFA (environ 171 à 1 711 dollars US).[330]
Toute personne qui aide à pratiquer ou pratique un avortement illégal encourt des sanctions incluant un à cinq ans d’emprisonnement et une amende de 200 000 à 2 000 000 de francs CFA (environ 342 à 3 421 dollars US).[331] Si une personne a pratiqué des avortements à plusieurs reprises, la sanction prévue va de cinq à dix ans d’emprisonnement, avec une amende de 500 000 à 1 000 000 de francs CFA (environ 855 à 1 711 dollars US).[332] Même si un fonctionnaire du ministère de la Santé a expliqué à Human Rights Watch qu’aucune poursuite n’a été engagée en 2015 ou 2016 pour pratique ou demande d’avortement, le personnel médical a indiqué que la peur de sanctions contribue à son approche prudente dans la demande d’autorisation pour des avortements.[333] Un médecin travaillant pour une organisation non gouvernementale internationale à Boda a indiqué : « Nous pouvons pratiquer [un avortement], mais je voudrais avoir toutes les garanties légales... Si je pense que médicalement [la grossesse] lui causera un problème psychologique, je donne mon avis médical au procureur. Mais s’il dit non, alors je n’interviens pas. »[334]
Une sage-femme de l’hôpital de Kaga-Bandoro a déclaré qu’en dernier ressort, elle orienterait une femme demandant un avortement vers un médecin, mais qu’elle déconseillerait vivement aux victimes de viol d’interrompre leur grossesse. « Nous demandons à la femme de garder le bébé même si elle ne le veut pas », a-t-elle indiqué. « C’est comme ça. Je ne peux rien y faire. »[335]
Un tel conseil de la part des ONG ou du personnel médical, associé aux pressions sociales et religieuses, peut dissuader certaines femmes qui veulent avorter de demander un avortement, même dans les cas de grossesse due à des violences sexuelles. Carine a expliqué qu’elle est tombée enceinte après que quatre Mbororo armés l’ont violée à Kaga-Bandoro en juillet 2015 et elle a été influencée par le personnel de l’hôpital et les sages-femmes de deux organisations internationales, aucun d’eux ne lui ayant fourni des informations sur la possibilité d’interrompre sa grossesse. « Au contraire, les sages-femmes m’ont conseillé de maintenir le bébé en bonne santé jusqu’à la naissance », a raconté Carine.[336]
Une victime a confié à Human Rights Watch qu’elle a pratiqué un avortement clandestin après être tombée enceinte quand des combattants anti-balaka l’ont détenue en tant qu’esclave sexuelle pendant 18 mois. Elle décrit avoir payé « un homme dans le quartier » qui est un « spécialiste en avortement » pour mettre un terme à sa grossesse.[337] Une autre victime a indiqué qu’elle a bu un médicament traditionnel pour provoquer une fausse couche.[338] Une sage-femme à l’hôpital de Boda a expliqué : « Il y a beaucoup de cas d’avortements clandestins en raison de grossesses non désirées, dues aux viols commis par des groupes armés ».[339]
Les normes de l’Organisation mondiale de la Santé sur les soins après un viol préconisent l’accès à l’avortement sûr pour les victimes de violences sexuelles, conformément à la loi nationale.[340] Des organismes de protection des droits humains et des experts de l’ONU, y compris le Comité des droits de l’homme de l’ONU, le Comité des droits économiques, sociaux et culturels (CESCR), le Comité CEDAW, le Comité CRC et le Rapporteur spécial sur le droit à la santé ont noté que la pénalisation de l’avortement, y compris les sanctions pénales pour les femmes qui ont subi un avortement, est discriminatoire et met en danger les vies, la santé et les droits des femmes.[341]
Absence de dépistage pour les violences sexuelles
Certaines victimes qui cherchaient des services médicaux ont raconté qu’elles n’ont pas fait état du viol parce que les professionnels médicaux n’ont pas posé de questions sur les circonstances ayant conduit à leurs maladies ou à leurs blessures.
Pernille, 47 ans, a indiqué qu’elle est allée à l’établissement médical du camp de déplacés de M’poko après qu’un combattant de la Séléka l’a violée à Bangui en 2013, et qu’elle a uniquement reçu de l’ibuprofène. « Je n’ai pas dit que j’avais été violée parce qu’ils n’ont pas posé de questions, donc j’ai juste parlé de ma douleur », a-t-elle expliqué.[342]
Les Directives de l’IASC pour l’intégration d’interventions ciblant la violence basée sur le genre dans l’action humanitaire recommandent aux agences d’envisager la formation des prestataires de soins de santé et d’autres services sur la manière d’identifier ou de déceler les signes de violences sexuelles ou autres violences basées sur le genre, en soulignant que le personnel devrait uniquement réaliser ce dépistage avec une formation appropriée et des pratiques de confidentialité en place.[343] Les recherches ont montré que, lorsque les conditions et prérequis adéquats sont respectés, le dépistage des VBG dans les établissements de soins primaires dans les contextes de crises humanitaires peut encourager le signalement de violences et faciliter l’accès des victimes aux services.[344]
Manque de sensibilisation et idées fausses sur les services
Le manque de sensibilisation a aussi empêché aussi des victimes d’accéder rapidement aux services. Lorsqu’elles connaissaient l’existence des services, les idées reçues sur les soins disponibles et la qualité des services, en plus de la peur des coûts, les ont parfois dissuadées de chercher de l’aide.
Bien qu’une organisation non gouvernementale internationale (ONGI) propose des services spécialisés gratuits pour les victimes de violences sexuelles à Bangui, Georgette, 47 ans, a dit qu’elle ne pensait pas que des soins gratuits pour les victimes de viol soient disponibles. Ses propos font écho aux dires de plusieurs victimes lorsqu’elle a précisé : « [L’ONGI] traite uniquement le paludisme et les parasites. Même si les soins sont gratuits, il faut payer les prescriptions. »[345] Une autre victime a indiqué : « Nous avons pensé nous rendre à [l’ONGI] à l’hôpital général, mais nous avons appris que c’est uniquement pour les blessures et les personnes qui ont des fractures ».[346]
Les victimes avaient des idées fausses similaires sur les soins médicaux disponibles dans les camps de déplacés. Rachelle, 25 ans, a exprimé les points de vue de plusieurs femmes quand elle a dit que les services médicaux dans son camp à Bangui ne sont pas pour les victimes de viol. « Ils sont là sur le site, mais les médicaments ici ne servent pas à nous traiter », a-t-elle raconté. « C’est du paracétamol, de l’ibuprofène, mais ce n’est pas ce qui nous soignera. »[347]
Mécanismes d’orientation inadaptés
Beaucoup de femmes et de filles interrogées par Human Rights Watch n’avaient pas connaissance des services disponibles pour les victimes de violences sexuelles, dans certains cas malgré les interactions avec des prestataires de services ou d’autres qui devraient orienter les victimes vers des soins. Les orientations vers des soins médicaux spécialisés et un soutien psychosocial sont une pierre angulaire des soins complets pour les victimes de violences sexuelles.[348] Les directives de l’IASC accordent la priorité à l’instauration de mécanismes d’orientation « permettant, de façon sûre et confidentielle, de mettre en contact les survivants avec les autres services disponibles » dans différents secteurs, y compris les services de santé, les soins de santé mentale, la police et l’assistance judiciaire.[349] Des représentants de l’UNFPA, l’agence des Nations Unies chargée de la coordination sur les violences basées sur le genre (VBG), et d’ONGI mettant en œuvre les programmes VBG ont expliqué à Human Rights Watch que les organismes concernés avaient établi un parcours d’orientation pour les victimes dans des zones incluant Bangui, Bambari, Boda et Kaga-Bandoro.
Cependant, de nombreuses femmes et filles qui se sont rendues dans des centres de santé ont fait savoir à Human Rights Watch que le personnel ne les a pas informées sur les services médicaux et psychosociaux à proximité pour les victimes de viol. Alors que certains membres du personnel des centres de santé et d’autres prestataires de services ont indiqué qu’ils orientaient les victimes vers des ONGI ou des hôpitaux locaux ayant des services complets après un viol, d’autres ont dit qu’ils n’avaient pas connaissance d’orientations ou n’avaient pas orienté les femmes ou les filles vers ces services ou encore que ces services n’étaient pas toujours opérationnels.[350]
Marguerite, 27 ans, et Lucie, 28 ans, ont raconté qu’elles ont reçu des soins minimaux et aucune orientation au camp de déplacés du monastère de Bangui après que des combattants de la Séléka les ont violées à Boy-Rabe en avril 2013. Lucie a expliqué :
Ils n’ont pas fait d’analyse de sang. Pas d’examen physique. Ils m’ont juste donné des comprimés. Ils m’ont donné du Bactrum [antibiotique] et du paracétamol pour que je ne sois pas malade. Ils ne m’ont pas orientée vers un autre lieu. Ils ont seulement dit : « Si la situation [sécuritaire] s’améliore, vous devez essayer d’aller à l’hôpital pour faire des analyses de sang ».[351]
Dans au moins neuf cas où les victimes ont été en contact avec la mission de maintien de la paix des Nations Unies, MINUSCA, immédiatement ou peu après avoir subi des violences sexuelles, les Casques bleus ne les ont pas dirigées vers des services critiques. Après que les combattants de la Séléka ont tué son mari, l’ont violée et l’ont gardée captive à Bambari en mai 2014, Christine a raconté que des Casques bleus l’ont conduite de Sibut, au nord de la capitale, à Bangui et lui ont conseillé de se rendre à l’hôpital de Bangui, mais ils n’ont pas fourni de transport ni d’informations sur où trouver ces services :
J’ai dit à la [MINUSCA] que j’avais été victime de violences sexuelles et que [les anti-balaka] avaient tué mon mari. Ils m’ont mise dans un véhicule pour aller à Bangui... Quand je suis arrivée à Bangui, ils ont dit que je devais aller à l’hôpital pour faire des analyses de sang... Ils ne m’ont pas amenée à l’hôpital... Je ne suis pas allée à l’hôpital.[352]
Nadège a raconté que des combattants anti-balaka les ont violées et détenues, elle et trois autres femmes, près de Boali en mars 2016. Les combattants anti-balaka ont fui lorsqu’ils ont entendu un véhicule de la MINUSCA qui patrouillait sur une route voisine. Nadège a expliqué que les Casques bleus ont stoppé une voiture qui passait pour conduire les femmes à Bangui, mais ils ne les ont dirigées vers aucun service. « Ils ont compris que nous avons été violées par les anti-balaka », a dit Nadège au sujet des Casques bleus. « Nous étions très traumatisées. Ils nous ont envoyées à Bangui seules. »[353]
D’après les supports de formation datant de février 2017 produits par les Casques bleus de l’ONU, la réponse à un incident de violences sexuelles devrait inclure l’assistance aux victimes, spécifiquement par le biais de l’orientation et du transfert vers un établissement de santé pour des soins après un viol complets.[354] La MINUSCA fait partie des agences de l’ONU qui ont participé à l’élaboration des POS sur la prévention et la réponse aux VBG en République centrafricaine pour orienter ou, de préférence, accompagner la victime jusqu’à un prestataire de services médicaux ou psychosociaux.[355]
Manque d’orientations vers des services psychosociaux
Seules 66 victimes de violences sexuelles sur 296avaient eu accès à un soutien psychosocial avant de rencontrer Human Rights Watch. Même dans des zones où des services psychosociaux sont disponibles – tels que les maisons d’écoute qui offrent des espaces sûrs pour des consultations psychologiques de base – de nombreuses victimes ont dit qu’elles n’ont pas eu accès à ces services ou n’en avaient pas connaissance.
Même si une ONGI a organisé des services et des maisons d’écoute mobiles pour les violences basées sur le genre à Bambara depuis 2013, y compris au camp de déplacés appelé « camp Sangaris », plusieurs victimes vivant au camp ont déclaré qu’elles n’ont pas reçu de soutien psychosocial ni d’informations sur les services.[356]
Aurore a expliqué qu’après avoir été violée, avec ses filles, par des combattants de la Séléka à Liwa en juin 2014, du personnel de l’ONGI est venu au camp Sangaris, mais n’a pas proposé de soins de suivi ni d’informations sur les services supplémentaires. « J’ai tout expliqué », a-t-elle raconté. « Je ne leur ai parlé qu’une seule fois. Après ça, ils ne sont pas revenus. Ils ne m’ont pas parlé de la maison d’écoute [au camp Sangaris]. »[357]
Prisca, 28 ans, qui vit aussi dans le camp Sangaris, a indiqué qu’elle s’est rendue à l’hôpital de Bambari après que dix combattants de la Séléka l’ont violée en 2014. Elle a expliqué que le personnel de l’ONGI a pris son nom et est venu une fois la conseiller à son abri. Lorsqu’elle a voulu bénéficier d’une autre consultation psychologique à la maison d’écoute du camp, le personnel n’était pas disponible. « Ils ont dit que tout le monde était allé dans les villages », s’est-elle souvenue.[358] Prisca a ajouté que personne n’avait fourni d’informations sur la disponibilité des conseillers et, qu’en date de janvier 2016, elle n’avait pas eu accès à des soins supplémentaires malgré des symptômes persistants.[359]
Quand Sonia, 52 ans, s’est rendue à l’hôpital de Kaga-Bandoro une semaine après que des combattants de la Séléka l’ont violée en 2013, le personnel de l’hôpital a réalisé un test de dépistage du VIH et des analyses d’urine et lui a donné des médicaments, mais il ne l’a pas orientée vers les services psychosociaux sur place assurés par une ONGI. Au lieu de cela, a-t-elle dit, le médecin l’a réprimandée. « Il ne m’a pas orientée vers des soins psychosociaux, c’est lui qui m’a conseillée », a-t-elle indiqué. « Il m’a dit que la faim ne tue pas les gens. [Il a dit que] pendant la crise, vous ne devriez pas aller dans la brousse, quelle qu’en soit la raison, parce qu’il y a des groupes armés. Donc vous devriez rester tranquille et rester chez vous. »[360]
La sage-femme responsable des services liés aux violences sexuelles à l’hôpital de Boda a indiqué que le personnel oriente les victimes vers une ONGI pour un soutien psychosocial.[361] En avril 2016, un superviseur de l’ONGI a raconté à Human Rights Watch qu’un projet regroupant huit maisons d’écoute avait été suspendu en 2015 et qu’à l’époque, aucun soutien psychosocial n’était disponible à Boda.[362]
Des victimes dans plusieurs camps de déplacés à Bangui ont expliqué à Human Rights Watch qu’elles n’ont pas eu accès à des soins psychosociaux, même quand elles se sont rendues dans les établissements de santé qui disaient offrir des services psychosociaux intégrés. Un gynécologue à l’hôpital communautaire a déclaré à Human Rights Watch que l’hôpital fournit des soins gratuits pour les victimes de violences sexuelles, y compris une assistance psychosociale.[363] Patricia a décrit être allée à l’hôpital communautaire après que des combattants anti-balaka l’ont violée et l’ont détenue pendant deux jours en avril 2016. Même si elle a parlé du viol au médecin, elle a dit avoir reçu des soins médicaux limités, sans aucune orientation pour un soutien psychosocial.[364]
D’après leurs principes directeurs pour la protection dans les situations de crises humanitaires, les standards Sphère incitent à ce que toutes les victimes de violence aient accès à un soutien psychosocial et à des soins de santé mentale, y compris via des mécanismes d’orientation.[365] Les recommandations cliniques et politiques de l’OMS sur la réponse aux violences sexuelles encouragent les professionnels de santé à orienter les victimes vers un soutien psychosocial et des services spécialisés.[366]
Manque de services confidentiels et centrés sur les victimes
Dans leur recherche de soins médicaux, les victimes ont parfois été dissuadées de divulguer les violences sexuelles ou d’accéder à l’aide nécessaire en raison de l’absence de fourniture de soins discrets, confidentiels et adaptés.
Certaines victimes ont déclaré à Human Rights Watch qu’elles ont pu obtenir des soins médicaux, mais qu’elles n’ont pas révélé leurs viols au personnel médical car les services n’étaient pas confidentiels. Estelle, 44 ans, a raconté qu’elle s’est rendue dans un centre de santé à Bangui en janvier 2014, mais elle n’a pas expliqué qu’elle avait subi un viol collectif par des anti-balaka : « Il y avait trop de patients, trop de femmes... Ce n’était pas intime. »[367] Aimée, 23 ans, a indiqué à Human Rights Watch qu’elle a signalé son viol aux membres du personnel au camp de déplacés de Saint-Bernard à Boy-Rabe, mais ils ne lui ont pas fait d’examen complet parce qu’ils manquaient d’installations privatives. « Ils ont dit qu’ils n’avaient pas la place pour faire des consultations », a-t-elle dit. « Ils avaient uniquement une bâche arrangée [pour délimiter l’espace pour traiter les patients]. »[368]
Beaucoup de victimes ont confié qu’elles n’avaient pas confiance dans le personnel médical pour maintenir la confidentialité et ont eu peur que le personnel de santé ne les expose au ridicule en public. Anne-Marie s’est rendue à l’hôpital de Kaga-Bandoro, mais elle n’a pas fait état de son viol par cinq combattants de la Séléka en janvier 2015. Elle a expliqué :
Si je vais à l’hôpital et que je parle à la sage-femme, elle racontera le secret à d’autres. Je les ai entendus parler d’autres [femmes qui ont été violées]. Souvent lorsqu’ils vont dans un bar pour prendre une bière, ils ne parlent de rien d’autre que ça.[369]
D’autres victimes ont indiqué que le personnel de santé ne les traitait pas avec respect. Leila a expliqué que le personnel l’a refoulée lorsqu’elle s’est présentée à l’hôpital Castor à Bangui en avril 2016 après que des combattants anti-balaka l’ont détenue avec plusieurs autres femmes dans la brousse pendant deux jours, les violant de façon répétée. « J’ai expliqué [le viol] à la sage-femme là-bas », a-t-elle décrit. « Elle a répondu que je ne disais pas la vérité. Elle a dit : “Ce sont des mensonges”. Je n’ai reçu aucun soin médical. »[370]
Les directives internationales sur la gestion des violences basées sur le genre, y compris dans les situations d’urgence, insistent sur la fourniture de services confidentiels qui garantissent la sécurité des victimes et respectent leurs besoins.[371]
V. Accès à la justice
J’ai pensé à la justice. J’ai pensé à toutes ces choses que la Séléka a faites : ils ont pillé des maisons, violé des femmes et tué des gens. Je demande si la justice sera rendue pour cela.
– Nora, 25 ans, Bangui, janvier 2016
Ce ne sont pas les femmes qui ont été abusées qui devraient avoir honte, mais les auteurs de ces crimes... Nous veillerons à ce que les auteurs soient tenus responsables et nous ne leur laisserons aucun endroit pour se cacher. Et où que nous allions, nous les poursuivrons.
– Zeinab Bangura, ex-Représentante spéciale du Secrétaire général des Nations Unies chargée de la question des violences sexuelles en conflit, décembre 2012[372]
Malgré la litanie de crimes graves documentés dans ce rapport, la plupart des femmes et des filles interrogées par Human Rights Watch avaient peu d’espoir de voir leurs bourreaux être poursuivis en justice et leurs doutes sont justifiés. De nombreux obstacles pour accéder à la justice subsistent en République centrafricaine et les victimes de violences sexuelles sont confrontées à des défis particuliers. Certaines victimes ont raconté à Human Rights Watch avoir vu leurs agresseurs circuler librement dans leur communauté ou même occuper une fonction publique, alors que d’autres ont expliqué que les autorités leur ont demandé de présenter leurs propres violeurs en vue d’enquêtesou de poursuites. La longue histoire d’impunité pour les violences basées sur le genre nourrit le scepticisme à l’égard de la justice pénale pour les violences sexuelles et le système judiciaire en général souffre d’une pénurie de ressources, d’un manque d’infrastructures et d’une capacité inadaptée Ces obstacles et d’autres, dont la difficulté à identifier les auteurs et le manque de ressources financières ou d’assistance juridique, ont empêché la vaste majorité des victimes interrogées par Human Rights Watch de signaler les cas aux autorités.
Dans seulement 11 des 305 cas de violences sexuelles documentés par Human Rights Watch, les victimes ont dit avoir tenté d’agir pour que leurs agresseurs soient poursuivis. Seules 9 victimes ont signalé leur cas à la police, aux gendarmes ou à d’autres autorités étatiques. Dans trois de ces cas, les victimes ont aussi parlé avec des organisations non gouvernementales qui proposent une assistance juridique ; deux autres victimes ont discuté avec des ONG concernant le dépôt de plaintes contre leurs agresseurs, mais elles ont indiqué qu’elles ne savaient pas si des démarches avaient été effectuées pour déposer des plaintes officielles.
Sept victimes ont déclaré qu’elles ou des membres de leur famille ont signalé les violences sexuelles à la MINUSCA et une victime a confié qu’elle en a informé les troupes françaises de la mission de maintien de la paix Sangaris, qui opéraient dans le pays entre décembre 2013 et octobre 2016.[373] Dans seulement deux des cas signalés aux missions de maintien de la paix, les victimes ont pu confirmer que l’incident a aussi été rapporté aux autorités locales.
Six femmes et filles sur les neuf qui ont signalé le crime aux autorités étatiques ont expliqué que les autorités les ont ma"ltr"aitées, exigeant que les victimes retrouvent leurs agresseurs, refusant d’enregistrer leurs plaintes ou négligeant d’assurer le suivi de ces affaires.
En plus du système judiciaire national, la Cour pénale spéciale (CPS) et la Cour pénale internationale (CPI) offrent une possibilité de justice pour certaines victimes de violences sexuelles liées aux conflits. La CPS a connu des retards et, alors que des mesures critiques ont été prises pour qu’elle devienne opérationnelle, des défis colossaux persistent concernant la protection des témoins et des victimes, le développement des capacités du personnel et l’engagement durable de ressources financières et techniques. En même temps, la CPI se concentre uniquement sur les crimes les plus graves et les crimes perpétrés par de hauts commandants ou responsables, et est en mesure de traiter un petit nombre d’affaires en raison de ses ressources limitées.
Malgré ces défis, les victimes veulent que leurs agresseurs soient traduits en justice. Comme beaucoup de femmes et de filles interrogées par Human Rights Watch, Carole, 25 ans, a expliqué qu’elle avait peu d’espoir de poursuites à l’encontre des deux combattants de la Séléka qui l’ont violée à Bangui en 2013, mais qu’elle mérite justice. « Contre qui devrais-je porter plainte ? Qui pourrais-je accuser ? » a demandé Carole, en disant qu’elle ne pouvait pas identifier ses violeurs. « Mais je sais que c’est une grave injustice qui m’a été faite. »[374]
Mélanie, 31 ans, a déclaré que des combattants Séléka de l’UPC avaient pris d'assaut sa maison lors de l'attaque de mai 2017 contre Alindao et forcé son mari à se déshabiller, pour ensuite l'emmener après l'avoir ligoté avec une corde. Après que Mélanie a retrouvé le cadavre de son mari égorgé avec des balles dans l'estomac, deux combattants de la Séléka l'ont violée, provoquant chez elle d'intenses douleurs. « Je souffrais terriblement », a-t-elle raconté. « J'étais blessée au vagin – je ne pouvais plus marcher. »[375] Mélanie a ensuite été testée positive au VIH-SIDA. Elle a déclaré :
Ils ont tué mon mari, ils m'ont violée, je n'ai plus de maison, je suis infectée [avec le VIH] – voilà ce qu'ils m'ont fait. Je veux les traîner devant la justice parce qu'ils ont détruit ma vie.[376]
Obstacles à l’accès à la justice pour les violences sexuelles
Le récent conflit a amplifié les faiblesses existantes du système judiciaire centrafricain, ainsi que les contraintes sociales, financières et autres qui entravent l’accès à la justice pour les victimes de violences sexuelles. Jusqu’à présent, les membres des groupes armés qui ont été identifiés comme les agresseurs par les victimes sont libres de leurs mouvements et n’ont pas été sanctionnés.
L’absence de système judiciaire national qui fonctionne, la réponse inappropriée de la part des autorités, la peur de représailles, les coûts associés aux démarches judiciaires, le manque d’assistance juridique et les normes sociales limitant l’autonomie des femmes dissuadent les femmes et les filles de demander justice pour les violences sexuelles subies ou compromettent leurs tentatives allant dans ce sens. Des défis pratiques, comme la difficulté à identifier les auteurs ou à obtenir des certificats médicaux, créent aussi des obstacles à l’accès à la justice.
Nicole, 26 ans, qui a été violée par trois combattants de la Séléka en décembre 2013, a décrit un manque de confiance courant dans le système judiciaire national. « La loi est ignorée », a-t-elle dit. « Lorsque vous n’avez pas d’argent pour déposer une plainte, ils ne font rien, mais ils gardent votre dossier. »[377]
Absence de système judiciaire national qui fonctionne
Le nouveau gouvernement a hérité d’un système judiciaire défaillant, incapable de mener des enquêtes et des poursuites sur les auteurs de crimes graves. Dans la majeure partie de la République centrafricaine, et en particulier dans l’est, la plupart des structures judiciaires n’étaient pas opérationnelles entre le début de l’année 2013 et 2017. Au moment de la rédaction du présent rapport, certains tribunaux fonctionnaient dans neuf régions du pays, y compris Bangui et Boda ; aucun tribunal ne fonctionnait à Kaga-Bandoro et dans les régions du nord et de l’est.[378] En avril 2017, des fonctionnaires judiciaires ont indiqué à Human Rights Watch que les tribunaux dans le pays sont officiellement opérationnels, bien que certains ne fonctionnent pas correctement.[379]
Cent treize avocats inscrits servent le pays entier, la plupart étant basés à Bangui. Plusieurs juges interrogés par Human Rights Watch ont expliqué que la police judiciaire néglige systématiquement d’enquêter sur les affaires criminelles lorsque l’auteur n’avoue pas.[380]
Le Code pénal centrafricain inclut le viol et l’agression sexuelle comme des infractions pénales. Cependant, en 1998, le bureau du procureur général a émis une circulaire ordonnant que les actes de viol et certains autres crimes soient « correctionnalisés » ou jugés comme des délits (avec des sanctions moindres) plutôt que comme des infractions pénales, sous prétexte d’accélérer les procédures judiciaires stagnantes.[381] Des sources ont indiqué que cette reclassification a davantage effrité la confiance dans l’importance que semble accorder le système judiciaire aux violences sexuelles et à la sanction de leurs auteurs.[382] Cela a été modifié quand une nouvelle circulaire du ministère de la Justice en mars 2016 a ordonné la fin de cette pratique pour les affaires de violences sexuelles.[383] Cependant, un expert de l’ONU a soulevé des préoccupations en avril 2017 sur le fait que le viol continue d’être traité comme attentat à la pudeur par les autorités locales.[384]
Pendant la période où les crimes ont été traités comme des délits, les procédures pénales ont été quasiment inexistantes dans le pays. Depuis que le conflit a commencé à la fin de l’année 2012, le gouvernement n’a organisé que deux sessions de la cour criminelle à Bangui, l’une en 2015 et l’autre en août 2016. Sur les 55 affaires jugées pendant la session de 2016, trois étaient des cas de viol, mais aucun des auteurs n’appartenait à des groupes armés.[385]
Alors que 163 magistrats devraient œuvrer dans le pays, de nombreux postes étaient vacants au moment de la rédaction du présent rapport. Dans de nombreuses régions, les procureurs n’avaient pas réintégré leur poste, venaient à peine d’arriver ou étaient en poste dans la région à temps partiel. Comme l’a dit une victime âgée de 15 ans à Kaga-Bandoro : « Je veux porter plainte, mais il faut que les autorités judiciaires soient en place ».[386]
Des représentants du gouvernement ont déclaré à Human Rights Watch que le redéploiement des autorités judiciaires est une première étape essentielle pour combattre l’impunité.[387] Tant que cela ne sera pas fait, beaucoup de victimes devront parcourir de longues distances jusqu’à une autre juridiction simplement pour déposer une plainte.[388]
Avant de déployer les autorités judiciaires, cependant, le gouvernement doit reprendre le contrôle de la police et des tribunaux. Dans certaines villes, dont Kaga-Bandoro, les groupes armés continuent de contrôler le secteur de la sécurité local, ce qui dissuade les personnes de signaler les violences commises par les parties au conflit. Lorsque Human Rights Watch est allé à Bambari en janvier 2016, un membre du personnel de l’UNFPA, agence de l’ONU chef de fil en matière de violences basées sur le genre, a expliqué que l’occupation du poste de police et de la cour d’appel par la Séléka rendait les poursuites pour violences sexuelles extrêmement difficiles. « Les groupes armés peuvent tout faire sans crainte », a indiqué la personne. « Ils peuvent faire ce qu’ils veulent devant des gens – il est difficile d’agir parce que personne n’ose. »[389]
Certaines victimes ont raconté à Human Rights Watch que même si elles voulaient obtenir justice, il n’y avait nulle part où signaler les cas. « Je ne suis pas allée à la gendarmerie », a expliqué Claudette, qui a été violée par la Séléka à Bambari en décembre 2015. « Elle ne fonctionne pas réellement, donc comment [les gendarmes] pourraient-ils aller chercher la Séléka comme ça ? »[390]
À Kaga-Bandoro, une victime a indiqué à Human Rights Watch qu’elle n’a pas signalé son viol par des Peuls en 2015 parce que la Séléka contrôlait la ville et ses services de sécurité. « Je ne peux pas porter plainte parce que c’est la Séléka qui a le pouvoir dans cette ville », a-t-elle confié.[391]
Les problèmes de sécurité permanents entravent aussi le processus judiciaire. Certains juges et procureurs n’ont pas réintégré leurs postes hors de la capitale en raison de l’insécurité, et certains policiers et gendarmes hésitent à arrêter les auteurs présumés, car ils craignent pour leur propre sécurité.[392] Le chef d’une unité de police a décrit l’inutilité d’identifier les membres d’un groupe armé qui avaient violé une fille de 14 ans à Bangui :
[N]ous ne pouvons pas aller [dans les quartiers] pour les arrêter parce qu’ils sont armés et qu’ils nous tireront dessus. La fille peut identifier ses agresseurs, mais nous pourrions être attaqués nous aussi si nous allons là-bas. Donc elle peut nommer celui qui l’a violée, mais nous ne pouvons pas faire grand-chose.[393]
Les établissements pénitentiaires inappropriés aggravent le problème. Parmi les 28 centres de détention dans tout le pays, seuls six sont opérationnels, dont trois se situent dans la capitale ou dans sa périphérie. Au moment de la rédaction de ce rapport, deux centres supplémentaires devaient devenir opérationnels. Des évasions massives ont eu lieu dans certaines des prisons en fonctionnement.[394] De plus, la lenteur des procédures judiciaires peut conduire à une détention provisoire longue et problématique.
En avril 2016, le procureur de Boda de l’époque a déclaré à Human Rights Watch que les lacunes en matière d’infrastructures entravaient sa capacité à juger les criminels. Sans la prison, qui a été détruite pendant le conflit, il a indiqué qu’il ne pouvait pas détenir les suspects. Tous les auteurs présumés de crimes graves devaient être envoyés à Bangui pour être jugés, mais le procureur a ajouté qu’il manquait de moyens pour transférer les suspects de manière sûre. Il a décrit avoir fait transférer près de dix membres des forces anti-balaka et Séléka à Bangui pour des meurtres et des viols présumés, pour finalement les voir s’échapper. « À Bangui, ils ont fui et sont retournés dans la brousse », a-t-il raconté. « Ils y sont toujours. Je n’ai pas les forces suffisantes ni les moyens pour les attraper à nouveau. »[395]
Elinor, 27 ans, a expliqué qu’après que des combattants anti-balaka l’ont violée et ont mutilé son mari à Bambari en 2014, un des agresseurs a été arrêté. Plus tard cependant, elle a appris qu’il s’était échappé de prison avec d’autres détenus et elle n’a plus cherché à obtenir justice.[396]
Dans le cadre des mesures temporaires d’urgence spécifiées dans son mandat, la MINUSCA peut « procéder à des arrestations et des mises en détention en vue de maintenir l’ordre public fondamental et de lutter contre l’impunité ».[397] Suite à la demande du président Touadéra en mai 2016, le Conseil de sécurité a autorisé le prolongement des mesures temporaires d’urgence jusqu’en novembre 2017.[398] Alors que les forces de la MINUSCA ont arrêté certains leaders anti-balaka, comme Rodrique Ngaïbona (alias Andilo), elles n’ont pas arrêté et placé en détention les commandants de la Séléka suspectés d’avoir commis des abus.[399]
Le Programme des Nations Unies pour le développement (PNUD), avec le soutien des États-Unis et de l’Union européenne, aide à renforcer le système judiciaire national. En plus de restaurer les infrastructures physiques, de fournir des équipements de bureau et de faciliter la formation du personnel judiciaire, les activités financées incluent des mesures spécifiques pour lutter contre les violences sexuelles grâce à la sensibilisation aux droits des victimes, à la facilitation de l’accès des victimes aux services via des organisations de la société civile, et au soutien de l’instauration d’une unité spécialisée chargée d’accepter et de traiter les plaintes de violences sexuelles et basées sur le genre.[400]
En janvier 2015, le gouvernement de transition a publié un décret établissant une Unité mixte d’intervention rapide et de répression des violences sexuelles faites aux femmes et aux enfants (UMIRR) à Bangui.[401]Financée par le PNUD et la MINUSCA, l’UMIRR, qui est composée de policiers et de gendarmes nationaux formés à la conduite d’enquêtes sur les violences sexuelles, est destinée à enregistrer tous les cas de violences sexuelles et basées sur le genre et d’abus envers les enfants, en période de conflit ou non. Une équipe de trente-deux personnes affectées à l’unité a participé à la formation sur la réponse aux violences sexuelles, sur l’interrogation des victimes de traumatismes, sur la fourniture d’orientations médicales et la collecte de preuves médico-légales. Suite à des retards prolongés en raison de problèmes de financement et de logistique, l’UMIRR n’a commencé à opérer qu’en juin 2017. Des questions demeurent sur la coordination entre l’UMIRR et les Brigades des Enfants existantes ainsi que les bureaux d’accueil des victimes installés dans certains postes de police.[402]
En août 2017, un membre haut placé du personnel de l’UMIRR a déclaré que l’unité avait reçu près de 100 cas, dont 10 seulement étaient liés au conflit. Il a expliqué que l’UMIRR transférera les cas de violences sexuelles liées au conflit à la Cour pénale spéciale suite aux enquêtes, mais que l’unité fait face à des défis permanents pour enquêter sur ces affaires – notamment hors de Bangui – en raison de l’insécurité dans certaines régions du pays, du manque de protection du personnel de l’UMIRR et des contraintes matérielles et logistiques. « L’UMIRR a une autorité nationale, mais il faut qu’elle puisse se déployer hors de Bangui », a-t-il indiqué.[403]
Impunité, représailles et crainte de représailles
L’impunité règne pour les membres de groupes armés qui ont commis des violences sexuelles en République centrafricaine, alors que des combattants menacent et usent de représailles contre les victimes et les membres de leur famille, entravent les enquêtes et détiennent des postes de pouvoir.
Expliquant la nécessité de rendre rapidement opérationnelle la Cour pénale spéciale, une avocate qui assiste les victimes de violences sexuelles a indiqué à Human Rights Watch : « Les agresseurs sont toujours là. Ils circulent librement et les victimes sont trop effrayées pour les dénoncer. »[404]
Cécile, 50 ans, qui a déclaré avoir été violée par trois combattants anti-balaka à Bambari en janvier 2015, a décrit se sentir démunie lorsqu’elle a vu ses agresseurs se déplacer librement dans la ville :
Lorsque je les ai vus, j’étais très effrayée, mais il n’y a aucune loi ici, donc je vais dans ma hutte et je pleure... [S]i les tribunaux étaient ouverts, j’irais porter plainte [contre eux]. Mais je ne suis pas allée voir les gendarmes, parce que là, il faut payer et, en fin de compte, ils ne font rien.[405]
Certaines victimes ont confié qu’elles craignaient une vengeance si elles désignaient leurs agresseurs ou si elles tentaient de porter plainte. Albertine, 30 ans, a expliqué qu’après que le chef d’un groupe anti-balaka l’a violée à Bangui en décembre 2015, elle avait même peur de connaître l’identité de son agresseur. « Avec ce qu’il a fait, je ne veux pas connaître son nom parce que je suis nerveuse... J’ai peur qu’il puisse me trouver et me faire du mal », a-t-elle confié.[406]
Deux victimes ont raconté à Human Rights Watch que des anti-balaka sous le commandement de Gilbert Wité à Boda les ont violées et, lorsque les membres de leur famille sont allés trouver Wité ou ses hommes, les anti-balaka les ont blessés ou menacés. Camille, 15 ans, a indiqué que des combattants sous le contrôle de Wité les ont attrapées elle et une amie alors qu’elles fuyaient les attaques contre Boda vers janvier 2014 et les ont violées. Le lendemain, la mère de Camille est allée demander des comptes à Wité. Camille a expliqué :
Elle est allée voir Wité et a dit : « Vos hommes ont violé ma fille ». Wité a pointé son fusil vers ma mère. Elle est venue le voir à nouveau, mais il a pointé son arme vers elle une deuxième fois. Il a dit : « Si tu continues à venir me parler, je te tuerai ». Donc ma mère a abandonné.[407]
La famille de Camille subit une intimidation continue. « Mes parents veulent porter plainte, mais ils sont toujours menacés par les anti-balaka », a-t-elle conclu. « Ils ont peur de déposer une plainte. »[408]
Justine, 13 ans, a décrit à Human Rights Watch comment des hommes de Wité l’ont attrapée alors qu’elle rentrait après avoir vendu du bois de chauffage en avril 2015. Elle a indiqué que les anti-balaka l’ont poussée au sol et un d’eux l’a violée. Justine a expliqué que sa famille a demandé des comptes aux hommes de Wité :
Ma grande sœur est allée voir les anti-balaka pour les interroger sur [le viol], mais ils l’ont frappée. Ils lui ont lié les mains dans le dos et l’ont détenue. Puis son mari a dû aller voir [les anti-balaka], mais ils l’ont frappé et l’ont attaché lui aussi.[409]
Justine a précisé que son oncle a payé 20 000 francs CFA (environ 33 dollars US) pour leur libération. « Quand je pense à ça, j’ai mal au cœur », a-t-elle dit de l’agression et de ses conséquences. « Quand je pense à la manière dont ils m’ont violée, je pleure. »[410]
Une autre victime, Monique, 30 ans, a rapporté qu’elle a reçu des menaces après avoir accompagné la police et la MINUSCA pour identifier les hommes qui l’ont violée. Elle a raconté que des combattants musulmans l’ont attrapée, elle ainsi que trois autres femmes, sur le marché PK5 de Bangui en avril 2015, prétendant que l’un des maris des femmes était affilié aux anti-balaka. Deux des hommes ont violé Monique avant de la relâcher plus tard ce jour-là ; les trois autres femmes n’ont jamais été retrouvées et sont présumées mortes. Monique a signalé le cas à la MINUSCA, qui lui a dit d’aller voir la police. La MINUSCA et la police l’ont emmenée pour identifier ses agresseurs à PK5, où une foule de plus de 50 personnes l’a prise à partie pour avoir dénoncé l’agression. « Les musulmans m’ont sortie de force de la voiture », s’est souvenue Monique. « J’étais effrayée. Je me suis mise à pleurer. »[411] La police a ramené Monique au poste et lui a annoncé qu’elle était en danger. Peu après, elle a commencé à recevoir des appels téléphoniques de menaces. Elle a essayé de partir en France, où sa sœur habite, mais sa demande de visa a été refusée.
Malgré les craintes pour sa sécurité, Monique a présenté son cas à une ONGI, qui a localisé les agresseurs, mais qui lui a dit qu’il n’y avait pas grand-chose à faire. « Ils m’ont dit que [la police] ne peut pas les arrêter maintenant parce que des personnes au gouvernement les protègent », a indiqué Monique. « Ils ont dit qu’après les élections [nationales], ils pourront essayer de leur mettre la main dessus. »[412] Au moment de la rédaction de ce rapport, Human Rights Watch n’a pas pu confirmer si les autorités avaient pris des mesures supplémentaires pour poursuivre les auteurs.
Une autre victime, Elisabeth, a expliqué que la Séléka à Kaga-Bandoro l’a détenue pendant trois jours vers février 2015, après l’avoir violée et avoir tué sa fille. Lorsqu’ils l’ont libérée, ils lui ont dit qu’ils la tueraient s’ils la voyaient circuler en ville.[413] Elisabeth a signalé le cas à la MINUSCA, qui l’a transférée à Bangui, mais elle n’a eu aucun contact avec la MINUSCA depuis son retour à Kaga-Bandoro en mai 2015. Elle a confié qu’elle avait peur de sortir de chez elle.[414]
Plusieurs fonctionnaires et membres du personnel des services d’assistance juridique ont indiqué à Human Rights Watch que la protection des victimes et des témoins, ainsi que des avocats et des juges, sera essentielle pour juger les crimes graves commis pendant le conflit et que le manque actuel d’une telle protection est un obstacle majeur à la justice.[415] Une avocate qui assiste les victimes de violences sexuelles, par exemple, a expliqué que certaines de ses clientes avaient reçu des menaces, mais que les autorités étaient impuissantes à répondre. « Nous avons discuté de ces menaces avec le procureur, mais il nous a répondu que les magistrats eux-mêmes n’étaient pas en sécurité », a-t-elle raconté.[416]
Un expert de la justice chez ONU-Femmes à Bangui a confirmé que les autorités judiciaires craignent les groupes armés. « La question de la sécurité est très délicate », a-t-il expliqué. « En privé, les juges avouent être effrayés ; [ils disent] : “Si nous jugeons ces personnes, nous et nos familles sommes en danger”. »[417]
Un responsable de l’UMIRR a aussi indiqué que l’insécurité et le manque de protection du personnel entravent les enquêtes sur les violences sexuelles liées au conflit, notamment hors de Bangui. « Si un enquêteur sort pour mener une enquête sur le terrain, il pourrait être tué », a-t-il indiqué, notant que les victimes et les témoins sont exposés à des risques similaires.[418] Au moment de la rédaction du présent rapport, la MINUSCA élaborait une stratégie de protection pour les victimes et les témoins au sein du système judiciaire standard et de la CPS.[419]
Les Stratégies et mesures concrètes types actualisées de l’ONU concernant la justice pénale pour les violences contre les femmes appellent les États à faciliter la capacité des victimes féminines à participer aux enquêtes et à témoigner dans les procédures pénales, y compris en garantissant leur sécurité et « en mettant en place de vastes programmes destinés à protéger les témoins et les victimes ».[420]
Pour lutter contre l’impunité, il convient aussi de stopper l’intimidation et l’exercice de la force par les groupes armés au niveau du gouvernement. Le parlement devrait accepter de lever l’immunité parlementaire pour traduire en justice les membres du parlement accusés de crimes. La législation instaurant la Cour pénale spéciale prévoit que la loi s’applique de manière égale à toutes les personnes et le Code pénal centrafricain stipule qu’il ne doit pas y avoir d’immunité pour les crimes graves, bien que la Constitution contienne également une disposition qui autorise l’immunité parlementaire.[421] Un ancien membre du Conseil national de transition a cité l’élection au parlement de leaders anti-balaka comme un risque, soulignant qu’ils pourraient bloquer la Cour pénale spéciale en s’opposant à l’adoption de son budget ou à l’élimination de l’immunité parlementaire pour les suspects. Il a ajouté :
Pour que les immunités soient levées, la Cour devra être forte, sinon ces individus intimideront les autres parlementaires. Le parlement est devenu une nurserie pour criminels de guerre.[422]
Par exemple, il a soulevé des inquiétudes sur le fait que Rombhot détienne des sièges parlementaires bien qu’il soit soupçonné d’avoir commis de potentiels crimes de guerre, notamment des violences sexuelles documentées dans le présent rapport.[423]
Mauvais traitements et réponses inappropriées aux plaintes
Les expériences de quelques femmes et filles qui ont raconté à Human Rights Watch leur tentative de signaler les violences sexuelles subies ont largement confirmé les craintes de celles qui ont choisi de ne pas chercher à obtenir justice. Des victimes ayant rapporté les violences ont décrit avoir été envoyées d’un bureau à l’autre, n’avoir reçu aucun suivi, ou même s’être entendu dire qu’elles devaient retrouver elles-mêmes leurs agresseurs. Dans certains cas, les autorités ont exposé les victimes à des risques et des traumatismes supplémentaires et ont favorisé l’impunité en refusant d’agir ou en entravant activement les enquêtes.
Paulette, 14 ans, a expliqué qu’elle et sa mère se sont rendues à la gendarmerie de Kaga-Bandoro le lendemain de son viol par un combattant de la Séléka près du village de Kpokpo en avril 2016. Elle a décrit comment les gendarmes – eux-mêmes affiliés à la Séléka – lui ont effectivement demandé de faire leur travail :
Les gendarmes nous ont indiqué à ma mère et moi que nous devions aller dire à la Séléka de se présenter à la gendarmerie. Nous sommes allées au poste de contrôle [tenu par les agresseurs] et nous avons fait ce que les gendarmes nous ont demandé. Le lendemain, [les agresseurs] ont refusé de venir. La deuxième fois, nous y sommes allées avec les gendarmes pour leur demander à nouveau de venir. Ils n’étaient plus là. Les gendarmes nous ont dit de rentrer chez nous et que quand ils les retrouveront, ils les arrêteront. Ils ont dit qu’ils vont les chercher, mais que s’ils ne les trouvent pas, ce sera fini. Ils [les agresseurs] ont fui la ville.[424]
Interrogée en mai 2016, Paulette a indiqué que les hommes qui l’ont violée n’avaient pas été arrêtés.
Laure, 17 ans, a raconté qu’aucune démarche n’a été effectuée après qu’elle a signalé aux gendarmes et à la MINUSCA que des anti-balaka les avaient violées, elle et sa sœur aînée, à Bangui en août 2015. « J’ai décrit à la MINUSCA ce qu’il s’est passé. Ils n’ont rien fait. Ils m’ont dit : “Maintenant Dieu vous fortifiera, vous donnera la force” », a-t-elle expliqué. Elle a ajouté que les Casques bleus de la MINUSCA l’ont conduite à l’hôpital, ont pris des informations sur son cas et l’ont amenée à la gendarmerie. « J’ai déposé une plainte à la gendarmerie, mais il n’y a pas eu de suivi », s’est-elle souvenue. « Les gendarmes n’ont rien dit, ils n’ont pas réagi. La MINUSCA ne nous a [rien] dit non plus. »[425]
Certaines autorités ont déclaré que les procureurs et les juges locaux avaient reçu une formation limitée, voire aucune formation, sur les enquêtes et les poursuites en matière de violences sexuelles.[426]D’autres ont indiqué à Human Rights Watch que les procureurs et les juges avaient suivi quelques formations sur les violences sexuelles, par exemple sur la manière de préparer les audiences ou de travailler dans le respect des victimes. Malgré tout, la capacité à répondre aux violences sexuelles reste inadaptée.[427] Cela inclut la capacité de la police et des gendarmes, et des effectifs adéquats aux points de signalement.
Clémence, 53 ans, a expliqué que le manque de personnel a créé des obstacles considérables pour accéder à la justice, après que deux combattants anti-balaka les ont violées elle et quatre autres femmes, entre Aba et Amada-Gaza vers septembre 2015. Elle a ajouté que les victimes se sont rendues à l’unité de police d’Amada-Gaza immédiatement après l’incident et ont raconté à un agent que des anti-balaka les avaient attrapées et leur avaient volé leurs biens. « Nous avons parlé avec l’auxiliaire de brigade de l’unité, un homme », a-t-elle décrit. « Nous avions trop honte pour signaler les viols. Il n’y avait pas de personnel féminin. Ils ont dit : “Nous n’avons pas le personnel ici, mais nous enverrons un message à Berbérati pour qu’ils envoient du personnel pour nous aider”. Nous n’avons eu aucune nouvelle jusqu’à aujourd’hui. »[428]
Entre autres dispositions, les directives internationales sur la réponse du système judiciaire aux violences envers les femmes exigent que les États garantissent une mise en œuvre cohérente et efficace des lois pénales et des politiques sur les violences envers les femmes. Elles appellent aussi à des mesures en conformité avec les normes de meilleures pratiques afin de faciliter les enquêtes et les poursuites, y compris la formation spécialisée de la police et des procureurs, et afin de combattre les attitudes parmi le personnel du secteur judiciaire qui entretiennent les violences envers les femmes.[429]
Coûts et manque d’assistance
Beaucoup de victimes ont indiqué qu’elles n’ont pas signalé le crime aux autorités parce qu’elles pensaient qu’un dépôt de plainte impliquerait des coûts financiers. « La justice ici coûte de l’argent », a expliqué Merveille, 40 ans, qui a dit avoir été violée par des combattants de la Séléka et avoir été détenue pendant deux jours à Bambari vers avril 2014. « Mais comment vais-je me procurer de l’argent ? Si la justice était gratuite, j’irais porter plainte. »[430]
Certaines victimes ont déclaré qu’elles voulaient porter plainte, mais qu’elles ne savaient pas comment faire. Bien que des organisations non gouvernementales offrent une assistance juridique, la plupart des victimes interrogées par Human Rights Watch n’avaient pas connaissance de ces services.
D’autres ont senti qu’elles avaient besoin d’un soutien moral qui n’était pas disponible. Emmanuelle, 23 ans, qui a été violée par un combattant de la Séléka à Bangui au début de l’année 2014, a expliqué qu’elle ne pouvait pas déposer de plainte sans le soutien d’un membre de sa famille, mais que tous ses proches avaient fui le pays. « S’il n’y a personne, j’abandonnerai », a-t-elle dit. « J’ai besoin que quelqu’un m’accompagne au tribunal pendant toute la procédure. »[431]
La loi centrafricaine donne à certaines victimes de crimes le droit à une assistance juridique, mais il n’existe aucun système pour fournir ou garantir la disponibilité d’une telle assistance.[432]Une stratégie nationale récemment mise au point sur la fourniture d’une assistance juridique inclut la révision et l’adoption d’un projet de loi d’aide légale, développé avec le soutien du PNUD.[433] Si elle est adoptée, cette loi pourrait améliorer l’assistance juridique pour les victimes de violences sexuelles et d’autres crimes commis par les groupes armés. En vertu des dispositions du projet de loi, les victimes de crimes qui n’ont pas suffisamment de ressources peuvent bénéficier d’une aide financière pour tout ou partie des frais juridiques.[434] Les mesures solides de la stratégie nationale pour aider les victimes tout au long de la procédure judiciaire pourraient aussi être déterminantes pour faciliter l’accès à la justice pour les victimes de violences sexuelles.[435]
Les directives internationales recommandent la fourniture de services juridiques gratuits et accessibles pour les victimes de violences sexuelles et d’autres violences basées sur le genre.[436] Une résolution de l’Assemblée générale de l’ONU de 2010 appelle aussi les États à éliminer les obstacles à l’assistance juridique pour les femmes victimes de violences afin qu’elles bénéficient d’une représentation adéquate et puissent prendre des décisions éclairées concernant les procédures judiciaires.[437] Les Stratégies et mesures concrètes types de l’ONU sur la justice pénale pour les violences contre les femmes préconisent l’assistance des victimes, en spécifiant que les États devraient « veiller à ce que les femmes victimes d’actes de violence aient pleinement accès aux systèmes de justice civile et pénale, qu’elles bénéficient notamment d’une aide juridique gratuite ».[438]
Pressions familiales
Dans certains cas, les victimes ont indiqué que des membres de leur famille les avaient dissuadées de déposer une plainte. Aisha a décrit que sept combattants anti-balaka ont tué son mari et ses quatre enfants puis l’ont violée à Bangui en décembre 2013, mais son père l’a dissuadée de signaler le cas. « J’ai rédigé une plainte. Je voulais la déposer », a-t-elle raconté. « Mais mon père a dit non ».[439] Aisha a expliqué qu’elle ne se sentait pas en mesure de désobéir à son père et qu’elle avait besoin de son autorisation pour porter plainte.[440]
Jolie, 23 ans, a raconté que des anti-balaka l’ont prise pour « femme » et l’ont soumise à de multiples viols près de Bambari en juin 2014, mais son mari ne l’a pas laissée aller voir les autorités. « Je veux porter plainte, mais le père de mes enfants a refusé », a-t-elle expliqué. « Il a dit que c’est Dieu qui jugera. »[441]
Difficulté à identifier les agresseurs
À plusieurs reprises, les victimes ont indiqué à Human Rights Watch qu’elles ne pensaient pas pouvoir signaler les cas aux autorités ou porter plainte parce qu’elles n’étaient pas en mesure d’identifier leurs agresseurs ou ne savaient pas où ceux-ci se trouvaient. Reflétant les propos de nombreuses victimes, Lydie s’est interrogée sur la valeur d’un dépôt de plainte si elle n’était pas en mesure d’identifier les hommes qui l’ont violée. « Je ne connais pas leurs visages », a-t-elle dit des cinq combattants de la Séléka qui l’ont violée sur la route de Kaga-Bandoro à Ndele vers janvier 2013. « Si je porte plainte aujourd’hui, je vais demander justice contre qui ? »[442]
La police en République centrafricaine a l’obligation d’ouvrir un dossier sur un signalement de violences sexuelles, indépendamment du fait que la victime puisse identifier l’agresseur.[443] Cependant, l’ex-procureur général a expliqué que la mobilité des groupes armés commettant les violences, associée à l’incapacité des victimes à identifier leurs agresseurs, pose des défis considérables pour poursuivre les crimes de violences sexuelles.[444] D’autres autorités judiciaires ont confirmé que la police pouvait ouvrir une enquête contre un agresseur inconnu, mais que la probabilité de retrouver l’agresseur était mince. Un fonctionnaire de la police nationale a indiqué à Human Rights Watch que la police n’avait pas enregistré beaucoup de cas de viol par les groupes armés depuis le début de l’année 2016. « Cela ne signifie pas qu’il n’y a pas ces types de cas, mais un problème majeur est que nous ne connaissons pas [l’identité] des auteurs de ces crimes », a expliqué cette personne.[445]
Certaines victimes ont exprimé une volonté ferme de chercher à obtenir justice indépendamment du fait qu’elles connaissaient ou non l’identité de leurs agresseurs. Marie a raconté que quatre combattants de la Séléka l’ont violée devant son mari à Boy-Rabe en avril 2013. Elle a relaté les faits :
J’ai pensé à ce que ces hommes ont fait et à obtenir justice pour moi. Je veux que ces hommes soient jugés et mis en prison. Je veux porter plainte contre eux, même si je ne sais pas qui ils sont.[446]
La responsabilité des enquêtes sur les violences sexuelles incombe aux autorités, indépendamment de la capacité de la victime à identifier ou non son ou ses agresseur(s). Les Stratégies et mesures concrètes types de l’ONU sur la justice pénale pour les violences contre les femmes spécifient que « la responsabilité principale d’ouvrir des enquêtes et d’engager des poursuites incombe à la police et aux autorités de poursuite, et non pas aux femmes victimes d’actes de violence, quels que soient le degré ou la forme de violence ».[447] Cela inclut une enquête sur l’identité et la localisation des auteurs présumés.
Absence de certificats médicaux
Bien que, légalement, la procédure pénale n’exige pas de certificat médical attestant des signes de violences sexuelles, les prestataires de services et les autorités judiciaires ont indiqué à Human Rights Watch qu’une condamnation sans certificat était improbable. Rempli par un médecin au moment de la fourniture des services – que la victime accède à ces services immédiatement ou longtemps après un viol – le certificat médical offre la confirmation qu’une patiente présente des symptômes correspondant à des violences sexuelles, qui peuvent être physiques ou non en fonction du cas et du délai écoulé entre l’incident et l’administration des soins. « Un certificat médical est nécessaire pour attester des violences sexuelles », a confirmé l’ancien procureur général à Human Rights Watch. Sans lui, a-t-il précisé, « la seule chose qui reste est le témoignage. »[448] Cependant, a-t-il ajouté, les autorités peuvent quand même ouvrir des dossiers et utiliser d’autres méthodes – y compris la corroboration de témoignages et des témoins experts – pour juger les affaires dans lesquelles le certificat médical est absent.[449]
Un fonctionnaire du ministère de la Santé a indiqué à Human Rights Watch que les prestataires de soins de santé expliquent la valeur et l’importance des certificats médicaux aux victimes de viol, et remettent des certificats gratuits directement aux victimes sur demande.[450] Cependant, les Procédures opérationnelles standards (POS) pour les violences basées sur le genre (VBG) en République centrafricaine, adoptées par les principales agences soutenant les initiatives de lutte contre les violences basées sur le genre signale que les certificats médicaux ne sont pas gratuits « alors qu’ils constituent des [sic] importantes preuves médico-légales. La jurisprudence montre que le certificat (ou le rapport) constitue souvent l’élément principal probatoire en cas de recours à la justice pour une affaire de viol. »[451] D’après les POS, les certificats médicaux pour viol occasionnent un coût de 5 000 francs CFA (environ 8,09 dollars US) pour la documentation d’un cas récent ou de 20 000 francs CFA (environ 32,35 dollars US) pour un cas plus ancien. Le document note que les signataires plaident pour une fourniture gratuite de certificats ou de rapports médicaux.[452] Beaucoup de prestataires de services et d’autorités qui se sont entretenus avec Human Rights Watch n’avaient pas connaissance d’une politique officielle concernant ces honoraires, mais ils ont indiqué que les professionnels de santé dans les cliniques gérées par l’État ou les hôpitaux font souvent payer les certificats médicaux.[453]
Des praticiens dans certaines ONGI, ainsi qu’à l’hôpital de l’Amitié et à l’hôpital communautaire à Bangui ont expliqué qu’ils fournissent des certificats médicaux gratuitement à toute victime et certaines victimes qui se sont rendues dans ces établissements ont confirmé l’obtention de ces certificats.[454] Cependant, seules 14 victimes sur 112 qui ont signalé le viol au personnel des établissements de santé ont indiqué à Human Rights Watch qu’un prestataire de soins de santé leur avait fourni un certificat médical. Dans deux cas, les victimes ont raconté que le certificat a été remis à un membre de leur famille plutôt qu’à elles directement. D’autres ont rapporté qu’elles n’ont pas reçu de certificat ou qu’elles ne savaient pas si un certificat avait été établi.
Le père de Christelle, 13 ans, s’est souvenu avoir conduit sa fille à l’hôpital de Bambari après que des combattants de la Séléka l’ont violée en novembre 2015. « Ils nous ont juste donné un livret médical et nous ont dit d’aller de service en service », a-t-il raconté. « Il n’y avait pas de certificat médical. »[455]
Plusieurs victimes à Kaga-Bandoro ont indiqué à Human Rights Watch que le personnel hospitalier a établi des certificats médicaux, mais qu’il les a conservés à l’hôpital. Le personnel a expliqué aux victimes qu’elles devaient retirer les certificats auprès de l’hôpital si elles voulaient porter plainte.[456] D’autres femmes qui se sont rendues à l’hôpital de Kaga-Bandoro pour des soins ont précisé qu’elles n’avaient pas du tout eu connaissance d’un certificat médical.[457]
Une sage-femme à l’hôpital de Kaga-Bandoro a confirmé que l’hôpital gardait les certificats médicaux des victimes de violences sexuelles jusqu’à ce qu’une procédure judiciaire soit lancée. Elle a indiqué à Human Rights Watch, qui s’est rendu à l’hôpital en mai 2016, qu’ils ne fournissaient pas de certificats médicaux. « Nous ne pouvons émettre un certificat médical maintenant », a-t-elle raconté en mai 2016. « Nous attendons que le système judiciaire recommence à fonctionner. »[458] Elle a aussi dit que le personnel n’établit pas de certificats médicaux de manière systématique, mais plutôt à la demande de la patiente. « C’est quand elle le demande que nous l’établissons », a-t-elle indiqué. « Ce n’est pas à nous de lui en parler. »[459]
Un médecin de l’hôpital de Bambari et une sage-femme de l’hôpital de Boda ont aussi affirmé que leurs établissements ne fournissent un certificat médical aux victimes que sur demande.[460] À l’hôpital de Bambari, un médecin a déclaré qu’il ne savait pas si les patientes devaient payer des frais pour le certificat.[461]
Certaines victimes pensaient qu’elles avaient besoin d’un certificat médical pour porter plainte. Natifa a raconté qu’elle n’a pas pu déposer de plainte parce que les hôpitaux ne fonctionnaient pas quand des combattants anti-balaka l’ont violée à Bangui en février 2014 et qu’elle n’avait pas de certificat médical. « Si vous allez à l’hôpital et que vous obtenez un certificat médical, alors vous pouvez aller porter plainte », a-t-elle expliqué.[462]
Les recommandations de l’Organisation mondiale de la Santé sur la prise en charge clinique du viol dans les situations d’urgence prévoient que les soins après un viol incluent la rédaction d’un certificat médical. « Il incombe au prestataire de soins examinant la victime de s’assurer qu’un certificat est effectué », stipulent les recommandations. « Le certificat médical est un document médical confidentiel que le médecin doit transmettre à la victime. »[463] Les POS concernant les VBG en République centrafricaine préconisent la remise de certificats médicaux aux victimes gratuitement.[464]
Cour pénale spéciale
En juin 2015, la présidente de l’époque Catherine Samba-Panza a signé une loi instaurant une Cour pénale spéciale (CPS) temporaire pour engager des enquêtes et des poursuites sur les graves violations des droits humains perpétrées dans le pays depuis 2003.[465] Il s’agit de la première fois qu’un gouvernement adopte une loi qui crée un tribunal hybride, composé de juges et de procureurs nationaux et internationaux, intégré dans son système judiciaire national. Étant donné la faiblesse du système judiciaire national centrafricain et la concentration de la CPI sur les poursuites à l’encontre des responsables haut placés des crimes les plus graves, la CPS pourrait contribuer de manière significative à lutter contre l’impunité pour les violations graves commises pendant le conflit armé.[466]
Le mandat de la CPS inclut les enquêtes et les poursuites concernant les graves violations des droits humains et du droit international humanitaire perpétrées en République centrafricaine depuis le 1er janvier 2003, « telles que définies par le Code Pénal Centrafricain et en vertu des obligations internationales contractées par la République Centrafricaine en matière de Droit international, notamment le crime de génocide, les crimes contre l’humanité et les crimes de guerre ».[467] Le Code pénal centrafricain définit les crimes de guerre conformément aux Conventions de Genève de 1949 et est conforme au droit international humanitaire coutumier.[468] Les crimes contre l’humanité, tels que définis par le Code pénal centrafricain, incluent « [l]e viol, l’esclavage sexuel, la prostitution forcée, la grossesse forcée, la stérilisation forcée ou toute autre forme de violence sexuelle de gravité comparable ».[469]
Dans leur rapport du Projet Mapping de 2017, les Nations Unies avertissent que, compte tenu des crimes nombreux et divers commis par les groupes armés, « les cas de violence sexuelle risquent d’être négligés » par les enquêteurs de la CPS, comme cela s’est produit dans le passé avec des mécanismes de justice similaires.[470] Le rapport souligne l’urgence de donner la priorité aux enquêtes sur les crimes de violences sexuelles, dans le système de tribunaux nationaux et à la CPS, et de protéger les victimes et les témoins dans ces affaires.[471]
La loi établissant la CPS prévoit que si la CPI et la CPS sont amenées à travailler sur la même affaire, la priorité reviendra à la CPI.[472] En termes de compétence par rapport aux tribunaux nationaux ordinaires, la CPS bénéficie d’une compétence prioritaire mais non exclusive, ce qui signifie qu’elle a priorité pour sélectionner les affaires, mais les tribunaux ordinaires peuvent toujours juger les affaires de crimes internationaux graves restantes, conformément à la législation centrafricaine.[473]
Les avancées dans l’établissement de la Cour ont été lentes en raison de retards dus à l’insécurité permanente, à l’organisation d’élections nationales et aux longues négociations pour déterminer les tâches et les responsabilités des autorités nationales et internationales impliquées dans la CPS, y compris la MINUSCA.[474]
Dans une étape majeure pour rendre la CPS opérationnelle, le 15 février 2017, le président Touadéra a nommé Toussaint Muntazini Mukimapa de la République démocratique du Congo comme procureur spécial de la CPS.[475] Le 11 avril, le ministre de la Justice Flavien Mbata a annoncé la nomination de deux juges internationaux, suivie le 5 mai par la désignation de cinq juges nationaux. Le 6 juin, le président Touadéra a nommé un procureur international adjoint.[476]
Certains fonctionnaires judiciaires ont exprimé des inquiétudes sur le fait que la CPS détournera du personnel indispensable, attirera l’attention internationale et bénéficiera du soutien financier du système judiciaire national sans renforcement du système national.[477] Une fois opérationnelle, la CPS devrait s’efforcer, dans ses méthodes de travail, d’améliorer – plutôt que de mettre à mal – la capacité du système judiciaire national pour juger les crimes graves.
Un défi clé pour la CPS et les tribunaux nationaux consiste à assurer une protection fiable pour les témoins et les victimes de violences sexuelles. Actuellement, il n’existe aucun mécanisme de protection de ce type en République centrafricaine. Aucune victime n’a participé, que ce soit en tant que témoin ou que partie civile, à la session criminelle de 2015 assistée par l’ONU à Bangui, en partie pour des questions de sécurité.[478] Dans la session criminelle de 2016, quatre témoins ont participé en tant que parties civiles ; un seul était témoin dans une affaire liée au conflit, qui impliquait des accusations d’associations de malfaiteurs.
Au moment de la rédaction du présent rapport, la MINUSCA assurait la sécurité des fonctionnaires de la Cour pénale spéciale nommés à ce jour, conformément à son mandat pour aider la CPS.[479] Du personnel de la MINUSCA a indiqué que des membres de la MINUSCA et de la police centrafricaine seront affectés à la sécurité du personnel de la Cour.[480]
Comme indiqué, la MINUSCA élaborait une stratégie de protection pour le système judiciaire standard et la CPS au moment de la rédaction de ce rapport.[481] En raison du manque de ressources et de capacité au niveau national, l’aide continue de la MINUSCA pour protéger le personnel judiciaire, les victimes et les témoins est critique.
Cour pénale internationale
Les crimes documentés dans ce rapport peuvent faire l’objet de poursuites judiciaires devant la Cour pénale internationale (CPI), qui a compétence sur les crimes les plus graves lorsque les États n’ont pas la volonté ou la capacité de mener des enquêtes ou de juger ces crimes.[482] Cela inclut les crimes contre l’humanité et les crimes de guerre.[483]
En mai 2014, la présidente par intérim Catherine Samba-Panza a déféré la situation en République centrafricaine à la Cour pénale internationale (CPI), invitant la procureure à enquêter sur les crimes entrant dans la compétence de la Cour. En septembre 2014, la procureure de la CPI a annoncé l’ouverture d’une enquête sur les crimes présumément commis en République centrafricaine depuis août 2012.[484] La procureure a noté qu’il y avait « une base raisonnable permettant de croire que la Séléka et les groupes anti-balaka ont commis des crimes contre l’humanité et des crimes de guerre », notamment des viols et des meurtres.[485]
Le Bureau du Procureur a déployé deux équipes pour enquêter sur les crimes graves commis par la Séléka et les anti-balaka. Au moment de la rédaction du présent rapport, la CPI n’avait encore prononcé de charges à l’encontre d’aucun individu.
L’enquête de la CPI sur les crimes commis depuis 2012 représente la deuxième enquête de ce type sur les crimes perpétrés en République centrafricaine. La première enquête, ouverte en mai 2007, s’est concentrée sur les crimes commis pendant les bouleversements politiques de 2002 et 2003 et le coup d’État mené par Bozizé.[486] Ainsi, la CPI a mené une enquête et engagé des poursuites contre Jean-Pierre Bemba Gombo, ancien vice-président de la République démocratique du Congo, pour des abus commis par ses troupes. En mars 2016, la CPI a jugé Bemba coupable de crimes de guerre et de crimes contre l’humanité, qui incluent tous deux le viol.[487] Le verdict a créé un précédent notable sur la responsabilisation pour les violences sexuelles en période de conflit et sur la culpabilité individuelle découlant de la responsabilité du commandement.[488] Le 21 juin 2016, Bemba a été condamné à 18 ans de prison.[489] Le verdict de culpabilité à l’encontre de Bemba autorise les victimes de violences sexuelles à soumettre des demandes de réparations.
V. Obligations légales de la République centrafricaine
« Nous sommes innocents – nous n’avons rien à voir avec le conflit. Le gouvernement a la responsabilité de gérer ses problèmes, mais nous sommes abandonnés par notre gouvernement. Personne ne nous aide. »
– Aisha, 37 ans, Bangui
Les actes de violences sexuelles documentés dans le présent rapport – ainsi que les attaques aveugles contre des civils, les exécutions, les actes de torture, l’esclavage et les pillages – violent le droit international humanitaire et relatif aux droits humains et peuvent constituer des crimes de guerre et des crimes contre l’humanité. Le viol et l’esclavage sexuel enfreignent les traités internationaux et régionaux auxquels la République centrafricaine est partie, ainsi que sa propre législation nationale.
Droit international humanitaire et droit pénal international
Le conflit entre les groupes armés Séléka et anti-balaka en République centrafricaine est un conflit armé non international ; il est donc soumis au droit international humanitaire coutumier applicable aux conflits armés non internationaux, ainsi qu’à l’article 3 commun aux quatre Conventions de Genève (« Article 3 commun ») et au deuxième protocole additionnel de 1977 aux Conventions de Genève (Protocole II), auxquels la RCA est partie.[490] Les personnes sous le contrôle de groupes armés dans un conflit armé interne doivent dans tous les cas être traitées conformément au droit international humanitaire, qui comprend d’importantes normes de droits humains.[491]
Le droit international humanitaire interdit toute violence délibérée envers les civils et les autres personnes qui ne participent pas aux hostilités au moment des faits. Le droit international humanitaire coutumier proscrit le viol et les autres formes de violences sexuelles. L’article 3 commun interdit « les atteintes portées à la vie et à l’intégrité corporelle », notamment « les traitements cruels [et] tortures », ainsi que « les atteintes à la dignité des personnes, notamment les traitements humiliants et dégradants » sur toute personne ne participant pas au conflit.[492] Ces abus sont censés couvrir les actes de viols et les autres violences sexuelles. En outre, le Protocole II des Conventions de Genève établit des garanties fondamentales pour la protection des civils qui interdisent le viol et l’attentat à la pudeur, ainsi que toutes les formes d’esclavage.[493]
Violences sexuelles comme crime de guerre et crime contre l’humanité
Les violences sexuelles perpétrées par les groupes armés en République centrafricaine depuis 2013 représentent une violation grave du droit international humanitaire et constituent dans la plupart, voire la totalité, des cas un crime de guerre et peuvent constituer un crime contre l’humanité.
Conformément au statut établissant la CPI (le Statut de Rome), les crimes de guerre et les crimes contre l’humanité relevant de la compétence de la Cour incluent le viol, l’esclavage sexuel, la prostitution forcée, la grossesse forcée, la stérilisation forcée ou toute autre forme de violence sexuelle de gravité comparable.[494]
Les commandants et autres supérieurs sont pénalement responsables de la perpétration ou de la tentative de crimes de guerre découlant de leurs ordres et peuvent aussi être pénalement responsables en vertu du principe de « responsabilité du commandement » pour les crimes commis par leurs subordonnés s’ils connaissaient ou avaient une raison de connaître l’existence de ces crimes et n’ont rien fait pour les prévenir ou pour sanctionner les auteurs.[495] La CPI est compétente pour traduire en justice les commandants et les autres supérieurs dans de telles circonstances.
Crimes de guerre
Lorsqu’elles sont commises délibérément, les violations « graves » du droit international humanitaire ou les violations qui « mettent en danger des personnes ou des biens protégés, ou [qui] enfreignent des valeurs importantes » constituent des crimes de guerre.[496] Cela s’applique à la fois aux conflits armés internationaux et non internationaux, et aux acteurs étatiques et non étatiques.[497] Le droit international humanitaire oblige les États à mener des enquêtes et à juger les crimes de guerre commis par leurs citoyens ou sur leur territoire, que ce soit pendant un conflit armé international ou non international.[498]
Le Statut de Rome prévoit que la CPI peut juger le viol, l’esclavage sexuel et d’autres formes de violences sexuelles en tant que crimes de guerre, lorsque les éléments constitutifs du crime existent.[499] Le viol pouvait être poursuivi comme un crime de guerre en vertu du statut du Tribunal pénal international pour le Rwanda (TPIR)[500] et le Tribunal pénal international pour l’ex-Yougoslavie (TPIY) a statué que les actes de viol commis pendant le conflit étaient des crimes de guerre.[501]
Les organismes internationaux de protection des droits humains ont déterminé que les violences sexuelles peuvent être assimilées à de la torture et c’est clairement le cas lorsque le viol a lieu dans un contexte de privation de liberté.[502] En janvier 2016, le Rapporteur spécial sur la torture a explicitement noté que le viol et les autres violences sexuelles dans les conflits, qu’ils soient commis par des acteurs étatiques ou non étatiques, « sont incontestablement constitutifs de torture » en vertu de la jurisprudence pénale internationale et constituent, par conséquent, une violation du droit international humanitaire.[503]Les jugements prononcés par le TPIY définissent le viol comme une forme de torture.[504]
Les individus peuvent être tenus pénalement responsables lorsqu’ils ont commis un crime de guerre, mais aussi lorsqu’ils ont facilité, aidé ou encouragé la perpétration d’un crime de guerre ou la tentative d’en commettre un.[505] De plus, ils sont « aussi responsables [s’ils] planifient ou incitent à commettre un crime de guerre ».[506] Conformément au droit humanitaire coutumier sur la responsabilité du commandement, les individus peuvent être tenus pénalement responsables pour les crimes de guerre commis sur leurs ordres ou pour le fait de ne pas avoir empêché les crimes commis ou sur le point d’être commis par leurs subordonnés, dont ils avaient raisonnablement connaissance.[507] Un individu peut aussi être tenu responsable pour ne pas avoir sanctionné les subordonnés qui ont commis de tels crimes.[508]
L’article 28 du Statut de Rome énonce le principe de « responsabilité du commandement », en vertu duquel un commandant peut-être tenu pénalement responsable des crimes sous son commandement si, entre autres aspects, les crimes concernés relevaient de la responsabilité et du contrôle effectifs du commandant.[509]
Crimes contre l’humanité
Certains crimes, dont le viol, lorsqu’ils sont perpétrés dans le cadre d’attaques généralisées ou systématiques contre des civils, peuvent être reconnus comme des crimes contre l’humanité. « Généralisé » se réfère à l’échelle des actes ou au nombre de victimes.[510] « Systématique » renvoie à une attaque conduite selon un « schéma ou un plan méthodique ».[511] L’attaque doit viser un nombre suffisant de personnes qui sont essentiellement des non-combattants.[512] Pour être inculpé de crimes contre l’humanité, un individu doit avoir eu connaissance du fait que ses actions faisaient partie d’une telle attaque.[513]
Le viol et l’esclavage sexuel peuvent tous deux constituer des crimes contre l’humanité en vertu du Statut de Rome, si les autres éléments constitutifs d’un crime contre l’humanité exposés ci-dessus sont présents.[514] Les statuts du TPIY et du TPIR incluent l’esclavage comme un crime contre l’humanité et le TPIY a considéré l’esclavage sexuel comme étant un crime contre l’humanité.[515]
Dans son rapport de 2014, la Commission d’enquête de l’ONU sur la République centrafricaine a noté des preuves de responsabilité du commandement et de crimes contre l’humanité pour des violences sexuelles commises par des groupes armés :
Les actes de viol étaient suffisamment fréquents et suffisamment liés aux attaques plus larges contre la population civile, pour que les supérieurs au sein de la chaîne de commandement des forces respectives impliquées dans la perpétration des viols connaissent ou soient censés connaître la conduite de leurs subordonnés. Les représentants du réseau de commandement et de contrôle des groupes respectifs étaient soit présents sur la scène de crime, soit informés par les rapports reçus, ou auraient dû avoir connaissance de toute autre manière des actes de viol commis par leurs subordonnés. Ceci est particulièrement le cas étant donné la nature publique de certains viols, le recours fréquent au viol collectif par plusieurs auteurs et l’impunité flagrante avec laquelle les actes ont été commis, démontrant la connaissance, la tolérance ou l’acceptation aux plus hauts niveaux du commandement et de la coordination des groupes armés respectifs.[516]
Le Projet Mapping de l’ONU documentant les violations du droit international des droits humains et du droit international humanitaire commises en République centrafricaine, publié en mai 2017, indique aussi, à propos des violences sexuelles, que « [l]es chefs des groupes armés et les hauts gradés au sein des forces de sécurité ont encouragé de tels actes, n’ont pas essayé de les empêcher en usant de leur supériorité hiérarchique ou ont parfois été eux-mêmes impliqués dans des actes de violence sexuelle ».[517]
Droit international relatif aux droits humains
Les violences sexuelles enfreignent plusieurs droits humains internationaux protégés fondamentaux comme les droits à la vie, à la sécurité de la personne, à ne pas être soumis à la torture ou à d’autres mauvais traitements, et au meilleur état de santé physique ou mentale possible. Certaines formes de violences sexuelles, comme l’esclavage sexuel, violent les interdictions absolues concernant l’esclavage et le travail forcé en vertu du droit international relatif aux droits humains.[518] La République centrafricaine est un État partie au Pacte international relatif aux droits civils et politiques (PIDCP), au Pacte international relatif aux droits économiques, sociaux et culturels (PIDESC), à la Convention contre la torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants (CAT) et à la Convention sur l’élimination de toutes les formes de discrimination à l’égard des femmes (CEDAW). Ces traités affirment les droits énoncés plus haut, reconnaissant que les femmes et les filles ont le droit à une vie exempte de violences.[519] La République centrafricaine est aussi un État partie à la Convention relative aux droits de l’enfant (CRC), qui prévoit les mêmes droits à la vie, à la santé, à l’absence de discrimination et à la protection contre la violence, la torture et autres mauvais traitements pour toute personne de moins de 18 ans.[520]
Dans le cadre des hostilités survenant au cours d’un conflit armé, le droit international humanitaire, en tant que lex specialis (loi spécialisée), peut avoir préséance sur le droit international relatif aux droits humains, mais ne peut pas le remplacer.
Droit à la protection contre les violences sexuelles et à un recours pour les abus
Le droit international exige un traitement égal des hommes et des femmes et interdit la discrimination sur la base du sexe.[521] La CEDAW impose aux États de faire en sorte que les femmes jouissent des mêmes libertés et droits fondamentaux que les hommes, y compris les droits à la vie et à la santé, et de garantir « le plein développement et le progrès des femmes ».[522] Cela inclut des efforts pour lutter contre les attitudes et les comportements pouvant être préjudiciables aux femmes.[523]
Les organismes internationaux ont établi que la violence basée sur le genre ou « la violence exercée contre une femme parce qu’elle est une femme ou qui touche spécialement la femme » constitue une forme de discrimination.[524] Le comité chargé de la surveillance et des rapports concernant le respect de la convention CEDAW (Comité CEDAW) a précisé que la responsabilité des États d’éliminer toute discrimination exige qu’ils prennent les mesures appropriées pour réglementer les actes commis par des acteurs non étatiques.[525]
Dans sa Recommandation générale n° 30 sur les femmes et les conflits, le Comité CEDAW spécifie que les droits garantis par la Convention – et par le droit international humanitaire, le droit des réfugiés et le droit pénal complémentaires – s’appliquent pendant les périodes de conflit.[526] Le Comité appelle les États à interdire et « [prévenir] les actes de violence sexiste, enquête[r] sur ces actes et les sanctionne[r], en particulier les actes de violence sexuelle perpétrés par des acteurs étatiques et non étatiques » dans les conflits.[527] Les États ont l’obligation de protéger les femmes et les filles des violences, d’offrir un accès à des services pour les victimes de violences et de traduire en justice les auteurs, y compris dans les cas de violences sexuelles contre des personnes déplacées à l’intérieur du pays et des réfugiées.[528]
Dans les Observations finales suivant son rapport sur la République centrafricaine en 2014, le Comité CEDAW a rappelé au gouvernement ses obligations continues d’éliminer la discrimination à l’égard des femmes, y compris les violences contre les femmes et les filles, pendant le conflit en cours.[529] La résolution 1325 (2000) du Conseil de sécurité de l’ONU sur les femmes, la paix et la sécurité appelle tous les États membres de l’ONU et les parties à tout conflit armé à « prendre des mesures particulières pour protéger les femmes et les petites filles contre les actes de violence sexiste, en particulier le viol et les autres formes de sévices sexuels, ainsi que contre toutes les autres formes de violence dans les situations de conflit armé ».[530] La résolution 1325 invite également les États à mettre fin à l’impunité et à traduire en justice les auteurs de crimes contre l’humanité et de crimes de guerre, « y compris toutes les formes de violence sexiste et autre contre les femmes et les petites filles ».[531] Les résolutions du Conseil de sécurité de l’ONU 1820 (2008), 1888 (2009), 1889 (2009), 1960 (2010), 2106 (2013), 2122 (2013) et 2242 (2015) réitèrent l’appel à ce que « toutes les parties à des conflits armés [...] mettent immédiatement et totalement fin à tous actes de violence sexuelle » et à ce qu’elles s’engagent à prendre des mesures assorties de délais pour lutter contre les violences sexuelles.[532]
Outre les protections contre les violences sexuelles, le droit international relatif aux droits humains garantit le droit à un recours pour les victimes d’abus.[533] La résolution 1325 insiste sur la nécessité de responsabilisation pour les violences sexuelles, exhortant les États à poursuivre en justice les auteurs de violences sexuelles et d’autres crimes basés sur le genre et à exclure ces crimes des mesures d’amnistie.[534] Dans sa Recommandation générale sur l’accès à la justice, le Comité CEDAW reconnaît que les femmes peuvent rencontrer des obstacles supplémentaires pour obtenir réparation et appelle les États à garantir aux femmes un accès à des voies de recours opportunes, adéquates, efficaces et proportionnées pour les abus subis.[535] Concernant les violences sexuelles dans les conflits, le Comité spécifie que les États devraient mettre en œuvre des réformes institutionnelles et adopter une législation « prévoyant des sanctions adéquates, conformément aux normes internationales en matière de droits de l’homme ».[536] Toute décision déterminant les réparations devrait être prise avec la participation étroite des organisations féminines et de la société civile.[537] De plus, le Comité engage les États à ne pas utiliser de mécanismes de justice alternatifs en lieu et place d’enquêtes et de poursuites sur les violences sexuelles dans les conflits.[538] Comme stipulé dans la Note d’orientation du Secrétaire général de l’ONU sur les réparations pour les victimes de violences sexuelles commises en période de conflit, « toutes les victimes devraient avoir accès à des recours judiciaires efficaces qui comprennent des réparations adéquates, rapides et complètes pour le préjudice subi ».[539]
Droit à la santé
En plus des instruments internationaux qui garantissent le droit au plus haut niveau possible de santé, plusieurs organismes de protection des droits humains se sont spécifiquement penchés sur le droit aux soins de santé sexuelle et génésique, y compris pour les victimes de violences sexuelles. Le Comité des droits économiques, sociaux et culturels (CESCR), qui surveille la mise en œuvre du PIDESC, a déclaré que « le droit à la santé sexuelle et procréative fait partie intégrante du droit à la santé ».[540] Le CESCR reconnaît que les femmes et les filles touchées par un conflit peuvent subir un impact disproportionné sur leur droit à la santé sexuelle et procréative du fait de violences sexuelles.[541] Les obligations des États d’offrir des soins de santé complets – y compris des soins après un viol – pour les victimes de violences sont spécifiques et non équivoques :
Les États doivent garantir des soins de santé physique et mentale aux victimes de la violence sexuelle et conjugale dans toutes les situations, notamment l’accès à des services de prévention postérieurs, à la contraception d’urgence et à des services d’avortement médicalisé.[542]
Dans sa Recommandation générale n° 30 sur les femmes et les conflits, le Comité CEDAW note que, du fait de l’interruption des systèmes de santé et de la prévalence des violences sexuelles pendant les conflits, les femmes et les filles sont exposées à des risques plus élevés de maladies et de blessures touchant à la santé génésique, telles que grossesse non désirée, blessures pelviennes et maladies sexuellement transmissibles, dont le VIH.[543] De même, le Comité constate que les femmes et les filles sont confrontées à des obstacles supplémentaires pour exercer leur droit à la santé : « La détérioration ou la destruction des services de santé, associée aux contraintes pesant sur la mobilité des femmes et leur liberté de mouvement, sape encore davantage l’égalité d’accès des femmes aux soins de santé ».[544] Pour répondre aux besoins des victimes de violences sexuelles dans les zones touchées par les conflits, le Comité appelle les États à faire en sorte que les soins de santé sexuelle et génésique incluent une contraception d’urgence, une prophylaxie post-exposition et d’autres médicaments pour traiter et prévenir les infections sexuellement transmissibles, des services d’avortement sûrs, des soins psychosociaux et des soins pour les blessures liées aux violences sexuelles.[545] Les femmes déplacées et réfugiées devraient aussi avoir accès à ces services.[546]
Les organes de traités de l’ONU surveillant la mise en œuvre du PIDCP, du PIDESC, de la CEDAW, de la CRC et de la CAT se sont dits à plusieurs reprises préoccupés par l’impact que les lois restrictives sur l’avortement ont sur les droits des femmes à la vie, à la santé et à la non-discrimination et ont appelé à la dépénalisation de l’avortement, notamment en cas de grossesse résultant d’un viol.[547]
L’Observation générale n° 22 du CESCR note que l’obligation des États de respecter, protéger et réaliser le droit à la santé sexuelle et procréative interdit les lois restrictives sur l’avortement, y compris l’obligation d’obtenir l’accord d’un tiers pour accéder à l’avortement :
L’obligation de respecter impose aussi aux États de supprimer les lois et les politiques qui entravent l’accès aux services de santé sexuelle et procréative et de s’abstenir d’en adopter. Cela recouvre l’obligation d’obtenir l’accord d’un tiers, notamment d’un parent, de l’époux ou d’une autorité judiciaire, pour l’accès aux services et à l’information de santé sexuelle et procréative, y compris pour l’avortement et la contraception.[548]
Le CESCR indique aussi que ces restrictions figurent parmi un large éventail de lois, de politiques et de pratiques qui « compromettent l’autonomie et le droit à l’égalité et à la non-discrimination dans le plein exercice du droit à la santé sexuelle et procréative ».[549] Les Comités CEDAW, CRC, CAT, le Comité des droits des personnes handicapées (CRPD), l’OMS et le Rapporteur spécial de l’ONU sur le droit à la santé ont aussi appelé les États à supprimer l’obligation d’autorisation d’un tiers, constatant qu’elle est discriminatoire pour les femmes et constitue un obstacle pour l’accès aux services de santé génésique.[550]
Alors que le CESCR reconnaît que certains États peuvent ne pas avoir la capacité pour garantir immédiatement la pleine réalisation de tous les droits à la santé sexuelle et procréative, les États doivent montrer qu’ils prennent les mesures nécessaires et utilisent tous les moyens pour respecter rapidement et efficacement ces obligations.[551] Toute mesure qui discrimine des groupes particuliers concernant l’accès à des soins de santé sexuelle et procréative – y compris les lois restrictives sur l’avortement – doit être éliminée immédiatement.[552] De plus, les femmes dans les zones rurales doivent avoir un accès égal aux établissements de santé, y compris aux services de santé procréative.[553]
Les organismes de protection des droits humains ont aussi appelé spécifiquement au retrait des sanctions pénales à l’encontre des femmes qui subissent un avortement. Le CESCR a indiqué que les « obstacles juridiques qui empêchent les individus d’accéder aux services de santé sexuelle et procréative, tels que des dispositions pénales visant les femmes qui avortent » violent les droits des femmes.[554] Plaidant en faveur de la dépénalisation de l’avortement, le Rapporteur spécial sur le droit à la santé a demandé aux États d’« envisager, en tant que mesure intermédiaire, la formulation par les autorités compétentes de politiques et de protocoles imposant un moratoire à l’application des lois pénales qui concernent l’IVG ».[555]
Droit régional relatif aux droits humains
Le droit régional relatif aux droits humains inclut aussi des protections contre les violences sexuelles. La Charte africaine des droits de l’homme et des peuples garantit les droits à la vie, à ne pas être soumis à la torture ou à d’autres mauvais traitements, à l’absence de discrimination, et à la santé.[556] Le Protocole à la Charte africaine des droits de l’homme et des peuples relatif aux droits des femmes en Afrique (Protocole de Maputo), que la République centrafricaine a signé mais pas ratifié, détaille les obligations des États pour protéger les femmes des violences sexuelles, y compris en adoptant et en appliquant des lois, en fournissant des services accessibles aux victimes et en garantissant la sanction des auteurs.[557] De plus, en période de conflit armé, les États doivent agir pour protéger les femmes contre « toutes les formes de violence, le viol et autres formes d’exploitation sexuelle » et doivent « s’assurer que de telles violences sont considérées comme des crimes de guerre, de génocide et/ou de crimes contre l’humanité et que les auteurs de tels crimes sont traduits en justice devant des juridictions compétentes ».[558]
En outre, le Protocole sur la prévention et la répression de la violence sexuelle contre les femmes et les enfants de la Conférence internationale sur la région des Grands Lacs (CIRGL), qui engage la République centrafricaine en tant que membre de la CIRGL, invite les États à prévenir et à sanctionner les violences sexuelles, qu’elles soient commises en temps de conflit ou de paix.[559] Conformément au Protocole de la CIRGL, les États membres doivent garantir aux victimes de violences sexuelles l’accès à des services juridiques et médicaux et faciliter l’accès à la justice en simplifiant les procédures de plaintes, en utilisant des méthodes respectueuses des victimes dans le cadre des poursuites judiciaires et en formant le personnel du secteur de la sécurité et du système judiciaire à la réponse aux violences sexuelles.[560]
La Charte africaine des droits et du bien-être de l’enfant, que la République centrafricaine a signée mais pas ratifiée, prévoit les droits à la vie, à la non-discrimination et au plus haut niveau possible de santé mentale et physique.[561] La Charte appelle aussi les États à « pren[dre] des mesures législatives, administratives, sociales et éducatives spécifiques pour protéger l’enfant contre toute forme de tortures, traitements inhumains et dégradants », y compris les sévices sexuels.[562] Des mesures doivent aussi être prises spécifiquement pour protéger les enfants touchés par les conflits armés.[563]
Législation nationale
En vertu de la Constitution adoptée à la fin de l’année 2015, le gouvernement de la République centrafricaine doit protéger les droits de tous les citoyens à la vie, à la liberté, à l’intégrité corporelle et à la non-discrimination.[564] Condamnant la torture et les autres traitements cruels, inhumains, dégradants ou humiliants, la Constitution stipule explicitement que personne ne doit être soumis au viol.[565] De plus, elle prévoit que la protection des femmes et des enfants contre la violence constitue « une obligation pour l’État ».[566] Toutes les victimes de violations des dispositions de la Constitution ont droit à des réparations.[567]
Le Code pénal de la République centrafricaine inclut le viol et l’attentat à la pudeur comme des infractions pénales, même s’il ne définit pas la notion d’« attentat à la pudeur ».[568] Les sanctions pour un viol vont des amendes et des peines de prison de dix ans maximum jusqu’aux travaux forcés. La peine de mort peut être imposée si la victime est décédée, a été torturée ou a subi de graves sévices.[569] Le viol d’un enfant entraîne la peine maximale et les violences sexuelles, les tentatives de violences sexuelles ou l’agression sexuelle envers un enfant de moins de 15 ans sont considérées comme un viol par la loi.[570] Le viol avec des circonstances aggravantes – notamment sur une personne enceinte ou présentant un handicap mental ou physique, ou commis par de multiples auteurs ou sous la menace d’une arme – peut être puni par des travaux forcés à perpétuité.[571]
La loi de 2006 portant protection de la femme contre les violences impose des sanctions pour les violences dirigées contre les femmes ou les filles « causant ou pouvant causer aux femmes un préjudice ou des souffrances physiques, sexuelles ou psychologiques ».[572] Comme dans le Code pénal, la loi stipule que le viol – ainsi que la tentative de viol – doit être puni par des travaux forcés.[573] En cas de coups ou de violences délibérés, ainsi qu’en cas de violence commise en public, les condamnations doivent inclure des amendes et des peines d’emprisonnement.[574] Celles-ci peuvent augmenter du fait de circonstances aggravantes, notamment si la victime est enceinte ou si la violence a entraîné une maladie ou une infirmité.[575] La loi exige que tous les établissements médicaux, qu’ils soient publics ou privés, fournissent des soins d’urgence à toutes les victimes de violences.[576]
En 1998, le procureur général a publié une circulaire appelant à traiter certains crimes comme des délits pour réduire les délais des procédures. Parmi ces crimes, figurait le viol ou la tentative de viol.[577] Bien que la circulaire demande que « toute la rigeur de la loi soit appliquée », y compris en imposant les peines les plus sévères, des autorités travaillant dans le secteur judiciaire ont indiqué à Human Rights Watch que la circulaire a conduit à ce que des procureurs traitent le viol comme un délit plutôt que comme une infraction pénale, faisant donc l’objet de sanctions moins lourdes.[578] En mars 2016, le ministre de la Justice a publié une nouvelle circulaire enjoignant tous les juges et les fonctionnaires des tribunaux à cesser cette pratique pour les crimes de violences sexuelles, notant avec inquiétude des taux élevés de violences sexuelles et la nécessité de garantir la responsabilisation. « La fréquence de ces crimes et leur commission pendant les conflits justifient désormais que toute la rigueur de la loi soit appliquée afin de dissuader les éventuels auteurs », a-t-il ordonné.[579] Des autorités judiciaires ont expliqué à Human Rights Watch que cet ordre serait appliqué immédiatement, indiquant que les affaires de violences sexuelles seraient désormais jugées lors de sessions de la cour criminelle.[580]
Recommandations
Aux dirigeants de la Séléka et des forces anti-balaka
- Mettre fin immédiatement aux attaques à l’encontre des civils et donner des ordres publics clairs à vos forces respectives de cesser toute violence sexuelle – y compris harcèlement et intimidation – dans les zones sous votre contrôle.
- Garantir un accès sans entrave aux zones sous leur contrôle aux organismes et aux organisations non gouvernementales qui fournissent des services aux personnes ayant survécu à des violences sexuelles, ainsi qu’à la police, aux procureurs, aux juges et aux autres employés du système judiciaire et d’application de la loi.
- Coopérer dans toutes les enquêtes et les poursuites menées par les autorités nationales et internationales sur des membres de la Séléka et des anti-balaka soupçonnés d’avoir commis des atteintes aux droits humains.
- Enquêter et imposer des sanctions lorsque des violences sexuelles ont été commises par des combattants sous leur contrôle, y compris transférer ces combattants aux autorités gouvernementales nationales et à la MINUSCA en vue de poursuites judiciaires.
Au Bureau du Président de la République centrafricaine
- En coopération avec les agences de l’ONU, la mission de l’ONU et les ministères du gouvernement concernés, soutenir de toute urgence le développement et la mise en œuvre d’une stratégie nationale pour lutter contre les violences sexuelles et y répondre, y compris les violences sexuelles liées au conflit.
- Élaborer et mettre en place, en collaboration avec les Nations Unies, une stratégie pour la protection des civils, incluant des mesures spécifiques pour protéger les femmes et les filles et pour limiter le risque de violences sexuelles.
- Conjointement avec la mission de l’ONU, accélérer la mise en place de la Cour pénale spéciale et lui apporter un soutien politique total pour qu’elle remplisse son mandat, tout en respectant son indépendance.
- Garantir une participation totale et égale des femmes dans l’élaboration et la négociation de tout accord de paix, inclure des experts en genre pour s’assurer que ces accords respectent entièrement les droits des femmes et des filles, et s’opposer activement à toute amnistie dans ces accords pour les auteurs de violences sexuelles.
Au Parlement
- Ratifier le Protocole à la Charte africaine des droits de l’homme et des peuples relatif aux droits des femmes en Afrique (communément appelé Protocole de Maputo) et mettre en place une législation, ou renforcer la législation existante, visant à protéger les femmes des violences sexuelles, fournir des services accessibles pour les victimes et garantir la sanction des auteurs.
- Modifier le Code pénal et la loi n° 06.005 relative à la santé de reproduction pour supprimer l’autorisation d’un tiers pour l’avortement, y compris en cas de viol ou d’inceste, éliminer les mesures punitives pour les femmes qui ont recours à l’avortement et dépénaliser l’avortement.
- Adopter une loi d’aide légale pour fournir une assistance juridique aux victimes de crimes qui n’ont pas les moyens de payer une représentation légale, y compris les victimes de violences sexuelles.
Au Ministère de la Justice
- Former la police, les gendarmes, les procureurs et les juges sur la manière de répondre aux violences sexuelles et basées sur le genre et de mener des enquêtes et des poursuites sur ces cas. Apporter un soutien constant à l’Unité mixte d’intervention rapide et de répression des violences sexuelles faites aux femmes et aux enfants (UMIRR) afin d’enquêter sur les violences sexuelles conformément aux normes des meilleures pratiques internationales. Cela inclut le recrutement de personnel féminin, la nomination et la formation de chargés de liaison compétents dans toutes les provinces et un travail pour étendre le principe de l’Unité mixte au niveau provincial.
- Introduire un mécanisme de vérification des antécédents pour les hauts fonctionnaires et les responsables militaires afin de s’assurer qu’aucun auteur de violences sexuelles n’entre en fonction.
- Enquêter sur les allégations de réintégration de membres de la Séléka et des anti-balaka au sein des forces de sécurité, dont la police, la gendarmerie et l’armée nationale. Suspendre immédiatement tout combattant connu de la Séléka ou des anti-balaka de ces forces en attendant un processus de vérification pour s’assurer qu’il n’a pas participé à des violations de droits humains, y compris des violences sexuelles et d’autres formes de violences basées sur le genre.
- Proposer et soutenir une modification du Code pénal et de la loi n° 06.005 relative à la santé de reproduction pour supprimer l’autorisation d’un tiers pour l’avortement, y compris en cas de viol ou d’inceste, éliminer les mesures punitives pour les femmes qui ont recours à l’avortement et dépénaliser l’avortement. Faciliter, en attendant, l’accès à un avortement sûr et légal, clarifier immédiatement les procédures pour accéder à un avortement légal en vertu de la loi existante, y compris en cas de viol.
Au Ministère de la Santé
- Garantir la disponibilité et la fourniture gratuite de soins médicaux d’urgence après un viol essentiels dans les postes de santé, les centres de santé et les hôpitaux de district, régionaux et nationaux. S’assurer que de tels soins respectent le protocole national de prise en charge clinique du viol, y compris – avec le consentement éclairé de la victime – une contraception d’urgence, une prophylaxie post-exposition pour la prévention du VIH, la prévention et le traitement d’autres infections sexuellement transmissibles, ainsi qu’un test de grossesse et un accès à un avortement sûr ou une orientation pour avorter.
- Former le personnel – y compris les infirmiers et les sages-femmes – dans les postes de santé, les centres de santé et les hôpitaux de district, régionaux et nationaux à la fourniture de soins médicaux après un viol exhaustifs, centrés sur la victime et confidentiels. La formation devrait inclure une clarification de la loi et des procédures concernant l’accès à l’avortement en cas de viol et l’information des victimes sur les services d’avortement.
- En collaboration avec les Nations Unies et les organisations humanitaires, mettre en œuvre des systèmes d’orientation parmi les prestataires de services médicaux, psychosociaux et légaux pour les victimes de violences sexuelles. Former le personnel médical sur la manière et la raison d’orienter les victimes vers des services médicaux, psychosociaux et légaux.
- Garantir l’accès à un soutien psychosocial pour les victimes de violences sexuelles, ainsi que pour les enfants et les autres personnes qui ont été témoins de violences sexuelles ou d’autres traumatismes, au niveau des hôpitaux de district et plus haut. Au niveau de la communauté, garantir l’accès à des services psychosociaux via des systèmes d’orientation lorsque les soins ne sont pas disponibles sur place.
- Fournir des certificats/rapports médicaux gratuits à toutes les victimes de violences sexuelles au moment de la consultation médicale initiale après le viol.
- En coordination avec le ministère des Affaires sociales/du Genre, mener des activités de sensibilisation et d’évolution des comportements pour éduquer les membres de la communauté sur la manière et la nécessité pour les victimes d’accéder rapidement aux services et pour lutter contre la stigmatisation et le rejet des victimes.
- Envisager un dépistage des patientes ayant subi des violences sexuelles et basées sur le genre dans les établissements de santé au niveau du district et plus haut, après l’instauration de conditions préalables incluant la disponibilité d’espaces confidentiels et la formation du personnel sur les mécanismes de réponses aux violences et d’orientation.
À la Mission des Nations Unies en République centrafricaine (MINUSCA)
- Donner la priorité à la prévention et à la surveillance des violences sexuelles dans le conflit, ainsi qu’à la réalisation d’enquêtes et de rapports opportuns.
- Aider les autorités à identifier, arrêter et poursuivre en justice les auteurs de crimes de violences sexuelles commis par des groupes armés conformément au mandat de la mission.
- Encourager le financement et la formation de la police et d’autres institutions de l’État de droit, y compris des procureurs, des juges et du personnel déployé à la Cour pénale spéciale et à l’UMIRR, sur les enquêtes et les poursuites concernant les violences sexuelles et basées sur le genre. Accorder la priorité à l’inclusion de personnel féminin dans les équipes qui travaillent sur ces affaires.
- S’assurer que la stratégie de protection des civils inclut des mesures pour prévenir les violences sexuelles commises par des groupes armés et y répondre. Déployer des équipes civiles, y compris des spécialistes de la protection, dans les zones où les civils sont exposés à un risque accru pour instaurer la confiance auprès de la population et des autorités locales.
- Conjointement avec le gouvernement national, accélérer la mise en place de la Cour pénale spéciale et offrir un appui politique solide pour qu’elle remplisse son mandat. Intégrer une protection des témoins et des victimes dans le soutien de la Cour et des autres institutions judiciaires, notamment pour les affaires sensibles comme les cas impliquant des violences sexuelles dans lesquels les témoins ou les victimes sont confrontés à un risque de stigmatisation, de menaces ou de mort.
- Former les Casques bleus et la police de l’ONU à répondre aux violences sexuelles et basées sur le genre, y compris l’orientation des victimes de violences sexuelles vers des services appropriés.
- Travailler à l’amélioration des relations et de la communication avec les communautés locales en intégrant dans les patrouilles des assistants linguistiques et des officiers de liaison avec les communautés, ainsi qu’en aidant les civils à signaler les abus à la mission en toute sécurité.
- En coordination avec le Sous-Cluster VBG, participer à la collecte de données et au partage d’informations sur les violences sexuelles conformément aux normes de bonnes pratiques.
- En coordination avec les agences gouvernementales et les organisations locales et internationales, aider à la distribution d’aliments, d’eau, d’abris et d’autres ressources essentielles pour contribuer à réduire les risques de violences à l’égard des femmes et des filles.
- S’assurer que les commandants des bases sur le terrain de la MINUSCA s’efforcent d’identifier et de limiter les risques pour la protection des femmes et des filles en coordination avec les autorités locales, les chefs traditionnels et les représentants de la société civile et des personnes déplacées, y compris les leaders et les groupes de femmes.
Au Conseil de sécurité des Nations Unies
- Insister sur l’exécution totale de la résolution 1325 et des résolutions suivantes sur les femmes, la paix et la sécurité en République centrafricaine, y compris la fin de la perpétration de violences sexuelles par les groupes armés, la fin de l’impunité pour les violences sexuelles dans le conflit, la fourniture de services d’assistance complets pour toutes les victimes et la participation totale et égale des femmes dans les négociations de paix, les mécanismes de justice transitionnelle et les processus de désarmement, de démobilisation et de réintégration.
- Imposer des sanctions aux individus responsables de violences sexuelles liées au conflit, conformément aux critères tels qu’amendés dans la résolution 2339 du Conseil de sécurité de janvier 2017.
- Promouvoir le soutien de la MINUSCA à la Cour pénale spéciale et aux autres efforts du gouvernement pour rendre justice, y compris pour les crimes de violences sexuelles, dans le but de traduire en justice les responsables des abus commis dans le conflit en vertu des normes internationales de procès équitable.
- Préconiser et surveiller la formation des Casques bleus de la MINUSCA et d’autres missions de l’ONU de protection des civils, y compris la formation à la prévention des violences sexuelles et basées sur le genre et à la réponse à y apporter, avant leur déploiement.
- Inciter la division des droits de l’homme de la MINUSCA à s’engager à établir des rapports réguliers sur les atteintes aux droits humains, en portant une attention particulière aux enquêtes et à la publication des conclusions sur les violences sexuelles et basées sur le genre.
À la Commission de l'Union africaine
- Renforcer le soutien à la Cour pénale spéciale et à la reconstruction des mécanismes de la justice au niveau national.
- Travailler avec les autorités centrafricaines ou autres pour soutenir les services médicaux, psychosociaux, socio-économiques et juridiques offerts aux victimes.
À la Commission africaine des Droits de l'homme et des peuples et à l'Envoyé spécial de l'Union africaine sur les femmes, la paix et la sécurité :
- Lancer de toute urgence une mission d'enquête et de promotion pour enquêter sur les crimes de violence sexuelle commis par les groupes armés en République centrafricaine, sensibiliser la population à l'existence de ces crimes, promouvoir la protection des droits des femmes, et rendre publics des rapports sur les résultats obtenus.
- Appuyer publiquement les services destinés aux survivants et appeler à des mesures visant à éliminer la stigmatisation des survivants.
- Soutenir le Tribunal pénal spécial et la reconstruction des mécanismes nationaux de la justice.
- Par le biais des mandats du Rapporteur pour la République centrafricaine et le Rapporteur spécial sur les droits de la femme en Afrique, condamner systématiquement et publiquement les crimes de violence sexuelle commis par les groupes armés en RCA.
- Exhorter le gouvernement centrafricain à présenter son rapport sur la situation générale des droits de l'homme dans le pays, conformément à l'article 62 de la Charte africaine des droits de l'homme et des peuples.
- Exhorter le gouvernement centrafricain à ratifier le Protocole à la Charte africaine des droits de l'homme et des peuples sur les Droits de la femme en Afrique.
À la division des droits de l’homme de la MINUSCA, au Bureau du Haut-Commissariat aux droits de l’homme des Nations Unies, au Fonds des Nations Unies pour la population (UNFPA) et à ONU-Femmes
- Coordonner et mettre en œuvre des systèmes d’orientation pour améliorer l’accès opportun à des services médicaux et psychosociaux complets pour les victimes dans le pays.
- Avec d’autres agences de l’ONU, des agences gouvernementales et des organisations non gouvernementales, collecter des données et produire des rapports réguliers sur les violences sexuelles liées au conflit. Établir des définitions et des normes cohérentes entre agences pour la collecte des données et le partage des informations conformément aux normes de bonnes pratiques.
- Partager les preuves et les informations sur les auteurs de violences sexuelles liées au conflit avec le Groupe d’experts des Nations Unies sur la République centrafricaine, qui a pour mandat de formuler des recommandations pour les désignations de sanctions.
- S’engager à établir des rapports publics en temps opportun sur l’incidence et les tendances des violences sexuelles liées au conflit au sein de la République centrafricaine, y compris l’identification des auteurs lorsque cela est possible.
- Dialoguer avec les personnes ayant survécu à des violences sexuelles, les groupes de femmes, les prestataires de services locaux et les représentants des communautés pour rassembler des informations sur les violences sexuelles dans le conflit et pour élaborer des stratégies visant à renforcer la prévention, la réponse et la fourniture de services aux victimes.
Aux organisations non gouvernementales fournissant des services aux victimes de violences sexuelles
- Accorder la priorité à la fourniture de services médicaux, psychosociaux, légaux et de réintégration aux victimes de violences sexuelles à la fois dans les zones rurales et urbaines.
- En coordination avec le Sous-Cluster VBG et les agences de l’ONU et du gouvernement, mettre en œuvre des systèmes d’orientation pour améliorer l’accès rapide à des services médicaux et psychosociaux complets pour les victimes. Garantir l’accès à des fonds pour les coûts associés, tels que les frais de transport, afin que ceux-ci ne soient pas un frein pour accéder aux services.
- Offrir un soutien psychosocial aux enfants et aux autres personnes qui ont été témoins de violences sexuelles ou qui sont affectés par des violences sexuelles subies par un membre de leur famille.
À la Représentante spéciale du Secrétaire général des Nations Unies chargée de la question des violences sexuelles en conflit, et à la Rapporteuse spéciale des Nations Unies sur la violence contre les femmes
- Se rendre rapidement en République centrafricaine pour nouer le dialogue avec les victimes, la société civile, l’ONU, les hauts responsables du gouvernement et les représentants des groupes armés, et pour faire en sorte de mettre un terme aux violences sexuelles commises par les groupes armés et de promouvoir la responsabilisation.
- Encourager les agences de l’ONU à garantir aux victimes de violences sexuelles un soutien médical, psychosocial et légal gratuit et en temps opportun, ainsi qu’une aide économique.
- Inciter la MINUSCA à accorder la priorité à la prévention et à la surveillance des violences sexuelles dans le conflit, ainsi qu’à la réalisation d’enquêtes et de rapports opportuns, et à soutenir pleinement la Cour pénale spéciale.
À l’Union européenne, aux gouvernements de France, des Pays-Bas, des États-Unis et à d’autres bailleurs de fonds internationaux
- Augmenter le financement des services médicaux, psychosociaux, légaux essentiels et des services de réintégration pour les victimes de violences sexuelles, y compris l’accès à une contraception d’urgence et à un avortement sûr, soutenir le développement de capacités des prestataires de services, la facilitation de la réinscription à l’école et des activités générant des revenus. Fournir un soutien pour garantir que le transport et les autres coûts n’empêchent pas les victimes d’accéder aux services.
- Apporter un soutien financier et politique supplémentaire à la Cour pénale spéciale pour s’assurer qu’elle puisse accomplir son mandat afin de rendre justice pour les crimes graves, y compris les crimes de violences sexuelles, commis pendant le conflit armé.
- Renforcer l’aide pour les efforts visant à rétablir le système judiciaire national et pour la formation de la police, des procureurs et des juges sur les enquêtes et les poursuites judiciaires des violences sexuelles et basées sur le genre.
- Intégrer la formation sur la protection des droits humains comme un élément de soutien essentiel pour les programmes de réforme futurs du secteur de la sécurité et créer des mécanismes de vérification des antécédents pour faire en sorte que des membres de la Séléka, des anti-balaka ou de l’armée nationale responsables d’atteintes graves aux droits humains ou de crimes de guerre ne soient pas réintégrés dans l’armée nationale ou autorisés à occuper d’autres fonctions gouvernementales officielles.
- S’assurer que tout accord de paix futur exclut l’amnistie pour les auteurs présumés de crimes graves et favoriser des procès équitables et crédibles de ces crimes conformément aux normes internationales.
À la Procureure de la Cour pénale internationale
- Continuer à tenir compte des crimes de violences sexuelles dans le cadre de l’enquête sur les crimes perpétrés depuis août 2012 dans le pays.
Remerciements
Les recherches menées pour le présent rapport ont été réalisées par Hillary Margolis, chercheuse de la division Droits des femmes, et Lewis Mudge, chercheur de la division Afrique. Ce rapport a été rédigé par Hillary Margolis, avec la participation de Lewis Mudge. Thierry Magloire Messongo Boboyangue a fourni une assistance pour les recherches et la traduction en République centrafricaine. Adonise Francielle Fioboy a assuré l’interprétation et a contribué à faciliter les rencontres en République centrafricaine, et Patricia Ngoy a apporté son aide pour l’interprétation de certains entretiens. Naizaire Bangue Soumangue a fourni une assistance logistique.
Le rapport a été édité par Fred Abrahams, directeur adjoint du bureau des Programmes ; Heather Barr, chercheuse senior de la division Droits des femmes ; Janet Walsh, directrice par intérim de la division Droits des femmes ; Aisling Reidy, conseillère juridique senior ; et Babatunde Olugboji, directeur adjoint du bureau des Programmes. Des relectures spécialisées ont été réalisées par Julianne Kippenberg, directrice adjointe de la division Droits de l’enfant, Emina Cerimovic, chercheuse de la division Droits des personnes handicapées, Akshaya Kumar et Louis Charbonneau, directeurs de plaidoyer auprès des Nations Unies, Diederik Lohman, directeur de la division Santé et droits humains, et Elise Keppler, directrice adjointe du Programme Justice internationale. Daniel Bekele, directeur de plaidoyer auprès de la division Afrique, et Wendy Isaack, chercheuse, ont contribué leur avis d’experts lors de la formulation des recommandations. Grace Choi a fourni les cartes.
Agnieszka Bielecka, collaboratrice de la division Droits des femmes, a fourni une assistance à la production et à l’édition. La mise en page et la production ont été coordonnées par Olivia Hunter, coordinatrice du département des Publications/photographies, et par Fitzroy Hepkins, responsable administratif. Sarah Leblois a traduit le rapport en français, avec le concours de David Boratav pour certaines sections. Peter Huvos, éditeur du site Web français, a révisé la traduction française.
Human Rights Watch remercie les nombreuses personnes ayant survécu à des violences sexuelles, les témoins, les activistes, les prestataires de services et autres personnes qui se sont entretenues avec nous aux fins du présent rapport et, en particulier, les femmes et les filles qui ont fait part de leurs histoires, malgré les difficultés et les risques personnels importants que cela implique.