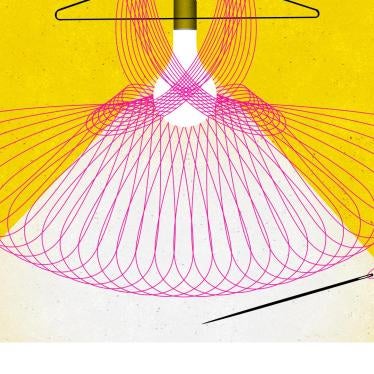1. Sur quoi porte le procès de Ben Ali ?
3. Quels sont les chefs d’inculpation?
4. Quelles sont les failles du procès?
5. Y a-t-il d’autres procès connectés au soulèvement de décembre 2010?
7. Pourquoi les procès de Ben Ali se déroulent-ils devant des tribunaux militaires ?
9. Les victimes peuvent-elles participer aux procédures?
10. Quelles ont été les principales étapes du procès du Kef? Combien d’audiences ont eu lieu?
11. Quelles preuves ont été présentées contre Ben Ali et ses coinculpés?
12. Le procès a-t-il respecté les droits de la défense?
14. Quel est le point de vue de Human Rights Watch sur la peine de mort?
15. Quelle est la perception générale de ces procès en Tunisie ?
16. Quelles autres procédures, accusations et condamnations y a-t-il eu contre Ben Ali?
17. Quelles sont les formes de réparation offertes aux victimes?
1. Sur quoi porte le procès de Ben Ali ?
Le procès de l’ancien président Zine el Abidine Ben Ali, de deux de ses anciens ministres de l’Intérieur, de quatre directeurs généraux des forces de sécurité, et de 16 autres hauts gradés et officiers de moindre rang au sein des forces de sécurité, est basé sur les accusations de meurtre et tentative de meurtre de manifestants pendant le soulèvement populaire en Tunisie. Le procès couvre les événements qui se sont déroulés entre le 17 décembre 2010 et le 14 janvier 2011, jour où Ben Ali s’est enfui en Arabie saoudite. Il s’est ouvert le 28 novembre 2011 devant le tribunal militaire permanent du gouvernorat du Kef et couvre les meurtres commis dans les gouvernorats du Kef, Jendouba, Béja, Siliana, Kasserine et Kairouan. Il est couramment désigné comme « le procès du Kef ».
Les manifestations populaires qui ont conduit à l’éviction de Ben Ali ont fait 132 morts et 1 452 blessés pendant la période couverte par le procès, selon le rapport final émis le 4 mai 2012 par la « Commission nationale d’établissement des faits sur les dépassements commis entre le 17 décembre 2010 et la fin de son mandat », créée par le premier gouvernement de transition. Certains des incidents les plus meurtriers ont eu lieu les 8, 9 et 12 janvier dans les villes de Kasserine, Tala et Regueb, faisant 23 morts et plus de 600 blessés. La majorité des victimes ont été tuées ou blessées par des balles réelles tirées par les forces de sécurité.
2. Qui sont les inculpés?
Les accusés sont l’ex-président Zine el Abidine Ben Ali ; les anciens ministres de l’Intérieur Rafik Hadj Kacem et Ahmed Friâa; Adel Tiouiri, l’ex-directeur général de la Sûreté nationale ; Jalel Boudriga, l’ancien directeur général des Brigades de l’ordre public (police anti-émeute) ; Ali Seriati, l’ex-directeur général de la Sécurité présidentielle ; et Lotfi Zouaoui, l’ancien directeur général de la Sécurité publique. Quatorze autres officiers supérieurs et de moindre rang sont également poursuivis. Des 22 inculpés, neuf sont détenus depuis avril 2011, douze sont en liberté provisoire, et un – Ben Ali – est en fuite.
3. Quels sont les chefs d’inculpation?
Ben Ali, ses deux ministres de l’Intérieur et les quatre directeurs des forces de sécurité sont inculpés de complicité d’homicide volontaire et de tentative d’homicide en vertu de l’article 32 du code pénal. Celui-ci définit la complicité comme le fait de faciliter un crime en aidant, encourageant, assistant, en donnant des instructions pour commettre le crime, ou en conspirant avec autrui dans un but criminel. Les autres sont inculpés d’homicide avec préméditation ou de tentative d’homicide en vertu des articles 201, 202 et 59 du code pénal.
L’article 201 prévoit la peine de mort pour l’homicide avec préméditation. Cependant, l’article 53 donne aux juges la latitude d’appliquer des peines moindres en fonction des circonstances de l’affaire. L’article 33 exige d’appliquer les mêmes peines aux auteurs principaux du crime et à leurs complices, ce qui implique que ceux qui seraient reconnus coupables de complicité d’homicide prémédité en vertu de l’article 32 risquent la condamnation à mort.
4. Quelles sont les failles du procès?
Human Rights Watch n’a pas constaté de graves violations du droit à un procès équitable. Par contre, le fait qu’en droit tunisien il n’existe pas d’inculpation pour « responsabilité du supérieur hiérarchique » a entravé la capacité des autorités à poursuivre efficacement les accusés pour des actes équivalant à des crimes en droit international. En outre, la promotion de plusieurs accusés, après leur inculpation pour des crimes graves, suggère que des éléments au sein des forces de sécurité sont restés opposés à l’obligation de rendre des comptes.
Un droit pénal mal adapté pour traiter la responsabilité du supérieur hiérarchique
Le procès du Kef est basé sur la responsabilité supposée des inculpés vis-à-vis du comportement des forces de sécurité placées sous leur commandement, mais la loi tunisienne est mal outillée pour traiter la responsabilité du commandant ou du supérieur hiérarchique. Elle énonce qu’une personne ne peut être tenue pénalement responsable que d’un crime commis directement, ou d’une complicité selon l’article 32 du code pénal. De telles formes de responsabilité ne couvrent pas ce qu’on appelle en droit international la « responsabilité du supérieur hiérarchique », qui impute aux chefs militaires ou aux supérieurs civils la responsabilité des crimes commis par des agents subordonnés des forces armées ou par d’autres personnes placées sous leur contrôle.
D’après ce principe, un chef peut être tenu pénalement responsable même s’il, ou elle, n’a pas ordonné les crimes commis, si on peut prouver trois conditions : qu’il existe une relation effective de supérieur à subordonné ; que le chef savait, ou avait des raisons de savoir, que son subordonné commettait un crime ; et que le chef a manqué de prévenir ou de punir de tels actes. Cette forme de responsabilité englobe la responsabilité par inaction. Pourtant, les gouvernements tunisiens n’ont pas encore intégré ce principe dans la loi tunisienne, qui exige toujours la preuve d’une implication active pour établir une complicité de crime.
Le cas de Seriati, un des inculpés du procès du Kef, illustre les difficultés du tribunal à s’en remettre exclusivement au crime de « complicité » dans son verdict. Seriati était directeur général de la Sécurité présidentielle du 1er septembre 2001 au 14 janvier 2011, jour où les autorités l’ont arrêté après la fuite de Ben Ali hors du pays. En tant que directeur général, Seriati est présumé avoir exercé un contrôle effectif sur cette garde présidentielle, formée de 2 500 agents des forces spéciales de sécurité. Le juge d’instruction n’a pas présenté de preuves indiquant que les forces commandées par Seriati avaient participé à la répression des manifestants. En outre, les avocats de la défense ont introduit des preuves issues d’une enquête du ministère de l’Intérieur, qui avait conclu qu’aucune munition assignée à la garde présidentielle n’avait été utilisée pour mater les manifestations. Ce fait n’a pas été contesté par l’accusation.
Pourtant, l’accusation a déclaré que Seriati devrait être reconnu coupable de complicité d’homicide avec préméditation en vertu de l’article 59. L’accusation a soutenu qu’il portait une responsabilité parce qu’il avait participé aux réunions de cellule de crise, du 8 au 10 janvier, en tant que membre du cercle de décideurs qui contrôlait la réponse aux révoltes. Bien que le juge n’ait pas trouvé de preuves d’ordres de « tirer pour tuer », ni même d’utiliser des balles réelles contre les manifestants, il est arrivé à la conclusion que Seriati était responsable, sur la base de témoignages selon lesquels il était très influent au sein des forces de sécurité. La théorie de responsabilité appliquée dans ce cas s’apparente à la culpabilité par association, qui ne remplit pas le critère de responsabilité pénale individuelle.
Les avocats de la défense ont également soutenu que l’accusation n’avait fourni aucune preuve du fait que les inculpés ayant occupé des postes élevés dans le commandement aient donné des ordres de réprimer les manifestations en utilisant des moyens meurtriers, ou aient été, de quelque autre façon, responsables de l’assassinat des manifestants. Ils ont plaidé que l’accusation faisait porter la faute aux inculpés uniquement sur la base de leur responsabilité politique, sans prouver les éléments de complicité de ces crimes. Ils ont soutenu que les meurtres étaient le résultat d’actes individuels par des agents de police ayant perdu la tête pendant une période de manifestations violentes. De plus, certains avocats de la défense ont déclaré qu’ils avaient apporté des preuves montrant que leurs clients avaient donné l’ordre aux policiers d’observer la plus grande retenue pour affronter les manifestants, des preuves que selon eux, le tribunal n’a pas examiné comme il se devait.
Promotion de certains inculpés à des postes plus élevés
Des ministres du gouvernement de transition ont promu certains accusés du procès du Kef à des postes supérieurs dans la sécurité d’État, et ce malgré les poursuites entamées contre eux, suscitant ainsi l’inquiétude sur la bonne volonté des autorités provisoires à garantir que chacun rende des comptes.
Par exemple, le deuxième gouvernement de transition – entre mars et octobre 2011 – a nommé en mars l’un des accusés, Moncef Krifa, qui avait été directeur régional de la police anti-émeute (Brigades de l’ordre public, BOP), comme directeur de la Garde présidentielle.
De même, après sa nomination, le même gouvernement a promu Moncef Laajimi, un inculpé qui avait dirigé la police anti-émeute à Tala, comme directeur général de la police anti-émeute. Le 10 janvier 2012, le nouveau ministre de l’Intérieur, Ali Laareyedh, a voulu évincer Laajimi de ce poste. Pourtant, sous la pression de l’union syndicale de la police anti-émeute, qui menaçait d’une grève générale, il est revenu sur sa décision et a nommé Laajimi chef de cabinet adjoint au ministère de l’Intérieur.
5. Y a-t-il d’autres procès connectés au soulèvement de décembre 2010?
Il y a deux procès collectifs. Dans le second, dit « procès de Tunis », qui se tient devant le tribunal militaire permanent de Tunis, 43 personnes sont accusées du meurtre de manifestants dans les gouvernorats de Tunis, l’Ariana, la Manouba, Ben Arous, Bizerte, Nabeul, Zaghouan, Sousse et Monastir. Comme dans le procès du Kef, on trouve parmi les inculpés du procès de Tunis : Ben Ali, ses deux anciens ministres de l’Intérieur, et les quatre ex-directeurs généraux des forces de sécurité. Les autres accusés du procès de Tunis sont Mohamed El Arbi Krimi, directeur de la Salle d’opérations au ministère de l’Intérieur ; Ali Ben Mansour, inspecteur général des forces de sécurité ; et Rachid Ben Abid, directeur des Services spéciaux ; ainsi que d’autres hauts gradés et officiers de moindre rang.
En plus, un procès est en cours au tribunal militaire permanent de Tunis, contre quatre membres des forces de sécurité accusés d’avoir tué six personnes lorsque les policiers avaient ouvert le feu sur les membres de comités de défense de voisinage, le 15 janvier 2011, à Ouardanine, une ville à 120 km au sud de Tunis.
Enfin, le 30 avril 2012, le tribunal militaire permanent de Sfax a condamné deux policiers, Omran Abdelali et Mohamed Said Khlouda, à 20 ans de prison et 80 000 dinars d’amende (49 230 US$) pour le meurtre de Slim Hadhri, abattu alors qu’il participait à une manifestation le 14 janvier 2011 à Sfax, une ville à 270 km au sud de Tunis.
6. En quoi les procès de Ben Ali et de ses coinculpés constituent-ils une avancée dans la lutte contre l’impunité?
Dans la mesure où ils sont perçus comme transparents et équitables, les procès des crimes perpétrés pendant le soulèvement constituent une opportunité de rompre avec l’impunité des forces de sécurité pour les violations des droits humains qu’elles ont abondamment commises pendant les 23 ans de la présidence Ben Ali. Ils aident aussi à établir le récit des événements du 17 décembre 2010 au 14 janvier 2011, et à déterminer des responsabilités pour les décès et les blessures de manifestants pendant cette période, y compris celle des chefs qui supervisaient les forces de sécurité ayant utilisé des moyens meurtriers.
Cependant, les procès du Kef et de Tunis sont limités dans leur portée temporelle. L’État a l’obligation d’enquêter et de faire rendre des comptes pour les graves abus des droits humains commis par le gouvernement pendant les 23 ans de la présidence Ben Ali, et non pas seulement pendant la révolte d’un mois qui y a mis fin. Ces abus comprenaient la torture ainsi que l’emprisonnement arbitraire et prolongé pour l’exercice non violent de la liberté d’expression.
7. Pourquoi les procès de Ben Ali se déroulent-ils devant des tribunaux militaires ?
En vertu de l’article 22 de la loi d’août 1982 portant statut général des Forces de sécurité intérieure, ce sont les tribunaux militaires qui ont compétence pour juger tous les crimes présumés commis par des membres des forces de sécurité, indépendamment de l’identité des victimes ou de la qualité des criminels supposés lorsqu’ils les ont perpétrés. Au départ, les victimes de la violence gouvernementale pendant le soulèvement populaire ont déposé des plaintes auprès des tribunaux civils de leur lieu de résidence. Le premier à ouvrir une enquête, le 24 février 2011, a été le procureur du tribunal de première instance de Kasserine, une ville à 218 km au sud-ouest de Tunis. Pourtant, les juges d’instruction des tribunaux de première instance de Kasserine, Kairouan et le Kef ont renvoyé les dossiers de ces affaires au système judiciaire militaire.
L’article 22 énonce que « sont du ressort des tribunaux militaires compétents, les affaires dans lesquelles sont impliqués les agents des Forces de sécurité intérieure, ou des faits survenus dans ou à l'occasion de l'exercice de leurs fonctions, lorsque les faits incriminés ont trait à leurs attributions dans les domaines de la sécurité intérieure ou extérieure de l’Etat, ou au maintien de l'ordre (…) au cours ou à la suite des réunions publiques, cortèges, défilés, manifestations et attroupements ».
8. Les tribunaux militaires peuvent-ils garantir des procès équitables et un accès effectif à la justice ?
Les réformes effectuées par le gouvernement de transition au sein du système judiciaire militaire renforcent les garanties de procès équitables et l’accès effectif à la justice pour les victimes. Elles donnent aux victimes l’opportunité de déposer des plaintes, de faire valoir leur droit à réparation et d’être représentées auprès des tribunaux militaires. Mais les réformes sont loin de garantir l’indépendance de ces tribunaux militaires vis-à-vis du pouvoir exécutif.
Le code de justice militaire de Tunisie a été promulgué le 10 janvier 1957. Après la chute du gouvernement Ben Ali, le gouvernement de transition a remanié le système judiciaire militaire et renforcé les garanties de procès équitable, y compris en donnant certains droits aux inculpés. Le décret-loi n°69 du 29 juillet 2011, modifiant et complétant le code de justice militaire, et le décret-loi n°70 du 29 juillet 2011, relatif à l’organisation de la justice militaire et au statut des magistrats militaires, forment le nouveau cadre juridique applicable au système de justice militaire. Ces nouvelles lois ont introduit trois réformes principales :
- Elles ont renforcé l’indépendance du système de justice militaire vis-à-vis de la branche exécutive du gouvernement en abolissant l’obligation, de la part du procureur général, d’informer le ministre de la Défense avant le début des procédures pénales, et d’attendre sa permission pour y procéder ; et en supprimant le pouvoir octroyé au ministre de la Défense de suspendre l’exécution des peines prononcées par les tribunaux militaires.
- Elles ont créé une cour d’appel militaire ayant compétence pour examiner tous les verdicts criminels prononcés par un tribunal de première instance. De plus, des chambres d’appel criminelles, formées d’un juge militaire et de deux juges des tribunaux civils, doivent à présent revoir et confirmer les mises en examen élaborées par les juges d’instruction militaires.
- Elles ont obligé les tribunaux militaires à appliquer le Code de procédure pénale ordinaire, à toutes les étapes des procédures. Les réformes affirment également la composition mixte des tribunaux militaires pour inclure à la fois des juges militaires et civils. Des juges des tribunaux civils président les cours d’appel militaires ainsi que les tribunaux militaires permanents de première instance de Tunis, Le Kef et Sfax en temps de paix.
Malgré ces réformes, des préoccupations subsistent sur l’indépendance du système de justice militaire. Bien que la loi énonce que les juges militaires sont indépendants de leur hiérarchie militaire dans l’exercice de leurs fonctions, ils dépendent toujours formellement du ministère de la Défense, à travers le Conseil de la magistrature militaire, qui est présidé par le ministre de la Défense et qui supervise la nomination, l’avancement, les mesures disciplinaires et la révocation des juges militaires. En outre, le président de la Tunisie nomme par décret les juges civils devant siéger dans les tribunaux militaires, en suivant les recommandations des ministres de la Justice et de la Défense.
Par conséquent, le système de justice militaire n’est pas indépendant aux yeux des standards internationaux. Le principe n°13 du Projet de principes sur l’administration de la justice par les tribunaux militaires, élaboré en 2006 par la Commission des droits de l’homme des Nations Unies (le prédécesseur du Conseil des droits de l’homme de l’ONU), requiert : « Le statut des magistrats militaires doit garantir leur indépendance et leur impartialité, notamment par rapport à la hiérarchie militaire ». Le même principe énonce plus loin : « L’indépendance statutaire des juges par rapport à la hiérarchie militaire doit être strictement protégée, en évitant toute subordination directe ou indirecte, qu’il s’agisse de l’organisation et du fonctionnement de la justice elle-même ou du déroulement de la carrière du juge militaire ».
9. Les victimes peuvent-elles participer aux procédures?
En vertu du nouveau décret-loi n°69, les victimes peuvent désormais porter plainte et être représentées auprès des tribunaux militaires. L’article 7 de la loi stipule que « la constitution de partie civile et l’exercice de l’action civile sont permis devant la justice militaire conformément aux règles et procédures prévues par le code de procédure pénale ». Or le code de procédure pénale autorise « tous ceux qui ont personnellement souffert du dommage causé directement par l'infraction » à intenter une action civile. En outre, les victimes ont à présent le droit de faire valoir leur droit à réparation en vertu du code de procédure pénale.
10. Quelles ont été les principales étapes du procès du Kef? Combien d’audiences ont eu lieu?
Suite au renvoi des affaires initialement déposées auprès des tribunaux de première instance de Kasserine, de Kairouan et du Kef, vers le système militaire judiciaire, le juge d’instruction militaire du tribunal militaire du Kef, Faouzi Ayari, a mis en examen les 22 inculpés le 17 août 2011. La chambre d’appel criminelle de la Cour d’appel du Kef a revu les mises en examen et confirmé les chefs d’inculpation le 6 septembre 2011. Le procès a commencé au tribunal militaire du Kef le 28 novembre. Le tribunal a tenu dix audiences, au cours desquelles il a examiné et interrogé les inculpés et les témoins. Les plaidoiries orales ont débuté le 21 mai 2012, avec des plaidoiries et des argumentations présentées par les avocats des victimes, le procureur, et les avocats de la défense.
11. Quelles preuves ont été présentées contre Ben Ali et ses coinculpés?
L’inculpation repose en grande partie sur les témoignages de centaines de manifestants déclarant soit que les policiers leur ont tiré dessus, soit qu’ils les ont vus en train de tirer sur d’autres personnes participant aux manifestations. Dans la plupart des cas, les témoins n’étaient pas capables d’identifier les gens qui ont tiré; les témoins ont déclaré qu’ils avaient vu à la fois des policiers locaux et d’autres forces de sécurité œuvrer à mater les manifestations. Dans quelques cas, les témoins ont déclaré avoir vu la personne qui avait ouvert de feu et l’ont identifiée par son nom. Ce qui ressort des déclarations des audiences et des dossiers de l’affaire, c’est que les preuves ne contiennent pas d’analyses balistiques détaillées, et peu d’examens médicolégaux.
Le juge d’instruction, lors du procès, a interrogé plusieurs officiers de police qui étaient présents lors des événements. Aucun d’entre eux n’a admis avoir reçu l’ordre d’utiliser des balles réelles, au lieu de cela, ils ont déclaré avoir tiré sur les manifestants en légitime défense. Pour analyser les ordres donnés aux forces de police pour mater les manifestations, le juge d’instruction s’est aussi tourné vers les minutes de la Direction centrale des opérations du ministère de l’Intérieur de décembre 2010 à janvier 2011. Le rôle de cette unité était de surveiller les développements sécuritaires dans le pays, d’informer le ministre de l’Intérieur et les directeurs des forces de sécurité, et de transmettre les ordres aux unités de sécurité. Toutes les conversations téléphoniques de ou vers l’unité étaient automatiquement enregistrées sur le disque dur de la Direction centrale des opérations.
Le juge d’instruction a déclaré qu’il n’avait pas trouvé, sur ces enregistrements, d’ordre d’utiliser des balles réelles pour contrer les manifestants. Par contre, il a fait remarquer que les directeurs de sécurité pouvaient utiliser des téléphones portables pour transmettre des ordres aux unités de police régionales et de division, sans que l’appel ne soit enregistré par le système téléphonique de l’unité centrale.
En l’absence de preuves directes d’ordres de tuer ou d’identification des personnes exactes impliquées dans chaque incident ayant tué ou blessé un manifestant, le juge d’instruction a eu recours à un raisonnement déductif et à des preuves circonstancielles pour démontrer qu’il existait le plan de tuer des manifestants chez les plus hauts responsables du gouvernement.
12. Le procès a-t-il respecté les droits de la défense?
Les tribunaux ont apparemment respecté, dans l’ensemble, les droits des inculpés à un procès équitable. Les inculpés avaient accès à des avocats de leur choix et l’opportunité de préparer une défense appropriée, avec l’accès aux preuves utilisées contre eux, l’opportunité de faire un contre-interrogatoire des témoins et d’introduire des preuves à décharge pour soutenir leur défense.
Tous les instruments internationaux et régionaux relatifs aux droits humains exigent des gouvernements qu’ils garantissent le droit à une audition équitable par un corps judiciaire légalement constitué qui soit compétent, indépendant et impartial. Entre autres, ce droit inclut : suffisamment d’opportunités de préparer un dossier, de présenter des arguments et des preuves, et de mettre à l’épreuve ou répliquer aux arguments ou preuves de la partie adverse ; le droit d’être consulté et représenté par un représentant légal ; ainsi que le droit à un procès sans retard exagéré, et celui de faire appel auprès d’un corps judiciaire supérieur.
Pendant le procès du Kef, tous les accusés avaient le droit de choisir leurs propres représentants légaux. Les conseils de défense ont confirmé qu’ils avaient accès aux dossiers de l’affaire et qu’ils avaient pu obtenir tous les documents de ces dossiers, y compris la mise en examen, le témoignage des victimes et des témoins, et les autres preuves utilisées lors des procédures. Ils ont également pu faire des contre-examens, appeler des témoins et introduire des preuves.
Cependant, les avocats de la défense ont déclaré qu’à plusieurs moments le tribunal avait refusé certaines requêtes qu’ils estimaient importantes pour leur stratégie de défense. Par exemple, le tribunal a refusé leur requête d’une liste des appels que leurs clients avaient effectués de leurs téléphones portables entre le 24 décembre 2010 et le 14 janvier 2011, dont ils avaient besoin pour vérifier si les inculpés avaient communiqué avec leurs subordonnés, comme l’affirmait l’accusation. Alors que des requêtes de la défense étaient en attente, pour introduire des preuves supplémentaires à décharge et pour accéder à des documents qu’ils considéraient comme importants, les juges du procès du Kef leur ont brusquement ordonné de conclure leur argumentation.
13. Pourquoi la compétence des tribunaux militaires devrait être limitée à des infractions purement militaires?
Human Rights Watch s’oppose fermement à tout procès de civils devant les tribunaux militaires, où le déroulement des procès ne protège pas les droits à une procédure en bonne et due forme, ni ne répond aux exigences d’indépendance et d’impartialité des cours de justice.
Même pour le procès de forces armées ou de sécurité, il existe une norme en voie de cristallisation en droit international, qui exige que la compétence des tribunaux militaires se limite à juger les infractions purement militaires. Par conséquent, Human Rights Watch encourage à utiliser les tribunaux civils pour toutes les affaires de violation des droits humains contre des civils, indépendamment de la qualité civile ou militaire des inculpés.
Le Comité des droits de l’homme de l’ONU exhorte également les États parties de la Convention contre la torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants, à juger le personnel militaire accusé de violations des droits humains dans des tribunaux civils. En 1999 le comité a écrit dans ses conclusions finales sur un rapport du Chili que « la compétence étendue des tribunaux militaires, qui sont habilités à connaître de toutes les affaires mettant en cause des militaires, contribue à l’impunité dont jouissent ces derniers pour ce qui concerne les violations graves des droits de l’homme ».
Dans l’affaire Suleiman vs. Soudan en mai 2003, la Commission africaine des droits de l’homme et des peuples a également affirmé que les tribunaux militaires devraient seulement « connaître des délits d’un caractère purement militaire commis par le personnel militaire » et « ne devraient pas connaître des délits qui sont de la compétence des juridictions ordinaires ». De plus, les Directives et principes sur le droit à un procès équitable et à l’assistance judiciaire en Afrique, proclamés par la Commission africaine des droits de l’homme et des peuples, énoncent que « les tribunaux militaires ont pour seul objet de connaître des infractions d’une nature purement militaire commises par le personnel militaire ».
14. Quel est le point de vue de Human Rights Watch sur la peine de mort? Hoz
Lors de la plaidoirie finale du procès du Kef, le 23 mai 2012, le procureur militaire a requis la peine de mort contre l’ancien président Ben Ali et des peines sévères contre tous les autres inculpés. Human Rights Watch est opposée à la peine capitale en toutes circonstances à cause de sa cruauté inhérente et de son irréversibilité. En outre, c’est une forme de punition entachée par l’arbitraire, le préjugé et l’erreur.
15. Quelle est la perception générale de ces procès en Tunisie ?
Le procès a été régulièrement couvert par les médias tunisiens. Les journalistes avaient accès aux audiences et les ont largement couvertes dans la presse, à la radio et à la télévision. Aussi bien les représentants des victimes que les avocats de la défense ont régulièrement mis en question la volonté et la capacité de la justice tunisienne à mener efficacement les poursuites. Ces préoccupations ont bien été rapportées dans les médias et ont contribué à une critique publique des procès.
La défense et les victimes ont exprimé leur préoccupation sur le manque d’examens balistiques et médicolégaux qui auraient pu permettre avec certitude d’identifier les individus ayant tiré sur les manifestants. La défense et les victimes ont également soutenu que le ministère de l’Intérieur n’était pas coopératif, par exemple en ne fournissant pas d’importants éléments de preuve au tribunal, comme le registre que le ministère est supposé tenir des armes et des munitions disponibles pour chaque agent. De plus, les familles des victimes ont régulièrement critiqué le fait que certains des accusés aient été placés en liberté provisoire sous caution et même promus à de meilleurs postes.
16. Quelles autres procédures, accusations et condamnations y a-t-il eu contre Ben Ali?
Le tribunal de première instance de Tunis a condamné Ben Ali à plus de 66 ans de prison pour des accusations allant du détournement d’argent au trafic de drogue. Le 20 juin 2011, le tribunal de première instance de Tunis l’a aussi condamné, en même temps que sa femme, à 35 ans de prison et à 65,6 millions US$ d’amendes pour vol et possession illégale d’argent et de bijoux. Le tribunal militaire permanent de Tunis l’a aussi condamné à cinq ans de prison pour « usage de violence » contre 17 officiers supérieurs, dans l’affaire dite de « Barraket Essahel », d’après la ville où les autorités avaient déclaré, en 1991, avoir découvert un plan orchestré par des officiers pour renverser Ben Ali et établir un régime islamiste.
17. Quelles sont les formes de réparation offertes aux victimes?
En février 2011, le gouvernement provisoire a décidé d’allouer 20 000 dinars (12 624 US$) aux familles des tués et 3 000 dinars (1 900 $) aux personnes blessées pendant le soulèvement, indépendamment de la gravité des blessures. Les autorités ont payé des dédommagements à 2 749 blessés et aux familles de 347 tués, d’après les chiffres officiels. En décembre 2011, le gouvernement provisoire a distribué un second acompte du même montant aux blessés et aux familles des tués. Pourtant, ces mesures de réparation limitées n’ont pas comblé le besoin de traitements médicaux en cours et de soins aux victimes, ni compensé suffisamment les salaires qu’elles ont perdus.
Le procès du Kef et de Tunis déterminera le préjudice matériel résultant de l’usage de la force, à la fin des procès. L’article 7 de la loi n°69 du 29 juillet 2011 donne aux victimes le droit de demander réparation pour les torts subis, selon les règles applicables dans le code de procédure pénal ordinaire.
18. Pourquoi Ben Ali est-il jugé par contumace? Quel est le point de vue de Human Rights Watch sur les procès par contumace?
Ben Ali s’est enfui en Arabie saoudite le 14 janvier 2011. Bien qu’il y ait un mandat d’arrêt international en cours contre lui, la Tunisie doit encore exiger son extradition.
Depuis sa nomination comme nouveau chef du gouvernement, Hamadi Jebali a déclaré que l’extradition de Ben Ali n’était pas une priorité des autorités provisoires. Le 17 février 2012, la veille d’une visite officielle en Arabie saoudite, Jebali avait annoncé sur Radio Sawa qu’il ne discuterait pas du sort de Ben Ali avec les Saoudiens, qualifiant l’affaire de « mineure », « pas une priorité ».
Juger un inculpé par contumace peut réduire certains droits basiques de l’inculpé à un procès équitable, y compris le droit d’être présent, d’être défendu par le conseil de son choix et d’examiner les témoins. Le droit international ne favorise pas, mais n’interdit pas non plus, les procès in absentia. Les systèmes nationaux qui conservent cette pratique devraient au moins instituer des protections procédurales pour garantir les droits basiques de l’accusé. Il faut notamment que l’inculpé soit averti à l’avance des procédures et qu’il renonce à son droit d’être présent sans équivoque et de façon explicite. Il ou elle devrait aussi avoir le droit d’être représenté en son absence, et devrait pouvoir obtenir que soit déterminé à nouveau le bien-fondé de la sentence dès son retour dans le territoire de la juridiction.
Le code de procédure pénale tunisien ne contient pas de dispositions spécifiques pour les procès par contumace. Le tribunal du Kef a désigné un avocat pour défendre Ben Ali, mais cet avocat n’a pas participé pleinement aux procédures. Pendant les plaidoiries finales, il était présent, mais a décliné la possibilité de faire un exposé. Ces éléments indiquent que les protections procédurales minimales recommandées pour les procès par contumace étaient absentes dans cette affaire.
19. Y a-t-il d’autres formes de recherche de la vérité pour les crimes commis sous le régime de Ben Ali?
La loi n°8, datée du 18 février 2011, promulguée peu après l’éviction de Ben Ali, a mis en place une « Commission nationale d’établissement des faits sur les dépassements commis entre le 17 décembre 2010 et la fin de son mandat ». Tawfik Bouderbala, une personnalité bien connue de la société civile tunisienne, ancien président de la Ligue tunisienne des droits humains, a été nommé président de la commission et a sélectionné le reste de ses 14 membres. Son mandat établissait qu’elle collecterait des informations et de la documentation sur les abus commis pendant cette période, à travers des témoignages de victimes ou de familles des tués ou des blessés, et des documents à collecter dans toute administration ou institution concernée. La commission a émis son rapport final le 4 mai 2012. Le rapport contient 1 040 pages, en comptant les annexes (dont une liste des tués et des blessés).
Suite aux élections de l’Assemblée nationale constituante (ANC) du 23 octobre 2011, l’Assemblée a adopté la Loi sur l’organisation provisoire des pouvoirs publics. L’article 24 de cette loi énonce que l’ANC « adopte[ra] une loi organique organisant la justice transitionnelle, fixant ses bases et sa compétence ». À ce jour, l’ANC n’a toujours pas adopté une telle loi.