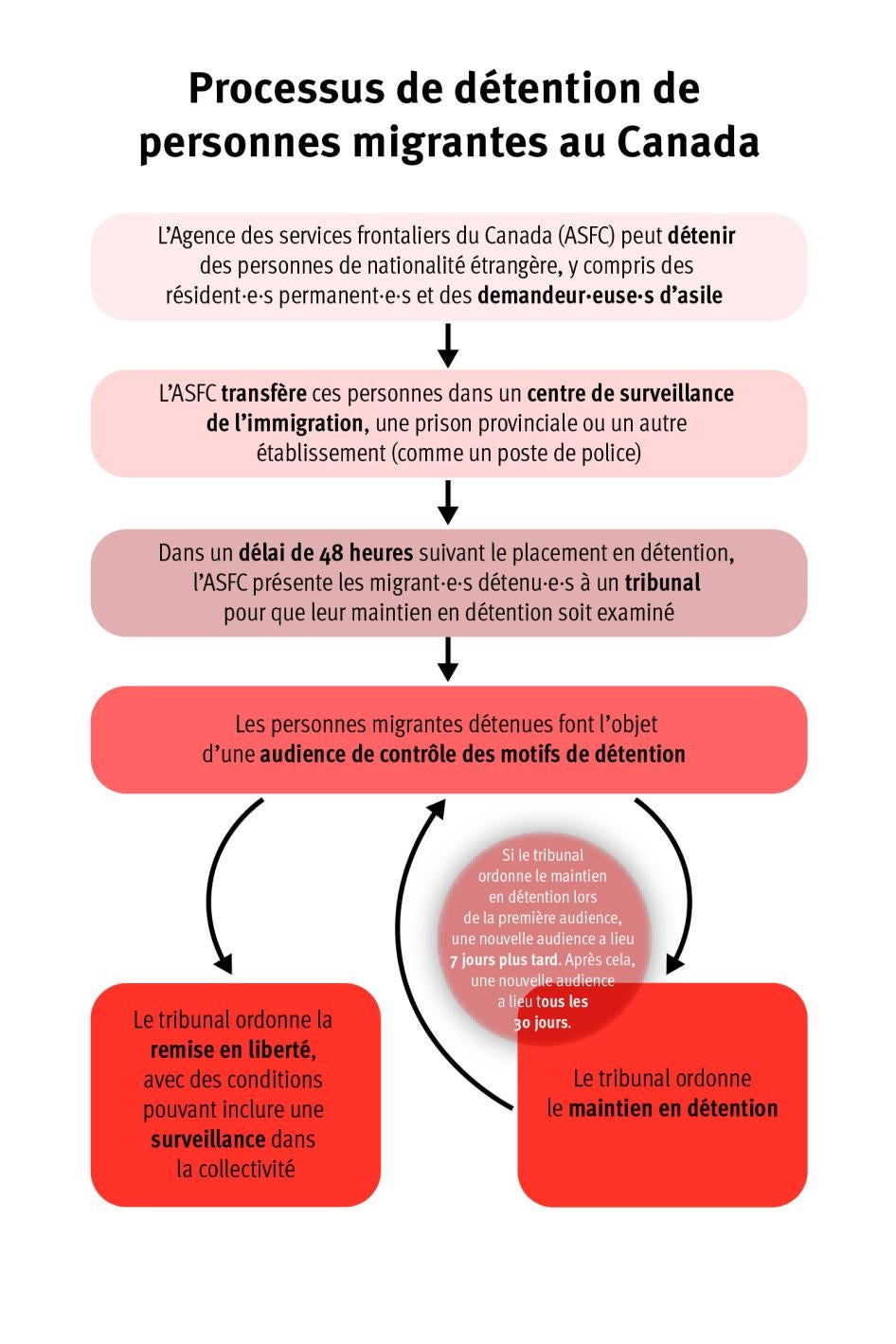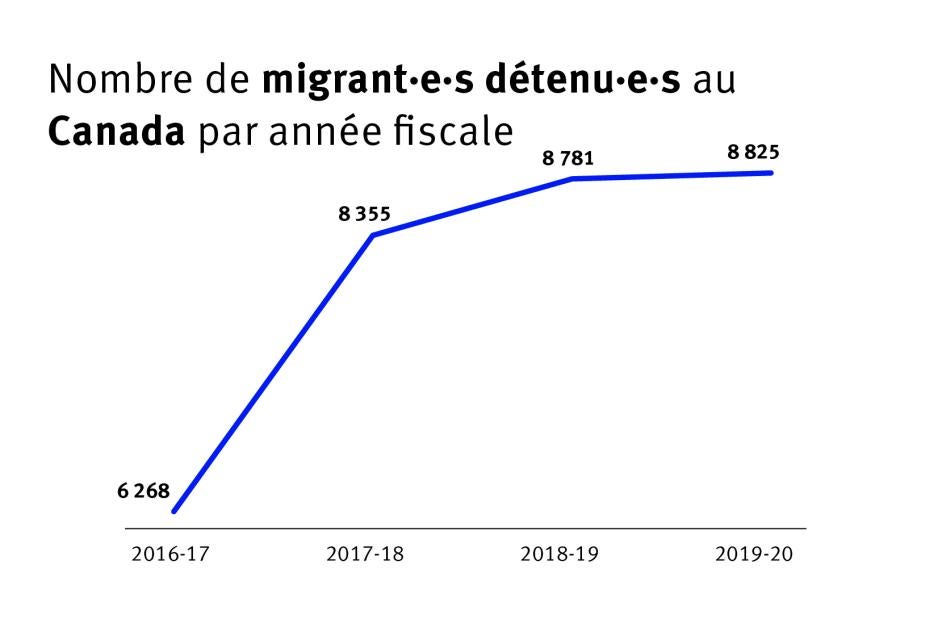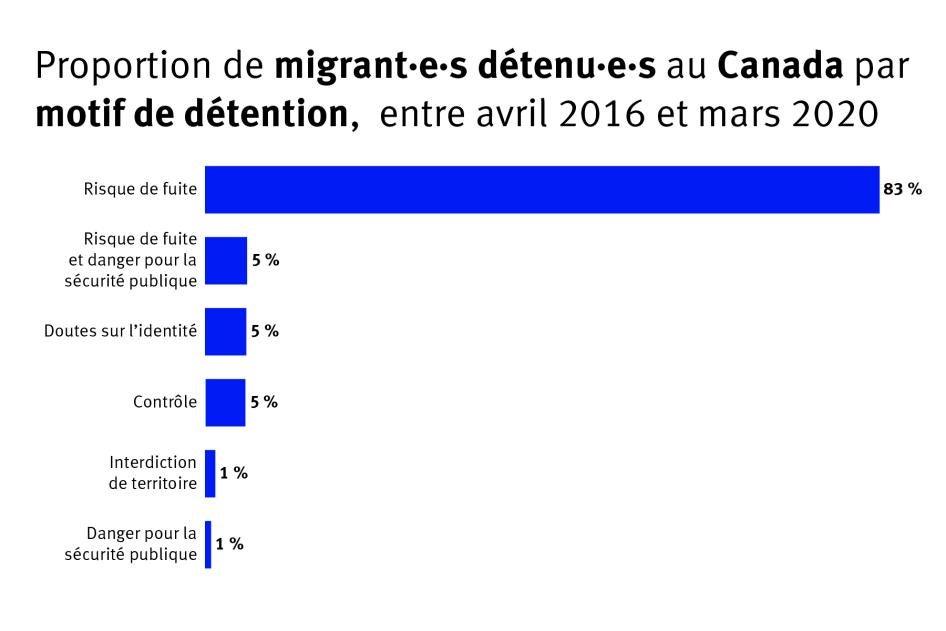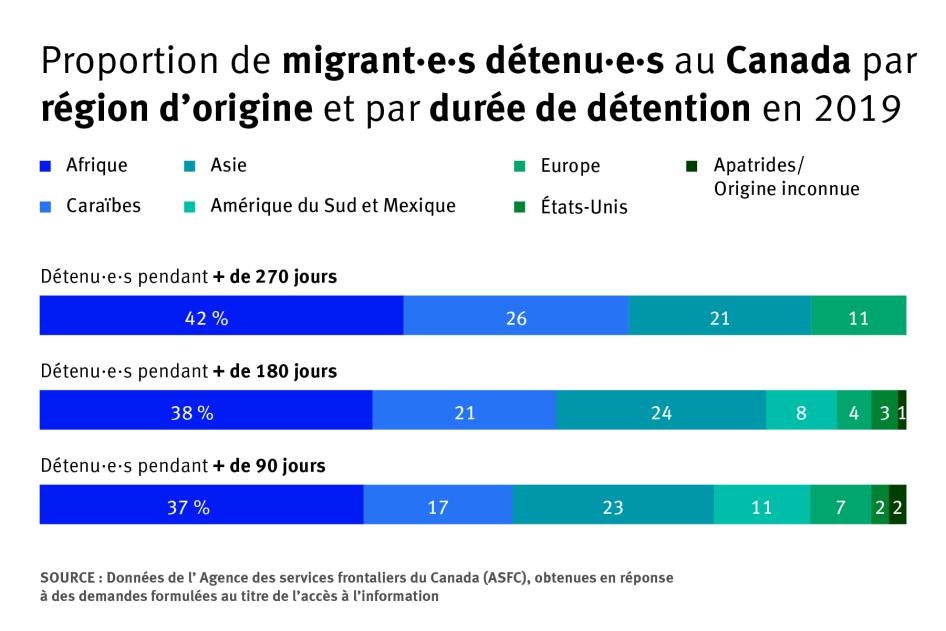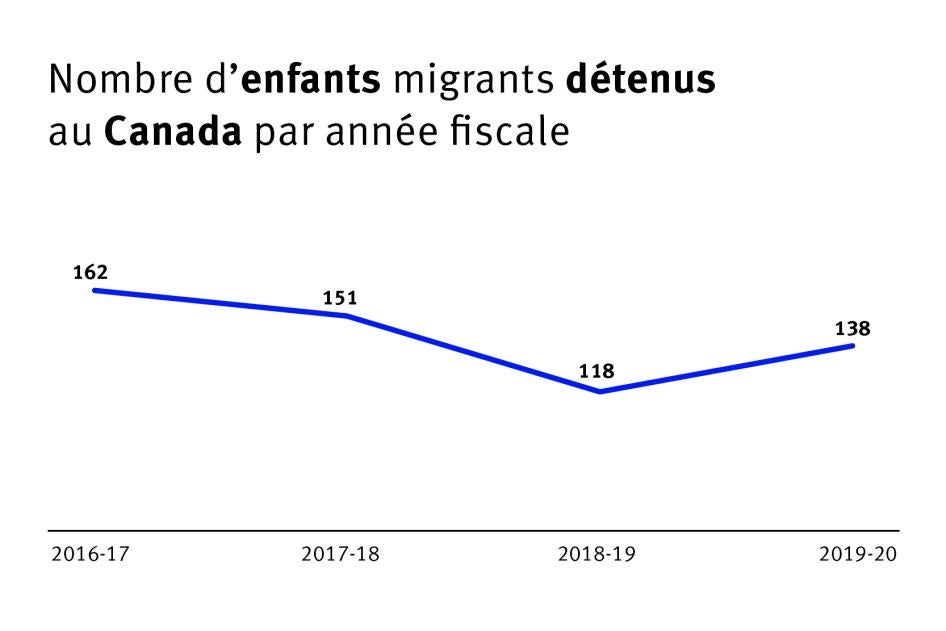Résumé
L’un des agents [des services frontaliers] m’a dit : « Le Canada est un pays de liberté pour les Canadiens, pas pour les étrangers. » Il semblait très content de me dire : « Ce soir tu dormiras en prison. » Ça faisait rire les autres agents.…
La détention liée à l’immigration a changé la manière dont je vois le Canada. Avant, pour moi, le Canada était le meilleur endroit du monde. Pour les personnes fuyant des persécutions, c’était l’endroit idéal pour trouver la paix et une vie meilleure. Mais quand j’ai vu ça, je me suis dit que tout ce que nous entendons sur le Canada est faux, c’est du cinéma.
– « Idriss », demandeur d’asile ayant été incarcéré au centre de surveillance de l’immigration de Laval en 2020
Malgré sa réputation de pays multiculturel et accueillant pour les migrant·e·s, le Canada place chaque année en détention des milliers de personnes pour des raisons liées à l’immigration, y compris des gens qui fuient des persécutions, d’autres qui cherchent un emploi et une vie meilleure, et des personnes qui vivent au Canada depuis leur enfance. Bien que détenues pour des raisons non criminelles, les personnes migrantes sont soumises à des conditions d’enfermement parmi les plus restrictives du pays ; certaines sont notamment incarcérées dans des établissements à sécurité maximale et à l’isolement cellulaire, sans date de libération connue.
Les statistiques de l’Agence des services frontaliers du Canada (ASFC) révèlent que le nombre de migrant·e·s incarcéré·e·s au Canada a augmenté chaque année fiscale entre 2016-2017 et 2019-2020, culminant à 8 825 durant l’année fiscale 2019-2020. Depuis le début de la pandémie de Covid-19 en mars 2020, les autorités canadiennes ont procédé à un nombre sans précédent de libérations de migrant·e·s détenu·e·s, ce qui prouve clairement qu’il existe d’autres solutions viables que celle consistant à priver des gens de leur liberté pour une durée indéterminée. En revanche, pour les nombreux·ses migrant·e·s qui n’ont pas été libéré·e·s, les conditions de détention se sont durcies, avec des confinements plus fréquents et un accès restreint aux téléphones et aux douches. Pendant la première année de la pandémie, des personnes migrantes se sont mises en grève de la faim à trois reprises au centre de surveillance de l’immigration de la région de Montréal.
Bien qu’elle dispose d’importants pouvoirs de police – notamment des pouvoirs d’arrestation, de détention, de fouille et de saisie – l’ASFC reste le seul organisme de sécurité publique du Canada à ne pas être soumis à une surveillance indépendante civile susceptible de contrôler ses politiques ou d’enquêter sur d’éventuels manquements. Partout dans le pays, des avocat·e·s, des activistes, des professionnel·le·s de la santé mentale, des personnes travaillant directement auprès des migrant·e·s en détention et d’anciens migrant·e·s détenu·e·s dénoncent de nombreux cas de mauvais traitements aux mains de l’ASFC.
Cette agence a toute latitude pour choisir où elle incarcère les personnes migrantes. Entre les années fiscales 2016-2017 et 2019-2020, environ deux tiers des migrant·e·s incarcéré·e·s ont été placé·e·s dans des centres de surveillance de l’immigration, dédiés uniquement à la détention dans le contexte de l’immigration et semblables à des prisons à sécurité moyenne, dans les provinces de l’Ontario, du Québec et de la Colombie-Britannique. Pendant cette même période, des milliers d’autres migrant·e·s – 1 932 pour la seule année fiscale 2019-2020 – ont été incarcéré·e·s dans des prisons provinciales, aux côtés de personnes accusées d’infractions pénales en attente de jugement ou condamnées à des peines de deux ans maximum. Beaucoup de ces prisons provinciales sont des établissements à sécurité maximale. Enfin, une minorité de personnes migrantes ont été détenues dans d’autres lieux, tels que des postes de police. Depuis le début de la pandémie de Covid-19, environ la moitié des migrant·e·s détenu·e·s ont été placé·e·s dans des prisons provinciales, contre à peu près un cinquième avant la pandémie.
Bien qu’elles n’aient été condamnées à aucune peine, les personnes migrantes en détention sont souvent traitées comme les détenu·e·s incarcéré·e·s pour des infractions pénales : elles sont menottées, enchaînées, fouillées, détenues à l’isolement cellulaire et enfermées dans des espaces restreints soumis à une routine stricte et sous surveillance constante, avec un accès limité au monde extérieur. Dans les prisons provinciales, beaucoup de migrant·e·s sont détenu·e·s dans un climat tendu, voire dangereux, qui les expose à la violence. Les personnes migrantes de couleur, notamment celles qui sont noires, semblent être incarcérées pendant de plus longues périodes, et sont plus souvent placées dans des prisons provinciales que dans des centres de surveillance de l’immigration.
Ces dernières années, les procédures judiciaires et les initiatives de plaidoyer engagées par de nombreux activistes et organisations de terrain, universitaires, cliniques juridiques et organisations non gouvernementales (ONG) ont porté principalement sur les conséquences de la détention sur la santé mentale, ses répercussions sur les enfants, et l’équité procédurale lors des audiences de contrôle des motifs de détention.
Fondé sur des recherches menées entre février 2020 et mars 2021, ce rapport conjoint de Human Rights Watch et Amnistie internationale documente des graves violations du droit international relatif aux droits humains auxquelles sont confrontées les personnes migrantes détenues au Canada, en particulier celles qui sont en situation de handicap psychosocial. Les chercheur·euse·s ont notamment interrogé des migrant·e·s ayant été détenu·e·s et leurs proches, des spécialistes de la santé mentale, des universitaires ayant travaillé sur la détention des personnes migrantes, des avocat·e·s, des membres de la société civile et des fonctionnaires.
Le Canada est l’un des rares pays de l’hémisphère nord où la durée de la détention liée à l’immigration n’est pas juridiquement limitée. En vertu du droit canadien, les personnes migrantes peuvent donc être incarcérées pour une durée indéterminée. Human Rights Watch et Amnistie internationale ont découvert que, depuis 2016, le Canada avait maintenu plus de 300 migrant·e·s en détention pendant plus d’un an. La durée la plus longue était de plus de 11 ans et concernait un homme ayant semble-t-il un handicap psychosocial, qui a été détenu à l’isolement cellulaire et dont les autorités n’ont pas pu établir l’identité.
Des études menées auprès de demandeur·euse·s d’asile montrent que la détention pour des raisons liées à l’immigration a des effets dévastateurs sur la santé mentale. Pour beaucoup de personnes détenues, le fait de ne pas savoir combien de temps elles vont être maintenues en détention est source de traumatisme et d’angoisse et provoque un sentiment d’impuissance. La détention peut exacerber des handicaps psychosociaux existants et en déclenche souvent de nouveaux, tels que la dépression, l’anxiété et le stress post-traumatique. Des études scientifiques ont également montré que des épisodes de détention, même de courte durée, entraînaient une détérioration importante de la santé mentale chez les personnes demandeuses d’asile. D’après nos recherches, un grand nombre de migrant·e·s développent des idées suicidaires car ces personnes commencent à perdre espoir, en particulier si elles ont fui des expériences traumatisantes et des persécutions pour venir chercher sécurité et protection au Canada. La détention liée à l’immigration a des effets particulièrement délétères sur les personnes de couleur, les demandeur·euse·s d’asile, les enfants et les familles.
Les personnes migrantes en situation de handicap psychosocial font face à la discrimination tout au long du processus de détention : elles risquent davantage d’être placées dans des prisons provinciales plutôt que dans des centres de surveillance de l’immigration (réservés à la détention dans le contexte de l’immigration) ; dans les prisons provinciales de l’Ontario, elles sont souvent placées à l’isolement cellulaire ; elles ne sont pas toujours autorisées à prendre des décisions indépendantes sur le plan juridique, des représentant·e·s étant désigné·e·s par les tribunaux pour prendre toutes les décisions à leur place ; elles se heurtent à d’importants obstacles pour obtenir leur libération ; et, quand elles sont libérées, elles risquent davantage d’être soumises à des conditions de libération particulièrement strictes pour avoir le droit de vivre parmi la population, ce qui peut les amener à être de nouveau arrêtées. En résumé, les autorités considèrent souvent les handicaps psychosociaux comme un facteur de risque et, au lieu de recevoir l’aide cruciale dont ils ont besoin, les détenu·e·s concerné·e·s sont soumis·e·s à un traitement coercitif disproportionné.
Des agent·e·s et agentes de l’ASFC interrogés par Human Rights Watch et Amnistie internationale ont indiqué que les personnes ayant un handicap psychosocial étaient parfois placées dans des prisons provinciales (plutôt qu’en centre de surveillance de l’immigration) afin qu’il soit possible de « les gérer efficacement au vu de leur comportement » ou pour faciliter « l’accès à des soins spécialisés ». Cette politique et cette pratique sont discriminatoires. L’ASFC a toute latitude pour classer les personnes migrantes comme détenu·e·s « à risque moyen » ou « à haut risque », ce qui peut déterminer leur lieu de détention : une prison provinciale ou un centre de surveillance de l’immigration. Or, le manuel d’exécution de la loi de l’ASFC associe explicitement « un comportement instable associé à un déséquilibre mental » à un « danger ».
Des avocat·e·s ont constaté que certaines personnes migrantes avaient été placées dans des prisons provinciales au moins en partie parce qu’elles présentaient des symptômes témoignant de handicaps psychosociaux, tels que des idées suicidaires, ou de problèmes médicaux. Dans ce type de cas, les agent·e·s de l’ASFC considèrent souvent les comportements des personnes porteuses de handicaps psychosociaux ou en mauvaise santé mentale comme un « refus de coopérer » ou un motif de maintien en détention.
Lors d’un entretien avec les chercheur·euse·s, certains agent·e·s de l’ASFC ont cherché à justifier l’utilisation des prisons provinciales en affirmant que les détenu·e·s en situation de handicap psychosocial pouvaient bénéficier de « soins spécialisés » dans ces établissements. Or, les soins de santé mentale manquent cruellement dans les prisons provinciales. Selon une étude indépendante sur le traitement des personnes en situation de handicap psychosocial dans les prisons provinciales de l’Ontario, menée en 2020 à la demande du Tribunal des droits de la personne de l’Ontario, « l’isolement prolongé (15 jours ou plus) demeure une pratique courante pour les personnes ayant une désignation de problèmes de santé mentale ou de risque de suicide à leur dossier ». Le rapport de cette étude constate également « des pratiques d’isolement discriminatoires » à l’encontre des personnes ayant un handicap psychosocial et s’inquiète de ce que « certaines … catégories de soins spécialisés ne constituent qu’une autre forme d’isolement ».
Nos recherches montrent que plusieurs mois voire années après leur libération, de nombreuses personnes migrantes ayant été incarcérées continuent de ressentir les effets dus aux handicaps psychosociaux développés pendant leur détention. La détention liée à l’immigration a aussi des conséquences qui vont bien au-delà des personnes concernées et se répercutent sur leurs enfants, leurs proches et leur communauté. Souvent, le seul moyen pour obtenir une libération est que quelqu’un se porte caution ou garant. Il s’agit généralement d’un·e membre de la famille ou d’un·e ami·e, qui est chargé·e de veiller à ce que la personne libérée respecte les conditions de sa libération. Les liens cruciaux les unissant peuvent être mis à mal par le fait que l’ASFC s’appuie sur la surveillance et le contrôle exercés par les personnes garantes ou cautions au sein des foyers et des communautés. Par ailleurs, la détention pour des raisons liées à l’immigration a de profondes répercussions sur la confiance des individus dans les forces de l’ordre et le système judiciaire, qu’ils aient eux-mêmes vécu la détention ou qu’ils en aient subi les conséquences par le biais d’un·e proche.
Ces dernières années, le gouvernement canadien a adopté de nouvelles politiques, lignes directrices et réformes réglementaires en réponse aux procédures judiciaires et aux initiatives de plaidoyer concernant la détention des personnes migrantes. Cependant, celles-ci sont loin d’être suffisantes pour remédier aux failles structurelles profondément enracinées qui touchent de façon disproportionnée les personnes porteuses de handicap psychosocial placées en détention en raison de leur situation au regard de la législation sur l’immigration. La façon dont le Canada traite ces personnes est discriminatoire et contraire aux obligations du pays en vertu du droit international relatif aux droits humains. Le pays devrait abolir progressivement la détention liée à l’immigration. Nul ne devrait, en aucune circonstance, être traité de façon punitive pour des raisons liées à l’immigration, et notamment être détenu à l’isolement, ou dans des établissements destinés aux auteurs d’infractions pénales tels que des centres de détention, des prisons ou des postes de police, ou dans tout autre établissement de type carcéral. Des changements structurels et législatifs importants sont nécessaires pour remédier aux violations profondément ancrées dans le système dont sont victimes les personnes migrantes détenues.
Comme l’a déclaré en novembre 2020 une avocate spécialisée dans la défense des personnes migrantes et réfugiés : « Si nous pensons que les migrants et migrantes en détention peuvent comme nous ressentir de la douleur, de l’anxiété, de l’amour et de l’espoir, l’incarcération ne peut pas être une solution. Elle n’est envisageable que si nous estimons qu’ils sont moins humains que nous. »
Glossaire
Capacité juridique : capacité d’une personne à avoir des droits et des obligations, et à agir en droit, sur la base de l’égalité avec les autres[1]. La notion de capacité juridique englobe le droit à la personnalité juridique, le droit d’être reconnu comme une personne devant la loi, et la capacité d’agir en droit, c’est-à-dire la capacité d’accomplir des actes reconnus par la loi et d’exercer ces droits[2].
Centre de surveillance de l’immigration : établissement de détention semblable à une prison à sécurité moyenne et fonctionnant de la même manière, où sont détenues les personnes faisant l’objet d’une mesure de détention pour des motifs liés à l’immigration au Canada.
Contrôle des motifs de détention : audience tenue par la Section de l’immigration de la Commission de l’immigration et du statut de réfugié du Canada en vue de déterminer s’il convient de libérer ou de maintenir en détention la personne migrante dont le cas est examiné.
Enfant : le terme « enfant » désigne une personne âgée de moins de 18 ans. La Convention relative aux droits de l’enfant dispose qu’« un enfant s’entend de tout être humain âgé de moins de dix-huit ans, sauf si la majorité est atteinte plus tôt en vertu de la législation qui lui est applicable[3] ».
Handicap psychosocial : terme privilégié pour désigner les états de santé mentale tels que la dépression, la bipolarité, la schizophrénie et la catatonie. Le terme « handicap psychosocial » fait référence aux états généralement qualifiés de « maladie mentale » ou de « troubles psychiatriques », en particulier par les professionnel·le·s de la santé mentale, les tribunaux, les avocat·e·s, le personnel pénitentiaire et les médias. La Convention relative aux droits des personnes handicapées reconnaît que le handicap est une notion qui évolue et qu’il résulte de l’interaction entre des personnes présentant des incapacités et les barrières sociales, culturelles, comportementales et environnementales qui font obstacle à leur pleine et effective participation à la société sur la base de l’égalité avec les autres[4]. Le terme « handicap psychosocial » est préférable car il exprime l’interaction entre les différences psychologiques et les limites sociales ou culturelles dans les comportements, ainsi que les préjugés de la société à l’égard des personnes ayant un handicap intellectuel[5].
Représentant·e désigné·e : personne désignée par le tribunal canadien en charge du contrôle des motifs de détention pour protéger les intérêts d’une personne migrante détenue qui est mineure ou qui « n’est pas en mesure de comprendre la nature de la procédure[6] ».
Section de l’immigration : une des sections de la Commission de l’immigration et du statut de réfugié du Canada chargée de tenir des audiences de contrôle des motifs de détention afin de déterminer s’il convient de libérer ou de maintenir en détention les personnes migrantes détenues.
Acronymes
ASFC – Agence des services frontaliers du Canada
CDHP – Convention relative aux droits des personnes handicapées
CISR – Commission de l’immigration et du statut de réfugié du Canada
CSI – Centre de surveillance de l’immigration
ENRD – Évaluation nationale des risques en matière de détention
GCSC – Gestion des cas et surveillance dans la collectivité
LIPR – Loi sur l’immigration et la protection des réfugiés
ONG – Organisation non gouvernementale
SRD – Solutions de rechange à la détention
Principales recommandations au gouvernement du Canada
- Abolir progressivement la détention liée à l’immigration. Nul ne devrait, en aucune circonstance, être traité de façon punitive pour des raisons liées à l’immigration, et notamment être détenu à l’isolement cellulaire, ou dans des établissements destinés aux auteurs d’infractions pénales tels que des centres de détention, des prisons ou des postes de police, ou dans tout autre établissement de type carcéral.
- Mettre un terme à la pratique de la détention à l’isolement cellulaire des personnes migrantes.
- Créer un organisme indépendant chargé de superviser l’ASFC et d’enquêter sur ses actes, auprès duquel les personnes migrantes détenues pourraient déposer plainte en cas d’allégations de violences, de négligence ou d’autres préoccupations relatives aux droits de la personne, afin que les autorités aient à rendre des comptes. Cet organisme devra avoir le pouvoir d’ordonner de véritables réparations et sanctions et d’engager des enquêtes et évaluations à sa propre initiative, notamment sous la forme d’inspections surprises, et ne pas agir uniquement en cas de plainte. Il devra aussi permettre à des tiers, comme des organisations non gouvernementales, de porter plainte aussi bien sur des cas individuels que sur les politiques et les pratiques de l’ASFC.
- Signer et ratifier le Protocole facultatif se rapportant à la Convention contre la torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants, afin d’autoriser l’inspection internationale de tous les lieux de détention.
- Mener une enquête nationale indépendante sur le système de détention des personnes migrantes, en mettant l’accent sur le racisme systémique et la discrimination à l’égard des personnes en situation de handicap, en particulier celles qui sont porteuses de handicaps psychosociaux réels ou présumés.
- Retirer la déclaration et la réserve émises par le Canada à propos de l’article 12 de la Convention relative aux droits des personnes handicapées.
Méthodologie
Ce rapport conjoint de Human Rights Watch et Amnistie internationale documente des graves violations du droit international relatif aux droits humains auxquelles sont confrontées les personnes migrantes détenues au Canada, en particulier celles qui sont en situation de handicap psychosocial.
Les recherches pour ce rapport ont été menées entre février 2020 et mars 2021. Les chercheur·euse·s des deux organisations ont interrogé au total 90 personnes, dont 24 migrant·e·s ayant été détenu·e·s entre 2007 et 2020 pour des périodes allant de trois jours à presque six ans, ainsi qu’une personne qui se trouvait toujours en détention au moment de l’entretien en 2021.
Ils ont aussi interrogé 37 avocat·e·s et représentant·e·s légaux, cinq représentant·e·s désigné·e·s de migrant·e·s détenu·e·s, trois spécialistes de la santé mentale et médecins, quatre universitaires, sept prestataires de services et représentant·e·s d’ONG, quatre membres de la famille d’ancien·ne·s détenu·e·s, trois fonctionnaires de l’ASFC, et deux représentant·e·s de la Section de l’immigration de la Commission de l’immigration et du statut de réfugié du Canada.
Ils ont également étudié diverses publications pertinentes, telles que des rapports et des documents d’ONG, d’universitaires et d’organismes gouvernementaux, des articles de médias nationaux et internationaux, et des documents des Nations Unies.
Par ailleurs, les chercheur·euse·s ont adressé au total 112 demandes de documents officiels à l’ASFC, à la CISR et aux ministères des Services correctionnels dont dépendent les prisons provinciales où sont détenues des personnes migrantes dans les 10 provinces et dans deux des trois territoires. Ils ont reçu 105 réponses. Ils ont ensuite écrit aux ministères des Services correctionnels des 10 provinces pour leur demander des informations complémentaires sur leurs accords avec l’ASFC dans le contexte de la détention des migrant·e·s, et ont reçu une réponse détaillée de l’un des ministres provinciaux. Enfin, après avoir rencontré des agent·e·s de l’ASFC en février 2021, les chercheur·euse·s ont envoyé des questions supplémentaires à cette agence, et ont reçu une réponse en avril 2021. Ils ont fait en sorte d’intégrer ces réponses dans le rapport lorsque c’était pertinent.
Human Rights Watch et Amnistie internationale ont adressé les recommandations préliminaires de ce rapport à l’ASFC et à la Section de l’immigration de la CISR en mai 2021, en les invitant à leur faire part de leurs réactions. Les deux organismes gouvernementaux ont répondu en proposant des rencontres, et la CISR a transmis une réponse écrite.
En raison de la pandémie de Covid-19, les déplacements et les recherches sur le terrain ont été limités et les chercheur·euse·s n’ont pas pu se rendre dans les lieux de détention. L’une des principales difficultés a été d’entrer en contact avec des personnes migrantes détenues ou ayant été détenues, non seulement en raison des restrictions liées à la pandémie, mais aussi parce que ces personnes craignaient des représailles de la part de l’ASFC, et étaient toujours dans l’incertitude quant à leur statut d’immigrant·e au Canada. Human Rights Watch et Amnistie internationale ont consulté des activistes, des avocat·e·s et des prestataires de services pour trouver des personnes migrantes prêtes à témoigner ; certaines des personnes interrogées leur ont aussi recommandé d’autres personnes ayant été détenues qui étaient désireuses de témoigner.
Toutes les personnes interrogées ont été informées de l’objectif de l’entretien et de la manière dont les informations seraient utilisées. Aucune rémunération ni contrepartie n’a été promise ou offerte à ces personnes en échange de leur témoignage. Leur consentement a été recueilli avant l’entretien et il leur a été précisé qu’elles pouvaient refuser de répondre à certaines questions et mettre un terme à l’entretien à tout moment. Les entretiens ont été menés sur la base du volontariat, de façon individuelle, et ont duré entre 30 minutes et trois heures. Tous les entretiens ont eu lieu directement avec la personne, au téléphone ou en visioconférence, en anglais ou en français, avec l’aide d’interprètes si besoin.
Toutes les personnes migrantes interrogées pour ce rapport sont citées de façon anonyme, et certaines sont désignées par un pseudonyme, sauf celles dont le cas avait déjà été rendu public. Les pseudonymes apparaissent entre guillemets à la première occurrence. Toutes les informations susceptibles de permettre une identification, comme les lieux, la date de l’entretien ou d’autres éléments distinctifs, ont aussi été supprimées afin de respecter la confidentialité et d’éviter d’éventuelles représailles de la part des autorités en charge de l’immigration ou des auteurs de persécutions dans le pays d’origine des personnes migrantes interrogées. Les noms des autres personnes interrogées, telles que les avocat·e·s, les prestataires de services, les membres d’organisations de la société civile et les activistes, ne sont pas donnés non plus afin de protéger leurs client·e·s et bénéficiaires d’éventuelles représailles des services de l’immigration.
Human Rights Watch et Amnistie internationale ont fait tout leur possible pour corroborer les témoignages reçus, s’appuyant pour cela sur des informations parues dans les médias, des dossiers médicaux ou psychiatriques et des entretiens avec des représentant·e·s légaux, le cas échéant. Des juristes et des défenseur·e·s des droits des personnes migrantes ont relu bénévolement les conclusions du rapport et vérifié toutes les références au droit national et international.
I. Contexte
Présentation générale du système de détention des personnes migrantes au Canada
Au Canada, la détention pour des motifs liés à l’immigration est mise en œuvre par plusieurs organismes gouvernementaux dont les compétences se recoupent. Le ministère de l’Immigration, des Réfugiés et de la Citoyenneté du Canada a compétence générale sur l’administration de la Loi sur l’immigration et la protection des réfugiés (LIPR)[7]. Le ministère de la Sécurité publique et de la Protection civile est chargé de son application, notamment des arrestations, des incarcérations et des expulsions[8], et a délégué ces responsabilités à l’ASFC, créée en 2003, qu’elle a désignée pour exercer ses pouvoirs de mise en œuvre[9].
Décision d’arrestation, motifs de détention et lieu d’incarcération
L’ASFC est dotée de larges pouvoirs de police ; elle peut notamment procéder à des arrestations, à des placements en détention, à la collecte de renseignements, à des fouilles et à des saisies[10]. Dans le contexte de la détention liée à l’immigration, elle a compétence pour décider qui est arrêté et incarcéré au titre de la LIPR, pour déterminer les motifs de la détention et pour choisir le lieu de détention des personnes migrantes.
L’ASFC a le pouvoir, sur le territoire canadien, d’arrêter et de placer en détention une personne étrangère, y compris demandeuse d’asile ou résidente permanente, dès lors qu’un·e agent·e a des motifs raisonnables de croire que cette personne est interdite de territoire et constitue « un danger pour la sécurité publique » ou se soustraira vraisemblablement au contrôle ou à toute autre procédure[11]. Ses agent·e·s n’ont pas besoin de mandat, sauf s’il s’agit d’une « personne protégée[12] ». Les agent·e·s de l’ASFC peuvent aussi arrêter et incarcérer une personne étrangère si son identité ne leur a pas été prouvée ou pour contrôler sa situation à son entrée au Canada[13]. Enfin, une personne peut être arrêtée et placée en détention sans mandat à son entrée au Canada si un·e agent·e de l’ASFC soupçonne qu’elle est interdite de territoire pour raison de sécurité, pour « atteinte aux droits humains ou internationaux » ou pour participation à des actes criminels ou criminalité organisée[14].
Malgré ses importants pouvoirs de police, l’ASFC est le seul organisme de sécurité publique du Canada à ne pas être soumis à une surveillance indépendante civile. La Loi sur l’immigration et la protection des réfugiés et ses règlements ne contiennent aucune disposition prévoyant une surveillance indépendante des lieux de détention, et le Canada n’a pas ratifié le Protocole facultatif se rapportant à la Convention contre la torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants, qui prévoit un système de contrôle indépendant mené par les Nations Unies.
Bien que les personnes migrantes soient détenues pour des motifs administratifs et non pénaux, le Canada soumet certaines d’entre elles à des conditions de détention parmi les plus restrictives du pays. L’ASFC a toute latitude pour décider où sont incarcérés les migrant·e·s : dans des centres de surveillance de l’immigration, dans des prisons provinciales ou dans d’autres établissements[15]. Les prisons provinciales sont destinées à accueillir des personnes accusées d’infractions pénales en attente de jugement ou condamnées à des peines de deux ans maximum[16]. Plusieurs avocat·e·s ont indiqué que les personnes migrantes y étaient placées dans les mêmes quartiers et les mêmes cellules que les personnes inculpées d’infractions pénales ou condamnées, ce qu’ont confirmé des migrant·e·s concerné·e·s[17]. L’ASFC détient aussi certaines personnes dans d’autres lieux, par exemple dans des cellules de la police locale ou provinciale, aux points d’entrée dans le pays, et dans des cellules des bureaux intérieurs d’exécution de la loi ou de la Gendarmerie royale du Canada, généralement pendant quelques heures à quelques jours, dans l’attente de leur transfert dans une prison provinciale ou un centre de surveillance de l’immigration[18].
|
Le centre de surveillance de l’immigration de Laval, au Québec, a une capacité maximale de 109 détenu·e·s et accueille des personnes arrêtées au Québec, dans la région de l’Atlantique et dans le nord de l’Ontario (à Cornwall et à Ottawa)[19]. Il est exploité en vertu d’un protocole d’accord avec les Services correctionnels du Canada, qui en sont propriétaires. Le centre se compose de trois bâtiments offrant des secteurs résidentiels séparés pour les hommes, les femmes et les familles ou les enfants non accompagnés. Le centre de surveillance de l’immigration de Toronto, dans l’Ontario, a une capacité maximale de 183 détenu·e·s et accueille des personnes arrêtées dans le Grand Toronto, le sud de l’Ontario et le nord de l’Ontario (à l’exception de Cornwall et d’Ottawa)[20]. Il est exploité en vertu d’un contrat de service avec une tierce partie, laquelle fournit l’installation à l’ASFC. Il s’agit d’un bâtiment de trois étages comprenant des secteurs résidentiels pour les hommes, les femmes et les familles. Le centre de surveillance de l’immigration de Surrey, en Colombie-Britannique, a une capacité maximale de 70 détenu·e·s et accueille des personnes arrêtées dans les régions du Pacifique et des Prairies[21]. L’ASFC en est propriétaire, et a conclu un contrat avec un tiers pour la prestation de services au sein de l’établissement. Ce bâtiment de deux étages offre des secteurs résidentiels séparés pour les hommes, les femmes et les familles. |
Le Canada détient aussi des personnes migrantes dans trois centres de surveillance de l’immigration situés dans différentes régions du pays[22]. Les centres de surveillance de l’immigration sont gérés par du personnel régional de l’ASFC, avec l’aide de gardiens contractuels[23]. Ces établissements sont semblables à des prisons à sécurité moyenne et fonctionnent de la même manière, avec d’importantes restrictions de la vie privée et de la liberté, des règles strictes et une routine quotidienne, ainsi que des mesures punitives en cas de non-respect des règles et des ordres[24].
Les personnes migrantes détenues dans ces centres sont surveillées en permanence par des gardiens en uniforme et des caméras[25]. Elles sont régulièrement fouillées. Les centres de surveillance de l’immigration sont équipés de portes à fermeture centralisée et les déplacements entre les différents secteurs du bâtiment sont limités et possibles uniquement sous l’escorte d’un gardien[26]. Certains effets personnels de base, comme les téléphones portables et autres appareils électroniques, sont interdits[27]. Les personnes détenues ne peuvent communiquer avec leurs proches, leurs avocat·e·s et les personnes qui les soutiennent au sein de la société civile qu’au moyen des téléphones du centre ou lors de visites sur des créneaux imposés[28]. Celles qui ne respectent pas les règles strictes peuvent être isolées à titre de sanction, dans des conditions similaires à celles de l’isolement cellulaire, se voir privées de certains avantages comme les visites, voire être transférées dans une prison provinciale[29].
En vertu de la politique de l’ASFC, dès lors qu’il n’y a pas de centre de surveillance de l’immigration à proximité, les personnes migrantes arrêtées sont automatiquement placées dans des prisons provinciales, y compris des établissements à sécurité maximale[30]. Par ailleurs, même lorsqu’il existe un centre de surveillance de l’immigration à proximité, l’ASFC peut décider de placer des migrant·e·s dans des prisons provinciales si elle estime que leur comportement « ne peut être géré dans un CSI [centre de surveillance de l’immigration][31] », ou à la demande du centre de surveillance de l’immigration le plus proche si celui-ci a atteint un taux de remplissage d’au moins 85 % de sa capacité, ou rencontre d’autres difficultés en termes de capacité[32]. Enfin, les personnes ayant « des problèmes de santé mentale » peuvent aussi être placées dans des prisons provinciales afin qu’il soit possible de « les gérer efficacement au vu de leur comportement » ou pour faciliter « l’accès à des soins spécialisés[33] ».
Décision de maintien en détention ou de remise en liberté
Une fois qu’elle a arrêté et incarcéré une personne migrante, l’ASFC conserve le droit de la libérer dans les 48 heures suivant l’arrestation[34]. Ensuite, c’est un tribunal administratif, la Section de l’immigration de la Commission de l’immigration et du statut de réfugié (CISR), qui est habilité à ordonner une remise en liberté. La CISR est un organe quasi-judiciaire indépendant, et sa Section de l’immigration tient régulièrement des audiences de contrôle des motifs de détention afin de déterminer s’il convient de libérer ou de maintenir en détention les personnes migrantes détenues[35].
La première audience de contrôle des motifs de détention se tient environ 48 heures après l’arrestation et, si la détention est confirmée, une nouvelle audience a lieu dans les sept jours, puis tous les 30 jours jusqu’à ce que la personne soit libérée ou expulsée[36]. L’audience de contrôle des motifs de détention est une procédure contradictoire opposant deux parties : la personne migrante, qui peut être représentée par un·e avocat·e, et le ministre de la Sécurité publique et de la Protection civile, représenté par des agent·e·s d’audience de l’ASFC[37]. La charge de la preuve repose sur le ministre, qui doit démontrer que les motifs justifiant la détention sont toujours valables selon la prépondérance des probabilités[38].
Les audiences de contrôle régulières ont pour but d’offrir une garantie contre la détention arbitraire et illimitée. Cependant, la Section de l’immigration n’est « pas liée par les règles légales ou techniques de présentation de la preuve », et peut fonder sa décision sur « les éléments qu’elle juge crédibles ou dignes de foi en l’occurrence[39] ».
En outre, le tribunal a un rayon d’action limité : il ne peut qu’ordonner le maintien en détention ou la libération de la personne concernée[40]. Il peut prendre en compte les conditions et le lieu de détention dans ses décisions, mais c’est l’ASFC qui a toute latitude de décider où sont détenues les personnes migrantes[41]. Le tribunal n’a pas le pouvoir d’ordonner un changement des conditions de détention ni de déterminer si le lieu de détention est approprié[42]. Par conséquent, des migrant·e·s détenu·e·s pour des motifs similaires peuvent être soumis à des conditions de détention très différentes, allant des centres de surveillance de l’immigration à des prisons provinciales à sécurité maximale.
La détention des personnes migrantes : faits et chiffres
Chaque année, le Canada place en détention des milliers de personnes pour des raisons liées à l’immigration[43], y compris des demandeur·euse·s d’asile, des migrant·e·s venu·e·s chercher un emploi et une vie meilleure, et des personnes qui ont obtenu la résidence permanente et vivent au Canada depuis leur enfance. Entre avril 2016 et mars 2020, environ 32 000 migrant·e·s ont été détenu·e·s au Canada[44]. Pendant cette même période, le nombre annuel de migrant·e·s incarcérée·s au Canada a augmenté chaque année fiscale, culminant à 8 825 durant l’exercice 2019-2020[45].
Le Canada place aussi bien des adultes que des enfants en détention pour des motifs liés à l’immigration. Durant l’exercice 2019-2020, il a détenu 8 825 migrant·e·s âgé·e·s de 15 à 83 ans, dont 48 personnes de 65 ans et plus[46]. Par ailleurs, les enfants peuvent être « hébergés » en centre de détention même s’ils ne font l’objet d’aucune décision officielle d’incarcération, afin d’accompagner leurs parents incarcérés ; ils peuvent aussi être séparés de leurs parents[47]. Durant l’exercice 2019-2020, 138 enfants au total ont été placés ou « hébergés » en détention (dont 73 de moins de six ans), soit une augmentation de 17 % par rapport à l’année précédente[48]. L’ASFC ne collecte pas de données sur le nombre d’enfants séparés de leurs parents durant la détention.
La grande majorité des personnes migrantes détenues sont incarcérées pour des raisons non liées à des questions de sécurité publique[49]. Entre avril 2016 et mars 2020, environ 94 % d’entre elles étaient détenues parce que les autorités soupçonnaient un risque de fuite, c’est-à-dire estimaient que ces personnes risquaient de ne pas se présenter à une audience ou de se soustraire à leur expulsion ; parce que les autorités n’étaient pas satisfaites de leurs papiers d’identité ; ou à des fins d’examen de leur situation[50]. Parmi ces motifs, le plus fréquent était le risque de fuite : entre 81 % et 86 %[51]. Durant cette même période, seule une petite minorité de migrant·e·s – entre 5 % et 7 % – ont été détenu·e·s parce que les autorités considéraient qu’ils ou elles présentaient un risque en matière de sécurité publique[52]. Environ 1 % ont été placé·e·s en détention parce que soupçonné·e·s d’être interdit·e·s de territoire[53]. Aucune personne n’a été placée en détention en raison d’une menace supposée pour la sécurité nationale[54].
Les migrant·e·s détenu·e·s pour risque de fuite représentent non seulement la majorité des personnes incarcérées en général, mais aussi la majorité de celles qui sont placées dans des prisons provinciales[55]. Entre avril 2017 et mars 2020, plus d’un cinquième des migrant·e·s emprisonné·e·s – environ 5 400[56] – ont été placé·e·s dans 78 prisons provinciales sur tout le territoire canadien, aux côtés de détenu·e·s inculpé·e·s d’infractions pénales ou condamné·e·s[57].
Les personnes migrantes qui sont détenues dans des prisons provinciales sont non seulement soumises à un régime plus restrictif que celles qui sont placées dans des centres de surveillance de l’immigration, mais elles ont aussi une plus grande probabilité de rester plus longtemps en détention. Les données obtenues par les chercheur·euse·s en réponse à des demandes formulées au titre de l’accès à l’information montrent que les personnes détenues pendant 90 jours ou plus en 2019 étaient plus souvent incarcérées dans des prisons provinciales que dans des centres de surveillance de l’immigration[58] : 78 % d’entre elles avaient passé au moins une partie de leur détention dans un établissement provincial[59]. Ce pourcentage augmentait à 85 % pour les personnes détenues pendant 180 jours ou plus, et à 100 % pour les personnes détenues pendant 270 jours ou plus[60].
II. Détention des personnes migrantes et santé mentale
Beaucoup de gens ont développé des problèmes de santé mentale en prison.… La plupart du temps, je restais juste allongé et je sentais mon esprit divaguer. Je restais là à respirer l’air brassé par la ventilation. C’est un endroit où il faut être très fort pour ne pas perdre la tête et rester la même personne qu’avant…. Quand je repense à tout ça– toute la pression et le fait d’être séparé de ma femme et de mes enfants – c’était vraiment dur à supporter. Je n’avais rien d’autre à faire que de prier.
--« Charles », migrant ayant été incarcéré dans des prisons provinciales de l’Ontario à deux reprises en 2015 et 2020
La détention pour des raisons liées à l’immigration peut avoir des effets dévastateurs sur la santé mentale. Toutes les personnes migrantes ayant été détenues que nous avons interrogées pour ce rapport nous ont dit à quel point la détention avait affecté leur bien-être.
Les chercheur·euse·s ont ainsi interrogé « John », un homme d’une trentaine d’année qui a quitté son pays d’origine en Afrique alors qu’il était encore mineur et qui a passé plusieurs années au Canada après avoir été débouté de sa demande d’asile. L’ASFC l’a placé en détention dans une prison provinciale de l’Ontario pendant environ un an pour risque de fuite. John a vécu plus longtemps au Canada que dans son pays d’origine, et les autorités n’ont pas pu l’expulser car son pays d’origine ne l’a pas reconnu comme ressortissant. John a raconté s’être senti désespéré et avoir eu des pensées suicidaires en détention :
L’une des choses essentielles pour la santé mentale est d’avoir des objectifs, d’avoir quelque chose à attendre…. Quand il n’y a plus rien, quand c’est sans fin, ça devient très difficile.… Nous n’avions plus d’espoir et nous avions le sentiment que quelque chose devait changer. Nous avions l’impression de devoir faire quelque chose de radical. Beaucoup de gens étaient prêts à mourir…. Je me suis donné un délai : si je n’étais pas libéré avant telle date, je trouverai un moyen [de me suicider][61].
Human Rights Watch a aussi interrogé « Daryan », un Irakien qui a demandé l’asile à son arrivée au Canada. Il a été arrêté à l’aéroport et placé dans un centre de surveillance de l’immigration pendant plus d’un mois. Daryan a raconté avoir été le témoin de la crise de santé mentale vécue par son compagnon de cellule, lui aussi demandeur d’asile : « Il ne pouvait pas accepter d’être emprisonné sans raison. C’est pourquoi il a tenté de se suicider. Il s’est cogné la tête très fort contre le mur et il a perdu connaissance.… Puis [l’ASFC] l’a emmené à l’hôpital, menotté[62]. »
Un autre ancien détenu, Abdirahmaan Warssama, somalien, a demandé l’asile en 1989 et a reçu un permis ministériel l’autorisant à rester au Canada pour des motifs d’ordre humanitaire, mais il n’a pas obtenu la résidence permanente. Il a été incarcéré pour risque de fuite pendant plus de cinq ans dans deux prisons provinciales à sécurité maximale entre 2010 et 2015, tandis que les autorités tentaient de l’expulser en Somalie[63]. Il a été libéré après 76 audiences de contrôle des motifs de détention et une décision cinglante de la Cour fédérale du Canada[64]. Après sa libération, Abdirahmaan Warssama a poursuivi le gouvernement en justice, réclamant 55 millions de dollars canadiens de dommages et intérêts. Il a déclaré avoir vécu des « expériences humiliantes et dégradantes » en détention, et notamment avoir été déshabillé entièrement pour des fouilles corporelles, agressé, dépouillé de certaines de ses affaires, privé de vêtements chauds et de soins médicaux, et contraint de supporter des températures glaciales, des conditions de vie insalubres et des confinements prolongés[65]. Il a qualifié sa période de détention de « torture », ajoutant : « Je ne suis plus le même qu’avant [ma détention][66]. »
Un avocat de Toronto qui a travaillé avec des dizaines de migrant·e·s incarcéré·e·s et a défendu certaines des personnes ayant passé le plus de temps en détention pour des raisons liées à l’immigration au Canada a décrit les effets de la détention sur ses client·e·s : « Ce ne sont pas de petits effets. [Ils] ne n’exhibent pas seulement une plus grande anxiété sociale, par exemple. Cela se manifeste physiquement par des tremblements, des hurlements, une incapacité à trouver le sommeil, une impossibilité de fonctionner[67] ». Un autre avocat de Toronto a expliqué aux chercheur·euse·s que certaines personnes détenues qui avaient été défendues par son cabinet avaient des crises si fortes « qu’elles étaient incapables de communiquer[68] ». De même, un autre avocat a observé que certains de ses clients et clientes incarcérés dans des prisons provinciales avaient développé des troubles psychosociaux si graves qu’ils n’étaient plus en mesure d’apprécier les risques qu’ils couraient en cas d’expulsion[69].
Une avocate de Vancouver a raconté le cas d’une de ses clientes, une mère célibataire chez qui on a diagnostiqué une dépression et un stress post-traumatique, et qui avait subi de graves violences domestiques[70]. Lorsqu’elle a été incarcérée pour risque de fuite, elle a été séparée de ses deux enfants[71]. Lors de son audience de contrôle des motifs de détention, il lui a été demandé de décrire les conséquences qu’avaient eu sur elle ses 10 jours de détention :
Terrible. Je suis traumatisée. Ils m’ont mis à l’isolement [pendant] quatre jours. [D’abord] ils m’ont déshabillée. [Puis] ils m’ont mis une robe bizarre parce qu’[ils] pensaient que j’allais me suicider car je suis très déprimée. J’ai beaucoup pleuré, beaucoup, tout le temps, toute la journée, toute la nuit. Je n’ai pas dormi.… Je ne mange pas. Je ne bois pas. Je maigris…. Je crois que je vais mourir, c’est comme si quelqu’un me comprimait la poitrine. J’ai du mal à respirer. Je me sens bloquée – ma respiration reste bloquée à l’intérieur de mon corps. J’ai sonné [inaudible] plein, plein de fois et j’ai tambouriné très fort pour demander de l’aide. Je me sens toujours mal, j’ai la tête qui tourne en permanence[72].
Selon Dr. Efrat Arbel, professeure agrégée à la faculté de droit Peter A. Allard de l’université de Colombie-Britannique, qui consacre une grande partie de ses recherches au système de détention des personnes migrantes au Canada : « Sans la possibilité de prévoir et de se projeter, nous perdons la qualité d’êtres humains[73]. » Dans un article universitaire de 2018, Arbel et son coauteur Ian Davis ont évoqué le « problème du temps » dans le contexte de la détention liée à l’immigration : « Les détenu·e·s ne savent jamais quand – ni même si – leur détention va s’arrêter. Le temps en détention est informe, sans fin et indéterminé[74]. » Selon Arbel, les incertitudes et l’absence de limite de durée inhérentes à la détention dans le contexte de l’immigration au Canada « accaparent toute l’énergie … et sont source de traumatismes répétés[75] ». Une psychiatre qui a travaillé avec des dizaines de personnes migrantes ayant été détenues a confirmé les propos d’Arbel[76].
Selon Dr. Janet Cleveland, psychologue et universitaire de l’université McGill qui consacre une grande partie de ses recherches aux effets de la détention sur la santé mentale des personnes migrantes, beaucoup de ces détenu·e·s connaissent une détérioration de leur santé mentale[77]. Les recherches de Cleveland montrent que même des périodes de détention relativement courtes peuvent provoquer un stress post-traumatique, une dépression et de l’anxiété[78].
D’après Cleveland, l’impression de contrôler la situation, sentiment fondamental que les gens perdent en détention, est « indispensable pour préserver la santé mentale[79] ». Dans les lieux de détention, les règles, la routine et l’environnement hostile privent les personnes migrantes de tout contrôle sur les plus petits détails de leur vie quotidienne. Le sentiment d’impuissance et la perte de contrôle sont tous deux des facteurs de risque de la dépression, et « une fois qu’une personne craque, il peut lui falloir beaucoup de temps pour se remettre, même après la libération, et il peut aussi y avoir des séquelles sur le long terme[80]. »
Pour les personnes qui fuient l’oppression et les persécutions, la détention peut être particulièrement traumatisante et conduire parfois à une grave détérioration de la santé mentale[81]. Une avocate de Toronto spécialisée dans la défense des réfugié·e·s a constaté que la détention pour des raisons liées à l’immigration était d’autant plus choquante pour les demandeur·euse·s d’asile qu’elle semblait « incongrue » par rapport à l’image du pays accueillant qu’ils avaient du Canada : « Ils associent la détention aux régimes répressifs qu’ils ont fuis[82] » Cette même avocate a indiqué que certains de ses clients et clientes avaient tellement perdu espoir en détention qu’ils avaient arrêté les démarches pour tenter d’obtenir un permis de séjour légal au Canada, l’expulsion étant leur seul moyen de sortir de détention[83].
En 2018, un audit externe commandé par le président de la CISR a recommandé que les autorités s’attaquent à « l’énorme problème que représente le traitement équitable et humain à accorder aux personnes détenues qui ont des troubles de santé mentale[84] ». Malgré de nouvelles politiques adoptées récemment, telles que les Directives du président de la CISR sur la détention et le Cadre national en matière de détention liée à l’immigration de l’ASFC[85], beaucoup reste à faire pour remédier aux problèmes plus importants et généralisés qui existent au sein du système de détention liée à l’immigration, en particulier pour les personnes en situation de handicap psychosocial[86]. Selon une avocate ayant plusieurs dizaines d’années d’expérience auprès des migrant·e·s détenu·e·s, « l’ASFC et la Section de l’immigration continuent manifestement de manquer de façon flagrante à leur obligation de prendre en compte correctement l’état de santé mentale quand les gens sont pris dans la machine administrative[87] ».
Le Canada est partie à de nombreuses conventions internationales relatives aux droits humains et a l’obligation juridique de mettre en œuvre des dispositions protégeant les droits des personnes migrantes[88], notamment le droit à la liberté et le droit de ne pas faire l’objet d’une détention arbitraire[89]. En vertu des normes internationales relatives aux droits humains, la détention pour des motifs liés à l’immigration ne peut intervenir que si elle est raisonnable, nécessaire et proportionnée pour atteindre un intérêt légitime de l’État, et doit tenir compte des moyens moins drastiques d’atteindre le même but. Comme l’a indiqué le Groupe de travail des Nations Unies sur la détention arbitraire, cette forme de détention ne doit être utilisé qu’à titre exceptionnel, en dernier recours, si cela est nécessaire pour remplir un intérêt légitime de l’État[90]. Le rapporteur spécial sur la torture a conclu que la détention fondée exclusivement sur le statut migratoire outrepassait les intérêts légitimes de l’État et devait être considérée comme arbitraire[91]. Il a par ailleurs indiqué que, notamment du fait de sa durée prolongée ou indéterminée, elle provoquait de graves dommages psychologiques pouvant s’apparenter à des mauvais traitements interdits[92]. Selon le Groupe de travail des Nations Unies sur la détention arbitraire, les personnes migrantes en situation de handicap ne devraient pas être placées en détention[93], et « la détention pour infraction à la législation sur l’immigration devrait être progressivement abolie[94] ».
La non-reconnaissance des handicaps psychosociaux et l’absence de mesures de soutien
Souvent, les agent·e·s de l’ASFC et les juges de la Section de l’immigration ne reconnaissent pas les symptômes de handicaps psychosociaux chez les personnes migrantes détenues. Selon cinq avocates spécialisées dans la défense des personnes migrantes et réfugiées exerçant dans différentes régions du pays, durant les audiences de contrôle des motifs de détention, les autorités considèrent souvent les comportements de ces personnes comme un refus de coopérer et un motif justifiant leur maintien en détention[95]. Une prestataire de services a décrit une situation dans laquelle son client, détenu à l’isolement depuis plusieurs mois, avait commencé par frustration à se frapper la tête contre les murs, à refuser de manger et à avoir des pensées suicidaires[96]. En réaction, l’ASFC a jugé lors de son audience de contrôle des motifs de détention qu’il n’était « pas coopératif » et a considéré que c’était un argument supplémentaire pour le maintenir en détention ; le tribunal a partagé cet avis et l’homme est resté emprisonné[97].
Dans certains cas, le seul moyen qu’ont les personnes détenues de contrer les allégations qui découlent de symptômes relevant de handicaps psychosociaux mal interprétés est de fournir un dossier médical et un diagnostic officiel, ce qui peut les obliger à subir des examens psychiatriques.
Selon deux avocates, il arrive que, en l’absence de documents justificatifs, les autorités ne croient tout simplement aux handicaps psychosociaux des détenu·e·s[98]. De fait, selon une activiste basée à Montréal, « certains agents de l’ASFC et gardiens du CSI [centre de surveillance de l’immigration] voient dans la vulnérabilité [affective] des détenus une stratégie de manipulation pour obtenir une libération, éviter une expulsion ou bénéficier de plus de droits[99] ».
Le fait d’exiger des dossiers médicaux et des diagnostics officiels pose problème non seulement parce que cela peut conduire à des examens psychiatriques forcés, mais aussi parce que les autorités ne garantissent pas systématiquement aux personnes détenues la possibilité de consulter des professionnel·le·s susceptibles de mener les évaluations requises et de fournir les documents nécessaires. Selon des avocates de différentes régions du pays, il est extrêmement difficile, voire impossible, d’obtenir un examen psychiatrique des personnes détenues, en particulier si elles sont incarcérées dans une prison provinciale, et les autorités ne font généralement rien pour faciliter cette démarche[100]. Une psychiatre a décrit les différents obstacles à la réalisation de tels examens psychiatriques, allant des confinements imposés aux détenu·e·s par manque de personnel aux emplois du temps stricts des prisons en passant par l’impossibilité de rencontrer les personnes détenues autrement qu’à travers une vitre en plexiglas et sans aucune intimité, et les problèmes logistiques d’accès aux prisons provinciales distantes et isolées[101]. Dans ces conditions, il est souvent extrêmement difficile de mener un entretien satisfaisant à des fins d’évaluation psychiatrique.
Les personnes détenues qui le souhaitent doivent pouvoir bénéficier d’examens psychiatriques, mais les autorités doivent aussi donner du poids, dans leurs décisions relatives à la détention, aux observations non médicales réalisées par des pairs, des prestataires de services et des avocat·e·s, et prévoir des aménagements procéduraux pour que les personnes détenues puissent participer à la procédure au même titre que quiconque, ainsi que des aménagements raisonnables dans les autres lieux.
Des détenu·e·s empêché·e·s de prendre des décisions en toute indépendance
Lorsqu’un handicap psychosocial a été diagnostiqué ou est soupçonné chez une personne détenue, le tribunal peut décider qu’elle n’est « pas en mesure … de comprendre la nature de la procédure[102] ». Dans ce cas, il nomme, généralement à partir d’une liste de contractuel·le·s, un·e représentant·e désigné·e de son choix, qu’il rémunère pour « représenter » la personne détenue[103]. Les Commentaires du tribunal sur les Règles de la Section de l’immigration relatives aux représentants désignés qualifient de « personne incompétente » une personne qui « n’est pas en mesure de comprendre la nature de la procédure », tout en indiquant que ces personnes « peuvent aussi être aptes à participer aux décisions, selon le type de décision à prendre et selon la nature et la gravité de leur trouble ou de leur incapacité[104] ». Les représentant·e·s désigné·e·s ont de vastes pouvoirs, et doivent notamment :
- décider s’il y a lieu de retenir les services d’un conseil et, le cas échéant, donner à celui-ci des directives, ou aider la personne représentée à donner des directives à son conseil ;
- prendre des décisions concernant l’affaire, ou aider la personne représentée à prendre ces décisions ;
- protéger les intérêts de la personne représentée et présenter les meilleurs arguments possibles devant le tribunal[105].
Un audit externe réalisé en 2018 à la demande du président de la CISR a relevé des incohérences dans les rôles assignés aux représentant·e·s désigné·e·s lors des audiences[106]. Dans au moins une audience, la vérificatrice a observé que « la personne détenue n’[avait] pas été autorisée à formuler des observations au motif que son représentant désigné parlait en son nom[107] ».
La vérificatrice a aussi décrit le cas d’un migrant qui a été incarcéré de 2012 à 2016 et qui « a subi un effondrement mental complet après 16 mois de détention » lorsque sa demande de résidence permanente a été rejetée[108]. La vérificatrice a souligné que, pendant les trois années suivantes de sa détention, cet homme avait « cessé de parler et [était] devenu insensible à toute interaction ». Il a fait l’objet d’un diagnostic de catatonie[109]. Pendant cette période, des audiences de contrôles des motifs de détention se sont tenues tous les 30 jours et le tribunal a qualifié à maintes reprises son comportement de « non coopératif », concluant qu’il « nui[sai]t de façon très extrême au processus de renvoi », qu’il « ne [voulait] pas participer », et qu’il avait « choisi de ne pas participer au contrôle des motifs de détention[110] ». Le tribunal a nommé un représentant désigné, qui a assisté à 23 audiences de contrôle des motifs de détention, mais qui a signalé qu’il « n’avait été en mesure à aucun moment de communiquer avec le détenu[111] ». La vérificatrice a par ailleurs observé :
À chaque contrôle des motifs de détention, le représentant désigné a seulement déclaré qu’il n’avait aucune solution de rechange à la détention à offrir. Les contrôles des motifs de détention durent moins de cinq minutes. Le représentant désigné ne soutient à aucun moment que le détenu ne constitue plus un danger pour le public ou un risque de fuite parce qu’il est immobile, passif et non verbal.
La présence du représentant désigné semblait donner l’assurance aux commissaires de la SI [Section de l’immigration] que tout était en ordre, mais, pendant ce temps, le détenu n’avait jamais parlé au représentant désigné et était détenu dans un état catatonique, sans ses médicaments et sans traitement approprié. La seule fois où il a été amené dans la salle vidéo pour un contrôle des motifs de détention, il ne semblait pas conscient de son environnement et avait simplement posé la tête sur la table[112].
La vérificatrice a recommandé que le tribunal élabore « des lignes directrices plus strictes sur le rôle et les responsabilités des représentants désignés » et que « soit mis en place un processus de contrôle de la qualité des conseils et du soutien offerts par les représentants désignés[113] ».
Le système des représentant·e·s désigné·e·s risque de bafouer les droits des personnes migrantes détenues ayant un handicap psychosocial à une procédure régulière et à la capacité juridique – ou leur droit de prendre leurs propres décisions. Plutôt que de se contenter d’aider ces personnes à prendre des décisions concernant leurs affaires juridiques, les représentant·e·s désigné·e·s ont le pouvoir de prendre des décisions à leur place.
Le droit international et régional relatif aux droits humains interdit expressément la discrimination et impose aux États parties de prendre des mesures pour éliminer toutes les formes de discrimination, y compris à l’égard des personnes en situation de handicap[114]. La non-discrimination est aussi l’un des principes fondamentaux de la Convention relative aux droits des personnes handicapées (CDPH)[115]. Celle-ci dispose que « toutes les personnes sont égales devant la loi et en vertu de celle-ci et ont droit sans discrimination à l’égale protection et à l’égal bénéfice de la loi[116] ». Elle impose également aux États de prendre toutes les mesures appropriées pour faire en sorte que des aménagements raisonnables et procéduraux soient apportés[117], y compris dans des situations de privation de liberté, que ce soit en prison ou dans d’autres lieux de détention officiels[118]. L’article 14(1) de la CDPH dispose qu’« en aucun cas l’existence d’un handicap ne justifie une privation de liberté[119] ». Le Comité des droits des personnes handicapées, organe indépendant créé par la CDPH pour superviser sa mise en œuvre, a par ailleurs déclaré que les décisions concernant la détention de personnes migrantes devaient prendre en considération ses effets sur l’état de santé mentale et que les États devraient mettre en place des services appropriés d’aide sociale communautaires à l’intention des personnes présentant un handicap psychosocial[120].
En vertu de la CDPH, les personnes en situation de handicap ont le droit d’être reconnues en tous lieux comme des personnes à part entière devant la loi[121], ce qui implique qu’elles « jouissent de la capacité juridique dans tous les domaines, sur la base de l’égalité avec les autres[122] ». La Convention rejette la présomption selon laquelle les personnes handicapées n’ont pas la capacité d’agir et affirme clairement que leurs volontés et préférences doivent être respectées. Le Comité des droits des personnes handicapées, organe d’expert·e·s indépendant créé par la CDPH pour superviser sa mise en œuvre, reconnaît que la capacité mentale d’une personne et sa capacité à prendre des décisions peuvent varier en fonction de facteurs environnementaux ou sociaux, mais souligne que la capacité juridique « est un attribut universel inhérent à la personne humaine » dont personne ne peut être privé[123].
L’article 12(3) de la CDPH demande aux États parties de prendre « des mesures appropriées pour donner aux personnes handicapées accès à l’accompagnement dont elles peuvent avoir besoin pour exercer leur capacité juridique[124] ». Dans son interprétation des dispositions de la Convention, le Comité de la CDPH déclare : « À tout moment, y compris dans les situations de crise, l’autonomie individuelle des personnes handicapées et leur capacité de décision doivent être respectées[125]. » À cette fin, la CDPH impose aux États d’aider les personnes handicapées à exercer leur capacité juridique[126], par le biais d’un système appelé la « prise de décisions assistée ». Le Comité des droits des personnes handicapée précise, de façon cruciale, que « l’accompagnement dans l’exercice de la capacité juridique … ne devrait jamais équivaloir à une prise de décisions substitutive[127] ».
Le Canada a ratifié la CDPH mais a fait une déclaration interprétative et une réserve à propos de l’article 12 :
Le Canada reconnaît que les personnes handicapées sont présumées avoir la capacité juridique dans tous les aspects de leur vie, sur la base de l’égalité avec les autres. Le Canada comprend que l’article 12 permet des mesures d’accompagnement et de représentation relatives à l’exercice de la capacité juridique dans des circonstances appropriées et conformément à la loi.
Dans la mesure où l’article 12 peut être interprété comme imposant l’élimination de toutes mesures de représentation relatives à l’exercice de la capacité juridique, le Canada se réserve le droit de continuer l’utilisation de telles mesures dans des circonstances appropriées et sujet à ce qu’elles soient assorties de garanties appropriées et effectives[128].
Selon plusieurs juristes, étant donné que la CDPH a pour mission d’affirmer l’indépendance, l’égalité et la participation maximales des personnes handicapées dans la société, la réserve du Canada sur la capacité juridique des personnes en situation de handicap psychosocial « entrave sévèrement l’objet et le but de la Convention »[129].
Les audiences de contrôle des motifs de détention auxquelles les détenu·e·s présentant un handicap psychosocial ne peuvent pas participer de façon satisfaisante ne devraient pas se tenir après la simple nomination de représentant·e·s désigné·e·s pour « représenter[130] » les personnes en question et prendre les décisions à leur place. Ces procédures sont contraires aux droits des personnes détenues car elles portent atteinte à leurs droits à une procédure régulière et à la capacité juridique. Le fait que le Canada n’offre pas d’aménagements procéduraux aux migrant·e·s détenu·e·s qui présentent des handicaps psychosociaux constitue une violation de la CDPH[131]. Lorsque ces personnes ne peuvent pas exercer leur capacité juridique par le biais de la prise de décisions assistée ni bénéficier d’audiences respectueuses de la régularité de la procédure, elles doivent être libérées et recevoir l’aide dont elles ont besoin en dehors de la détention. Comme indiqué plus haut, selon le Groupe de travail des Nations Unies sur la détention arbitraire, les personnes migrantes en situation de handicap ne devraient pas être placées en détention[132].
Plusieurs personnes interrogées pour ce rapport ont aussi qualifié d’ambigu et inefficace le système des représentant·e·s désigné·e·s. Une représentante désignée a ainsi indiqué avoir été « confrontée aux limites éthiques et aux frontières mal définies de [son] rôle de représentante désignée[133] ». Une autre représentante désignée a fait remarquer : « Il ne semble y avoir nulle part de bonne réponse pour les gens qui ont des problèmes de santé mentale en détention.… Il est parfois difficile de savoir comme se rendre utile[134]. » Deux avocat·e·s et un activiste ont également fait part d’inquiétudes similaires sur l’inefficacité du système des représentant·e·s désigné·e·s[135].
Du fait de l’ampleur de leurs responsabilités, les représentant·e·s désigné·e·s ont aussi du mal à expliquer leur rôle aux personnes détenues. Une représentante désignée a ainsi expliqué que certaines personnes détenues pensaient qu’elle était une fonctionnaire de l’État, en conséquence de quoi il lui était difficile d’établir de la confiance et de bonnes relations[136]. Quand les personnes sont détenues dans des prisons provinciales, il est encore plus difficile pour les représentant·e·s désigné·e·s d’entrer en contact avec elles car il faut passer par les gardiens pour organiser une conversation téléphonique[137]. Une représentante désignée a indiqué : « Il est presque impossible pour [les détenu·e·s] de savoir qui je suis et comment je peux aider. Je ne suis qu’une voix de plus au téléphone[138]. »
Malgré leurs immenses responsabilités, les représentant·e·s désigné·e·s ne reçoivent pas de véritable formation ou soutien. Une représentante désignée a déclaré avoir été « choquée et horrifiée par la formation [qu’elle a] reçue[139]. » Cette formation, d’une durée approximative d’une à deux heures, a comporté une présentation des « bases du droit » et une information limitée sur les ressources communautaires, mais rien sur les handicaps psychosociaux[140]. En particulier, elle ne contenait « rien de substantiel sur la manière de travailler avec des personnes ayant de graves problèmes de santé mentale » ni sur « ce que cela signifie d’agir dans l’intérêt supérieur des personnes lorsqu’on vous donne des orientations contraires à ce que vous pensez être le mieux pour elles[141]. »
Des mesures coercitives en réponse aux handicaps
Nous n’avons rien à faire en prison.… Nous ne méritons pas de vivre ainsi. Ils devraient nous laisser en liberté et au moins nous permettre de sortir respirer un peu d’air frais, afin que nous ayons l’impression d’être humains.… J’ai commencé à prendre des antidépresseurs en détention et j’en prends encore parfois. Ces médicaments m’assomment.
— « Ken », migrant ayant été incarcéré dans une prison provinciale de l’Ontario de 2013 à 2017
Plusieurs avocat·e·s ont dit aux chercheur·euse·s avoir constaté que, lorsque les services de l’immigration reconnaissaient un handicap psychosocial chez une personne détenue, ils y voyaient souvent un facteur de risque et réagissaient par des mesures coercitives[142]. Le manuel d’exécution de la loi de l’ASFC indique aux agent·e·s que le « comportement instable » d’une personne, associé à « un déséquilibre mental », constaté lors d’un entretien « peut constituer un indicateur important quant à l’évaluation du danger et laisser supposer que la personne pourrait devenir violente[143]. »
Ces pratiques s’apparentent à de la discrimination à l’égard des personnes en situation de handicap psychosocial. Selon le Haut-Commissariat aux droits de l’homme des Nations Unies, la jurisprudence du Comité de la CDPH établit clairement que le fait d’être porteur d’un handicap réel ou supposé ne doit jamais constituer un motif de privation de liberté : « Il est contraire à l’article 14 de permettre le placement en détention de personnes handicapées au motif qu’elles risquent de présenter un danger pour elles-mêmes ou pour autrui. La détention non volontaire de personnes handicapées fondée sur un risque ou une dangerosité présumés liés au handicap est contraire au droit à la liberté[144]. »
Selon sept avocat·e·s interrogé e·s pour ce rapport, dans les procédures judiciaires, les agent·e·s de l’ASFC utilisent les handicaps psychosociaux comme argument contre les personnes détenues, affirmant que leur état les rend « peu fiables », « trompeuses », « indignes de confiance », « incontrôlables » ou « incapables de se conformer aux conditions qui leur sont imposées[145] ». Dans certains cas, ont-ils dit, des agent·e·s ont aussi affirmé que des détenu·e·s en situation de handicap psychosocial présentaient un risque de fuite car on ne pouvait pas compter sur eux pour se présenter en vue de leur expulsion ou à une audience[146]. Une avocate de Toronto a raconté qu’une de ses clientes avaient été maintenue en détention car le tribunal avait conclu qu’elle « serait mieux [en détention] » étant donné qu’« elle allait clairement mal et qu’elle ne serait pas capable de se conformer aux conditions de sa libération[147] ».
Selon cinq avocat·e·s et une activiste représentant des personnes en détention dans différentes régions du Canada, lorsque les détenu·e·s présentent ou signalent des symptômes révélant une tendance suicidaire ou indiquent souffrir de tels symptômes, les agent·e·s de l’ASFC ont tendance à considérer, dans les audiences de contrôle des motifs de détention, que cela justifie leur maintien en détention, où il sera possible de les empêcher de se faire du mal ou de se suicider[148]. Une avocate a affirmé : « Je conseille à mes clients d’éviter de dire à l’ASFC qu’ils ont des idées suicidaires car j’ai peur que ce ne soit utilisé contre eux[149]. »
L’ASFC utilise la détérioration de la santé mentale des personnes migrantes comme argument non seulement pour les maintenir en détention, mais aussi pour justifier leur arrestation. Une activiste qui aide depuis plus de 15 ans des migrant·e·s incarcéré·e·s a constaté que, lorsqu’une date d’expulsion était annoncée aux gens durant un entretien avec l’ASFC, les fonctionnaires pouvaient leur demander si la perspective d’une expulsion les inquiétait ou les déprimait ; des personnes ont, selon elle, été placées en détention et sous surveillance pour risque de suicide parce qu’elles avaient simplement paniqué ou exprimé leur peur d’être expulsées[150]. De fait, « une crise provoquée par l’annonce d’une date d’expulsion [peut être] utilisée pour justifier la détention », a déclaré cette activiste[151].
Placement dans une prison provinciale plutôt que dans un centre de surveillance de l’immigration
Je ne faisais qu’attendre et prier, j’essayais de me convaincre que la situation n’était pas si grave. Je me disais qu’ils ne pourraient pas me laisser ici.… Je ne me sentais pas comme un être humain dans cette prison : je me sentais comme un chien. Les gardiens ouvraient la porte uniquement pour me nourrir.
— « Joseph », migrant ayant été détenu dans une prison de l’Ontario en 2020
En février 2021, lors d’un entretien avec les chercheur·euse·s de Human Rights Watch et Amnistie internationale, des agent·e·s de l’ASFC ont indiqué que les personnes présentant un handicap psychosocial étaient parfois placées dans des prisons provinciales afin qu’il soit possible de « les gérer efficacement au vu de leur comportement » ou pour faciliter « l’accès à des soins spécialisés[152] ». Or, les soins de santé mentale font cruellement défaut dans les prisons provinciales et ont fait l’objet de récents rapports du Comité consultatif d’experts sur la transformation des soins de santé dans les établissements correctionnels de l’Ontario, du conseiller indépendant pour les services correctionnels de l’Ontario, et de la Commission ontarienne des droits de la personne[153]. Un rapport publié en 2019 par la vérificatrice générale de l’Ontario a conclu : « Les établissements correctionnels n’ont pas été aménagés pour fournir des soins adéquats au pourcentage croissant de détenus pouvant avoir un problème de santé mentale[154]. »
La cour supérieure de l’Ontario a aussi critiqué les traitements infligés aux personnes migrantes détenues dans des prisons provinciales. Dans l’affaire d’Ebrahim Touré, un homme en situation de handicap psychosocial incarcéré pour risque de fuite pendant plus de cinq ans (de 2013 à 2018), la cour a conclu que sa détention s’apparentait à « un traitement cruel et inhabituel », en violation de la Charte canadienne des droits et libertés, et que cette affaire révélait « un manquement institutionnel inexcusable des autorités fédérales à leur obligation de protéger les intérêts des personnes placées sous sa responsabilité et son contrôle[155] ». Dans l’affaire de Kashif Ali, un homme détenu pendant sept ans de 2010 à 2017, la cour a estimé que l’un des facteurs qui rendait sa détention illégale était le fait qu’il ne pouvait pas bénéficier de soins médicaux dans la prison provinciale : « Des éléments attestent que M. Ali a développé des problèmes de santé, tant physique que mentale, qui ne seront pas correctement pris en charge tant qu’il restera dans un établissement de détention provincial[156]. »
Trois avocat·e·s ont constaté que leurs client·e·s détenu·e·s dans des prisons provinciales avaient tendance à développer de graves symptômes relevant de handicaps psychosociaux[157]. Une avocate a déclaré : « La prison n’est pas l’endroit où aller pour obtenir des soins de santé mentale[158]. » Un autre a souligné : « La prison n’est pas un lieu adapté pour quelqu’un qui est activement suicidaire[159]. » Dans les prisons provinciales, beaucoup de détenu·e·s exhibent des signes d’anxiété, de dépression et d’insomnie, perdent espoir et ont des pensées suicidaires[160].
Le manuel d’exécution de la loi de l’ASFC indique que, même si un·e professionnel·le de santé recommande de ne pas transférer une personne dans une prison provinciale pour des raisons médicales, c’est aux responsables du centre de surveillance de l’immigration (qui sont des fonctionnaires de l’ASFC) que revient le pouvoir de prendre la décision finale sur le placement[161]. Deux représentant·e·s désigné·e·s de Toronto ont raconté qu’après avoir demandé pourquoi leurs client·e·s avaient été placé·e·s dans une prison provinciale plutôt que dans un centre de surveillance de l’immigration, des responsables de l’ASFC leur avaient répondu que le centre de surveillance de l’immigration (qui est géré par l’ASFC) avait refusé de les accueillir en raison de leur état de santé mentale[162]. Un avocat de Toronto a aussi constaté que certains de ses client·e·s qui exprimaient des pensées suicidaires au moment de leur arrestation étaient emmené·e·s directement dans une prison provinciale, et que d’autres qui avaient été placé·e·s initialement en centre de surveillance de l’immigration avaient été transféré·e·s dans une telle prison après avoir fait part de pensées suicidaires, « au motif que la prise en charge psychologique est soit disant meilleure en prison[163] ». De même, une avocate de Montréal a observé que les migrant·e·s détenu·e·s qui exprimaient des pensées suicidaires étaient transféré·e·s du centre de surveillance de l’immigration à une prison provinciale[164].
L’ASFC reconnaît qu’elle « exerce un contrôle limité sur les conditions de détention » dans les établissements provinciaux, ce qui « rend difficile l’application d’une norme commune de soins[165] ». À la demande des chercheur·euse·s qui voulaient savoir si l’ASFC restait responsable de la santé, de la sécurité et du bien-être des personnes migrantes détenues dans des prisons provinciales, des fonctionnaires de cette agence ont répondu : « En vertu d’accords avec les autorités correctionnelles provinciales, les détenus doivent pouvoir avoir bénéficier de soins médicaux de routine ou d’urgence quand ils sont incarcérés dans [une prison provinciale][166] ».
Selon le Groupe de travail des Nations Unies sur la détention arbitraire, les personnes migrantes « ne doivent pas être incarcérées dans des lieux tels que des postes de police, des maisons d’arrêt, des prisons ou d’autre établissements carcéraux car ceux-ci sont conçus pour les personnes qui ont affaire à la justice »[167]. Le Groupe de travail a également indiqué que « les migrants ne devaient pas être mélangés avec les autres détenus incarcérés pour des raisons pénales »[168]. Il a souligné que la détention liée à l’immigration « ne devait pas être punitive par nature » et que les « personnes migrantes ne devaient pas être considérées ou traitées comme des criminel·le·s, ni considérées uniquement sous l’angle de la sécurité nationale ou publique ni de la santé publique »[169].
Surmédication et manque de soutien en matière de santé mentale
Ils [le personnel médical de la prison] nous donnent des somnifères [des antidépresseurs] pour faire de nous des zombies. Il faut avoir une bonne vivacité d’esprit ici.… Il faut trouver comment éviter de devenir un zombie. Tout ce qu’ils veulent c’est nous donner des somnifères plutôt que d’écouter nos problèmes.[170]
— « Joseph », migrant ayant été détenu dans une prison provinciale de l’Ontario en 2020
Selon une psychiatre qui a travaillé avec des dizaines de personnes migrantes détenues et d’autres personnes incarcérées pour des raisons pénales, les soins de santé dans les prisons provinciales se limitent généralement à des aides pharmacologiques fournies par des médecins. Le soutien psychothérapeutique et les autres soins de santé mentale et aides psychologiques sont rares[171]. Un ancien détenu a souligné : « Ils préfèrent vous donner [des médicaments] que de mettre en place un soutien psychologique ou vous demander ce qui vous arrive réellement et pourquoi vous vous sentez ainsi[172]. » Selon trois anciens détenus et deux avocates, au lieu d’adapter les prescriptions aux besoins des détenu·e·s, les médecins des prisons provinciales se contentent souvent de leur prescrire des antidépresseurs[173].
« Joseph », Africain arrivé au Canada quand il était encore lycéen, avec un visa d’études qu’il a prolongé à son entrée à l’université, a fait part de son expérience aux chercheur·euse·s[174]. Il a expliqué avoir abandonné ses études quand il n’a plus pu payer les frais d’inscription et que son visa étudiant a expiré, quelques mois après le début de la pandémie de Covid-19. Au moment de son arrestation, il vivait au Canada depuis environ sept ans et son épouse canadienne était en train de boucler son dossier de parrainage d’un conjoint. Il a raconté que, pendant sa détention dans une prison provinciale à sécurité maximale de l’Ontario, il avait demandé au médecin de la prison du NyQuil (un médicament destiné à soulager les symptômes du rhume et de la grippe) car il n’arrivait pas à dormir. « Le sommeil est l’une des meilleurs choses [pour supporter] la prison – c’est le seul moyen de passer au jour suivant », a-t-il déclaré aux chercheur·euse·s. « Quand je n’arrivais pas dormir, je restais là à ruminer mes pensées[175]. » Le médecin de la prison lui a prescrit de la trazodone, un antidépresseur, sans lui dire ce que c’était ni lui expliquer les éventuels effets secondaires[176]. Joseph a cru qu’il s’agissait d’un somnifère. Il n’a pas eu d’autre rendez-vous avec le médecin et n’a appris que ce médicament était un antidépresseur qu’à sa sortie de prison[177].
Un autre migrant ayant été détenu dans une prison provinciale de l’Ontario pendant trois ans a indiqué avoir refusé de prendre les antidépresseurs prescrits par les médecins par crainte de devenir dépendant : « Mon seul exutoire était les séances de guérison traditionnelle autochtone : elles m’ont aidé à tenir le coup. Il n’y avait pas d’autre choix[178]. »
Une avocate et activiste de Toronto a indiqué que les personnes migrantes détenues dans des prisons provinciales se voyaient souvent prescrire trop de médicaments, l’objectif étant de les rendre plus « lucides et calmes », mais que les causes profondes de leur détresse et de leurs symptômes psychosociaux étaient ignorées[179].
En 2016, la commissaire en chef de la Commission ontarienne des droits de la personne s’est inquiétée « du fait que les services … étant fournis [aux personnes migrantes détenues dans des prisons provinciales de l’Ontario] ne tiennent pas compte des obligations du ministère de la Sécurité communautaire et des Services correctionnels (MSCSC) aux termes du Code [des droits de la personne de l’Ontario][180] ». Elle a en particulier déploré que ces personnes « n’aient pas accès à des traitements et services de soutien appropriés en matière de santé mentale[181] ».
Selon une psychologue et universitaire dont les recherches portent en grande partie sur les conséquences de la détention sur les personnes migrantes, les états de santé mentale comme la dépression, le stress post-traumatique et l’anxiété ne peuvent pas être traités tant que les gens sont maintenus dans une situation où les préjudices perdurent : « Si l’ASFC se préoccupe vraiment de la santé mentale des personnes détenues, elle doit commencer par les sortir de l’environnement néfaste dans lequel elles se trouvent[182]. »
Le Canada est partie au Pacte international relatif aux droits civils et politiques (PIDCP), qui impose aux États de respecter le droit à la vie et le droit d’être traité avec humanité[183]. Le Comité des droits de l’homme des Nations Unies, organisme d’experts indépendant qui interprète le PIDCP, a déclaré que les États avaient :
un devoir accru de prendre toutes les mesures qui s’imposent raisonnablement pour protéger la vie des personnes privées de liberté par l’État, étant donné que lorsqu’ils arrêtent, détiennent ou emprisonnent une personne ou la privent de liberté d’une autre manière, les États parties ont la responsabilité de prendre soin de sa vie et de veiller à son intégrité physique, et qu’ils ne sauraient invoquer le manque de ressources financières ou d’autres problèmes logistiques pour atténuer cette responsabilité.… L’obligation de protéger la vie de toutes les personnes détenues comprend celle de leur assurer les soins médicaux nécessaires et de surveiller leur santé régulièrement et de façon appropriée[184].
L’absence de soins médicaux appropriés peut aussi constituer une violation de l’interdiction des traitements cruels, inhumains ou dégradants figurant dans la Convention contre la torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants, à laquelle le Canada est partie[185]. Le droit international relatif aux droits humains protège également le droit de toute personne au meilleur état de santé susceptible d’être atteint[186]. Les États ont l’obligation d’offrir des soins médicaux satisfaisants, y compris des services préventifs, à toutes les personnes qui sont en détention. Ils n’ont pas le droit de refuser ou d’amoindrir l’égalité d’accès de toutes les personnes aux soins de santé, y compris des détenu·e·s[187]. L’Ensemble de règles minima des Nations Unies pour le traitement des détenus (ou « Règles Nelson Mandela »), dispose que :
L’État a la responsabilité d’assurer des soins de santé aux détenus, ceux-ci devant recevoir des soins de même qualité que ceux disponibles dans la société et avoir accès aux services nécessaires sans frais et sans discrimination fondée sur leur statut juridique[188].
Absence d’aménagements raisonnables
Les personnes en situation de handicap physique ou sensoriel détenues pour des raisons liées à l’immigration se heurtent aussi à de graves obstacles dans les prisons provinciales. Human Rights Watch et Amnistie internationale ont interrogé Abdelrahman Elmady, Égyptien avec un handicap auditif de 38 ans, qui a déposé une demande d’asile à son arrivée à Vancouver en 2017[189]. L’ASFC l’a arrêté à l’aéroport et a saisi ses effets personnels, y compris la pile rechargeable de son appareil auditif[190]. Abdelrahman Elmady a été incarcéré pendant environ deux mois dans trois prisons provinciales différentes – à la prison de Vancouver, au centre correctionnel régional de Fraser et au centre correctionnel régional de Fraser Nord – et a passé plusieurs semaines à l’isolement cellulaire[191]. Il devait passer par les agent·e·s de l’ASFC pour obtenir des piles pour son appareil auditif, mais celles-ci ne duraient que 10 heures[192]. Il a raconté aux chercheur·euse·s que les agent·e·s de l’ASFC ne lui donnaient qu’une pile à la fois, et seulement lors des entretiens ou des audiences de contrôle des motifs de détention[193]. Par conséquent, Abdelrahman Elmady a passé la majeure partie de sa détention dans un silence complet :
En prison, je n’entendais rien. J’ai envoyé des demandes [aux autorités carcérales] mais elles ont répondu qu’elles n’avaient pas les moyens de me fournir des piles.… J’essayais d’économiser la pile au maximum. J’éteignais mon appareil afin de le garder pour les situations très importantes.…
Pendant les trois premiers jours [de ma détention], j’ai demandé à appeler ma famille et ils m’ont donné un téléphone. J’ai dit à ma femme : « Ne t’inquiète pas pour moi. » Ensuite, je n’ai plus pu contacter ma famille pendant tout le reste de ma détention. Personne n’avait de nouvelles de moi. Je ne savais pas quoi faire. Je voulais parler à ma famille mais je n’avais pas de pile [dans mon appareil auditif]….
Quand j’ai enfin eu une pile, j’étais tellement content, je n’y croyais pas. J’avais l’impression de revivre[194].
Une avocate exerçant dans l’Ontario a elle aussi raconté l’exemple d’un de ses clients qui était malentendant et dont l’appareil auditif avait été endommagé lors de son arrestation[195]. Cet homme est resté en détention sans appareil auditif durant au moins deux mois, pendant la pandémie de Covid-19 : « Il était hyper-vigilant et inquiet…. Il ne pouvait pas savoir qui toussait autour de lui[196]. »
En vertu de la CDPH, les États sont tenus d’interdire toute discrimination fondée sur le handicap, de garantir aux personnes handicapées une égale et effective protection juridique contre toute discrimination, quel qu’en soit le fondement, et de prendre toutes les mesures appropriées pour que des aménagements raisonnables soient apportés[197]. Dans les deux cas évoqués ci-dessus, en ne proposant pas d’aménagements raisonnables à des migrants handicapés qui étaient en détention, le Canada a violé la CDPH[198].
Détention à l’isolement
Non seulement l’ASFC invoque les handicaps psychosociaux ou les pensées suicidaires des migrant·e·s pour justifier leur détention et leur placement dans des prisons provinciales plutôt que dans des centres de surveillance de l’immigration, mais en plus elle les soumet aussi parfois à l’isolement cellulaire. Les Règles Nelson Mandela définissent la détention à l’isolement comme étant « l’isolement d’un détenu pendant 22 heures par jour ou plus, sans contact humain significatif[199] ». Elles interdisent cette pratique, ainsi que l’isolement cellulaire prolongé (plus de 15 jours consécutifs)[200]. Selon le rapporteur spécial des Nations Unies sur la torture, « toute imposition de l’isolement cellulaire au-delà d’une durée de 15 jours constitue un acte de torture ou une peine ou un traitement cruel, inhumain ou dégradant, selon les circonstances[201]. » Le rapporteur spécial a également constaté que l’état des détenu·e·s présentant un handicap psychosocial « empir[ait] de façon dramatique en cas d’isolement » et que la détention à l’isolement « entraîn[ait] souvent une sévère aggravation du trouble mental préexistant[202]. » Il a par ailleurs insisté sur le fait qu’il était « interdit de mettre à l’isolement, pour quelque durée que ce soit … des handicapés physiques ou mentaux[203] ».
Au Canada, les autorités pénitentiaires provinciales placent souvent à l’isolement les personnes qui présentent des handicaps psychosociaux ou qui expriment des pensées suicidaires. Une étude indépendante sur le traitement des personnes en situation de handicap psychosocial dans les prisons provinciales de l’Ontario – y compris les personnes inculpées ou condamnées pour des raisons pénales – a conclu : « l’isolement prolongé (15 jours ou plus) demeure une pratique courante pour les personnes ayant une désignation de problèmes de santé mentale ou de risque de suicide à leur dossier[204] ». Elle a aussi constaté « des pratiques d’isolement discriminatoires » à l’encontre des personnes ayant un handicap psychosocial et a exprimé sa crainte que « certaines … catégories de soins spécialisés ne constituent qu’une autre forme d’isolement », car la province « n’a pas encore établi de paramètres clairs pour les soins spécialisés dépassant le seuil des deux heures qui marque le passage vers l’isolement[205]. » Toujours selon cette étude, les données fournies par le gouvernement de l’Ontario au sujet des personnes détenues dans les prisons de la province entre juillet 2018 et juin 2019 montrent que les personnes placées à l’isolement de manière répétée ou pour des périodes prolongées présentaient un taux bien plus élevé de désignation de problèmes de santé mentale et/ou de risques de suicide avant leur placement à l’isolement que la population carcérale en général :
- Au total, 46 % des personnes placées à l’isolement au moins une fois faisaient l’objet d’une désignation de problèmes de santé mentale dans leur dossier, contre 30 % de la population carcérale totale (incluant les personnes ayant été placées à l’isolement) ;
- Au total, 36 % des personnes ayant connu l’isolement avaient un signalement de risque de suicide dans leur dossier avant leur placement à l’isolement, contre 21 % de la population carcérale totale (incluant là aussi les personnes ayant été placées à l’isolement)[206].
Durant cette période, un cinquième des personnes migrantes détenues dans des prisons provinciales de l’Ontario – 174 sur 853 – ont été placées à l’isolement au moins une fois, selon les données du gouvernement provincial[207]. Parmi ces placements à l’isolement, 40 % concernaient des migrant·e·s faisant l’objet d’une désignation de problèmes de santé mentale et/ou de risque de suicide, et 14 % ont duré 15 jours ou plus[208].
De même, durant l’exercice 2019-2020, parmi les 1 066 migrant·e·s détenu·e·s dans des prisons provinciales de l’Ontario, 17 % (176 détenu·e·s) ont été placé·e·s à l’isolement cellulaire au moins une fois[209]. Cette année-là, 46 % des placements en question concernaient des personnes faisant l’objet d’une désignation de problèmes de santé mentale et/ou de risque de suicide, et 13 % ont duré 15 jours ou plus[210].
Près de la moitié (45 %) des personnes migrantes placées à l’isolement cellulaire pendant 15 jours ou plus faisaient l’objet d’une désignation de problèmes de santé mentale et/ou de risque de suicide[211]. Pour les personnes détenues à l’isolement cellulaire pendant de plus longues périodes, ce pourcentage était encore plus élevé : 77 % de celles maintenues à l’isolement cellulaire pendant 30 à 90 jours, et 100 % de celles maintenues à l’isolement cellulaire pendant 90 jours ou plus[212].
Les avocat·e·s qui travaillent avec des personnes détenues pour des raisons liées à l’immigration critiquent la pratique de l’isolement cellulaire. Selon une avocate, cette pratique revient à « empêcher physiquement les détenu·e·s de se faire du mal, mais sans s’attaquer aux causes de leurs pensées suicidaires[213] ». Les personnes détenues qui sont soupçonnées d’avoir des pensées suicidaires sont privées de leur intimité et soumises à une surveillance plus invasive afin de les empêcher de se faire du mal[214]. Trois migrants ayant été soumis à la détention ont raconté avoir vu les autorités utiliser l’isolement cellulaire en réponse à l’expression de pensées suicidaires par des détenu·e·s[215].
« Joseph », un autre migrant ayant connu la détention, a raconté l’examen destiné à évaluer sa santé mentale que lui a fait subir un agent de l’ASFC lors de son arrestation à Toronto, et à la suite duquel il a été placé sous surveillance 24 heures sur 24 pour risque de suicide :
Ce que je ne peux pas oublier, c’est cet agent [de l’ASFC] qui me demandait : « Avez-vous des pensées suicidaires en ce moment ? » Il se moquait de moi avec deux autres agents. Je restais sans réponse simplement car tout cela me heurtait au plus profond de moi-même. J’étais malade, aussi.… Je ne faisais que penser : « Est-ce que tout ça est vraiment en train d’arriver ? » Puis l’agent est devenu fou et a dit : « OK, ce gars ne parle pas, amenez-le à l’infirmière. » Ils n’en avaient rien à faire. J’étais menotté … Je ne pouvais pas dire : « Non, s’il vous plaît, ne me mettez pas en prison. » J’étais terrorisé et je ne comprenais pas ce qui se passait.…
J’ai dit à l’infirmière que j’avais été suicidaire par le passé mais que je m’en étais sorti…. Je ne voulais pas mentir à ces gens. Ensuite j’ai dû suivre le fonctionnaire. Ils m’ont déshabillé et m’ont mis sous surveillance pour risque de suicide. J’avais froid sur le lit métallique. J’ai demandé une couverture mais ils [les gardiens] ont dit : « Non, tu es sous surveillance pour risque de suicide. » Dès que je faisais un petit mouvement – même quand je ne faisais que me retourner sur le lit –, ils venaient et le notaient.… Dès que j’ai vu un psychiatre, mon isolement a été levé. Celui-ci m’a averti : « Faites attention à ce que vous dites. » … Après avoir été placé sous surveillance pour risque de suicide, je ne voulais dire à personne que je n’allais pas bien. Je me souviens de ce lit en métal – ce type de lit sert à poser les cadavres, c’est là qu’on vous met quand vous êtes mort[216]. »
La détention à l’isolement peut aussi être utilisée pour d’autres raisons. Un ancien détenu, « Usman », qui a fait une grève de la faim pendant 32 jours dans une prison provinciale de l’Ontario, a indiqué qu’il pensait avoir été placé à l’isolement « parce qu’ils ne voulaient pas que j’entraîne d’autres personnes [dans mon action][217] ». Un autre migrant, « Ken », qui a été détenu à deux reprises pour une durée totale d’environ cinq ans et placé à l’isolement dans une prison de l’Ontario, a raconté :
J’y suis resté deux semaines. Ils m’accusaient de donner du fil à retordre au gardien. [Il n’y a] pas de douches en isolement. Pas de lit. On dort par terre. Le sol était froid. On n’a pas le droit de sortir. Pas de téléphone. On est coincé là-dedans. Sans air frais. Avec un peu de chance, vous pouvez avoir une douche toutes les 72 heures, mais seulement s’il y a assez de personnel. La plupart des gens … en ressortent changés. Ils développent de la colère, de l’anxiété, du stress, une dépression. Ça vous ravage le cerveau. C’est de la torture[218].
Un avocat basé à Toronto a constaté que certain·e·s de ses client·e·s avaient été placé·e·s à l’isolement cellulaire pour leur propre protection : « Les conditions sont dangereuses en prison et ils [les migrant·e·s] ne parlent pas anglais ou se font harceler.… Mais quand ils sortent [de l’isolement], c’est comme s’ils avaient été torturés. Ils ne sont plus jamais les mêmes[219]. »
Les personnes migrantes incarcérées dans des centres de surveillance de l’immigration peuvent aussi être placées à l’isolement cellulaire. L’ASFC indique disposer d’« un secteur résidentiel qui peut être adapté avec des pièces qui peuvent être utilisées si un détenu doit faire l’objet d’une observation individuelle, s’il demande une telle évaluation, ou si un placement dans les autres secteurs résidentiels n’est pas dans l’intérêt supérieur du détenu ou des autres détenus de l’établissement[220]. » « Daryan », qui a été détenu dans un centre de surveillance de l’immigration, a raconté que l’ASFC avait menacé de le placer à l’isolement cellulaire car il refusait de manger[221].
Une activiste de Montréal a constaté que, dans les centres de surveillance de l’immigration, les personnes soupçonnées d’avoir des pensées suicidaires étaient souvent isolées, empêchées d’entrer en contact avec les autres détenu·e·s ou de se rendre dans la salle commune du centre, et placées sous la surveillance d’un gardien 24 heures sur 24[222]. L’ASFC a confirmé que les détenu·e·s qui s’automutilaient ou qui avaient des pensées suicidaires pouvaient être placé·e·s sous surveillance permanente pour risque de suicide[223]. Une ancienne détenue ayant été placée à l’isolement pendant environ 24 heures au centre de surveillance de l’immigration de Toronto a décrit une cellule froide, vide, et équipée d’un lit métallique, de toilettes et de caméras de surveillance :
Avec ces caméras tout autour de vous, vous n’avez aucune intimité, même pour aller aux toilettes.… Je devenais folle là-dedans. Je me souviens que j’avais un pantalon noir et que je triturais le tissu juste pour passer le temps. Je ne savais pas quoi faire.… Vous entendez juste les gardiens venir vous regarder, puis repartir. Quand vous demandez à parler à quelqu’un, on ne vous écoute pas. Ils n’en ont rien à faire de vous.… Dès que voulez quelque chose, vous devez demander aux gardiens – ce sont eux qui décident ce à quoi vous avez droit.…
J’ai commencé à me sentir mal, alors ils ont appelé l’infirmière. J’allais mal à cause du stress et de toute cette pression. J’ai eu l’impression que mon cœur s’arrêtait, je ne savais pas ce qui se passait. Tout est devenu noir. Je l’ai dit à l’infirmière mais elle m’a juste donné du Tylenol [paracétamol].… Elle m’a dit : « Je n’ai pas le droit de vous parler[224]. »
Le placement à l’isolement cellulaire peut aussi empêcher les migrant·e·s qui sont en détention d’engager un·e avocat·e et de s’impliquer véritablement dans les démarches nécessaires pour s’emparer des voies légales leur permettant de rester dans le pays. Dans un cas particulièrement scandaleux, une représentante désignée a raconté que les autorités carcérales de la province de Terre-Neuve avaient refusé de donner un stylo à son client car il était détenu à l’isolement et que, pour cette raison, celui-ci avait dépassé la date limite pour remplir un formulaire destiné à empêcher son expulsion vers un pays en guerre[225].
Des mesures coercitives néfastes pour la santé mentale des personnes détenues
Les autorités en charge de l’immigration soumettent les personnes migrantes détenues à des mesures coercitives qui sont préjudiciables pour leur santé mentale, qu’elles soient ou non arrivées en détention avec un handicap psychosocial préexistant.
Utilisation des menottes
L’ASFC utilise régulièrement les menottes contre des personnes migrantes incarcérées[226]. Un document d’information de l’ASFC destiné aux personnes migrantes détenues indique que des agents « pourraient vous menotter si vous devez être transporté ou participer à des procédures se déroulant à l’extérieur des installations [de détention] » et que « les personnes avec un handicap, les personnes âgées, les enfants d’âge mineur et les femmes enceintes pourraient être dispensés de cette procédure[227] ».
Presque toutes les personnes migrantes ayant été détenues interrogées par les chercheur·euse·s ont décrit le fait d’avoir été menottées comme une expérience traumatisante et profondément humiliante. « Michelle », qui a fui un pays d’Afrique pour demander l’asile et a été arrêtée à son arrivée à l’aéroport de Toronto en 2019, a raconté avoir été menottée alors que cela se voyait qu’elle était enceinte. Elle se souvient du traumatisme qu’elle a ressenti : « Être ainsi manipulée par des hommes [des agents de l’ASFC] et traitée comme une criminelle, ça a ouvert de nombreuses blessures[228]. » Une autre femme, arrivée à l’âge de sept ans avec ses parents et ses frères et sœurs pour demander l’asile après avoir fui l’Afghanistan, se souvient que sa famille a été arrêtée à son entrée au Canada en 2007 : « Voir ma mère menottée avec mon petit frère, encore bébé, dans les bras, c’était tout simplement insupportable[229]. »
Les chercheur·euse·s ont aussi interrogé « Idriss », un Africain de 19 ans qui est arrivé au Canada en 2020 et a demandé l’asile en arrivant dans le pays. Il a été arrêté à l’aéroport et placé dans un centre de surveillance de l’immigration. Il a raconté le choc que cela avait été pour lui d’être menotté :
Ils m’ont laissé les menottes pendant tout le trajet entre l’aéroport et le CSI [centre de surveillance de l’immigration] de Laval. C’était la première fois de ma vie que j’étais menotté. Ça a été un grand choc pour moi. Je n’avais jamais imaginé que cela m’arriverait un jour. J’ai connu la guerre dans mon pays d’origine mais je n’avais jamais été menotté. Je leur ai demandé pourquoi ils faisaient ça, et l’un des agents m’a répondu : « Bienvenue en Amérique du Nord. » Je n’aurais jamais cru que le Canada ferait cela. Dans mon esprit, menotter quelqu’un qui n’a rien fait de mal n’arrive que dans les pays du tiers monde[230].
Un autre ancien détenu se souvent que des agents de l’ASFC lui ont annoncé qu’il serait menotté durant son expulsion : « Ils m’ont dit : “Nous avons déjà ton billet [d’avion]. Si tu es gentil avec nous, peut-être que nous t’enlèverons les menottes dans l’avion”. Je leur ai répondu : “Oui, s’il vous plaît, car je ne veux pas que les autres me regardent.” … C’est humiliant[231]. »
Plusieurs des personnes interrogées par les chercheur·euse·s, dont deux médecins, un avocat et une prestataire de services, ont confirmé que les agent·e·s de l’ASFC et des autorités carcérales provinciales utilisaient régulièrement les menottes contre les migrant·e·s incarcéré·e·s, même lors de rendez-vous médicaux[232].
Un migrant ayant été détenu dans un centre de surveillance de l’immigration se souvient avoir eu besoin de soins dentaires et avoir été contraint par les agent·e·s de l’ASFC de choisir entre aller à son rendez-vous chez le dentiste avec des menottes aux poignets et des fers aux pieds ou ne pas y aller du tout[233]. Il a choisi la deuxième option et a dû supporter la douleur jusqu’à sa libération plusieurs jours plus tard[234].
Les chercheur·euse·s ont aussi interrogé « Usman », Africain qui a fui son pays d’origine alors qu’il était enfant à cause de la guerre. Devenu adulte, il a été incarcéré dans une prison provinciale de l’Ontario pendant environ trois ans et demi tandis que l’ASFC tentait de l’expulser, alors que son pays d’origine ne le reconnaissait pas comme ressortissant. Usman se souvient avoir été conduit menotté à l’hôpital pendant sa détention :
Une fois, on m’a emmené à l’hôpital. J’avais des problèmes d’audition.… J’étais menotté et je me souviens avoir pris l’ascenseur avec l’agent de l’ASFC et des gardiens de prison. Dans l’ascenseur, il y avait un gamin – un petit garçon de trois ou quatre ans – avec son père. Quand nous sommes entrés dans l’ascenseur, il a été choqué. Il a demandé à son père : « Qu’est-ce qu’il a fait le monsieur ? »
Et je me souviens que je suis resté là sans rien dire, dans cet ascenseur… Son père n’a pas pu répondre car il ne comprenait pas la situation, mais il a probablement pensé que j’étais un genre de criminel, ou que j’avais tué quelqu’un. Qui sait ? … Au retour, au lieu de prendre le même ascenseur, [l’agent de l’ASFC] m’a fait passer par le monte-charge. Je lui ai demandé pourquoi nous passions par là et il a dit : « Loin des yeux, loin du cœur. » … Ça a été le moment le plus triste de ma vie[235].
Une prestataire de services de Montréal a raconté qu’une femme enceinte détenue au centre de surveillance de l’immigration de Laval avait été emmenée à l’hôpital et avait échappé aux menottes car elle était enceinte, mais elle avait fait une fausse-couche et avait été menottée dès le lendemain quand elle avait été conduite à un entretien avec l’ASFC[236].
Des détenu·e·s privé·e·s de contacts humains et coupé·e·s de leurs réseaux d’entraide
Selon une avocat·e et une psychiatre, les personnes détenues pour des raisons liées à l’immigration sont isolées et coupées de leurs réseaux d’entraide, de leur famille et de leurs proches[237]. Une avocate de Montréal constate que beaucoup de ses client·e·s détenu·e·s sont « en manque de lien humain et de bienveillance, et perdent espoir[238] ». C’est particulièrement le cas des personnes détenues dans des prisons provinciales, qui sont largement tributaires du téléphone pour leurs contacts avec le monde extérieur[239].
Selon le ministère du Solliciteur général de l’Ontario, « le téléphone est le moyen principal par lequel les détenus maintiennent un contact avec d’autres personnes[240] ». Or, les personnes détenues dans les prisons provinciales de l’Ontario, y compris pour des raisons liées à l’immigration, ne peuvent pas passer d’appels vers des téléphones portables ; ils ne peuvent appeler que des lignes fixes, le coût de l’appel étant à la charge de la personne appelée[241]. Une avocate de Montréal a indiqué que les personnes détenues dans les prisons provinciales du Québec n’avaient elles aussi que la possibilité de passer des appels en PCV vers des lignes fixes[242]. Les prisons provinciales étant souvent situées loin des centres urbains, les migrant·e·s détenu·e·s doivent souvent faire des appels longue distance pour contacter leurs proches, et un simple appel de 20 minutes peut leur coûter jusqu’à 30 dollars canadiens[243]. Dans les prisons provinciales de l’Ontario, les téléphones sont généralement accessibles cinq heures par jour et les appels limités à 20 minutes, à l’issue desquelles la ligne est automatiquement coupée[244]. Un migrant ayant été détenu dans une prison provinciale de l’Ontario a raconté les difficultés qu’il avait à joindre son épouse pendant sa détention :
Je parlais [à ma femme] chaque fois que j’en avais l’occasion. Mais je ne pouvais pas appeler son portable. Je devais appeler un ami qui avait une ligne fixe et qui me mettait en relation [avec ma femme]. Donc je n’avais jamais de conversations privées avec elle. Et il n’y avait pas que mon ami qui écoutait, il y avait aussi les autorités carcérales. On entendait en fond les gardiens qui écoutaient nos appels[245].
Les migrant·e·s détenu·e·s ont aussi beaucoup de mal à communiquer avec leurs avocat·e·s. Un ancien détenu ayant été incarcéré dans une prison provinciale de l’Ontario pendant la pandémie de Covid-19 a raconté : « Je n’ai pas arrêté de demander [aux gardiens] de me laisser appeler un avocat.… Ce n’est qu’au bout de 16 jours [en détention] que j’ai appris que mon avocate avait essayé de me contacter maintes et maintes fois.… J’ai dû me mettre à genou et supplier un gardien pour qu’il me laisse passer un coup de fil [à mon avocate][246]. » Un autre ancien détenu a signalé : « Mon avocat essayait de me contacter mais je n’avais jamais le message[247]. »
Les avocat·e·s des personnes détenues dans huit des prisons provinciales de l’Ontario peuvent prendre rendez-vous pour appeler leurs client·e·s par le biais d’un système de téléconférence appelé Access Defence[248]. En revanche, les avocat·e·s des personnes incarcérées dans les autres prisons provinciales de l’Ontario doivent d’abord appeler la prison ou envoyer une demande par fax, et dépendent du bon vouloir des gardiens pour prévenir leurs client·e·s et organiser l’appel[249]. Quatre avocates ont signalé que, souvent, les gardiens des prisons provinciales n’informaient pas leurs client·e·s de leurs appels[250]. Un représentant désigné a aussi indiqué avoir du mal à entrer en contact avec les personnes détenues qu’il représente dans les prisons provinciales : « Nous dépendons de la bonne volonté [des gardiens] de la prison pour tous les contacts avec nos clients[251] ». Ce même représentant désigné a constaté que ses appels avec ses client·e·s se tenaient en présence de gardiens[252]. Il se souvient d’une fois où son client « avait craqué au téléphone et avait du mal à reprendre ses esprits » ; le gardien était alors intervenu en disant « Il part en vrille » et avait raccroché[253].
Selon le Groupe de travail des Nations Unies sur la détention arbitraire, « toutes les personnes migrantes placées en détention doivent pouvoir communiquer avec le monde extérieur et leurs proches, notamment par téléphone ou par courriel[254] ».
Violence et surpopulation dans les prisons provinciales
Les chercheur·euse·s se sont entretenu·e·s avec sept migrants ayant été détenus dans des prisons provinciales qui ont déclaré avoir été agressés ou avoir eu peur d’être violemment pris pour cible en prison[255]. L’un d’eux a ainsi décrit ce qu’il avait vécu dans une prison provinciale de l’Ontario : « Il y a une hiérarchie et des bagarres tous les jours, et vous ne savez jamais quand ça va être votre tour.… La prison, c’est la peur de ne pas savoir ce qui va se passer[256]. » Une migrante ayant été incarcérée dans une prison provinciale de Colombie-Britannique se souvient très bien de la peur que lui inspiraient ses codétenues inculpées ou condamnées pour des infractions violentes :
Ma première codétenue était là parce qu’elle avait agressé sa mère, qui avait passé 10 jours à l’hôpital. Et la dame qui … distribuait la nourriture [au réfectoire] était emprisonnée pour avoir planifié … l’assassinat de la femme de son amant. Une autre femme avec qui je travaillais à la blanchisserie était là parce qu’elle avait tué sa fille[257].
Un autre ancien détenu a lui aussi raconté avoir eu peur d’autres personnes dans la prison :
Je devais sourire à mon codétenu car j’avais peur de lui. J’en ai parlé à un gardien et il m’a dit de signer une demande pour aller dans une cellule d’isolement protecteur, normalement c’est pour les gens qui ont reçu des menaces ou qui craignent pour leur vie. J’ai pensé : « Laissez-moi juste vivre sans avoir à intégrer un gang et sans être sans cesse sur le qui-vive ».
Puis j’ai découvert que je travaillais avec un autre détenu qui était là pour viol. Il m’a demandé de venir dans sa cellule.… [Après le travail], je me dépêchais de retourner dans ma cellule et je ne la quittais plus. Je me demandais sans cesse : « Ça n’a pas de sens que je sois ici.[258] »
Des avocat·e·s spécialisé·e·s dans la défense des personnes migrantes ont indiqué aux chercheur·euse·s que la violence était répandue dans les prisons provinciales. Trois ont raconté que certains de leurs clients avaient été agressés, dont l’un dans le cadre d’un soi-disant « club de combat », où des détenu·e·s en forçaient d’autres à se battre, sous l’œil impassible des gardiens[259]. Un ancien détenu a déclaré : « Les caméras [de surveillance] ne filment pas les douches. Les douches sont un endroit dangereux. Les gens ont des armes [fabriquées avec] des carreaux de céramique[260] ». Un autre ancien détenu a raconté avoir été violé dans une prison provinciale de l’Ontario :
Les détenu·e·s se servent de vous. Ils disaient que j’étais du « poisson frais » : ça veut dire un nouveau détenu. Trois détenu·e·s m’ont pris, deux m’ont maintenu pendant que le troisième me violait. Les gardiens laissent les détenu·e·s abuser du « poisson frais ». Ils se contentent d’en rire. J’ai dû tailler un crayon pour m’en servir comme arme de protection[261].
Un autre migrant ayant été détenu dans une prison provinciale de l’Ontario a raconté qu’il avait été agressé par un autre détenu : « L’un des gardiens m’a dit qu’il pouvait s’arranger pour que je me retrouve tout seul dans une pièce avec cette personne, genre “Si tu veux te venger de lui, je peux t’arranger ça”.… [J’ai eu l’impression que] s’il me proposait ça, c’était pour que lui et ses collègues puissent se divertir en regardant ces … combats[262]. »
Dans les prisons provinciales, les conditions d’enfermement, les règles et la routine restrictives et la surpopulation contribuent aussi à exacerber les tensions et l’hostilité entre les détenu·e·s, y compris les personnes migrantes. Deux anciens détenus ont signalé que les cellules étaient surpeuplées dans la prison provinciale où ils avaient été incarcérés, même pendant la pandémie de Covid-19[263]. Par exemple, un migrant a déclaré avoir été placé avec trois autres détenus dans une cellule prévue pour deux, avec « des gens qui dormaient la tête contre les toilettes[264] ». Un autre migrant, qui a été détenu dans une prison provinciale de l’Ontario pendant la pandémie de Covid-19, a raconté :
Ma cellule faisait trois mètres sur deux mètres cinquante, avec un lit superposé en métal et des toilettes. En gros, vous dormez dans des toilettes avec une autre personne. Il n’y a aucune intimité. Quand les toilettes se bouchaient, [les gardiens] mettaient 10 jours à les réparer, et cela arrivait régulièrement. Nous devions attacher des couvertures autour de la cuvette pour limiter les odeurs[265].
En juin 2020, une centaine de détenu·e·s du centre correctionnel du Centre-Est, situé à Lindsay (Ontario) – qui accueille aussi des personnes détenues pour des raisons liées à l’immigration – se sont mis en grève de la faim pour dénoncer des « conditions de détention inhumaines », citant le manque d’eau potable, la saleté des vêtements, la mauvaise qualité de la nourriture, le manque de programmes à destination des détenus, l’impossibilité de se procurer des produits d’hygiène de qualité et la mauvaise qualité de l’air[266].
Les effets à long terme de la détention sur la santé mentale
La manière dont nous avons été traités – le fait d’être arrêtés et incarcérés – nous a donné le sentiment d’être différents.… Ça a créé un précédent comme quoi nous n’étions pas les bienvenus.[267]
— « Amina », migrante ayant été détenue au centre de surveillance de l’immigration de Toronto après avoir demandé l’asile à son arrivée au Canada en 2007
Les effets préjudiciables de la détention sur les migrant·e·s ne s’arrêtent pas avec leur libération, mais se poursuivent bien au-delà, pendant des années, et peuvent bouleverser la vie des personnes concernées. Comme l’a expliqué un activiste, « la résilience des gens est ébranlée, les familles sont détruites et les communautés mises à mal[268] ». Les femmes sont particulièrement touchées ; elles ont globalement plus de risques de développer des handicaps psychosociaux courants, comme la dépression et l’anxiété[269]. Certaines des personnes migrantes ayant connu la détention que nous avons interrogées ont déclaré avoir subi des effets psychologiques et physiques durables. Les autorités n’assument nullement leur responsabilité dans les conséquences à long terme de la détention sur les migrant·e·s et leurs proches.
Un avocat a décrit le cas d’un client, « Karim », qui a été détenu dans deux prisons provinciales de l’Ontario pendant environ trois ans au total car les autorités considéraient qu’il présentait un risque de fuite et avaient des doutes sur ses papiers d’identité. Il a fait l’objet d’un diagnostic de schizophrénie, et les autorités avaient connaissance de ce diagnostic tout au long de sa détention. Sa santé physique et mentale s’est considérablement dégradée en prison, jusqu’à ce que l’ASFC reconnaisse être dans l’incapacité d’obtenir des preuves de son identité et de sa nationalité. Cet homme est donc apatride de fait. Son avocat s’est souvenu lui avoir parlé environ six ans après sa libération :
Il continuait de craquer quand il évoquait son séjour [en prison] et son caractère déshumanisant. Il est maintenant marié, ils venaient d’avoir un bébé, il a créé son entreprise.… Il a remis sa vie en ordre mais il trouve toujours que la détention est l’épisode le plus traumatisant de son passé, alors qu’il a perdu ses parents pendant la guerre civile au Liban quand il était enfant. Il dit que son séjour en prison au Canada est la pire expérience qu’il ait vécue. Celle-ci le hante toujours aujourd’hui[270].
Quand les chercheur·euse·s ont interrogé Karim, cet homme a décrit l’impact que son incarcération continuait d’avoir sur sa vie :
Je ne me suis pas remis de la détention. On ne s’en remet jamais. Les dégâts sont irréversibles. Parfois j’ai l’impression d’y être de nouveau. Il faut se forcer à accepter cette réalité, même si elle est inacceptable. La détention a tellement détruit ma santé mentale que ça a des répercussions sur ma santé physique. Maintenant je souffre quotidiennement.… Comme si on me faisait du mal à l’intérieur.… C’est difficile d’y repenser. Trois ans à rester assis là-bas pour rien[271].
Une ancienne détenue a expliqué que, près de dix ans après sa détention, elle ne pouvait toujours rien porter aux poignets car cela lui rappelait les menottes[272]. Elle ne porte pas de vert non plus car c’était la couleur de sa tenue en prison[273]. Quand elle voit un agent de l’ASFC, elle dit qu’elle se met à trembler et qu’elle a des crises d’angoisse[274].
Un avocat qui a travaillé avec des dizaines de migrant·e·s incarcéré·e·s et a défendu certaines des personnes ayant passé le plus de temps en détention pour des raisons liées à l’immigration au Canada a décrit les effets à long terme de la détention sur ses client·e·s : « Ils me disent qu’ils n’arrivent pas à dormir la nuit, qu’ils ont des flashs où ils se revoient dans leur cellule, qu’ils ont peur de sortir, peur de la police[275]. »
La détention provoque aussi des traumatismes durables et une méfiance à l’égard des autorités. Une femme afghane arrivée au Canada à l’âge de sept ans pour demander l’asile et arrêtée à la frontière avec ses parents et ses frères et sœurs en 2007 a souligné :
La détention nous a rendus plus méfiants envers la police ; nous avions moins confiance, nous savions que, même si nous n’avions rien fait de mal, nous devrions prouver notre innocence.… J’avais toujours en tête que nous n’avions pas [la nationalité]. Nous devions toujours suivre les règles. Obéir, obéir, obéir.… Et j’étais censée oublier tout ce qui s’était passé et ne plus jamais en parler.… J’avais de bons souvenirs de mon pays d’origine. Je n’ai jamais eu conscience que nous étions en guerre. Mes parents ont bien réussi à nous le cacher. Je ne les ai jamais vu pleurer jusqu’à ce que nous arrivions à la frontière [canadienne][276].
Un autre ancien détenu a raconté qu’il avait été arrêté à l’hôpital et placé en détention par l’ASFC, après avoir été agressé et avoir appelé la police pour dénoncer le crime : « Même victime d’un crime, vous avez peur d’appeler la police, … vous ne pouvez même pas appeler une ambulance[277]. » Il est resté en détention pendant environ un an tandis que l’ASFC tentait de l’expulser, alors que son pays d’origine ne le reconnaissait pas comme ressortissant.
Interrogé sur le message qu’il aimerait faire passer aux autorités canadiennes à propos de la détention, un ancien détenu a déclaré :
Je ne veux pas qu’ils entendent parler de moi car ces gens-là ont du pouvoir. Ils peuvent tout vous prendre, vous perdez votre voix, et le monde continue de tourner sans vous. Je veux juste avoir une vie simple. Je me sens trop petit pour dire quoi que ce soit au Canada. Si c’est une situation que vous ne connaissez pas, félicitez-vous de ne pas y être confronté.…
[En prison], j’ai vu une unité SWAT [groupe tactique d’intervention] faire irruption et asperger de gaz poivre quelqu’un qui perdait la tête, puis l’emmener. J’ai vu quelqu’un faire une overdose de fentanyl [un médicament opioïde]. Les gardiens poursuivaient leur conversation comme si de rien était pendant qu’une infirmière essayait de ranimer ce gars. Je me suis dit : « Si je mourais, qui s’en soucierait[278] ? »
III. La pandémie de Covid-19
Avec l’arrivée de la pandémie de Covid-19 début 2020, les autorités en charge de l’immigration ont libéré un nombre considérable de personnes migrantes détenues dans différentes régions du Canada[279]. Les données de l’ASFC indiquent que, entre juillet et septembre 2020, celle-ci détenait 476 personnes, contre 2 578 durant la même période l’année précédente[280]. Selon l’ASFC, cette diminution du nombre de migrant·e·s en détention peut s’expliquer par « les mesures de sécurité publique mises en place depuis la mi-mars pour limiter la propagation de la Covid-19 », notamment « la fermeture des frontières à la plupart des étrangers[281] ». L’agence a par ailleurs indiqué que la pandémie avait « renforcé la détermination de l’ASFC à trouver des solutions pour la mise en liberté des détenus à la première occasion » et qu’elle avait « demandé aux agents de concentrer leurs efforts sur l’exploration de toutes les solutions de rechange à la détention valables dans l’ensemble des cas, pourvu qu’il n’y ait pas de préoccupation en matière de santé publique[282] ».
En revanche, pour les migrant·e·s qui n’ont pas été libéré·e·s, les conditions de détention se sont durcies. Les visites ont été suspendues et les détenu·e·s ont été soumis·e·s à des confinements beaucoup plus fréquents, durant lesquels ils n’avaient pas la possibilité de téléphoner ni de prendre des douches[283]. Un ancien détenu d’une prison de l’Ontario a raconté que le quartier dans lequel il était incarcéré était resté en confinement pendant presque la totalité du mois d’août 2020 en raison d’une pénurie de gardiens[284]. Sans possibilité de contrôler qui entrait dans leur espace de vie, qui touchait les ustensiles qu’ils utilisaient pour manger, et qui les fouillait, les détenu·e·s étaient constamment exposé·e·s au risque de contamination par les gardien·ne·s ou d’autres personnes[285]. Certain·e·s ont signalé un manque de ventilation et de mauvaises conditions sanitaires en détention[286]. Pendant la première année de la pandémie, entre mars 2020 et mars 2021, des personnes enfermées dans le centre de surveillance de l’immigration de la région de Laval, au Québec, se sont mises en grève de la faim à trois reprises pour protester contre leurs conditions de détention[287].
Human Rights Watch a interrogé « Marlon », Colombien d’une trentaine d’années qui a été détenu dans un centre de surveillance de l’immigration pendant environ quatre mois et a participé à deux grèves de la faim en février 2021. Cet homme a expliqué que lui et deux autres détenu·e·s du centre avaient obtenu un test positif au coronavirus et que l’ASFC les avait placé·e·s dans des conditions semblables à celles de l’isolement cellulaire pendant environ une semaine[288]. Il a raconté avoir été placé dans « une cellule minuscule et sale », qu’il ne pouvait quitter que pour aller à la douche ou passer des appels téléphoniques de 15 minutes toutes les deux heures, toujours en présence d’un gardien, avec lequel il ne pouvait pas garder la distance physique nécessaire[289]. Il a ajouté qu’il avait eu de la fièvre pendant plusieurs jours, mais qu’il n’avait pas reçu de soins médicaux à l’exception d’antidouleurs et de prises de température. « Je me sentais impuissant et angoissé. J’avais du mal à respirer », a-t-il déclaré. Alors que la pandémie faisait rage, il était impossible selon lui de se préserver du virus dans le centre de détention :
La ventilation est insuffisante car toutes les fenêtres sont fermées, les conditions sanitaires sont mauvaises, et les gardiens enlèvent parfois leur masque.… Je trouvais inconcevable qu’ils nous mettent ainsi dans des conditions qui ne nous permettaient pas de nous protéger du virus[290].
Quand un foyer de Covid-19 s’est déclaré dans le centre de surveillance de l’immigration de la région de Montréal en février 2021, les autorités ont semble-t-il placé au moins 12 détenu·e·s, dont Marlon, à l’isolement[291]. D’après Marlon et Solidarité sans frontières, un réseau de défense des personnes migrantes qui travaille auprès des personnes détenues dans ce centre, les détenus en question n’ont pas été testés de nouveau avant la levée de leur isolement et leur retour dans les espaces partagés, où la distanciation physique était impossible à respecter[292].
Trois migrants ayant connu la détention ont indiqué que, dans au moins deux prisons provinciales de l’Ontario, aucun masque n’avait été distribué aux détenu·e·s[293]. Un migrant ayant été incarcéré dans le complexe correctionnel de Maplehurst, dans l’Ontario, a déclaré que seuls certains gardiens portaient des masques et que les détenus n’en avaient pas :
Quand j’étais en détention, j’ai dû aller à l’hôpital, où on m’a donné un masque. Mais dès que je suis revenu en prison, les gardiens m’ont ordonné de jeter le masque car, ont-ils dit, je pourrais utiliser la petite [barrette] métallique qu’il contenait comme outil.… Nous avions peur que les gardiens nous contaminent quand ils venaient. Mais ils s’en fichent. Ils sont comme chez eux dans la prison. Ils font ce qu’ils veulent[294].
Un autre migrant ayant été détenu au centre de détention d’Ottawa-Carleton a aussi dit aux chercheur·euse·s que les détenu·e·s n’avaient pas reçu de masques[295]. Un avocat de Toronto a constaté que les autorités pénitentiaires étaient « désinvoltes avec la vie des gens » en prison : « Un gardien est venu [à la prison] déguisé en dinosaure, avec un badge sur lequel il était écrit : “Lavez-vous les mains pour éviter l’extinction[296]”. »
D’importants foyers de Covid-19 se sont développés dans plusieurs prisons provinciales du Canada. En janvier 2021, le complexe correctionnel de Maplehurst – qui accueillait la plus grande proportion de personnes migrantes depuis le début de la pandémie – a connu la plus forte flambée épidémique de toutes les prisons provinciales de l’Ontario[297].
Durant la pandémie, la proportion de personnes migrantes placées dans des prisons provinciales plutôt que dans des centres de surveillance de l’immigration a doublé, ainsi que la durée moyenne de leur détention[298]. L’ASFC explique ce changement drastique par le « profil de risque » des migrant·e·s détenu·e·s : « En raison du recours accru aux solutions de rechange à la détention pour les personnes posant un risque plus faible et du petit nombre de personnes venant au Canada, les individus qui demeurent en détention représentent en général un risque plus élevé[299]. » Pourtant, entre avril et octobre 2020, seuls 20 % des migrant·e·s étaient détenu·e·s pour des questions de sécurité publique[300]. Pendant cette période – comme avant la pandémie –, la grande majorité d’entre eux étaient incarcéré·e·s pour risque de fuite, à des fins d’examen complémentaire de leur situation ou en raison de doutes sur leurs papiers d’identité[301].
Selon une avocate de Toronto spécialisé dans la défense des personnes migrantes, malgré la baisse du nombre de migrant·e·s détenu·e·s pendant la pandémie, « la situation peut facilement s’inverser de nouveau, et on ne peut pas compter uniquement sur la volonté les autorités de protéger les droits fondamentaux[302] ».
IV. L’impact de la détention liée à l’immigration sur les personnes à risque
Les communautés de couleur
Les témoignages recueillis par les chercheur·euse·s auprès d’avocat·e·s, d’activistes et de personnes ayant été détenues, ainsi que l’analyse des données de l’ASFC relatives à la nationalité des détenu·e·s, laissent à penser que les décisions des autorités en matière de détention liée à l’immigration ont des effets négatifs disproportionnés sur les personnes de couleur. Les personnes migrantes de couleur, notamment celles qui sont noires, semblent être incarcérées pendant de plus longues périodes, et sont plus souvent placées dans des prisons provinciales que dans des centres de surveillance de l’immigration.
Lors d’un entretien réalisé en février 2021, des agent·e·s de l’ASFC ont indiqué que l’agence ne recueillait pas de données ventilées par appartenance ethnique[303]. Elle ne recueille que des données ventilées par pays de nationalité[304]. Ce manque de données limite les possibilités d’analyse de cette question.
L’analyse par les chercheur·euse·s des données fournies par l’ASFC à la suite de leurs demandes au titre de l’accès à l’information montre que, en 2019, la majorité des personnes migrantes détenues pendant 90 jours ou plus, 180 jours ou plus et 270 jours ou plus étaient originaires de pays africains[305].
Des avocat·e·s ont constaté que leurs client·e·s de couleur étaient traité·e·s plus durement dans le système de détention lié à l’immigration. Une avocate de Montréal a remarqué que les personnes migrantes détenues dans des prisons provinciales plutôt que dans des centres de surveillance de l’immigration étaient généralement « des hommes noirs incarcérés pour risque de fuite[306] ». En Nouvelle-Écosse, où les migrant·e·s sont placé·e·s par défaut dans des prisons provinciales en l’absence de centres de surveillance de l’immigration, une avocate a constaté que l’ASFC invoquait plus fréquemment le motif du danger pour le public lorsqu’il s’agissait de personnes noires, et que ces personnes devaient souvent verser une caution plus élevée pour obtenir leur libération[307]. Une avocate de Vancouver a aussi constaté que la plupart des personnes migrantes détenues dans des prisons provinciales pendant plusieurs mois, voire plusieurs années, étaient des hommes noirs : « Ils sont catalogués comme des “autres” indisciplinés et dangereux, qui doivent être enfermés sous un régime plus global de discipline et de contrainte[308] ». Deux avocats de Toronto ont fait des témoignages allant dans le même sens[309]. Une avocate de Vancouver a décrit les différences de traitement entre deux de ses client·e·s :
J’ai eu un client – un homme blanc originaire d’Australie – qui avait été arrêté après avoir été inculpé d’agression et parce que son visa avait expiré. L’ASFC l’a libéré sans même aucun contrôle judiciaire … J’ai eu une autre cliente – une femme noire, mère célibataire arrivant de France, atteinte de dépression et d’anxiété, et ayant vécu un traumatisme par le passé. L’un de ses enfants était canadien et elle avait déposé une demande de résidence permanente. L’ASFC l’a placée en résidence surveillée, puis l’a incarcérée pour risque de fuite car une fois elle n’a pas ouvert quand on a sonné à sa porte.… En détention, elle a été placée à l’isolement plusieurs fois et elle n’était pas autorisée à porter des vêtements, mais seulement une tunique médicale.… Comme elle était emprisonnée, ses enfants risquaient d’être placés ; on ne lui a jamais donné la possibilité de les garder avec elle.… À l’issue d’une audience de six heures, le tribunal l’a libérée car une personne s’était portée caution, mais l’ASFC a fait appel de cette décision devant la Cour fédérale. La seule explication que j’ai pu trouver [à cette différence de traitement] est la couleur de sa peau[310].
Selon une psychologue qui mène depuis plusieurs dizaines d’années des recherches sur l’impact de la détention liée à l’immigration au Canada, le racisme systémique est encore plus évident au niveau macro-structurel : « L’ASFC emprisonne des gens pour des motifs non pénaux et il s’avère que ces gens sont dans leur immense majorité originaires de pays du Sud[311]. » Un représentant juridique ayant travaillé pendant plusieurs décennies avec des centaines de personnes migrantes détenues a constaté que la majorité de celles-ci étaient des personnes de couleur, et que le système « reposait sur la race[312] ».
En juin 2016, l’ASFC a arrêté Olajide Ogunye, Canadien né au Nigeria, devant chez lui alors qu’il partait au travail[313]. Les agents lui ont dit qu’ils faisaient une descente dans le quartier[314]. Olajide Ogunye est resté détenu huit mois dans deux prisons provinciales à sécurité maximale le temps que l’ASFC vérifie son identité, alors qu’il avait une carte de citoyenneté canadienne et une carte Santé de l’Ontario[315]. Pendant sa détention, sa santé mentale s’est dégradée ; il a été placé sous surveillance pour risque de suicide et s’est vu administrer des antidépresseurs[316]. En 2018, Olajide Ogunye a raconté à CBC News : « Ils m’ont mis à rude épreuve. Ils ont détruit ma vie.… Ils ont détruit ma famille[317]. » Il a porté plainte contre l’ASFC, réclamant 10 millions de dollars canadiens de dommages et intérêts[318].
D’après une plainte déposée devant la Commission canadienne des droits de la personne en septembre 2019, Mohamed Duale, Canadien né en Somalie, a été arrêté par des agent·e·s de l’ASFC à la frontière canadienne à son retour d’un séjour à l’étranger et soumis à toute une série de questions[319]. Quand il a demandé pourquoi il avait été arrêté, une agente lui aurait répondu : « En raison de ton lieu de naissance. Tu es somalien, non[320] ? » C’est loin d’être la seule plainte dénonçant des comportements racistes de la part de l’ASFC[321]. En octobre 2020, le Conseil national des musulmans canadiens a publié un rapport détaillant ses préoccupations quant au profilage ethnique pratiqué par l’ASFC et réclamant une surveillance civile indépendante[322].
En juin 2020, le Premier ministre canadien Justin Trudeau a reconnu qu’il existait un problème de racisme systémique dans les institutions policières du pays, mais sans citer expressément l’ASFC : « Le racisme systémique est un problème partout dans le pays, dans toutes nos institutions, y compris dans tous nos corps policiers, dont la GRC [Gendarmerie royale du Canada]. C’est cela le racisme systémique[323]. »
La plupart des traités internationaux relatifs aux droits humains interdisent la discrimination et demandent aux États parties de prendre des mesures pour l’éradiquer[324]. La Convention internationale sur l’élimination de toutes les formes de discrimination raciale impose aux États d’interdire et d’éliminer toutes les formes de discrimination raciale directe et indirecte et de « faire en sorte que toutes les autorités publiques et institutions publiques, nationales et locales, se conforment à cette obligation[325] ».
Les demandeurs et demandeuses d’asile
La première chose que j’ai vue en arrivant au Canada, c’est une prison … Lorsque nous étions mélangés à des prisonniers canadiens, ils nous demandaient pourquoi nous étions là. Ils pensaient que nous étions des talibans. Nous leur avons expliqué que nous fuyions les talibans.… J’ai choisi le Canada car je croyais que les réfugiés y étaient bienvenus. Je me faisais une meilleure idée du Canada.… Nous sommes des êtres humains, tout comme vous, mais nous n’avons pas de pays.[326]
— « Omar », demandeur d’asile ayant été détenu dans une prison provinciale de Nouvelle-Écosse à son arrivée au Canada en 2017
La détention liée à l’immigration a des effets particulièrement délétères sur les demandeur·euse·s d’asile[327]. Plusieurs ancien·ne·s détenu·e·s venu·e·s demander l’asile au Canada ont raconté être arrivé·e·s dans le pays pleins d’espoir et soulagé·e·s à la perspective d’être enfin en sécurité[328]. Un homme originaire d’un pays d’Amérique latine qui était venu demander l’asile au Canada et a été placé en détention a déclaré :
Dès mon premier jour au Canada, je me suis senti en sécurité.… Aussitôt arrivé ici, j’ai réussi à dormir. J’étais en paix.… Je comprends que l’ASFC doive faire son travail, mais traitez-moi comme un être humain.… Nous craignons pour notre vie, tout ce que nous voulons c’est une meilleure chance de continuer à vivre, et on nous punit. C’est terrible[329].
« Idriss », un Africain ayant demandé l’asile à son arrivée au Canada et ayant été détenu dans un centre de surveillance de l’immigration, a décrit ses échanges avec les deux premiers agents de l’ASFC qui l’ont interrogé :
L’un des agents m’a dit : « Le Canada est un pays de liberté pour les Canadiens, pas pour les étrangers. » Il semblait très content de me dire : « Ce soir tu dormiras en prison. » Ça faisait rire les autres agents.…
La détention liée à l’immigration a changé la manière dont je vois le Canada. Avant, pour moi, le Canada était le meilleur endroit du monde. Pour les personnes fuyant des persécutions, c’était l’endroit idéal pour trouver la paix et une vie meilleure. Mais quand j’ai vu ça, je me suis dit : « Tout ce que nous entendons sur le Canada est faux, c’est du cinéma[330]. »
Une femme, « Michelle », demandeuse d’asile arrêtée à son arrivée au Canada, se souvient de ce qu’elle a pensé quand elle a été placée à l’isolement :
J’avais envie de me tuer. C’était la fin du monde pour moi. Personne ne m’a expliqué ce qui se passait, ce que j’avais fait de mal … Si au moins quelqu’un avait pu me dire ce que j’avais fait de mal.… Je me suis dit : « Pourquoi est-ce que je ne peux pas simplement mourir ? » J’ai raconté [à l’agente de l’ASFC] tout ce qui m’était arrivé dans mon pays, et comment j’avais fui pour survivre. J’ai essayé d’expliquer, et l’agente a dit : « OK, OK, je vois ce que vous voulez dire. » Mais elle ne m’a pas comprise, et elle ne m’a pas laissé lui expliquer … Je n’arrivais pas à m’arrêter de pleurer. Je me suis alors dit que j’aurais peut-être mieux fait de rester là-bas et d’y mourir. C’était trop pour moi. Avant mon arrivée au Canada, je ne savais pas à quoi ressemblait la prison[331].
Une avocate de Montréal constate que, généralement, les demandeur·euse·s d’asile « ont confiance dans le système à leur arrivée, ils pensent que la vérité va s’imposer », mais quand leur première expérience au Canada est la détention, « c’est toujours un grand choc et cela réduit à néant leur confiance dans le système[332] ». Un prestataire de services et défenseur des droits des réfugié·e·s a souligné que la détention était particulièrement traumatisante pour des personnes déjà traumatisées par les atteintes aux droits humains, la violence et la torture qu’elles avaient fuies : « Dès l’entrée dans le pays, vous êtes conduit en prison[333]. » Une avocate de Montréal se souvient d’une cliente égyptienne qui fuyait des violences domestiques et a été placée en détention à son arrivée au Canada : « Quand elle a été libérée, elle a juste regardé les étoiles et elle a pleuré[334]. »
De nombreux·ses demandeur·euse·s d’asile arrivent au Canada après avoir fui des expériences traumatisantes et bouleversantes ; la détention liée à l’immigration peut briser leurs défenses. Janet Cleveland se souvient avoir interrogé un jeune homme somalien détenu au centre de surveillance de l’immigration de Toronto :
Ce jeune homme, âgé d’une vingtaine d’années, avait clairement un syndrome de stress post-traumatique. Son père avait été assassiné sous ses yeux alors qu’il tentait de lui éviter d’être recruté par Al Shabab. Au premier abord, quand il est entré dans la pièce [pour notre rencontre], il semblait très calme. Mais il faisait des cauchemars et avait des terreurs nocturnes, et il avait déjà fait une tentative de suicide. Il avait tellement besoin d’aide et de soutien, et au lieu de cela il était en détention. Il essayait de se contrôler donc en surface ses tourments n’étaient pas visibles. Un agent non formé n’aurait pas pu déceler ses problèmes de santé mentale. C’est seulement quand il a commencé à avoir confiance qu’il a pu s’ouvrir et se confier. Je me souviens d’avoir pensé combien il était inhumain d’incarcérer ces gens dans de telles circonstances. Ils lui retiraient le peu qu’il lui restait pour tenir le coup[335].
Les agent·e·s de l’ASFC sont généralement les premier·ière·s représentant·e·s des autorités canadiennes que les demandeur·euse·s d’asile et autres personnes nouvellement arrivées rencontrent au Canada. Deux défenseur e·s des droits des réfugié·e·s nous ont raconté que la plupart de ces premiers contacts étaient agressifs, violents, voire cruels[336]. Selon un activiste ayant travaillé avec des centaines de demandeur·euse·s d’asile, beaucoup d’agent·e·s de l’ASFC font pression sur les personnes qui veulent demander l’asile pour qu’elles quittent le Canada et retournent dans leur pays : « Ils menacent des gens qui n’ont aucune connaissance de leurs droits[337]. » Une autre activiste et deux avocat·e·s de Montréal ont confirmé l’existence de telles pratiques[338].
Des demandeur·euse·s d’asile ont raconté que des agent·e·s de l’ASFC les avaient menacé·e·s de les expulser s’ils demandaient le statut de réfugié·e·s ou avaient tenté par d’autres moyens de les empêcher de faire une demande de protection à ce titre. Une ancienne détenue de Colombie-Britannique s’est souvenue qu’un·e agent·e de l’ASFC lui avait dit : « Savez-vous que nous expulsons 98 % des Mexicains qui viennent ici pour demander l’asile ? Préparez-vous à être expulsée[339]. » Un autre ancien détenu, Abdelrahman Elmady, qui a demandé l’asile à Vancouver, a indiqué que, après avoir détaillé les raisons pour lesquelles il avait fui son pays, il s’était vu reprocher par un·e agent·e de l’ASFC d’être égoïste car il avait laissé sa femme et ses enfants derrière lui[340]. Deux anciens détenus ayant demandé l’asile à leur arrivée au Canada ont raconté que des agent·e·s de l’ASFC leur avaient dit qu’ils n’avaient pas le droit de demander le statut de réfugiés[341].
Trois avocat·e·s spécialisé·e·s dans les questions d’immigration exerçant à Toronto, Montréal et Halifax ont signalé que des agent·e·s de l’ASFC avaient fait pression sur certains de leurs client·e·s en détention afin qu’ils renoncent à leurs droits ou retirent leurs demandes susceptibles de leur permettre de rester dans le pays[342]. Une avocate a raconté qu’un agent de l’ASFC avait dit à l’un de ses client·e·s – qui avait des pensées suicidaires et des symptômes liés à la dépression – qu’il ne sortirait de détention que s’il était expulsé du Canada[343].
Selon le Groupe de travail des Nations Unies sur la détention arbitraire, la détention ne devrait pas être utilisée comme moyen pour décourager les demandes d’asile[344].
Un ancien détenu, « Idriss », a fait remarquer : « Il faudrait plus d’humanité à la frontière. Il n’y a aucune humanité dans le centre de détention. Ils s’en fichent de vous.… J’étais déprimé. J’étais perdu. Je ne savais pas quoi faire. Je regrettais d’être venu là. J’ai vu que les autres souffraient aussi[345]. »
La détention d’enfants et la séparation de familles
J’ai supplié les agents de me laisser avec mes enfants, mais ils ont refusé. Il va falloir beaucoup de temps pour que la santé mentale de mes enfants se rétablisse. Être séparés de nous leur a fait beaucoup de mal.… C’est très difficile d’apaiser leur douleur. Ils n’ont pas encore appris comment se protéger car ils sont très jeunes.… Ils continuent de me demander tous les jours de leur promettre que je ne vais pas disparaître, et je leur répète : « Ne vous inquiétez pas, je serai toujours là[346] ».
— « Tiffany », demandeuse d’asile ayant été détenue au centre de surveillance de l’immigration de Toronto et séparée de ses enfants à deux reprises en 2018 et 2019
En matière de détention liée à l’immigration, les enfants sont soumis aux mêmes règles juridiques que les adultes au Canada, même si les juges doivent tenir compte de l’intérêt supérieur de l’enfant[347]. Par conséquent, les enfants peuvent être placés en détention pour les mêmes motifs que les adultes[348]. Ils peuvent aussi être « hébergés » en détention, même s’il n’existe pas de motifs justifiant leur incarcération, afin d’éviter de les séparer de leurs parents détenus[349]. Détenus de fait, ils sont alors soumis aux mêmes conditions de détention que les personnes officiellement incarcérées ; des enfants de nationalité canadienne peuvent figurer parmi eux[350]. Les enfants qui n’accompagnent pas leurs parents en détention sont séparés d’eux et peuvent être confiés aux services de la protection de l’enfance[351]. Selon le document d’information de l’ASFC à destination des migrant·e·s détenu·e·s, c’est l’intérêt supérieur de l’enfant qui détermine si les enfants sont « hébergés » en détention ou séparés de leurs parents détenus :
Si vous avez des enfants, [l’ASFC] évaluera minutieusement leur intérêt supérieur, d’après les faits. Un agent soupèsera quelles sont les solutions de rechange (p. ex. hébergement chez la famille), combien de temps votre détention devrait durer, et si du logement et des services adéquats sont disponibles pour vos enfants. Si tel est leur intérêt supérieur, vos enfants pourront séjourner avec vous au centre de surveillance de l’immigration.… On pourrait faire appel aux autorités provinciales et vos enfants pourraient être pris en charge par les services provinciaux d’aide à l’enfance. Si c’est le cas, vos enfants pourraient vous rendre visite[352].
Durant l’exercice 2019-2020, 138 enfants au total ont passé du temps en détention, dont 73 enfants de moins de six ans[353], ce qui représente une augmentation de 17 % par rapport à l’année précédente. La grande majorité de ces enfants (94 %) ont été détenus au Québec[354].
Il reste difficile de savoir combien d’enfants sont séparés de leurs parents détenus car l’ASFC ne collecte pas de données à ce sujet. Selon Action Réfugiés Montréal – la seule ONG autorisée à se rendre une fois par semaine dans le centre de surveillance de l’immigration de Laval pour y aider les personnes détenues[355] –, en 2019, au moins 182 enfants ont été séparés d’un parent détenu dans la seule province du Québec[356]. Plus des deux tiers de ces enfants ont été séparés de leur père à la frontière et envoyés dans un foyer avec leur mère après que leur famille a demandé l’asile[357]. Dans au moins six cas, des pères ont raté la naissance de leur enfant[358].
Selon une activiste et une avocate de Montréal, malgré les récentes réformes politiques et réglementaires imposant aux autorités de prendre en compte l’intérêt supérieur de l’enfant[359], aucun changement notoire n’a été constaté dans la manière dont les droits des enfants sont intégrés aux décisions relatives à la détention[360]. Au lieu de chercher des solutions de rechange à la détention pour les parents incarcérés, l’ASFC affirme dans de nombreux cas que l’intérêt supérieur de l’enfant consiste à placer les enfants en détention avec leurs parents ou à les séparer d’eux[361]. Cette même activiste de Montréal a par ailleurs constaté des incohérences régionales dans l’évaluation de l’intérêt supérieur de l’enfant par l’ASFC[362]. Une ancienne détenue du centre de surveillance de l’immigration de Toronto, qui a été séparée de ses jeunes enfants à deux reprises car incarcérée, se souvient : « Je suppliais tout le temps les agents de me laisser garder mes enfants avec moi en détention si je ne pouvais pas être libérée, mais ils disaient : “Non, les enfants ne sont pas autorisés en détention[363].” »
Les effets délétères de la détention liée à l’immigration sur la santé mentale des enfants ont été largement démontrés au Canada et partout dans le monde[364]. Des études confirment que les enfants placés en détention présentent « un taux élevé de symptômes psychiatriques, tels que des actes d’automutilation, des pensées suicidaires, une dépression sévère, une régression dans les grandes étapes du développement, des problèmes de santé physique, et des symptômes post-traumatiques[365] ». Les plus jeunes présentent aussi des retards de développement ou une régression, une angoisse de séparation et des troubles de l’attachement, ainsi que des changements comportementaux, comme une plus grande agressivité[366]. Même de brèves périodes d’enfermement peuvent être extrêmement stressantes et traumatisantes pour les enfants[367], et l’impact sur leur santé mentale peut durer longtemps après leur libération[368]. Autre élément important, les recherches montrent que la séparation des familles a aussi de graves effets psychologiques sur les enfants[369].
En 2015, des chercheuses de l’université McGill ont présenté leurs conclusions après avoir interrogé 20 familles, comprenant des enfants du plus jeune âge à l’adolescence, qui avaient été détenues dans les centres de surveillance de l’immigration de Toronto et de Laval[370]. Cette étude a montré que les enfants avaient réagi à l’enfermement avec « une détresse extrême, de la peur et des troubles fonctionnels », présentant tout un éventail de symptômes tant pendant la détention qu’après leur libération[371]. Des parents ont raconté que, en détention, leurs enfants étaient devenus agressifs et présentaient couramment des signes d’angoisse de séparation et de dépression, ainsi que des troubles du sommeil et une perte d’appétit[372]. Après leur libération, ces enfants sont restés en situation de détresse émotionnelle pendant plusieurs mois, avec des symptômes tels que l’angoisse de séparation, un mutisme sélectif, des troubles du sommeil et des symptômes de stress post-traumatique[373]. Plusieurs enfants ont développé une peur des symboles de l’autorité (comme les uniformes, les véhicules de police et les bâtiments institutionnels) et leurs résultats scolaires ont baissé[374].
Selon Rachel Kronick, psychiatre de l’université McGill qui étudie les conséquences de la détention liée à l’immigration sur les enfants et les familles, la détention prive les parents de leur capacité à jouer le rôle de forces protectrices pour leurs enfants[375]. Il existe un lien important entre la capacité d’action des parents en tant qu’adultes maîtres de leur destin et le bien-être de leurs enfants[376]. La détention a clairement un impact négatif sur la santé mentale des enfants, qu’ils soient détenus avec leurs parents ou séparés d’eux[377]. Les enfants dont les parents développent un handicap psychosocial ont un risque accru d’en développer un eux-mêmes[378].
Les répercussions sur la famille des détenu·e·s sont aussi énormes. Selon une avocate de Montréal spécialisée dans les questions d’immigration, « tout change d’un jour à l’autre et souvent les familles paniquent à l’idée de ne jamais revoir leurs proches[379] ». Cette même avocate a expliqué que, contrairement à de nombreuses autres procédures juridiques, « la détention est très concrète car soudain vos proches disparaissent[380] »
Les organes internationaux ont adopté des positions très fermes sur la détention des enfants migrants. Le Comité des droits de l’enfant a souligné que la détention d’un enfant en raison du statut migratoire de ses parents constituait une violation des droits de l’enfant et était toujours contraire au principe de l’intérêt supérieur de l’enfant[381]. Le Groupe de travail des Nations Unies sur la détention arbitraire a pour sa part rappelé que la situation d’un enfant ou de ses parents au regard la législation relative à l’immigration n’était pas un motif suffisant pour justifier sa mise en détention[382]. Selon lui, « il est interdit de priver de liberté un demandeur d’asile, un réfugié, un apatride ou un enfant migrant, y compris un enfant non accompagné ou séparé de ses parents[383] ». Le Groupe de travail a également indiqué :
Les enfants ne doivent pas être séparés de leurs parents ou tuteurs légaux. Plutôt que de justifier la détention d’enfants dont les parents sont incarcérés par la volonté de préserver la cellule familiale, il faut plutôt trouver des solutions de substitution à la détention pour l’ensemble de la famille[384].
Les rapporteurs spéciaux des Nations Unies sur les droits de l’homme des travailleurs migrants et sur la torture ont eux aussi appelé les États à préserver la cellule familiale en ayant recours à des solutions autres que la détention pour l’ensemble de la famille[385].
En septembre 2017, le Comité des Nations Unies pour l’élimination de la discrimination raciale a recommandé au gouvernement canadien « de mettre immédiatement fin à la pratique du placement de mineurs en détention[386]. » En décembre 2019, il lui a envoyé une lettre de suivi dans laquelle il jugeait « insatisfaisante » la réponse du gouvernement à cette recommandation[387]. Il y regrettait que le gouvernement fédéral n’interdise pas le recours à la détention contre les enfants migrants, dont un certain nombre continuaient d’être incarcérés[388].
La pratique du Canada consistant à placer des enfants en détention – qu’ils soient officiellement détenus ou simplement « hébergés » en détention – est une violation du droit international car elle porte atteinte à l’intérêt supérieur de l’enfant. Celle qui consiste à séparer des enfants de leurs parents détenus n’est pas non plus dans l’intérêt supérieur de l’enfant, et le Canada devrait tenir compte des appels des organes internationaux lui demandant de trouver des mesures de substitution pour l’ensemble de la famille.
V. L’ASFC : des pouvoirs très étendus sans surveillance civile indépendante
La législation canadienne donne aux autorités un immense pouvoir d’appréciation en matière de détention liée à l’immigration. C’est l’ASFC qui décide où les personnes migrantes sont détenues, il n’existe aucune limite législative de la durée pendant laquelle ces personnes peuvent être incarcérées, et même après leur libération celles-ci doivent respecter des conditions sous peine d’être réincarcérées.
Près de 20 ans après sa création, l’ASFC reste le seul organisme majeur de sécurité publique du Canada à ne pas être soumis à une surveillance civile indépendante[389]. Ces dernières années, des voix se sont fait entendre pour réclamer la création d’un organe de surveillance[390]. Entre 2014 et 2020, il y a eu plusieurs tentatives infructueuses de présenter et d’adopter des lois sur la surveillance de l’ASFC[391].
En l’absence de surveillance civile indépendante, l’ASFC exerce sans contrôle sa mission et ses pouvoirs d’application très étendus, ce qui donne régulièrement lieu à des violations des droits humains dans le contexte de la détention liée à l’immigration.
Depuis 2017, le gouvernement canadien a réagi aux problèmes de longue date dans ce domaine en adoptant plusieurs nouvelles politiques, en publiant des statistiques, en consultant les parties intéressées, et en procédant à des réformes réglementaires relatives à la détention des enfants migrants[392]. Cependant, ces mesures sont loin d’être suffisantes pour remédier aux failles structurelles profondément enracinées qui touchent de façon disproportionnée les personnes porteuses de handicap psychosocial placées en détention pour des raisons liées à l’immigration. Sans changements législatifs mettant en place de véritables garde-fous pour les personnes migrantes en détention, ce « patchwork » de pratiques positives introduites récemment n’est pas tenable, car dans la réalité l’application de ces garanties reste largement tributaire du pouvoir d’appréciation des autorités[393].
Des lieux de détention laissés à la libre appréciation de l’ASFC
Les personnes migrantes sont détenues pour des motifs administratifs, mais le Canada soumet certaines d’entre elles à des conditions de détention parmi les plus restrictives du pays et l’ASFC a tout pouvoir pour décider de leur lieu d’incarcération. Lorsque ces personnes se trouvent dans un lieu éloigné de l’un des trois centres de surveillance de l’immigration du pays – situés à Toronto, Laval et Surrey –, elles sont placées par défaut dans des prisons provinciales[394]. Par ailleurs, même lorsqu’il existe un centre de surveillance de l’immigration à proximité, l’ASFC peut décider de placer des migrant·e·s dans des prisons provinciales si elle estime que leur comportement « ne peut être géré dans un CSI [centre de surveillance de l’immigration][395] », ou à la demande du centre de surveillance de l’immigration le plus proche si celui-ci a atteint un taux de remplissage d’au moins 85 % de sa capacité[396]. L’ASFC a reconnu, dans son Plan ministériel 2020-2021, « la possibilité que les conditions de détention ne soient pas uniformes à l’échelle nationale en raison de sa dépendance à l’égard des établissements correctionnels provinciaux[397] ».
Non seulement l’ASFC a tout pouvoir de décider du lieu de détention des personnes migrantes, mais en outre il n’existe aucune norme juridique destinée à guider la décision de placer un·e migrant·e dans une prison provinciale ou dans un centre de surveillance de l’immigration. Cette décision administrative est prise sur la base d’une obscure évaluation des risques, appelée Évaluation nationale des risques en matière de détention (ENRD)[398]. L’ENRD consiste en un formulaire de deux pages établi par l’ASFC, qui attribue des points en fonction d’un certain nombre de « facteurs de risque et de vulnérabilité » afin de former une note, qui est ensuite utilisée pour déterminer si la personne doit être détenue dans une prison provinciale ou un centre de surveillance de l’immigration[399].
Les personnes migrantes placées en détention n’ont aucun moyen de contester ces évaluations des risques ni les décisions d’incarcération lors des audiences de contrôle des motifs de détention[400]. Des avocat·e·s de tout le pays ont confirmé que le contenu des ENRD n’était souvent pas dévoilé lors de ces audiences et qu’il n’existait aucune possibilité de contester ces évaluations devant le tribunal[401]. Des avocat·e·s, des représentant·e·s désigné·e·s, des activistes et des prestataires de services de différentes régions du pays ont affirmé que l’analyse des risques pratiquée par l’ASFC manquait de transparence et qu’il était difficile de savoir pourquoi certaines personnes étaient placées dans des prisons provinciales et d’autres dans des centres de surveillance de l’immigration[402].
Entre avril 2017 et mars 2020, plus d’un cinquième des migrant·e·s emprisonné·e·s – environ 5 400[403] – ont été placé·e·s dans 78 prisons provinciales sur tout le territoire canadien, aux côtés de détenu·e·s inculpé·e·s d’infractions pénales ou condamné·e·s[404]. Par le biais de demandes d’accès à l’information, les chercheur·euse·s ont obtenu les accords bilatéraux conclus entre le gouvernement fédéral et les provinces de la Colombie-Britannique, du Nouveau-Brunswick, de la Nouvelle-Écosse, du Québec, de l’Ontario et de la Saskatchewan à des fins de détention des migrant·e·s dans des prisons provinciales[405]. L’ASFC leur a confirmé qu’il existait également un accord avec l’Alberta, qui n’a pas été communiqué. Dans les autres provinces, elle a indiqué avoir « des accords informels » lui permettant de placer des personnes migrantes en détention dans des prisons provinciales[406].
Les personnes migrantes qui sont détenues dans des prisons provinciales restent sous la responsabilité juridique de l’ASFC en sa qualité d’autorité de mise en œuvre, mais l’agence renonce à son contrôle sur leurs conditions de détention. Dans son Plan ministériel 2020-2021, elle a ainsi indiqué : « L’Agence exerce un contrôle limité sur les conditions de détention dans les établissements qui ne relèvent pas d’elle, ce qui rend difficile l’application d’une norme commune de soins[407]. ». Elle a aussi précisé qu’elle n’avait aucun contrôle sur les décisions de placer les migrant·e·s dans les quartiers à sécurité maximale des prisons provinciales ou dans d’autres quartiers à plus faible sécurité : « Les établissements provinciaux procèdent à une évaluation interne des risques et gèrent les affectations, ce qui peut aboutir à des décisions internes de placement dans des quartiers d’un niveau de sécurité inférieur à celui des quartiers à sécurité maximale[408]. » Dans l’Ontario et au Québec, les personnes migrantes détenues dans des prisons provinciales peuvent être placées dans les quartiers à sécurité maximale de ces établissements au moins en partie en raison de leur situation au regard de la législation sur l’immigration[409]. Les politiques et procédures des Services communautaires et correctionnels de l’Île-du-Prince-Édouard indiquent que « dans le cas d’une personne détenue en vertu de la LIPR [pour des raisons liées à l’immigration], le personnel pénitentiaire doit garder à l’esprit que, même en l’absence de charges pénales, la personne en question doit être considérée comme présentant un risque en matière de sécurité[410] ».
La détention des personnes migrantes dans des prisons provinciales coûte cher. Les accords conclus par le gouvernement fédéral avec les différentes provinces prévoient le versement par les autorités fédérales d’un forfait journalier pendant toute la durée de la détention de chaque personne migrante placée dans une prison provinciale[411]. L’accord avec l’Ontario rajoute 20 % du forfait journalier « pour couvrir les frais administratifs et généraux liés à l’hébergement du détenu[412] ». Selon les données obtenues par les chercheur·euse·s à la suite de demandes d’accès à l’information, le forfait journalier versé par l’ASFC pour la détention de migrant·e·s dans des prisons provinciales varie selon les provinces[413].
|
Province |
Forfait journalier (en dollars canadiens) |
|
Colombie-Britannique |
235,00 $ CA |
|
Manitoba |
293,60 $ CA |
|
Nouveau-Brunswick |
231,33 $ CA pour les hommes ; 375,16 $ CA pour les femmes |
|
Nouvelle-Écosse |
392,30 $ CA |
|
Île-du-Prince-Édouard |
288,33 $ CA |
|
Québec |
270,28 $ CA pour les hommes ; 301,18 $ CA pour les femmes |
|
Saskatchewan |
203,74 $ CA |
Les données du gouvernement fédéral indiquent que le coût des programmes de détention de l’ASFC a augmenté entre l’exercice 2018-2019 et l’exercice 2019-2020, passant de 65,26 millions à 71,38 millions de dollars canadiens[414].
Le Groupe de travail des Nations Unies sur la détention arbitraire a affirmé que les conditions de détention devaient être humaines, adaptées et respectueuses, compte tenu du caractère non punitif de la détention liée à l’immigration[415]. Il a également indiqué :
Les demandeurs d’asile et autres migrants en situation irrégulière ne doivent pas être incarcérés dans des lieux tels que des postes de police, des maisons d’arrêt, des prisons ou d’autres établissements carcéraux car ceux-ci sont conçus pour les personnes qui ont affaire à la justice. Les migrants ne doivent pas être mélangés avec les autres détenus incarcérés pour des raisons pénales[416].
En 2016, la commissaire en chef de la Commission ontarienne des droits de la personne a déclaré : « La détention de personnes immigrantes n’ayant été reconnues coupables d’aucun délit et ne purgeant aucune peine dans des établissements carcéraux provinciaux conçus pour assurer la détention de contrevenants au Code criminel pose un problème fondamental et systémique[417] ». La pratique du Canada consistant à placer des personnes migrantes dans des prisons provinciales est une violation du droit international relatif aux droits humains car l’incarcération dans de tels établissements est par nature punitive et n’est pas adaptée à la détention dans le contexte de l’immigration ni autorisée par les normes internationales.
La détention pour une durée indéterminée
Lorsque vous êtes condamné à une peine d’emprisonnement, la date de votre libération est votre seule bouée.... C’est la seule chose à laquelle vous pouvez vous raccrocher. Sans cela, vous partez à la dérive.... Pour les migrants détenus, l’inconnu est une torture, c’est de la cruauté mentale. C’est pire qu’une violation des droits humains[418].
— « Jason », migrant ayant été détenu dans une prison provinciale de l’Ontario en 2020
La législation canadienne ne prévoit aucune limite de durée pour la détention liée à l’immigration. Depuis 2016, le Canada a maintenu plus de 300 migrant·e·s en détention pendant plus d’un an[419].
Souvent, les audiences régulières de contrôle des motifs de détention ne constituent pas une garantie suffisante contre la détention illimitée car les autorités peuvent examiner à maintes reprises les solutions de rechange à la détention – comme l’exige la loi[420] – sans pour autant ordonner une remise en liberté. Si la législation impose aussi aux autorités de tenir compte de la « durée de la détention » dans leurs décisions quant à la détention[421], il n’existe aucune norme précise indiquant ce qui est considéré comme une détention de longue durée. Une avocate de Toronto a constaté : « Tant qu’une personne n’est pas détenue depuis des mois, les autorités ne considèrent pas qu’il s’agit d’une détention prolongée[422]. »
Il arrive que des détenu·e·s ne puissent pas être expulsé·e·s du Canada pour diverses raisons : il est parfois impossible de déterminer leur pays de nationalité, il peut s’agir de personnes apatrides, ou encore leur pays d’origine refuse dans certains cas de les reconnaître comme ressortissant·e·s ou de leur délivrer un document de voyage. Ces impasses administratives – auxquelles les personnes détenues ne sont pour rien – peuvent durer des années et donner lieu à un maintien prolongé en détention. La durée la plus longue constatée au Canada est de 11 ans ; elle concernait un homme visiblement en situation de handicap psychosocial, qui a été détenu dans une prison provinciale et dont les autorités n’ont pas pu établir l’identité[423].
Les migrant·e·s ayant été détenu·e·s ont dans leur immense majorité indiqué que l’aspect le plus dévastateur de leur détention était sa durée indéterminée et le fait de ne pas du tout savoir quand elle se terminerait. Un ancien détenu a souligné : « Quand vous n’avez pas de date de fin en vue, ça crée de l’angoisse, qui vient s’ajouter à celle que tout le monde ressentirait dans une telle situation.… C’est très dur mentalement. Beaucoup de gens pensent à se suicider. Vous ne savez absolument pas quand vous allez sortir. C’était ça le pire [dans la détention][424]. »
Le Groupe de travail des Nations Unies sur la détention arbitraire a souligné que la législation devait établir une durée maximale de la détention pendant une procédure aux fins de contrôle de l’immigration, et que passé ce délai légal la personne détenue devait être automatiquement libérée[425]. Le Comité des droits de l’homme des Nations Unies a pour sa part émis l’observation suivante : « L’incapacité d’un État partie de procéder à l’expulsion d’une personne parce qu’elle est apatride ou à cause d’autres obstacles ne justifie pas la rétention pour une durée indéterminée[426]. » En 2015, dans son évaluation de la mise en œuvre du Pacte international relatif aux droits civils et politiques par le Canada, le Comité des droits de l’homme de l’ONU s’est dit « préoccupé par le fait qu’une personne entrée illégalement sur le territoire de l’État partie peut être placée en rétention pendant une période indéterminée » et a affirmé que le Canada devrait faire en sorte « qu’une durée maximale raisonnable de rétention soit fixée[427] ». La pratique du Canada consistant à incarcérer des personnes migrantes sans limite légale de durée de la détention est une violation du droit international.
Les solutions de rechange à la détention
La législation canadienne impose aux autorités d’examiner toutes les solutions de rechange à la détention (SRD) raisonnables avant de prendre une décision quant à la détention[428]. Les agent·e·s de l’ASFC et les juges de la Section de l’immigration ont tout pouvoir d’imposer les conditions qu’ils estiment nécessaires à la libération d’une personne détenue[429]. Les directives du président de la CISR sur la détention proposent une liste de conditions que les juges peuvent imposer aux détenu·e·s à leur libération, comme le respect d’un couvre-feu, l’interdiction d’utiliser un téléphone portable ou un ordinateur, l’absence de connexion Internet à leur domicile, l’autorisation pour le personnel de l’ASFC ou tout autre personnel désigné d’accéder à leur lieu de résidence, l’obligation de résider dans un centre communautaire ou un centre de réadaptation, l’obligation de demeurer à l’intérieur ou à l’extérieur d’une zone géographique donnée, et le port d’un bracelet électronique permettant de suivre leurs déplacements[430].
Les conditions de libération peuvent aussi inclure la remise d’un dépôt (caution) ou d’une garantie financière[431]. Dans ce cas, la personne caution ou garante doit fournir son adresse et informer les autorités de tout changement d’adresse[432].
Dans certains cas, les autorités n’acceptent de libérer des personnes migrantes qu’à condition qu’une organisation tierce accepte de les suivre au sein de la collectivité[433]. En 2018, l’ASFC a élargi la disponibilité de ce type de programmes[434], établissant de nouveaux partenariats avec la Société John Howard du Canada et l’Armée du salut en vue de mettre en place un programme de Gestion des cas et de surveillance dans la collectivité (GCSC), et renouvelant son contrat avec le Programme de cautionnements de Toronto[435].
Les personnes migrantes anciennement détenues qui ne respectent pas une ou plusieurs de leurs conditions de libération – de façon accidentelle ou délibérée – peuvent être réarrêtées et réincarcérées. Avant de les libérer, les autorités prennent leurs empreintes digitales et saisissent leurs papiers d’identité[436].
Suivi et surveillance dans la communauté
Selon une universitaire de l’université de Toronto qui étudie la détention liée à l’immigration au Canada et en Europe, les solutions de rechange à la détention « font en sorte que les gens continuent d’être étroitement contrôlés pendant une durée indéterminée, ce qui officialise un système de surveillance même après la libération[437] ». Un activiste ayant représenté et travaillé avec des centaines de migrant·e·s détenu·e·s a constaté que les SRD augmentaient le niveau d’intrusion et de surveillance au sein des communautés migrantes et réfugiées[438]. Selon ce même activiste, beaucoup de personnes migrantes sont soumises, après leur libération, à des programmes de SRD et à des obligations de se présenter aux autorités pendant des années, le temps que les services gouvernementaux traitent leur demande d’asile ou d’immigration[439].
Les conditions de libération très strictes – comme l’obligation de se présenter une fois par semaine à l’ASFC, les couvre-feux et l’obligation de vivre à une adresse précise et de porter un bracelet électronique – exposent les personnes migrantes au risque et à l’idée terrifiante d’être réarrêtées, même si elles ne sont pas légalement expulsables. Quatre avocat·e·s ont indiqué que beaucoup de leurs client·e·s avaient peur des agent·e·s de l’ASFC longtemps après leur libération et que leurs conditions strictes de libération les empêchaient de reprendre une vie normale[440]. Un avocat a décrit un client qui est sorti de détention et doit se présenter régulièrement à l’ASFC : « [Il] me dit que la semaine précédant son rendez-vous, il est tellement stressé qu’il n’arrive pratiquement pas à se concentrer au travail[441]. » Une autre avocate a évoqué un client qui, trois ans après sa libération, doit toujours se présenter aux autorités une fois par semaine : « Il a le sentiment d’être privé de sa dignité, d’être toujours sous leur coupe et perpétuellement puni[442]. »
Selon un activiste de Toronto, le recours à des personnes se portant caution fait aussi entrer l’agence gouvernementale dans les foyers et les communautés, les proches des migrant·e·s libéré·e·s se retrouvant à devoir les surveiller au nom de l’ASFC[443]. Cela peut créer des tensions au sein des réseaux d’entraide familiaux et communautaires et rendre impossible toute vie indépendante. Une avocate a raconté que les conditions de libération d’un de ses clients lui interdisaient ne serait-ce que de faire le tour du pâté de maison sans être accompagné[444]. L’illusion de la liberté face à des conditions de libération si sévères a inspiré cette remarque à cet ancien détenu : « J’envie les chiens ici, on les emmène en promenade plusieurs fois par jour[445]. »
Les solutions de rechange à la détention ne devraient pas être utilisées comme des formes alternatives de détention ; elles ne devraient pas non plus devenir des alternatives à la libération[446]. Selon le rapporteur spécial sur les droits de l’homme des migrants, « les mesures non privatives de liberté doivent se conformer aux principes pertinents du droit international, parmi lesquels les principes de non-discrimination, de nécessité et de proportionnalité, et ne doivent pas empêcher les personnes d’exercer leurs autres droits humains, dont le droit à la santé et à l’éducation[447] ».
Les obstacles à la libération des personnes migrantes en situation de handicap psychosocial
Les migrant·e·s qui présentent des handicaps psychosociaux peuvent se heurter à des obstacles supplémentaires empêchant leur libération. Leur remise en liberté peut être conditionnée à leur placement dans des établissements de soins. Dans ce type de cas, on peut craindre que la détention liée à l’immigration ne soit simplement remplacée par un internement médical non volontaire et des soins forcés, en violation des droits des personnes concernées, notamment leurs droits au respect de la vie privée et à l’intégrité corporelle.
Quoi qu’il en soit, le nombre de places dans ce type d’établissement est limité[448]. Le manque d’aides adaptées au sein de la collectivité et l’absence d’équité de traitement des personnes en situation en handicap psychosocial est un problème de longue date qui touche aussi bien les ressortissant·e·s canadien·ne·s que les non-ressortissant·e·s[449]. Toutefois, comme l’a fait remarquer une avocate de Toronto : « Pour beaucoup de personnes étrangères ayant des handicaps psychosociaux, la solution privilégiée [pour remédier au manque de services au sein de la collectivité] semble être un placement en détention liée à l’immigration[450]. »
Le manque de prise en charge médicale au sein de la collectivité peut aussi devenir un obstacle à la libération des migrant·e·s en situation de handicap psychosocial. Selon une avocate d’Ottawa, « La question de savoir qui va payer les soins revient toujours[451]. » Deux avocates ayant représenté des dizaines de personnes migrantes ont indiqué que, dans le cas de détenu·e·s qui présentent des handicaps psychosociaux, l’ASFC argumentait souvent en faveur de leur maintien en détention au motif qu’ils recevaient en prison un traitement médical dont ils ne bénéficieraient plus dans la collectivité[452].
Selon six avocat·e·s, la libération est aussi souvent retardée car il revient généralement aux avocat·e·s d’élaborer le plan de remise en liberté, or dans certains cas le tribunal demande que ce plan contienne un dispositif de supervision ou un programme d’hébergement et de soins menés par des organisations tierces, auxquels il est très difficile d’accéder[453].
L’élaboration des plans de remise en liberté comprenant un hébergement en établissement de soins est particulièrement difficile car les organismes qui fournissent de tels programmes exigent souvent une évaluation préalable pour déterminer si la personne y est éligible, or il est impossible de mener ce type d’évaluation en détention[454]. Une avocate d’Ottawa a indiqué : « Je ne suis pas formée pour rechercher des programmes d’hébergement et de soins afin d’élaborer des plans de remises en liberté, mais une grande partie de mon travail consiste à mendier des SRD[455] ». Une avocate de Montréal a témoigné dans le même sens[456].
Le fait que l’ASFC soit l’intermédiaire obligé pour accéder aux solutions de rechange à la détention pose aussi d’autres problèmes pour les personnes migrantes détenues qui sont en situation de handicap psychosocial.
Les services fournis par les partenaires communautaires de l’ASFC concernent, entre autres, l’obligation de se présenter en personne, le soutien en matière de santé physique et mentale, le soutien aux personnes touchées par des addictions, l’aide à l’emploi et au logement, l’aide à la famille et à l’enfance, et la résidence obligatoire[457]. Ces partenaires communautaires ont l’obligation contractuelle d’étudier le dossier de « tous les candidats qui leur sont référés par l’ASFC ou la CISR[458] ». Cependant, lors d’un entretien avec les chercheur·euse·s réalisé en mars 2021, le vice-président de la Section de l’immigration de la CISR a déclaré : « [Les juges du tribunal] peuvent demander à l’ASFC d’envisager un placement [avec un partenaire communautaire dans le cadre de programmes de GCSC] mais ne prennent pas eux-mêmes contact avec ces programmes. Ils demandent à l’ASFC d’examiner la question et de leur en rendre compte [lors d’une prochaine audience][459]. » Six avocates et un activiste de différentes régions du pays ont signalé que les partenaires de l’ASFC dans le cadre des programmes de GCSC ne pouvaient prendre en charge qu’un nombre extrêmement limité de personnes et qu’il y avait un véritable problème avec le fait que l’ASFC soit l’intermédiaire obligé[460]. En réponse à une demande des chercheur·euse·s sur les capacités du programme de GCSC, l’agence a indiqué qu’il existait au total pour tout le pays 19 « lits à haute intervention » dans les programmes de résidence obligatoire[461].
En outre, lors d’un entretien de février 2021 avec les chercheur·euse·s des agent·e·s de l’ASFC ont indiqué que les personnes détenues devaient être dans un état « stable » avant de pouvoir être libérées dans le cadre de programmes de surveillance dans la collectivité sous contrat avec l’ASFC, reconnaissant qu’ils essayaient « d’utiliser des médicaments pour obtenir cette stabilité » en détention avant la libération[462]. Interrogée par les chercheur·euse·s sur la politique de l’ASFC en matière d’orientation des migrant·e·s détenu·e·s vers les partenaires des programmes de GCSC, l’agence a confirmé que la santé mentale était l’un des éléments pris en compte[463]. Selon une avocate d’Ottawa, pour évaluer si un·e détenu·e est éligible à des SRD, les agent·e·s de l’ASFC « posent des questions très intrusive sur sa santé mentale », qu’ils peuvent ensuite utiliser pour justifier le maintien en détention[464]. Une avocate de Montréal a raconté qu’un de ses clients s’était vu refuser une prise en charge au sein de la collectivité par l’un des partenaires sous contrat avec l’ASFC en raison de ses handicaps psychosociaux et que, pour cette raison, il était resté en détention[465].
Par ailleurs, le Canada ne prend pas toujours des mesures suffisantes pour proposer des moyens d’hébergement raisonnables aux personnes migrantes porteuses de handicap afin de les aider, à leur sortie de détention, à respecter leurs conditions de libération, telles que les couvre-feux et les obligations de se présenter. Selon un représentant juridique et activiste ayant travaillé avec des centaines de migrant·e·s détenu·e·s, beaucoup de collectivités ne disposent pas de programmes, de ressources ni de financements suffisants pour apporter une aide véritable aux ancien·ne·s détenu·e·s, notamment les personnes qui ont des handicaps psychosociaux[466]. Les ancien·ne·s détenu·e·s qui ne respectent pas une des conditions de leur libération – même de façon accidentelle –, peuvent être réarrêtés par l’ASFC, et il leur devient alors plus difficile d’obtenir une nouvelle libération[467].
Les obstacles à la libération auxquels se heurtent les détenu·e·s en situation de handicap psychosocial sont contraires aux obligations juridiques internationales du Canada en termes de respect de la non-discrimination et du droit à la liberté. Ils portent aussi atteinte au droit au meilleur état de santé physique et mentale susceptible d’être atteint, qui est inscrit dans de nombreux instruments internationaux relatifs aux droits humains, tels que le PIDESC, la Convention relative aux droits de l’enfant, la Convention sur l’élimination de toutes les formes de discrimination à l’égard des femmes et la CDPH[468]. Selon le Comité des droits économiques, sociaux et culturels de l’ONU, organe international d’experts qui a pour mission de suivre la mise en œuvre du PIDESC, le droit à la santé suppose à la fois des libertés et des droits :
Les libertés comprennent le droit de l’être humain de contrôler sa propre santé et son propre corps, … ainsi que le droit à l’intégrité, notamment le droit de ne pas être soumis à la torture et de ne pas être soumis sans son consentement à un traitement ou une expérience médicale. D’autre part, les droits comprennent le droit d’accès à un système de protection de la santé qui garantisse à chacun, sur un pied d’égalité la possibilité de jouir du meilleur état de santé possible[469].
Le consentement éclairé est l’élément central du droit à la santé, en particulier en ce qui concerne les personnes présentant des handicaps psychosociaux. Le rapporteur spécial de l’ONU sur le droit à la santé a souligné :
Le consentement éclairé n’est pas seulement l’acceptation d’une intervention médicale mais également une décision volontaire et suffisamment étayée, protégeant le droit du patient de prendre part à la prise de décisions médicales et imposant des devoirs et des obligations aux prestataires de soins. Ses justifications normatives éthiques et juridiques se trouvent dans la promotion de l’autonomie du patient, l’autodétermination, l’intégrité physique et le bien-être[470].
Dans son rapport de 2018, la rapporteuse spéciale de l’ONU sur les droits des personnes handicapées a appelé les États à veiller à ce que tous les services en matière de santé « soient construits autour d’une conception du handicap fondée sur les droits de l’homme, ne soient pas discriminatoires, prévoient l’obtention du consentement préalable éclairé des patients avant tout traitement médical, respectent la vie privée des patients et soient exempts de torture ou d’autres traitements cruels, inhumains ou dégradants[471] ». La CDPH exige aussi clairement le consentement libre et éclairé des personnes handicapées avant tout traitement médical, et dispose que les services de santé doivent être fournis sans discrimination liée au handicap[472].
Les États parties ont aussi l’obligation de respecter le droit des non-ressortissant·e·s de jouir d’un niveau de santé physique et mentale adéquat, et doivent s’abstenir « d’empêcher ou de limiter leur accès à des services de santé préventifs, curatifs et palliatifs[473] ». Comme l’a indiqué le Comité des droits économiques, sociaux et culturels, les installations, biens et services en matière de santé doivent être accessibles sans discrimination, en particulier « aux groupes de populations les plus vulnérables ou marginalisés », dont les personnes en situation de handicap[474].
Recommandations
Recommandation générale
Au Premier ministre du Canada
- Abolir progressivement la détention liée à l’immigration. Nul ne devrait, en aucune circonstance, être traité de façon punitive pour des raisons liées à l’immigration, et notamment être détenu à l’isolement cellulaire, ou dans des établissements destinés aux auteurs d’infractions pénales tels que des centres de détention, des prisons ou des postes de police, ou dans tout autre établissement de type carcéral.
Principales mesures à prendre pour mettre en œuvre cette recommandation générale
À Sécurité Publique Canada, à l’Agence des services frontaliers du Canada, et aux ministères provinciaux des services correctionnels
- Cesser d’utiliser les prisons provinciales et d’autres établissements de détention pénale pour incarcérer des personnes migrantes. Annuler tous les accords et contrats entre les autorités fédérales et provinciales concernant la détention de personnes migrantes dans des prisons provinciales.
- Transformer les centres de surveillance de l’immigration en établissements d’accueil ouverts et sûrs. En particulier, les personnes migrantes placées dans ces centres devraient avoir le droit d’utiliser leurs téléphones portables et leurs appareils électroniques personnels, ne pas se voir imposer des horaires de repas et de réveil, et être autorisées à recevoir des visites en toute intimité.
- Remplacer la détention par une gestion des cas dans la collectivité pour les migrant·e·s dont le dossier est en cours d’examen par les services de l’immigration. Développer les programmes locaux proposant, au sein de la collectivité, des solutions de rechange à la détention visant à apporter une aide plutôt qu’à exercer une surveillance, et qui soient mises en œuvre par des organisations locales à but non lucratif indépendamment de l’ASFC.
- Mettre un terme à la pratique de la détention à l’isolement cellulaire des personnes migrantes.
- Cesser d’utiliser des menottes et des chaînes contre les personnes migrantes détenues.
- Assurer des services de santé mentale de proximité efficaces, solidaires, à but non lucratif et culturellement adaptés, qui soient disponibles et accessibles à toutes et tous quelle que soit leur nationalité. Envisager de redéployer une partie du budget de l’ASFC pour financer des services médicaux de proximité et des solutions de rechange à la détention mises en œuvre avec la participation d’organisations locales.
- Élaborer, en étroite et transparente collaboration avec les communautés de couleur, un véritable plan de lutte contre le racisme systémique au sein de l’ASFC et du système de détention des personnes migrantes, comprenant notamment la collecte et la publication de données anonymisées à propos des personnes migrantes détenues, ventilées par race et origine ethnique et recueillies avec leur consentement libre et éclairé.
- Publier le budget annuel de l’ASFC en détaillant les principales dépenses. Rendre publiques toutes les autres dépenses liées à la détention des personnes migrantes, notamment tous les frais payés aux provinces en échange de l’accueil de migrant·e·s dans des établissements provinciaux.
- Conformément aux consignes du Groupe de travail des Nations Unies sur la détention arbitraire, cesser de placer en détention des personnes migrantes en situation de handicap physique ou psychosocial. Les handicaps des personnes doivent par ailleurs être pris en compte lorsqu’il s’agit de déterminer la légalité, la nécessité et la proportionnalité de toute mesure non privative de liberté imposée dans le cadre de la législation relative à l’immigration.
- Veiller à ce que tous les agent·e·s de l’ASFC, les membres du personnel des centres de surveillance de l’immigration et les autorités en charge des prisons provinciales reçoivent une formation régulière et efficace sur la manière de se comporter avec les personnes porteuses de différents handicaps, et en particulier sur la manière de communiquer avec celles qui ont des handicaps psychosociaux ou intellectuels et de répondre à leurs besoins. Ces agent·e·s devraient bénéficier non seulement d’une formation initiale mais aussi d’une formation continue à ce sujet. Ces formations devraient être élaborées en consultation avec des personnes en situation de handicap.
- Améliorer les services de santé mentale dans les centres de surveillance de l’immigration et les prisons provinciales, en veillant à ce que ces services soient accessibles à tout le monde, indépendamment de l’existence ou non d’un diagnostic de handicap, à ce qu’il y ait suffisamment de professionnel·le·s qualifié·e·s de la santé mentale, à ce que les traitements soient fondés sur un consentement libre et éclairé, à ce que les moyens soient suffisants et à ce que les soins soient de même qualité que ceux disponibles en médecine de ville.
- Faire en sorte que les conclusions complètes des inspections d’établissements et des enquêtes sur les décès en détention ou liés à des traitements subis en détention soient rendues publiques au plus tard trois mois après avoir été établies. Rendre publiques les informations sur les tentatives de suicide, les grèves de la faim, les interruptions de programmes de travail, les placements à l’isolement, le recours à la force et tout autre événement significatif impliquant des migrant·e·s détenu·e·s dans les prisons provinciales et les centres de surveillance de l’immigration.
- Exiger de tous les établissements accueillant des personnes migrantes, y compris les prisons provinciales et les centres de surveillance de l’immigration, qu’ils autorisent les organisations à but non lucratif à rencontrer les migrant·e·s détenu·e·s afin de les conseiller sur leurs droits, de leur proposer des programmes correctionnels et de contrôler leurs conditions de détention.
À Immigration, Réfugiés et Citoyenneté Canada et à la Section de l’immigration de la Commission de l’immigration et du statut de réfugié du Canada
- Conformément à la Convention relative aux droits des personnes handicapées, garantir à toutes les personnes en situation de handicap qui sont détenues pour des raisons liées à l’immigration le droit à la capacité juridique et à une procédure régulière, y compris aux personnes porteuses d’un handicap psychosocial ou intellectuel, et en particulier :
- clarifier et limiter les rôles et responsabilités des représentant·e·s désigné·e·s afin de favoriser la prise de décisions favorables aux personnes migrantes détenues ; empêcher strictement les représentant·e·s désigné·e·s de prendre à la place des détenu·e·s des décisions empiétant sur leur capacité juridique ;
- veiller à ce que les personnes détenues puissent choisir ou approuver le choix de leur représentant·e désigné·e et à ce qu’elles puissent déposer un recours si celui-ci ou celle-ci ne leur convient pas ;
- nommer un·e médiateur·trice (« Ombudsperson ») chargé·e de superviser les représentant·e·s désigné·e·s et de veiller à ce que la volonté et les préférences des personnes détenues soient respectées durant le processus de prise de décision assistée, et à ce que les droits des détenu·e·s à la santé, à une procédure régulière et à la capacité juridique soient protégés ;
- libérer les personnes détenues si l’État n’est pas en mesure de garantir leur droit à la capacité juridique et à une procédure régulière.
- Modifier la Loi sur l’immigration et la protection des réfugiés afin de limiter la durée de la détention.
- Conformément aux consignes du Groupe de travail des Nations Unies sur la détention arbitraire, modifier le Règlement sur l’immigration et la protection des réfugiés afin d’interdire la détention des personnes migrantes en situation de handicap physique ou psychosocial. Les handicaps des personnes doivent être pris en compte lorsqu’il s’agit de déterminer la légalité, la nécessité et la proportionnalité de toute mesure privative ou non privative de liberté imposée dans le cadre de la législation relative à l’immigration ; il convient notamment d’évaluer les conséquences de ces mesures sur la santé mentale.
- Modifier la Loi sur l’immigration et la protection des réfugiés afin d’interdire la détention des enfants et le fait de séparer des enfants de leurs parents détenus, en vertu du principe selon lequel la détention et la séparation des familles ne sont jamais dans l’intérêt supérieur de l’enfant.
- Développer les programmes locaux proposant, au sein de la collectivité, des solutions de rechange à la détention visant à apporter une aide plutôt qu’à exercer une surveillance, et qui soient mises en œuvre par des organisations locales à but non lucratif indépendamment de l’ASFC. Les services d’aide devraient adopter une vision globale des besoins de la personne, notamment en termes de logement, de soins médicaux, de services de santé mentale, d’éducation, d’emploi, de besoins des enfants et de représentation juridique.
Au Cabinet du Canada
- Retirer la déclaration et la réserve émises par le Canada à propos de l’article 12 de la Convention relative aux droits des personnes handicapées.
- Mener une enquête nationale indépendante sur le système de détention des personnes migrantes, en mettant l’accent sur le racisme systémique et la discrimination à l’égard des personnes en situation de handicap, en particulier celles qui sont porteuses de handicaps psychosociaux réels ou présumés.
- Signer et ratifier le Protocole facultatif se rapportant à la Convention contre la torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants, afin d’autoriser l’inspection internationale de tous les lieux de détention.
- Créer un organe indépendant chargé de superviser l’ASFC et d’enquêter sur ses actes, auprès duquel les personnes migrantes détenues pourraient déposer plainte en cas d’allégations de violences, de négligence ou d’autres préoccupations relatives aux droits humains, afin que les autorités aient à rendre des comptes. Cet organisme devra avoir le pouvoir d’ordonner de véritables réparations et sanctions et d’engager ses propres enquêtes et évaluations, notamment sous la forme d’inspections surprises, et ne pas agir uniquement en cas de plainte. Il devra aussi permettre à des tiers, comme des organisations non gouvernementales, de porter plainte aussi bien sur des cas individuels que sur les politiques et les pratiques de l’ASFC.
Remerciements
Hanna Gros, consultante auprès de la division Droits des personnes handicapées de Human Rights Watch, a mené les recherches et a rédigé ce rapport, avec le soutien conséquent de Justin Mohammed, chargé de campagne Droit et politique à Amnistie internationale, et de Samer Muscati, directeur adjoint de la division Droits des personnes handicapées de Human Rights Watch.
Le rapport a été révisé à Human Rights Watch par Heather Barr, codirectrice par intérim de la division Droits des femmes ; Jane Buchanan, directrice adjointe de la division Droits des personnes handicapées ; Farida Deif, directrice Canada ; Bill Frelick, directeur de la division Droits des réfugié·e·s et migrant·e·s ; Michael Garcia Bochenek, conseiller juridique senior de la division Droits des enfants ; Clara Long, directrice adjointe du programme États-Unis ; Carlos Ríos Espinosa, chercheur senior et responsable de plaidoyer à la division Droits des personnes handicapées ; Brian Root, responsable senior de l’analyse de données ; Jordana Signer, chercheuse à la division Droits des réfugié·e·s et migrant·e·s ; et une personne spécialiste de la santé. À Amnistie internationale, il a été révisé par Brian Griffey, chercheur et conseiller régional (Amérique du Nord), Carolina Jiménez Sandoval, directrice adjointe de la recherche sur les Amériques, et Erika Guevara-Rosas, directrice pour les Amériques.
Maria McFarland Sánchez-Moreno et Aisling Reidy, conseillères juridiques seniors à Human Rights Watch, et Francesca Pizzutelli, directrice adjointe et responsable du programme Droits des réfugié·e·s et migrant·e·s à Amnistie internationale, ont vérifié le rapport sur le plan juridique ; Babatunde Olugboji, directeur de programme adjoint à Human Rights Watch, l’a vérifié sur le plan programmatique.
Nous remercions vivement les sept relecteur·trice·s expert·e·s, dont Audrey Macklin, Jenny Jeanes, Laura Best, Michael Bach et Molly Joeck, pour leurs conseils et retours précieux.
Vino Wijeyasuriyar, chercheuse au Samuel Centre for Social Connectedness, Elsie Tellier, stagiaire auprès de la division Droits des personnes handicapées de Human Rights Watch, Jaya Bordeleau-Cass, stagiaire en droit à Aminstie internationale, ainsi que Laksmiina Balasubramaniam, Sacha Poirier-Feraud et Fazan Baig, trois étudiant·e·s en Droit travaillant avec Amnistie internationale, ont apporté une aide importante pour les recherches.
La mise en page, la maquette et la production ont été coordonnées par le personnel de Human Rights Watch : Camilo Moraga-Lewy, collaborateur des divisions Amériques et Droits des personnes handicapées ; Fitzroy Hepkins, chargé de production ; Travis Carr, coordonnateur Photos et publications ; et Paula Beegan, consultante à la division Droits des personnes handicapées.
Estelle Bloom, consultante principale de Making It Clear, a créé la version « lecture facile » de ce rapport.
Le rapport a été traduit d’anglais en français par Cécile Joly, traductrice indépendante, et Sabine Vandame, traductrice/réviseuse et coordonnatrice de l’équipe de traduction française du Centre de ressources linguistiques d’Amnistie internationale. La version française du rapport a été relue pour Human Rights Watch par Paula Beegan et par Peter Huvos, rédacteur web.
Human Rights Watch et Amnistie internationale tiennent aussi à remercier les nombreux·se·s activistes, prestataires de services, avocat·e·s et professionnel·le·s de la santé mentale travaillant dans les domaines des droits des personnes réfugiées et migrantes et de la santé mentale qui leur ont apporté leur éclairage et leurs analyses ou toute autre forme d’aide.
Nous remercions tout particulièrement la Fondation de la famille Samuel et Kathryn Cottingham pour leur soutien financier, qui a rendu ces recherches et ce rapport possibles.
Enfin et surtout, Human Rights Watch et Amnistie internationale remercient toutes les personnes qui ont accepté de partager avec elles leurs expériences, leurs points de vue et leurs préoccupations. Nous vous sommes reconnaissants de votre confiance et de votre courage.