Résumé
En juillet 2016, « Rouhiya », alors âgée de 15 ans, a fui son père qui abusait d’elle sexuellement pour chercher refuge chez un homme de 23 ans qui lui avait promis de l’épouser[1]. Peu après, a-t-elle rapporté, cet homme l’a enfermée, droguée et violée collectivement, avec trois autres hommes. Rouhiya est restée en captivité pendant deux semaines jusqu’à ce que la police la trouve et la ramène au domicile dont elle avait tenté de s’échapper. Dans sa déclaration à la police, Rouhiya a révélé qu’elle connaissait un des agresseurs. Les policiers l’ont alors arrêtée et envoyée à la prison nationale pour femmes en l’accusant d’avoir eu des relations sexuelles hors mariage (zina). « Je leur ai demandé : ‘Mais pourquoi ?’ Qu’est-ce que j’ai fait de mal ?’ », a rapporté Rouhiya. « Ils m’ont dit de garder le silence et de ne pas poser de questions. »
En Mauritanie, peu de survivantes d’agressions sexuelles osent s’exprimer. Celles qui, comme Rouhiya, les dénoncent aux autorités doivent se frayer un chemin dans un système dysfonctionnel qui décourage les victimes de porter plainte, peut leur valoir d’être à nouveau traumatisées, voire punies, et manque de services adéquats d’aide aux victimes.
Ce rapport fait état des obstacles institutionnels, juridiques et sociaux que rencontrent les survivantes lorsqu’elles veulent rapporter à la police des incidents d’agressions sexuelles, amener les coupables devant la justice et obtenir un soutien médical et psychosocial. Human Rights Watch a mené des entretiens avec 12 filles et 21 femmes qui ont décrit un ou plusieurs incidents d’agressions sexuelles. Nos chercheurs se sont rendus à la prison nationale pour femmes et se sont entretenus avec trois femmes détenues après avoir été inculpées de zina, dont deux ont déclaré avoir subi des violences sexuelles.
La pression et la stigmatisation sociales, que ce soit dans la sphère privée ou la communauté, peuvent être des obstacles majeurs à surmonter pour les survivantes de violences sexuelles. Ainsi Mariama a relaté qu’elle a été violée par un chauffeur de taxi à l’âge de 20 ans mais qu’elle était trop inquiète pour oser parler de l’agression à ses parents : « Alors que j’étais enceinte de huit mois, ma mère s’en est rendu compte et m’a demandé comment c’était arrivé. C’est à ce moment-là que je lui ai raconté le viol », a déclaré Mariama. « Mon père s’est mis dans une rage folle. Il m’a amenée au commissariat et a dit aux policiers que sa fille devait être enfermée parce qu’elle avait couché avec un homme et qu’il ne la voulait plus chez lui. »
Malgré l’adoption en 2017 d’une nouvelle loi sur la santé reproductive et d’un Code général de l’enfance, la loi mauritanienne ne définit et ne pénalise pas convenablement les violences sexuelles. Le manque de définition du viol et d’autres formes d’agression sexuelle dans le droit national, allié à la criminalisation des relations sexuelles consensuelles, augmente le risque que les survivantes elles-mêmes soient poursuivies. En effet, si les femmes ou filles n’arrivent pas à convaincre les autorités judiciaires de la nature non consensuelle d’un rapport sexuel, d’accusatrices, elles peuvent se muer en accusées.
Par ailleurs, la Mauritanie manque de programmes et de centres de prise en charge financés par l’État et en mesure d’assurer aux survivantes la sécurité, la possibilité d’intenter une action en justice et le rétablissement. Le gouvernement n’a ni créé ni financé de refuges offrant des solutions d’hébergement aux survivantes qui veulent, ou doivent, partir de chez elles après une agression, ou aux femmes sortant de prison qui, après avoir été reconnues coupables de zina, n’ont nulle part où aller.
Outre la pression sociale les incitant à passer sous silence les agressions sexuelles, les survivantes font face à des barrières institutionnelles, notamment des procédures d’enquête policière et judiciaire qui ne tiennent pas compte des questions de genre, ne respectent pas la vie privée ou la confidentialité et peuvent virer à l’interrogatoire dans le but de cerner la moralité de la plaignante. Ainsi Zahra, une femme d’une vingtaine d’années, a rapporté avoir été violée par un voisin qui vivait dans le même habitat informel que sa famille et avait menacé de la tuer. L’assistante sociale qui l’a soutenue tout au long de la procédure judiciaire se souvient de l’attitude du procureur de la République qui a entendu Zahra après l’agression : « Il lui demandait : ‘Si tu n’étais pas consentante, pourquoi n’as-tu rien dit à tes parents ?’ Tu le connaissais ?’ », a-t-elle déclaré. « Lorsque Zahra s’est ouverte, il a rétorqué : ‘Ce n’est pas vrai. Tout ce que tu dis, c’est des mensonges, tu as fait ça de ton plein gré.’ »
Le manque d’experts en sciences médico-légales et de protocoles harmonisés pour la collecte de preuves, du côté des policiers aussi bien que des professionnels de santé, peut affaiblir les arguments d’une survivante au tribunal. La plupart des hôpitaux et des centres de santé publics n’offrent que des soins d’urgence limités et refusent souvent d’examiner les survivantes si elles ne disposent pas d’une réquisition de la police. Certains professionnels de santé semblent réticents à examiner les survivantes par crainte de représailles de la part des criminels présumés, au cas où leur évaluation médicale mènerait à des poursuites, voire à des condamnations. Les consultations médicales de suivi sont rares car beaucoup de survivantes n’ont pas les moyens financiers nécessaires pour bénéficier de soins médicaux d’urgence ou à long terme. Certaines familles n’ont même pas de quoi régler les frais de transport vers les centres médicaux. L’avortement, criminalisé, n’est autorisé que si la vie de la femme est en danger.
Les survivantes d’agressions sexuelles qui souhaitent porter plainte risquent également d’être poursuivies pour zina, ce qui non seulement punit les victimes mais surtout les dissuade de signaler l’agression sexuelle à la police. Une personne poursuivie pour zina peut être placée en détention provisoire. Si elle est reconnue coupable et condamnée à la flagellation ou à la mort par lapidation, elle peut rester en prison indéfiniment, puisque la Mauritanie observe depuis les années 1980 un moratoire sur les exécutions et les punitions corporelles prévues par le droit islamique. Alors que, selon la loi mauritanienne, le crime de zina ne s’applique qu’aux « musulmans majeurs », certains procureurs vont jusqu’à inculper des filles mineures de zina, surtout si elles sont enceintes, même si elles expliquent que leur grossesse est due à un viol. Les mineures peuvent se retrouver en détention provisoire ou condamnées à une peine de prison dans les mêmes établissements que les détenues adultes, ce qui viole le principe de séparation garanti par le droit international.
Non seulement l’accusation de zina viole le droit à la vie privée, mais en plus elle est appliquée d’une façon discriminatoire en fonction du sexe de la personne, puisque la grossesse sert de « preuve » du crime, même lorsque les femmes ou filles rapportent qu’elle est le résultat d’un viol. L’avocate mauritanienne Me Aïchetou Salma El Moustapha, qui représente des femmes et des filles soutenues par l’Association mauritanienne pour la santé de la mère et de l’enfant, a déclaré à Human Rights Watch : « Pour les affaires de viol de mineurs, lorsque la fille tombe enceinte, elle est condamnée pour zina, parce que dans l’imaginaire du juge, si la fille tombe enceinte, son corps est mûr – elle peut concevoir un enfant donc, du point de vue de la loi, elle est majeure. »
Ces dernières années, la Mauritanie a réalisé des avancées pour améliorer le paysage juridique pour les femmes, les filles et les survivantes de violences sexuelles. En mars 2016, le gouvernement a approuvé un projet de loi sur la violence fondée sur le genre, qui est toujours en attente d’un vote au parlement. Cette nouvelle loi définirait et punirait le viol et le harcèlement sexuel, créerait des sections spécifiques dans les tribunaux de première instance pour juger les affaires de violences sexuelles, consoliderait les procédures judiciaires pénales et civiles pour favoriser une compensation rapide des survivantes et permettrait aux organisations de la société civile de saisir les tribunaux au nom des survivantes.
Même s’il s’agit d’un pas en avant, le projet de loi actuel est insuffisant sur plusieurs points vis-à-vis des normes internationales : sa définition du viol est trop restrictive, il ne pénalise pas les autres formes d’agressions sexuelles, il contient une disposition qui criminalise explicitement les relations sexuelles consensuelles hors mariage et il omet d’abroger les dispositions du droit national qui criminalisent l’avortement.
Le droit international relatif aux droits humains oblige la Mauritanie à protéger les individus relevant de sa juridiction de toutes les formes de violence, y compris en prenant des mesures appropriées pour prévenir, examiner, punir et réparer les préjudices commis à l’encontre des droits d’une personne, aussi bien par des individus et entités privées que par des fonctionnaires et institutions d’État.
Les poursuites judiciaires intentées par l’État pour zina et son incapacité à faire en sorte que les personnes survivantes de violences sexuelles – essentiellement des femmes et des filles – aient accès à la justice, à des réparations effectives et à des centres de prise en charge, violent plusieurs droits humains. Parmi les droits qui sont bafoués, on compte le droit des femmes à la non-discrimination – puisque les violences sexuelles affectent les femmes de façon disproportionnée – ainsi que leur droit à l’intégrité et à l’autonomie corporelles, à la vie privée et à une réparation effective du tort subi.
Pour mieux protéger les femmes et les filles contre les violences sexuelles et remplir ses obligations internationales relatives aux droits humains, la Mauritanie devrait :
- Instaurer un moratoire immédiat sur les poursuites et la détention des personnes pour zina ;
- Libérer sans tarder toutes les personnes poursuivies pour zina actuellement détenues et entreprendre des mesures pour abolir la criminalisation de ces actes ;
- Adopter une loi sur les violences fondées sur le genre qui définit le crime de viol, pénalise toutes les autres formes de violences sexuelles, inflige des peines adéquates et proportionnées aux coupables présumés, dépénalise les relations sexuelles consensuelles, crée des unités spécialisées au sein du ministère public ainsi que des refuges dans tout le pays conçus pour héberger des femmes et des enfants à court, moyen et long terme, et enfin alloue des financements adaptés pour mettre en place ces réformes pour les;
- Renforcer sa capacité à proposer aux survivantes des espaces sûrs, au-delà des quelques options d’hébergement d’urgence que les organisations de la société civile offrent actuellement ;
- Élaborer des formations sur les méthodes d’enquête tenant compte des questions de genre, exiger des agents de police et procureurs qu’ils y assistent régulièrement et s’assurer qu’ils suivent, aux côtés des juges et des professionnels de santé, des protocoles médico-légaux spécifiques aux affaires d’agressions sexuelles ; et
- Garantir aux survivantes un meilleur accès aux soins médicaux, y compris au soutien psychologique.
Recommandations
À l’Assemblée nationale
- Examiner et adopter le projet de loi sur les violences fondées sur le genre, après en avoir modifié certaines dispositions afin qu’il se conforme aux obligations internationales de la Mauritanie vis-à-vis des droits humains, en veillant à ce que la loi prévoie toutes les mesures possibles adéquates permettant de prévenir et de dissuader les violences fondées sur le genre, d’en protéger les survivantes et d’en poursuivre les auteurs, notamment :
- Abroger les dispositions du Code pénal qui pénalisent les relations sexuelles consensuelles, les autres « crimes moraux » et l’avortement.
- Pénaliser toutes les formes d’agressions sexuelles (et tentatives d’agression) et de violences fondées sur le genre, notamment les mutilations génitales féminines et les mariages des enfants, précoces ou forcés.
- Prévoir dans le texte des définitions claires de notions telles que l’agression sexuelle, la tentative de viol, le viol (y compris le viol conjugal et la pénétration à l’aide d’un objet), les violences fondées sur le genre, le consentement et les pratiques inhumaines, en adéquation avec les normes internationales (voir plus loin).
- Prévoir des programmes obligatoires, périodiques et institutionnalisés de formation et de sensibilisation aux violences fondées sur le genre et aux réponses institutionnelles adéquates, à destination des agents de police, des procureurs, des juges et des professionnels de santé.
- Prévoir la création, au sein du ministère public, d’unités spécialisées dans les violences fondées sur le genre, tout en garantissant la protection des témoins et en prévenant la stigmatisation des survivantes de violences sexuelles.
- Prévoir un financement pour mettre en place des mesures prévues par la loi, en particulier la création de refuges proposant aux survivantes de violences sexuelles des solutions d’hébergement à court, moyen et long terme, des campagnes de sensibilisation, de nouveaux moyens d’analyse médico-légale, dont les tests ADN, et des unités/chambres spécialisées, au sein de la police, du ministère public et des tribunaux, destinées à traiter les affaires de violence sexuelle.
- Clarifier la façon dont ce projet de loi coexistera avec les autres lois existantes, comme le Code général de l’enfance, la loi sur la santé reproductive et le Code pénal.
- Abroger l’article 306 du Code pénal qui interdit, entre autres, l’outrage public à la pudeur et aux mœurs islamiques ; ce chef d’inculpation étant parfois utilisé comme article alternatif pour punir les relations sexuelles hors mariage.
- Abroger l’article 307 du Code pénal, qui criminalise les relations sexuelles consensuelles hors mariage (zina).
- Abroger l’article 293 du Code pénal et l’article 22 de la loi de 2017 sur la santé reproductive, qui criminalisent l’avortement.
- Amender l’article 309 du Code pénal afin de définir le viol soit comme une intrusion physique de nature sexuelle de n’importe quelle partie du corps de la victime par un objet ou un organe sexuel, qui a lieu sans consentement ou dans des circonstances de coercition – cette définition devra inclure explicitement le viol conjugal –, soit en prévoyant une infraction plus large, sous le nom d’agression sexuelle, définie comme une violation de l’intégrité et de l’autonomie corporelles, dont le degré de gravité dépend du préjudice subi, et en prévoyant des circonstances aggravantes, notamment l’âge de la victime, la relation entre l’agresseur et la victime, l’usage de menaces ou de violences, la présence de multiples agresseurs et la gravité des séquelles mentales et physiques de l’agression à long terme.
- Pénaliser les autres formes d’agressions sexuelles sans pénétration.
Au ministère des Affaires sociales et de la Famille
- Créer ou financer la création de refuges où les femmes et les enfants qui ont survécu à des violences sexuelles peuvent recevoir des services d’aide complets et accessibles à tous, aussi bien en milieu rural qu’urbain, dont une assistance juridique, une assistance psychosociale et des solutions d’hébergement.
- Augmenter l’appui financier et la supervision des centres existants, gérés par des organisations de la société civile, qui apportent des services d’aide directs aux survivantes de violences sexuelles, afin d’améliorer :
- Leur capacité d’accueil, y compris pour les personnes qui y passeront la nuit, et les services associés ; et
- Leur capacité à protéger les survivantes et leur personnel des menaces de représailles.
- Mettre en place ou financer la mise en place de services spécifiques, y compris un hébergement sûr, pour aider les femmes et filles qui ne veulent pas, ou ne peuvent pas, retourner chez elles ou loger chez des proches, soit parce qu’elles sont socialement exclues par leur statut de victimes d’agressions sexuelles en raison de perceptions liées à leur soi-disant transgression morale, soit à cause des risques d’agression qu’elles encourent chez elles. Les femmes et les filles accueillies dans les refuges doivent jouir de la liberté d’aller et venir et bénéficier d'une assistance pour rechercher des opportunités éducatives et professionnelles.
- Appuyer la mise en place de centres et services de transition adaptés aux besoins spécifiques des femmes et des filles sortant de prison.
- Mener des campagnes de sensibilisation aux différentes formes de violences sexuelles. Ces campagnes doivent cibler le grand public, la police, les magistrats, les professionnels de santé et les autorités religieuses, capables à leur tour d’influencer l’opinion. Elles doivent s’efforcer d’éroder la stigmatisation sociale entourant les survivantes d’agressions sexuelles et de viol, de lutter contre la culpabilisation des victimes et de faire connaître les ressources disponibles pour les survivantes qui seraient à la recherche de protection et de recours.
- Adopter des protocoles, harmonisés à l’échelle nationale, pour collecter des données sur les incidents et plaintes liés aux violences sexuelles, en coordination avec les ministères de la Santé, de la Justice, de l’Intérieur et avec l’Office national de la statistique. Ces données seront, au minimum, réparties par sexe, genre, âge (de la victime et, s’il est connu, de l’agresseur), langue parlée par la victime et type de violence. Une meilleure collecte de données est un pas en direction de la mise en place de politiques adaptées pour prévenir et traiter les violences sexuelles.
- Lancer des enquêtes sur la prévalence des violences sexuelles à l’encontre des hommes et des garçons.
Au ministère de la Santé et son Programme national de santé de la reproduction
- Adopter des directives, en matière de médecine légale, sur la façon de traiter les cas de violences sexuelles et de produire une documentation sur eux, en accord avec les directives de l’Organisation mondiale de la santé (OMS), notamment en utilisant un formulaire-type pour ce type de documentation, en interdisant les « tests de virginité » et en mettant l’accent sur l’obligation qui incombe aux médecins et autres professionnels de santé d’apporter leur assistance médicale, et des analyses médico-légales si la survivante le désire, sans exiger que la survivante obtienne une réquisition de la police.
- Faire en sorte que les professionnels de santé – médecins, infirmières et sages-femmes – soient formés en médecine légale pour pouvoir à la fois dispenser un traitement médical et mener des examens et tests médico-légaux lors d’une seule consultation, afin de donner aux survivantes un meilleur accès à la collecte de preuves médicales et d’augmenter la fiabilité de ces preuves devant les tribunaux.
- Rendre prioritaire le recrutement de femmes au sein du corps médical et des autres métiers de la santé, afin que les survivantes de violences sexuelles accèdent plus facilement à des soignantes de sexe féminin.
- Appuyer la mise en place d’unités consacrées aux violences sexuelles dans les hôpitaux publics et les centres de santé, et rendre leurs soins et analyses médico-légales accessibles – soit gratuits soit abordables pour tous les budgets. Il conviendra de suivre les directives de l’OMS sur les réponses médico-légales à apporter aux violences sexuelles et de se fonder sur l’expertise de l’unité spéciale mise en place à l’hôpital public « Mère et Enfant » à Nouakchott.
Au ministère de l’Intérieur
- Créer ou financer une formation périodique des agents des forces de l’ordre et notamment de police, à laquelle la participation serait obligatoire, sur la sensibilisation aux questions de genre, aux violences sexuelles et aux autres formes de violences fondées sur le genre, afin d’éviter que l’attitude des policiers ne retraumatisent les survivantes et d’éliminer les partis pris implicites des procédures d’enquête.
- Créer ou financer une formation spécifique, à laquelle la participation serait obligatoire, sur la façon de gérer les cas de violences sexuelles envers les enfants. Ces formations devraient être exigées pour les agents de police, en particulier ceux qui travaillent au sein de brigades des mineurs.
- Transmettre aux policiers des protocoles écrits qui, dans le cas de violences fondées sur le genre, exigeraient de :
- Effectuer des évaluations des risques, enregistrer la plainte, conseiller la plaignante sur ses droits, rédiger un rapport officiel, organiser son transport en vue de soins médicaux et apporter d’autres formes de protection ;
- Garantir que les plaignantes aient la possibilité de s’adresser et de présenter leur plainte à des agents de police de sexe féminin ;
- Garantir qu’une assistante sociale soit disponible pour épauler les femmes qui déposent plainte à la police ;
- Interroger les parties et les témoins, y compris les enfants, dans des pièces à part, pour garantir qu’ils aient la possibilité de s’exprimer librement ; et
- Vérifier que les agents suivent ces protocoles et demander des comptes à ceux qui ne le font pas.
- Augmenter les efforts de recrutement et de promotion d’agents de police, de gendarmerie et de la garde nationale de sexe féminin en s’attaquant et en s’efforçant d’éliminer la discrimination– qu’elle soit directe ou indirecte – lors du processus de recrutement, et mener des campagnes significatives et continues de recrutement et de développement professionnel qui ciblent les femmes.
Au ministère de la Justice
- Créer ou financer une formation périodique des procureurs et des juges, à laquelle la participation serait obligatoire, sur la sensibilisation aux questions de genre, aux violences sexuelles et aux autres formes de violences fondées sur le genre. Il s’agit de réduire la retraumatisation des survivantes et de s’attaquer aux partis pris implicites dans les pratiques des procureurs et les procédures judiciaires.
- Créer ou financer une formation spécifique des procureurs et des juges mauritaniens, à laquelle la participation serait obligatoire, sur la façon de gérer les cas de violences sexuelles envers les enfants.
- Instaurer un moratoire immédiat sur les poursuites et la détention des personnes pour zina et libérer sans tarder toutes les personnes poursuivies pour zina actuellement détenues ;
- Mettre en place, au sein du ministère public, des unités spécialisées dans les enquêtes sur les affaires de violences sexuelles et fondées sur le genre, leur fournir un budget suffisant et une formation spécialisée destinée aux procureurs, afin de développer l’expertise dans ce domaine, augmenter le nombre d’affaires faisant l’objet d’enquêtes et améliorer l’efficacité de l’instruction pour les plaignantes.
- Veiller à ce que les procureurs et juges d’instruction poussent les agents de police judiciaire placés sous leur autorité à être réactifs face à tous les cas de violence fondée sur le genre, à enquêter et à collecter des preuves avec diligence.
- Continuer à financer la formation des procureurs et juges mauritaniens, à laquelle la participation doit être obligatoire, sur les dispositifs internationaux et régionaux que la Mauritanie est tenue d’appliquer et de mettre en œuvre au niveau national, en particulier la Convention sur l'élimination de toutes les formes de discrimination à l'égard des femmes, la Convention relative aux droits de l’enfant, le protocole de la Charte africaine des droits de l'Homme et des peuples relatif aux droits des femmes en Afrique ainsi que la Charte africaine des droits et du bien-être de l'enfant.
- Veiller à ce que les documents de preuve présentés au tribunal, comme les certificats médicaux, qui seraient rédigés dans une langue autre que l’arabe, langue officielle des tribunaux, soient traduits et authentifiés afin de minimiser les problèmes de traduction qui pourraient émerger lors de la phase d’enquête du procès.
- Veiller à ce que toutes les plaignantes aient la possibilité de réclamer une compensation à l’accusé lors d’une procédure pénale, via le mécanisme de « partie civile », en poussant les policiers, procureurs et juges à informer les plaignantes de leur droit à réparation pour les préjudices subis présumés et à les accompagner dans les démarches nécessaires à ces procédures.
Au ministère des Affaires islamiques et de l’Enseignement originel
- Exhorter les ministères de l’Intérieur et de la Justice à libérer immédiatement toutes les personnes purgeant une peine de prison indéfinie du fait d’une condamnation pour zina.
- Mobiliser les chefs et lettrés religieux (oulémas) afin qu'ils apportent leur soutien à des campagnes de sensibilisation aux violences sexuelles en Mauritanie, en particulier en condamnant les agressions sexuelles et le viol et en encourageant les survivantes à s’exprimer et, si elles le souhaitent, à demander que justice leur soit rendue.
- Appuyer l’adoption d’un projet de loi sur les violences fondées sur le genre conforme aux normes du droit international relatif aux droits humains.
Aux Nations Unies, à l’Union africaine et aux bailleurs de fonds internationaux
- Exhorter les autorités mauritaniennes à libérer les personnes détenues pour des accusations de zina.
- Appuyer le gouvernement mauritanien pour qu’il mène des études sur l’étendue du problème de la violence sexuelle et sur la façon dont les systèmes judiciaire et de sécurité sociale traitent les survivantes, études qui pourront constituer la base de nouveaux plans d’action et politiques nationaux.
- Appeler le gouvernement mauritanien à donner la priorité à l’adoption d’une loi sur les violences fondées sur le genre qui soit en accord avec les obligations de la Mauritanie émanant du droit international, à l’abrogation des articles 293, 306 et 307 du Code pénal et à l’amendement des lois qui introduisent des discriminations à l’égard des femmes.
- Appuyer les droits des femmes et l’élimination des violences sexuelles en Mauritanie à travers un soutien politique, technique et économique. Dans le cadre d’un tel engagement, les priorités pourront être notamment :
- Une assistance régulière et de long terme aux organisations de la société civile qui fournissent des services d’aide directs aux survivantes de violences sexuelles, afin de leur permettre de proposer un hébergement, une aide juridique gratuite et un soutien psychosocial aux survivantes ;
- Un appui au gouvernement pour créer des refuges « ouverts » dans tout le pays, refuges qui proposeront des solutions d’hébergement à court, moyen et long terme ainsi que des programmes de réinsertion aux femmes et filles qui ont survécu à des violences sexuelles et à celles qui viennent de sortir de prison ;
- La mise en place d’une ligne téléphonique nationale d’urgence pour que les survivantes de violences sexuelles puissent rapporter ces incidents et demander de l’aide ;
- Des services et une assistance psychosociaux pour les femmes et filles détenues ; et
- Des campagnes nationales de sensibilisation de grande échelle conseillant les femmes et filles sur leurs droits et expliquant comment toute victime de violences sexuelles peut obtenir de l’aide.
Méthodologie
Ce rapport se fonde sur les entretiens menés par les chercheurs de Human Rights Watch lors de trois séjours dans la capitale, Nouakchott, et d’un séjour dans la ville de Rosso, dans le sud du pays, du 17 au 23 octobre 2017, du 20 janvier au 12 février 2018 et du 20 au 28 avril 2018. Les chercheurs ont rencontré des femmes dans la prison pour femmes de Nouakchott le 20 janvier 2018, grâce à l’autorisation accordée par la Direction des affaires pénales et de l’administration pénitentiaire.
Human Rights Watch a également interrogé 12 filles et 21 femmes – 8 femmes qui ont rapporté l’histoire d’une parente de moins de 18 ans et 13 autres qui ont raconté leur propre histoire – déclarant avoir subi un ou plusieurs incidents d’agressions sexuelles. Certaines de ces femmes avaient moins de 18 ans au moment de l’agression qu’elles ont relatée. L’équipe de recherche a mené tous les entretiens de façon individuelle, dans un lieu sûr et privé, à quelques exceptions près. Certains entretiens avec les enfants ont été menés en présence d’un adulte, parent ou proche.
Même si les chercheurs ont eu des difficultés à trouver des survivantes de violences sexuelles qui voulaient bien parler de ce qu’elles avaient vécu, ces 33 filles et femmes âgées de 13 à 42 ans l’ont fait volontairement. Les femmes et les filles qui ont accepté de participer à la recherche sont des Haratines (ou Maures noires, c’est-à-dire d’ascendance arabo-berbère) ou des « Afro-Mauritaniennes » (ou « Négro-Mauritaniennes »), et issues de familles assez pauvres. L’équipe de recherche a identifié ces personnes grâce aux indications de groupes mauritaniens de défense des droits des femmes travaillant dans des centres à travers le pays qui proposent aux survivantes de violences sexuelles des services directs d’aide à la personne.
Au cours de sa visite de la prison pour femmes, Human Rights Watch a interrogé individuellement trois femmes qui avaient été poursuivies ou reconnues coupables de zina et qui, au moment de l’entretien, étaient en détention provisoire ou purgeaient une longue peine de prison. Les entretiens se sont déroulés dans une pièce permettant une certaine intimité, en présence d’un interprète travaillant avec l’équipe de recherche et loin des gardiens de la prison.
Les entretiens étaient menés en hassanya, en arabe classique, en peul, en wolof ou en français, généralement à travers une interprète. Si de nombreuses survivantes interrogées ont courageusement confié ce qu’elles avaient vécu, déclarant qu’elles voulaient que le monde connaisse leur histoire, beaucoup ont demandé que Human Rights Watch la transmette de façon à masquer totalement leur identité. C’est pourquoi tous les noms utilisés pour identifier les victimes dans ce rapport sont des pseudonymes. Nous avons également passé sous silence les noms de lieux cités dans leurs récits.
Par ailleurs Human Rights Watch a mené des entretiens avec 23 autres personnes : des activistes, des responsables d’organisations non gouvernementales (ONG), des assistants sociaux, des avocats, des journalistes et un psychologue. Ces personnes sont affiliées à huit ONG mauritaniennes, dont trois qui gèrent des centres pour femmes apportant des services directs aux survivantes de violences sexuelles, et à quatre ONG internationales. L’équipe de recherche a également rencontré des représentants du gouvernement mauritanien et d’organisations multilatérales, notamment la ministre des Affaires sociales et de la Famille de l’époque, Mme Maïmouna Mint Taghi, la présidente de la Commission nationale des droits de l’Homme, Mme Irabiha Abdel Wedoud, des représentants du bureau Mauritanie du Fonds des Nations Unies pour la population, du bureau Mauritanie du Fonds des Nations Unies pour l’enfance, du Haut-Commissariat des Nations Unies aux droits de l’Homme et du bureau de la délégation de l’Union européenne. Nous avons également rencontré représentants des ambassades et agences de développement d’Allemagne, d’Espagne, des États-Unis et de France.
Même si l’équipe de recherche a limité ses entretiens à deux grandes villes, le rapport fait des observations plus générales sur les tendances nationales en se fondant sur l’expérience de terrain des organisations partenaires de la société civile qui ont des bureaux dans chaque région (wilaya), sur l’analyse des organisations multilatérales travaillant dans tout le pays et sur un examen des dossiers judiciaires disponibles.
Le 12 juillet 2018, nous avons adressé une lettre à divers ministères du gouvernement mauritanien, avec des questions fondées sur nos conclusions préliminaires. Nous n’avons reçu aucune réponse. La lettre est reproduite en annexe de ce rapport.
I. Contexte
La diversité ethnique de la Mauritanie reflète sa situation géographique, reliant le Maghreb à l’Afrique de l’Ouest subsaharienne. La population est formée de trois grands groupes ethniques, même si chacun est nuancé par d’importantes distinctions culturelles et hiérarchies sociales. La grande majorité, dans tous les groupes ethniques, sont des musulmans sunnites.
Les deux premiers groupes parlent le dialecte arabe local appelé hassanya. Le premier groupe de locuteurs du hassanya, dits « Beïdanes », descendent d’Arabes et de Berbères qui ont migré du nord et de l’est. Les Beïdanes dominent l’élite politique et économique du pays[2]. Les « Haratines » forment le second groupe de locuteurs du hassanya, et le plus important. Ce groupe contient surtout d’anciens esclaves, à la peau plus foncée, et leurs descendants. Le troisième groupe de population, souvent appelé « Afro-Mauritaniens » (ou « Négro-Mauritaniens »), comprend plusieurs groupes ethniques dont la langue maternelle est une des langues d’Afrique subsaharienne et non pas l’arabe[3]. Les Peuls constituent de loin le plus important sous-groupe afro-mauritanien, suivis par les Soninké et d’autres populations plus réduites parlant le wolof et le bambara.
Droits des femmes
En mai 2001, la Mauritanie a adhéré à la Convention sur l'élimination de toutes les formes de discrimination à l'égard des femmes, avec une réserve portant sur les dispositions qu’elle estime contraires à la loi islamique (charia) et à la constitution mauritanienne[4]. La même année, la Mauritanie a codifié les principes clés de son droit de la famille à travers l’adoption d’un Code du statut personnel[5]. Depuis son adoption, ce code a été très critiqué pour les discriminations qu’il impose à l’égard des femmes. En particulier il ne leur accorde pas les mêmes droits qu’aux hommes pour contracter mariage, au cours du mariage et lors de sa dissolution, en matière d’héritage et pour la transmission de la nationalité à la descendance (ainsi que le Code de la nationalité de 1961, qui lui aussi pose des conditions discriminatoires pour transmettre sa nationalité)[6].
Par la suite la Mauritanie a adopté des réformes juridiques et des plans stratégiques nationaux visant à renforcer les droits des femmes et à éliminer l’esclavage et l’exploitation sexuelle[7]. En décembre 2005, la Mauritanie a adhéré au protocole de la Charte africaine des droits de l'Homme et des peuples relatif aux droits des femmes en Afrique (protocole de Maputo), sans réserves[8]. En 2006, le pays a adopté une ordonnance réservant aux femmes 20 % des sièges aux élections municipales et exigeant que les listes électorales intègrent un quota minimum de femmes, qui varie selon le district électoral, lors des élections législatives[9].
En 2017, la Mauritanie a pris deux initiatives pour harmoniser son droit national avec les normes internationales relatives aux droits humains. En octobre 2017, l’Assemblée nationale a adopté une nouvelle loi sur la santé reproductrice, la reconnaissant comme un droit fondamental universel, autorisant le planning familial dans les hôpitaux publics et privés ainsi que dans les centres médicaux, et interdisant toute forme de violence et d’abus sexuels[10]. En décembre 2017, elle a adopté un nouveau Code général de l’enfance, qui élargit les protections des droits des enfants et renforce les dispositions de l’ordonnance de 2005 sur la protection pénale de l’enfant, qui avait fait date[11]. Début 2016, l’exécutif a également approuvé un nouveau projet de loi sur les violences fondées sur le genre, qui, s’il était amendé pour se conformer aux normes internationales relatives aux droits humains, pourrait nettement améliorer les services d’aide et les moyens de recours judiciaire auxquels les survivantes ont accès. Le projet de loi a été approuvé par le Sénat mauritanien en 2016 (une institution qui depuis a été dissoute), mais rejeté par l’Assemblée nationale par la suite. À l’heure où nous écrivons, il attendait un deuxième vote par cette même chambre.
En dépit des avancées législatives et institutionnelles réalisées lors des vingt dernières années, les femmes mauritaniennes restent marginalisées sur le plan économique, politique et social. Elles présentent des taux d’alphabétisation, de mobilité professionnelle et de sécurité financière nettement inférieurs à ceux des hommes[12].
D’après l’Office national de la statistique (ONS), en 2015, 27 % des Mauritaniennes déclaraient qu’un mari avait le droit de faire preuve de violence physique envers son épouse (ou ses épouses) si elle sort sans le lui dire, si elle néglige ses enfants, s’ils se disputent, si elle refuse d’avoir des relations sexuelles avec lui ou encore si elle laisse brûler le repas[13].
Même si des statistiques récentes sur l’incidence des violences fondées sur le genre ne sont pas disponibles publiquement, les ONG mauritaniennes et les acteurs institutionnels rapportent qu’elles sont très répandues. D’après un rapport de 2017 de la Commission nationale des droits de l’Homme, plusieurs facteurs courants entravent l’élimination de la violence à l’égard des femmes dans le pays, notamment « l’inadaptation des mesures de mise en œuvre existantes telles que les campagnes de sensibilisation au droit et les programmes de perfectionnement pour les responsables de l’application de la loi […] et, d’autre part, l’insuffisance des ressources humaines et financières nécessaires au fonctionnement des institutions compétentes ; […] la pauvreté, le faible niveau d’instruction des femmes, la méconnaissance de leur droit et la crainte de porter leurs problèmes devant les tribunaux, leur faible accès à l’information »[14].
En 2015, 28 % des filles/femmes âgées de 15 à 19 ans étaient mariées (contre 0,8 % des hommes au même âge). Les taux de mariage précoce et de mariage des enfants étaient deux fois plus élevés dans les zones rurales que dans les zones urbaines. En outre, 16 % des filles/femmes mariées de 15 à 49 ans étaient déjà mariées avant l’âge de 15 ans[15]. Alors que le Code du statut personnel prévoit que les hommes et les femmes doivent avoir au moins 18 ans pour formuler leur consentement au mariage[16], ce même code permet au tuteur légal d’une fille « incapable » (ce qui est largement interprété comme une fille orpheline ou sans représentant légal) de la marier « s'il y voit un intérêt évident »[17]. Le code prévoit également que « le silence de la jeune fille vaut consentement [au mariage] »[18]. Par ailleurs, le Code général de l’enfance prévoit des peines de 5 à 10 ans de prison et une amende pour un tuteur qui marierait une enfant « dans son intérêt exclusif », mais sans définir le sens de cette expression[19].
En 2015, deux tiers des filles/femmes âgées de 15 à 49 ans rapportaient avoir subi une forme de mutilation génitale féminine (MGF) ou excision dans le passé. Les taux étaient nettement plus élevés dans les zones rurales que dans les zones urbaines (79 % contre 55 %). Pour les femmes ayant des filles, plus de la moitié rapportaient qu’au moins une de leurs filles âgées au plus de 14 ans avaient subi une forme de MGF ou d’excision.
En 2017, la Mauritanie a criminalisé formellement et inconditionnellement la pratique de la MGF dans son nouveau Code général de l’enfance et dans la loi sur la santé reproductive[20]. Pendant des années, cette pratique ne pouvait conduire à des sanctions pénales qu’en cas de complications médicales[21].
Ces dernières années, le gouvernement a tenté de s’attaquer au problème de façon plus active en adoptant des stratégies nationales et en mettant en place des conseils nationaux et régionaux sur les violences fondées sur le genre et les MGF, dans le but d’éradiquer progressivement cette pratique néfaste. Le ministère des Affaires sociales et de la Famille, avec ses partenaires, a demandé aux médecins de signer une déclaration nationale condamnant les effets négatifs des MGF, tandis que les juristes islamiques émettaient une fatwa (un décret religieux fournissant une interprétation non contraignante relevant de la charia) – déclarant que la pratique n’avait aucun fondement religieux[22].
Les abus et violences sexuels dans le contexte des relations domestiques demeurent tabous et constituent un angle mort des études et activités coordonnées par les acteurs institutionnels qui travaillent sur les violences fondées sur le genre, d’après la Commission nationale des droits de l’Homme ainsi que les groupes mauritaniens de défense des droits des femmes[23].
Dans l’ensemble, par manque d’indicateurs sensibles à la dimension de genre et d’outils pour collecter des données sur les violences sexuelles, l’opacité règne autour du nombre d’affaires auxquelles les autorités doivent donner suite et de l’ampleur du phénomène en général, ce qui par conséquent empêche de concevoir des politiques publiques adaptées[24]. Une représentante de l’ONG espagnole Médicos del Mundo a déclaré à Human Rights Watch que « jusqu’à récemment, le ministère de la Santé mauritanien comptabilisait les incidents de violences sexuelles dans la catégorie des accidents de la voie publique ou des victimes de coups et blessures volontaires »[25].
De même, une représentante du bureau Mauritanie du Fonds des Nations Unies pour la population a déclaré à Human Rights Watch que « seules les organisations de la société civile rapportent des données sur le sujet. Et ces données de la société civile sont alarmantes » [26].
En 2017, l’ONG mauritanienne Association des femmes chefs de famille a rapporté qu’elle était intervenue dans 428 cas de viols, 128 mariages d’enfants et 1 623 conflits conjugaux, certains comportant des violences sexuelles. La même année, l’Association mauritanienne pour la santé de la mère et de l’enfant rapportait qu’elle avait aidé 260 personnes agressées sexuellement (femmes, filles et garçons) au niveau national et 40 femmes et filles ayant subi des violences conjugales[27].
II. Obstacles aux réparations pour les survivantes
|
Rouhiya Lorsqu’elle a confié son histoire à Human Rights Watch, Rouhiya était enceinte de cinq mois de son père, pour la seconde fois. À seulement 17 ans, elle faisait preuve d’un calme frappant. « Mon père me traitait comme sa femme alors que je suis sa fille. Je ne l’ai dit à personne, mais j’ai voulu m’enfuir. [...] Quand j’en ai parlé à ma mère, elle m’a dit de n’en parler à personne. Mon père m’a menacée de me tuer si j’en parlais. Il fait la même chose à ma sœur [qui est encore toute petite]. J’ai essayé de partir avec un jeune homme de 23 ans qui voulait m’épouser. J’ai connu cet homme dans la rue. » En juillet 2016, a rapporté Rouhiya, elle a rejoint le jeune homme chez lui, où il l’a enfermée, droguée et, en compagnie de trois autres hommes, violée collectivement et de façon répétée pendant deux semaines. Les parents de Rouhiya ont appelé la police, qui a fait irruption chez l’homme et retrouvé la jeune fille traumatisée. Son père l’a amenée au commissariat le jour suivant pour déposer plainte contre les quatre hommes. « Le lendemain, on a été voir le procureur. [...] Il m’a posé des questions sur mon histoire, les quatre hommes étaient réunis, nous étions dans le même bureau. Le procureur m’a demandé pourquoi j’étais partie avec cet ami. J’ai expliqué que j’avais peur de mon père – mais je n’ai pas avoué que mon père me violait. » Tandis que les quatre hommes étaient placés en détention provisoire, les policiers ont également arrêté Rouhiya, poursuivie pour avoir eu des relations sexuelles hors mariage (zina). Elle a passé quelques semaines dans un centre judiciaire pour mineurs, avant d’être transférée par la police à la prison nationale pour femmes de Nouakchott. « Je leur ai demandé : ‘Mais pourquoi [vous m’arrêtez] ?’ Qu’est-ce que j’ai fait de mal ? « Ils m’ont dit de garder le silence et de ne pas poser de questions », se souvient Rouhiya. Dans les heures suivant son arrivée en prison, Rouhiya s’est évanouie dans sa cellule. Dans les 24 heures, une organisation de défense des droits des femmes a réussi à la faire libérer pour raisons de santé. Hors de la prison, les organisations de défense des droits des femmes ont apporté leur soutien à Rouhiya, mais aucune n’avait la capacité de l’héberger à moyen terme. Rouhiya n’avait pas d’autre choix que de retourner dans son foyer, où elle est à la merci de nouveaux abus. Elle est revenue en 2017 au centre géré par l’organisation qui avait obtenu sa libération de prison alors qu’elle était enceinte de six mois de son père. « J’ai accouché », leur a-t-elle raconté. « Mais le bébé était mort-né. » |
Obstacles institutionnels et sociaux aux réparations
Stigmatisation et exclusion sociale des survivantes de violences sexuelles
Culturellement, les gens préfèrent ne pas faire cas [des incidents d’agressions sexuelles]. C’est une honte qui s’abat sur la famille. [...] Socialement, c’est très mal vu. La réaction sociale du milieu duquel la survivante est issue est difficile[28].
— Khadijetou Cheikh Ouedrago, spécialiste des questions de genre, bureau pays de l’UNFPA
La pression et la stigmatisation sociales, aussi bien à la maison que dans la communauté, peuvent constituer en Mauritanie le premier obstacle pour les survivantes. Cinq femmes qui ont affirmé avoir été violées, dont quatre avaient moins de 18 ans au moment du viol, ont déclaré à Human Rights Watch qu’elles n’avaient pas parlé du viol jusqu’à ce que leur grossesse devienne visible. Mariama, 20 ans, qui raconte avoir été violée par un chauffeur de taxi lorsqu’elle avait 17 ans, se souvient :
Alors que j’étais enceinte de huit mois, ma mère s’en est rendu compte et m’a demandé comment c’était arrivé. C’est à ce moment-là que je lui ai raconté le viol. Mon père s’est mis dans une rage folle. Il m’a amenée au commissariat et a dit aux policiers que sa fille devait être enfermée parce qu’elle avait couché avec un homme et qu’il ne la voulait plus chez lui. J’ai passé une nuit en garde à vue[29].
La CNDH mauritanienne a conclu que le tabou entourant les violences sexuelles «
‘victimise’ doublement les survivantes»[30]. Dans son rapport de 2017 sur les droits des femmes en Mauritanie, la CNDH fait remarquer : « Elles sont rejetées par la société, la famille ne les soutient pas et leur parcours judiciaire pour recouvrer leurs droits n’est pas facile. [31]. »
Les avocats mauritaniens interrogés par Human Rights Watch ont tous déclaré que la stigmatisation sociale diminuait la volonté de la survivante de demander de l’aide et d’intenter des poursuites. Me Jemal Abbad, qui représente les survivantes d’agressions sexuelles soutenues par l’ONG mauritanienne Association des femmes chefs de famille, nous a expliqué : « Les crimes sexuels sont tabous [...] dans la société mauritanienne. Il y a des parents qui ne veulent pas en parler. Ils pensent que ça fait du mal à l’honneur de la famille[32]. »
Me Ahmed Ould Bezeid El Mamy, affilié à la même organisation, a également observé que ce type de pression affectait de façon différente les femmes issues de groupes ethniques et de contextes socio-économiques différents. Selon lui, les violences sexuelles sont particulièrement taboues dans les familles aisées et plus en vue. Les femmes qui ont été violées, a-t-il expliqué, partent souvent au Sénégal pour accoucher discrètement si elles en ont les moyens. Il a également fait remarquer que le mariage précoce était un moyen courant de « sauver l’honneur de la famille »[33].
L’agression sexuelle, surtout pour les femmes célibataires et les filles, les marque socialement au point que leur acceptation par la communauté est limitée et que leurs perspectives de mariage se réduisent nettement. Marie-Charlotte Bisson, qui dirige le bureau Mauritanie de l’ONG suisse Terre des Hommes-Lausanne, a remarqué que « l’exclusion et la stigmatisation sociales associées à l’agression sexuelle poussent souvent toute la famille de la survivante à déménager dans un autre quartier »[34].
Comme dans de nombreux pays, le mythe selon lequel un hymen intact est l’indicateur de la virginité existe toujours. Me Fatimata M’Baye, la première femme à devenir avocate en Mauritanie, qui a fondé et dirige l’Association mauritanienne des droits de l’Homme, a déclaré : « Il faut revenir à cette appréciation sociale de l’hymen. Notre société patriarcale exige que la femme soit ‘intacte’ au moment de son mariage. Si elle ne l’est pas, c’est qu’elle a connu quelqu’un d’autre[35]. »
|
Aperçu de la procédure pénale
Afin de lancer une procédure judiciaire, une survivante doit signaler l’incident à la police. Les officiers de police judiciaire doivent informer de la plainte le procureur de la République, entamer une enquête préliminaire et fournir au procureur un procès-verbal de police et un dossier préliminaire de l’affaire, comprenant le certificat médical de la survivante[36]. Dans les affaires pénales, les officiers de police judiciaire travaillent sous la supervision, et suivent les instructions, soit d’un procureur de la République soit d’un juge d’instruction. Les officiers de police judiciaire peuvent arrêter des suspects et placer en garde à vue les personnes contre lesquelles il existe des « indices graves et concordants » pendant 48 heures, une période qui peut être renouvelée une fois sur autorisation du procureur de la République[37]. Le procureur de la République détermine s’il convient d’ouvrir une information judiciaire et de déférer l’affaire devant un juge d’instruction (qui supervisera la phase d’instruction débouchant sur le procès), ou bien d’abandonner les poursuites en prononçant une ordonnance de non-lieu[38]. Si le procureur de la République décide le non-lieu, il doit informer le plaignant dans les huit jours suivant sa décision[39]. Avant le procès, le juge d’instruction peut décider d’accorder aux accusés la liberté provisoire sous contrôle judiciaire ou au contraire de les placer en détention provisoire[40]. Les procédures d’instruction et de jugement peuvent être accélérées si l’accusé a été surpris en flagrant délit[41]. Si le juge d’instruction constate qu’il y a suffisamment de preuves pour qu’une affaire fasse l’objet d’un procès, il la défère à la chambre criminelle qui est compétente pour juger l’affaire[42]. |
Des réponses inadaptées de la part de la police et des procureurs
Lorsque les femmes ou les filles surmontent la pression sociale et osent rapporter les incidents de violences sexuelles aux autorités, elles rencontrent souvent de nouvelles difficultés dues à la façon dont la police gère les plaintes et dont les procureurs de la République mènent les enquêtes sur les affaires de violences sexuelles.
Signaler l’agression à la police est le premier pas que les survivantes doivent accomplir si elles veulent demander la protection des institutions et réclamer qu’on leur rende justice. Sur les 25 personnes interrogées qui étaient mineures à l’époque de leur agression, 23 ont déclaré qu’elles avaient rapporté l’incident à la police. Par contre, sur les 8 femmes qui étaient adultes au moment de leur agression, seules 4 l’ont signalée à la police. L’Association mauritanienne pour la santé de la mère et de l’enfant, une ONG de défense des droits des femmes qui gère dans tout le pays des centres proposant des services d’aide directs aux survivantes de violences sexuelles, a déclaré que les femmes avaient tendance à ne pas rapporter les incidents de violences sexuelles à la police à cause de la stigmatisation et du risque d’être poursuivies pour zina. La politique de l’ONG est de conseiller aux femmes de ne pas signaler les agressions sexuelles à la police, pour écarter le risque que les survivantes elles-mêmes soient poursuivies.
Aucun protocole standard n’existe, que ce soit au niveau régional ou national, pour guider la réponse des agents de police face aux affaires de violences sexuelles. Après avoir entendu le récit de la plaignante et pris des notes, un policier peut rédiger une réquisition pour qu’un médecin d’un hôpital ou d’un centre de santé public réalise un examen médico-légal. Dans les établissements publics de santé, les gynécologues obstétriciens effectuent en général les examens médicaux et les analyses médico-légales simultanément. Ils rédigent des certificats médicaux qui sont adressés directement à la police pour étoffer le dossier de la plaignante.
La capitale, Nouakchott, compte trois brigades des mineurs qui s’occupent exclusivement d’affaires impliquant des enfants, qu’ils soient accusés ou plaignants[43]. Ces commissariats accueillent des assistantes sociales en résidence, essentiellement employées par des organisations de la société civile, mais ne mettent pas toujours à leur disposition un espace de travail à part[44]. Les assistantes sociales rendent également visite périodiquement aux autres commissariats afin d’identifier de nouveaux cas de violences sexuelles. Elles peuvent aider les survivantes à s’y retrouver dans les interactions avec la famille et les tiers, à intenter une action en justice et à obtenir un soutien médical et psychologique. Les assistantes sociales à qui a parlé Human Rights Watch ont critiqué les limites de ce qu’elles peuvent accomplir dans les commissariats. Comme la plupart d’entre elles n’ont pas d’accréditation officielle et ne sont acceptées dans les commissariats que de façon informelle, on peut leur demander de quitter les locaux à n’importe quel moment.
Les assistantes sociales assistent généralement aux interrogatoires policiers au côté d’un avocat et peuvent aider les enfants et les adultes à accomplir les diverses étapes des procédures médicales et judiciaires. La directrice d’un centre pour femmes apportant des services d’aide directs aux survivantes de violences sexuelles à Nouakchott a déclaré à Human Rights Watch : « Quand l’assistante sociale reçoit un cas au commissariat, elle fait la distinction entre (1) les femmes majeures, à qui on conseille de ne pas porter plainte à cause du risque d’être poursuivie pour zina, et (2) les mineures, à qui on conseille de poursuivre le parcours judiciaire[45]. »
Des multiples entretiens menés par Human Rights Watch, il ressort qu’à chaque fois que les survivantes majeures avaient une relation préexistante avec l’auteur de l’agression, les policiers ont apparemment refusé d’enquêter sur les incidents de violences sexuelles. Khouloud, qui rapporte qu’elle est tombée enceinte après avoir été violée par son ex-mari, a déclaré à Human Rights Watch : « Quand j’ai été voir les policiers, ils m’ont dit que ça ne les concernait pas, que ce n’était pas leur boulot et que je devrais aller parler aux ONG[46]. »
D’après une représentante de l’UNFPA, « il y a encore beaucoup de progrès à faire pour qu’existe une prise en charge spécialisée dans les commissariats de police. La plupart des commissariats sont remplis d’hommes[47]. » Toutes les femmes et filles interrogées qui ont rapporté à la police qu’elles avaient été agressées ont mentionné qu’elles avaient surtout parler à des agents de sexe masculin et qu’à aucun moment les policiers de service ne leur avaient proposé de s’adresser à une collègue femme.
Par ailleurs elles ont subi des procédures d’enregistrement qui ne respectaient pas leur vie privée ni leur confidentialité : les agents les interrogeaient en général dans des espaces ouverts, en présence de plusieurs collègues et membres de la famille. Ainsi Fatimata, 15 ans, qui rapporte avoir été violée par un colocataire de l’appartement où vit sa famille, a raconté : « Au commissariat, il y avait beaucoup de policiers dans la salle [où on m’a interrogée], mon père, mon oncle, mon amie Aïcha [qui a été agressée par le même homme], son père, son oncle. Il y avait quelques policières, mais c’étaient les hommes qui posaient les questions[48]. »
Les survivantes ont rapporté à Human Rights Watch que les policiers leur avaient demandé de raconter l’incident. Les agents incorporent ensuite le récit de la survivante dans un rapport de police qui combine les observations des agents, les déclarations de la plaignante et les mesures de police prises en lien avec l’incident rapporté[49]. Les policiers envoient le rapport au procureur de la République, qui peut alors convoquer la plaignante et l’agresseur présumé pour une audience. En fonction des circonstances de l’agression, du degré de violence physique impliqué, de l’âge de la survivante et de la relation avec le coupable présumé, certains policiers et procureurs de la République semblent offrir leur propre jugement moral sur l’incident rapporté. Human Rights Watch a rencontré Zahra, une femme d’une vingtaine d’années, et sa fille de 7 mois, Sakina. En 2016, Zahra a déclaré que son voisin – vivant dans le même ensemble d’habitations informelles qu’elle et sa famille – l’avait violée en menaçant de la tuer à l’aide d’un couteau. « Il me faisait la cour, il m’avait dit qu’il m’épouserait un jour »[50], a déclaré Zahra. Une nuit, il est rentré tard du travail, alors que Zahra et sa belle-sœur étaient seules à la maison. « Il m’a demandé de lui apporter de l’eau, mais ensuite il a mis la main sur ma bouche, a sorti un couteau et a fermé la porte. J’ai voulu crier mais il m’a menacée de son couteau et m’a dit que si je criais, il m’égorgerait. » Zahra est tombée enceinte suite au viol et ce n’est qu’à six mois de grossesse qu’elle a rapporté l’agression à la police. L’agresseur a été placé en détention provisoire, mais elle aussi a été inculpée de zina et placée sous contrôle judiciaire. Une assistante sociale de l’Association des femmes chefs de famille qui a aidé Zahra au cours de la procédure judiciaire a déclaré à Human Rights Watch :
L’interrogatoire devant le procureur dure généralement une heure. Le procureur a demandé à Zahra : « Si tu n’étais pas consentante, pourquoi n’as-tu rien dit à tes parents ? » Il la provoquait avec des questions de ce type. […] Il lui demandait : « Tu le connaissais ? » Quand elle s’est ouverte, il a rétorqué : « C’est pas vrai. Tout ce que tu dis, c’est des mensonges, tu as fait ça de ton plein gré. » Il posait des questions orientées, mais ne notait que les réponses de Zahra[51].
Des soins médicaux peu accessibles et des examens médico-légaux inappropriés
Réquisitions délivrées par la police
Les survivantes, les assistantes sociales et les responsables d’ONG interrogés rapportent que souvent les médecins exerçant dans les hôpitaux et les centres de santé publics, qui effectuent à la fois les examens médicaux et les analyses médico-légales, n’acceptent d’examiner les survivantes, juste après une agression, que s’il existe une réquisition délivrée par la police ou si une intervention médicale urgente est nécessaire[52]. Faroudja a été violée à l’âge de 10 ans par un membre de sa famille dans une maison abandonnée quelques semaines avant de parler à Human Rights Watch. La même nuit, sa mère l’a emmenée dans un hôpital public de Nouakchott, où un médecin l’a informée qu’il ne pouvait pas l’examiner sans une réquisition de la police[53]. Le fait d’exiger cette réquisition empêche les survivantes qui ne souhaitent pas signaler l’incident à la police d’avoir accès à des soins médicaux immédiats et de collecter rapidement des éléments de preuve médico-légaux.
Examens de médecine légale
Il existe seulement un médecin pratiquant la médecine légale en Mauritanie et cette spécialité n’est pas réglementée[54]. Le manque d’expertise médico-légale est exacerbé par l’absence de médecins spécialisés en médecine légale et de protocoles uniformisés que les médecins pourraient suivre lorsqu’ils collectent des éléments de preuve médicaux. Aussi, ce sont des gynécologues obstétriciens qui doivent réaliser des examens médico-légaux non harmonisés auprès des survivantes de violences sexuelles. L’État n’autorise pas les sages-femmes à réaliser les examens médico-légaux, bien que des organisations non gouvernementales aient appelé à ce qu’elles puissent le faire, étant donné qu’il existe plus de sages-femmes que de femmes médecins. D’après la coordonnatrice de l’ONG espagnole Médicos del Mundo en Mauritanie, dans la plupart des hôpitaux et des centres de santé publics, le médecin qui examine et réalise les analyses médico-légales sur les survivantes de violences sexuelles a toutes les chances d’être un homme[55].
En outre, après une agression, les patientes doivent souvent attendre pendant des heures avant de voir un médecin, étant donné la pénurie générale de médecins en Mauritanie. En 2014, le ministère de la Santé estimait que seuls 239 médecins de famille (soit 1 pour 14 729 habitants) et 329 spécialistes (soit 1 pour 9 301 habitants) étaient disponibles sur tout le territoire national, pour soigner une population de près de 3,5 millions de personnes[56]. Pour obtenir un niveau de prise en charge élevé des accouchements par un personnel médical compétent (80 %), l’Organisation mondiale de la santé estime qu’il faut en moyenne 2,3 professionnels de santé compétents (médecins, infirmiers et sages-femmes) pour 1 000 habitants, ce qui dépasse de beaucoup le niveau trouvé en Mauritanie[57]. « La victime peut traîner toute une journée. Le médecin chef voit les opérations, les problèmes d’accouchement... Si la victime ne peut trouver le docteur que dans l’après-midi, elle a déjà pris une douche, elle a uriné... », ce qui atténue les indices médico-légaux, a expliqué Aminetou Mint Ely, présidente de l’Association des femmes chefs de famille, qui gère dans tout le pays des centres de prise en charge pour les survivantes d’agressions sexuelles[58].
La crainte des représailles dissuade également les médecins de réaliser des examens médico-légaux et de rédiger des rapports médicaux qui pourront être utilisés pour poursuivre les coupables présumés. Le docteur Amadou Kane, coordinateur de Médicos del Mundo, a déclaré à Human Rights Watch : « Les prestataires de soins ne veulent pas se mêler de procédures où ils peuvent être [appelés] à la barre. Être identifié comme le médecin ayant examiné une victime engagée dans un litige pose des problèmes de sécurité. [...] Certains prestataires de soins sont inquiets de pouvoir causer l’incarcération de l’agresseur » et craignent les représailles de ce dernier ou des membres de sa famille.
Parmi les survivantes interrogées qui ont vu un médecin juste après avoir été agressées, beaucoup n’ont pas bien compris l’examen médical dont elles ont fait l’objet. Adultes ou enfants, elles étaient seules lorsqu’elles ont rencontré le médecin, qui effectuait simultanément un examen médico-légal et des soins médicaux. Certaines patientes n’ont pas bien compris les analyses réalisées. « Je ne sais pas ce que la docteure a fait comme examen. Elle ne m’a pas expliqué ce qu’elle était en train de faire », a par exemple déclaré Rouhiya, 17 ans, dont l’histoire est relatée plus haut[59].
Les examens médicaux courants réalisés juste après une agression sont entre autres la collecte de frottis vaginaux, l’analyse de sperme et le dépistage des infections sexuellement transmissibles (IST)[60]. Même si les médecins prescrivent souvent la pilule du lendemain s’ils constatent des marques de pénétration vaginale, ils ne prescrivent que rarement des traitements prophylactiques post-exposition au VIH et à d’autres IST[61]. Quant aux tests ADN, ils ne sont pas disponibles dans le pays[62]. Quoi qu’il en soit, « le premier souci des familles, c’est de connaître l’état de l’hymen de la femme », a expliqué Amparo Fernández del Río, coordonnatrice du bureau Mauritanie de l’ONG espagnole Médicos del Mundo. Human Rights Watch a consulté plusieurs certificats médicaux élaborés par des médecins ayant examiné des victimes d’agressions sexuelles du point de vue médico-légal. Tous sont brefs, rédigés à la main. Tous répondaient à trois questions : le médecin a-t-il constaté des marqueurs de violence physique sur la patiente ; quel type de dépistage des IST a été effectué ; et quel était l’état de l’hymen de la survivante ?
Les pratiques actuelles ne sont pas en adéquation avec les directives de l’Organisation mondiale de la santé sur les rapports d’expertise médicale portant sur les violences sexuelles. Ces directives énoncent entre autres que « traiter une victime d’agressions sexuelles avec respect et compassion pendant tout l’examen l’aidera à se remettre » et exigent que « toutes les étapes de l’examen soient expliquées à l’avance ; pendant l’examen, il conviendra d’informer les patients du moment et de l’endroit où le contact aura lieu et de leur ménager de nombreuses occasions de poser des questions. Les souhaits du patient doivent être respectés à tout moment. » Les directives de l’OMS prévoient aussi que ce soit le même médecin qui effectue l’examen médico-légal et les soins de santé lors de la même consultation, ce qui est bien le cas actuellement en Mauritanie, et que les autorités doivent veiller « à ce que des infirmières ou médecins de sexe féminin soient disponibles chaque fois que possible. Si nécessaire, les efforts de recrutement de femmes pouvant effectuer les examens devront devenir une priorité[63]. » Pour les enfants et adolescents qui ont été abusés sexuellement, l’OMS a mis l’accent sur des considérations similaires, notamment le fait que dans la mesure du possible, il leur soit proposé de choisir entre un homme et une femme pour effectuer l’examen, et le fait qu’ils doivent être examinés par une personne spécialement formée[64].
De plus, l’OMS précise que « les tests de virginité n’ont pas lieu d’être. Ils n’ont aucune validité scientifique et sont humiliants pour l’individu », rappelant que « l’hymen n’est pas un indicateur fiable d’un éventuel acte de pénétration sexuelle ou de la virginité chez les filles pubères »[65]. Elle appelle à un examen physique approfondi des survivantes d’agressions sexuelles, notant que toutes les survivantes ne présenteront pas de lésions génitales visibles, même au niveau de l’hymen, sans pour autant que cela remette leurs accusations en cause[66].
Alors que les enquêtes judiciaires, comptes-rendus et jugements des tribunaux sont rédigés en arabe, les certificats médicaux intégrés au dossier d’une plaignante sont en français, ce qui peut mener à une traduction erronée au cours du procès, d’après les avocats consultés par Human Rights Watch. Me M’Baye a ainsi déclaré à Human Rights Watch :
J’ai une fois observé un procureur arabophone qui examinait un certificat médical rédigé en français, contenant le passage suivant : « attouchement, introduction d’un objet dans le vagin de la plaignante, présence de sang sur les petites lèvres ». Son interprète lui a expliqué en arabe que le certificat médical disait : « caresses mineures »[67].
Traitement médical des survivantes de violences sexuelles, criminalisation de l’avortement et coûts associés
La loi mauritanienne sur la santé reproductive de 2017 énonce que le droit aux services de santé reproductive est « un droit universel fondamental garanti à tout être humain, tout au long de sa vie »[68]. Cependant, cette loi interdit l’avortement, punissant ceux qui réalisent la procédure ainsi que ceux qui la reçoivent, sauf dans les cas où la poursuite de la grossesse « met en danger la vie de la mère »[69]. La loi interdit l’avortement même dans les cas de violences sexuelles. L’OMS a démontré que les lois restrictives, la stigmatisation et la faible disponibilité des services médicaux pouvaient entraîner que des femmes et filles aux grossesses non désirées aient recours à des avortements à risque, parfois même en étant forcées[70]. Dans les cas où les violences sexuelles résultent en une grossesse que la femme veut interrompre, l’OMS appelle à ce qu’elle puisse être dirigée vers des services d’avortement légaux[71].
Khouloud, 29 ans, qui a été violée par son ex-mari, a déclaré à Human Rights Watch : « Quand il a su que j’étais enceinte, il m’a apporté deux comprimés [abortifs]. Il en a mis un sous ma langue, l’autre dans mon vagin. Ensuite, je suis allée aux toilettes et j’ai perdu du sang, j’avais la nausée. Quand j’ai été voir les policiers, ils m’ont dit que ça ne les concernait pas, que ce n’était pas leur boulot. Ils m’ont dit : ‘On peut lui parler et lui dire de vous aider avec vos enfants, mais pour votre grossesse, vous devez aller parler aux ONG[72].’ »
Les soins médicaux prodigués suite à une agression, y compris les interventions d’urgence et les examens médico-légaux, représentent un coût qu’aucune des survivantes avec qui Human Rights Watch s’est entretenu n’avait les moyens de payer. Certaines familles n’avaient même pas de quoi régler les frais de transport vers les centres médicaux[73]. Tous les frais médicaux des survivantes interrogées ont été couverts par les assistantes sociales, qui ont confié que parfois elles devaient payer de leur propre poche les dépenses médicales des survivantes, lorsqu’elles excédaient le montant alloué par les ONG qui les emploient.
En juin 2017, la toute première – et à ce jour seule – unité d’un hôpital public dédiée aux violences sexuelles (Unité spéciale de prise en charge) a été inaugurée à l’hôpital « Mère et Enfant » à Nouakchott[74]. Dès sa première année de fonctionnement, l’unité a apporté son soutien à 184 survivantes de violences sexuelles à Nouakchott. Elle offre des consultations obstétriques et gynécologiques, des interventions chirurgicales d’urgence et des dépistages des IST. Tout cela est gratuit pour les survivantes, que la patiente soit munie d’une réquisition de la police ou non, avec automatiquement un rendez-vous de suivi un mois après la première consultation. Depuis mai 2018, l’unité offre également un soutien psychologique gratuit à toutes les nouvelles patientes grâce à l’aide d’un psychologue intégré au personnel de l’hôpital, avec le soutien du ministère de la Santé. Le personnel médical et les médecins ont été formés aux meilleures pratiques pour gérer les cas de violences sexuelles. Ils ont reçu des protocoles sur la façon d’enregistrer les nouveaux incidents de violences sexuelles et de réaliser des examens médico-légaux de façon à suivre les directives de l’OMS[75]. En fonction du lieu de résidence de la plaignante à Nouakchott, les réquisitions de la police ne dirigent pas systématiquement les survivantes vers cette unité pour effectuer un examen médico-légal.
De nombreuses survivantes interrogées ont rapporté qu’elles étaient passées par des réactions émotionnelles telles que les crises de larmes, la honte, la peur et le mutisme, pendant des semaines après l’agression. Selon l’OMS, de telles émotions sont des conséquences psychologiques directes de l’agression sexuelle, même si elles varient d’une personne à l’autre[76]. Au-delà de la consultation initiale avec un psychologue proposée par certains groupes de défense des droits des femmes, les survivantes interrogées n’ont reçu aucun soutien psychologique suite à leur agression. En 2016, l’ONG Médicos del Mundo recensait seulement quatre psychiatres et quinze psychologues pratiquant en Mauritanie, la plupart dans des hôpitaux publics de la région de Nouakchott[77].
Obstacles juridiques et inculpation des survivantes
Insuffisance des normes juridiques nationales
Le Code pénal criminalise le viol, mais sans le définir. En vertu de l’article 309, les accusés célibataires reconnus coupables de viol encourent une peine dite de hadd (prescrite par Dieu) et la flagellation, alors que les accusés mariés doivent être condamnés à mort[78].
Le viol constitue la seule forme de violence sexuelle explicitement interdite dans le Code pénal et le seul fondement pour porter plainte pour les adultes victimes d’agressions sexuelles.
Nouvelle loi sur la santé reproductive
La loi mauritanienne sur la santé reproductive de 2017 interdit « toutes les formes de violences et de sévices sexuels sur la personne humaine, notamment les enfants et les adolescents ». Pourtant elle ne définit pas la violence ni les abus sexuels et ne prévoit pas de peines, se contentant de se référer aux articles 309 (pénalisant le viol) et 310 (énonçant les circonstances aggravantes d’un viol) du code pénal[79]. En outre, elle réaffirme l’interdiction de l’avortement, ne faisant aucune exception pour les grossesses résultant d’agressions sexuelles[80] (voir plus haut).
Protections spéciales des enfants du point de vue concret et procédural
L’article 24 de l’Ordonnance portant protection pénale de l’enfant de 2005 prévoit des droits et protections spécifiques des enfants en droit pénal. L’ordonnance criminalise le viol commis à l’encontre d’un enfant, défini en droit mauritanien comme une personne de moins de 18 ans[81], mais là aussi sans définir le viol, se contentant de renvoyer aux dispositions du code pénal (article 309 et 310)[82]. Elle punit le viol commis sur un enfant d’une peine de hadd (prescrite par le droit islamique) ou d’un emprisonnement de 5 à 10 ans[83]. Les articles 25 et 26 de l’ordonnance pénalisent également le harcèlement sexuel d’un enfant et les « agressions sexuelles autres que le viol » à l’encontre des enfants. Elle prévoit 2 à 4 ans d’emprisonnement et une amende, sans définir l’infraction d’« agression sexuelle »[84]. L’article 26, section 2, dispose également que toute forme d’attouchement sexuel infligé à un enfant constitue un crime de pédophilie puni de 5 ans d’emprisonnement.
Code général de l’enfance
Le Code général de l’enfance adopté en 2017 par la Mauritanie a étendu la criminalisation des violences sexuelles contre les enfants en punissant tout type d’abus sexuel commis à l’encontre d’un enfant. Cette nouvelle loi définit l’abus sexuel d’un enfant comme le fait qu’il soit soumis à « des contacts sexuels par une personne vis-à-vis de laquelle il est en situation d'autorité ou de confiance, ou par une personne à l'égard de laquelle il est en situation de dépendance.»[85]. Selon le code, « le fait pour toute personne visée ci-dessus d'engager ou d'inciter l'enfant à la toucher, à se toucher ou à toucher un tiers directement ou indirectement avec une partie du corps ou avec un objet à des fins d'ordre sexuel », constitue un « contact sexuel »[86].
En outre, le code établit formellement qu’il est du devoir de n’importe quelle personne, même des professionnels soumis à une obligation de confidentialité, de signaler aux autorités locales « tout ce qui est de nature à constituer une menace à la santé de l'enfant, à son développement et à son intégrité physique ou morale. »[87].
Le code dispose également qu’en l’absence de centres spécifiques de détention juvénile, les enfants doivent être séparés et isolés des adultes au sein des lieux de détention[88].
Délits moraux et criminalisation de comportements sexuels consensuels
L’article 306 du code pénal interdit l’outrage public à la pudeur et aux mœurs islamiques. La version amendée en 2018 de l’article 306 interdit également la violation des « interdits d’Allah ». L’article 307 criminalise les relations sexuelles consensuelles hors mariage. Ces deux dispositions, ont déclaré les avocats, sont utilisées pour poursuivre certaines survivantes de violences sexuelles et dissuadent d’autres survivantes de rapporter leur(s) agression(s).
L’article 306(1) est une disposition fourre-tout qui sanctionne « toute personne qui aura commis un outrage public à la pudeur et aux mœurs islamiques ou a violé les interdits d’Allah ou aidé à les violer »[89]. Les coupables risquent trois mois à deux ans de prison et une amende.
L’article 307 criminalise l’acte de zina, défini comme une relation sexuelle consensuelle entre un homme et une femme en dehors du mariage. En vertu du code pénal mauritanien, le crime de zina s’applique seulement à « tout musulman majeur de l’un ou l’autre sexe ». Alors que le terme « majeur » implique que ce crime ne s’applique qu’à des personnes ayant plus de 18 ans, Human Rights Watch a documenté plusieurs cas où des mineures étaient inculpées de zina. L’article 307 précise que le zina peut être établi par le témoignage de quatre témoins ou par l’aveu de l’auteur. Si l’accusée est une femme, l’état de grossesse suffit pour établir le zina[90]. Si les accusés sont célibataires, ils encourent une peine de cent coups de fouet, exécutée publiquement, et un an de prison. Mais si les accusés sont mariés, ils peuvent être condamnés à mort par lapidation (rajoum).
L’article 308 interdit les comportements homosexuels entre musulmans majeurs et les punit de mort s’il s’agit de deux hommes[91].
De nos jours, les autorités mauritaniennes n’exécutent pas les peines capitales ou punitions corporelles prévues par la loi islamique (charia). Un moratoire de fait sur les exécutions est en vigueur depuis les années 1980.
Interprétation et application restrictive des lois existantes
Quatre avocats ont déclaré à Human Rights Watch que les juges avaient tendance à appliquer une définition étroite du viol. Pour les survivantes adultes, « ils ne tiennent compte que des preuves de brutalité physique », a expliqué Me Bezeid El Mamy.
Le consentement est l’élément distinctif qui différencie le crime de viol du zina (les relations sexuelles hors mariage)[92]. Pourtant la notion de consentement n’est pas clairement définie par la loi mauritanienne. D’après Me Bezeid El Mamy, les tribunaux trouvent difficile d’appliquer cette distinction, ce qui explique pourquoi « les juges se rabattent souvent sur l’article 306, une disposition fourre-tout qui punit les infractions d’‘outrage public à la pudeur et aux mœurs islamiques’, pour éviter d’avoir à utiliser l’article 307 [zina] ou 309 [viol] ». Le problème, c’est que la loi n’est pas claire, que ce soit pour les victimes enfants ou adultes. [Les dispositions] ne mentionnent que la sanction, sans fournir de définition[93]. » Appliquer l’article 306 permet aux juges de punir le comportement sexuel extraconjugal sans avoir à trancher la question de savoir si le rapport était ou non consensuel – un point qui exige souvent de confronter la parole de la plaignante à la parole de l’accusé[94].
D’après Me El Moustapha, lorsqu’une fille atteint la puberté, les juges adoptent souvent la position selon laquelle elle peut consentir à avoir des relations sexuelles avec un homme adulte.[95]
D’après Me M’Baye, « le test de virginité est automatique au cours des examens médico-légaux effectués dans les cas de viol, et le viol n’est reconnu en général que quand l’hymen est percé des suites de l’agression ». Ceci pose problème étant donné que l’état de l’hymen n’est pas un marqueur fiable de la virginité ni de l’agression sexuelle (voir plus haut la section sur les examens médico-légaux). Dans les quelques affaires d’agressions sexuelles que Human Rights Watch a examinées, le jugement écrit n’indiquait pas explicitement sur quelles preuves, dans le dossier de l’affaire, le juge s’était fondé pour décider si un viol avait eu lieu ou non.
La plupart des enfants interrogées qui avaient entamé des procédures judiciaires ont rapporté que, dès que leur agresseur avait été identifié par les autorités, il avait été placé en détention provisoire, et parfois reconnu coupable de viol et condamné à une peine de prison. Human Rights Watch n’a pas pu avoir accès aux archives des tribunaux et à la jurisprudence afin d’évaluer le nombre d’années moyen des peines de prison prononcées à l’encontre des violeurs condamnés.
L’Office des Nations Unies contre la drogue et le crime a recommandé de veiller à ce que les politiques pénales sur la violence à l’égard des femmes prennent en considération, entre autres, la nécessité de tenir les agresseurs responsables de leurs actes et de dénoncer et dissuader les violences faites aux femmes. Il recommande que les tribunaux infligent des peines qui sont proportionnelles à la gravité de l’infraction et à son impact sur les victimes et leur famille, et qui aident à mettre fin aux comportements violents. En outre, il appelle aussi les États à accorder aux victimes « le droit de demander une réparation financière à l’agresseur ou une compensation de l’État » et demande que pour évaluer les dommages et frais réels découlant du crime, les États « considèrent les dommages physiques et mentaux, les opportunités manquées, y compris en termes d’emploi, d’éducation et de bénéfices sociaux, les dommages matériels et moraux, les mesures de réinsertion, y compris les cas médicaux et psychologiques ainsi que les services juridiques et sociaux »[96].
Pourtant les juges mauritaniens, selon plusieurs avocats interrogés par Human Rights Watch, semblent presque toujours ne pas prononcer de sanctions autres que la peine d’emprisonnement. « La réparation n’est jamais prononcée. Il n’y a pas de préjudice. Pour eux, [le viol] est un crime, mais ils n’ont jamais envisagé que le dommage puisse être quantifié. Je n’ai jamais vu d’affaire de viol où un [accusé] a été condamné à payer des dommages à la personne qui a subi le préjudice, je n’ai vu que des peines privatives de liberté envers l’accusé », a ainsi déclaré Me Bezeid El Mamy[97].
Alors que le droit mauritanien offre aux plaignants la possibilité, au cours d’une procédure pénale, de réclamer une compensation pour les dommages subis (en se portant partie civile)[98], aucune des survivantes que nous avons rencontrées n’avait reçu de compensation pour les souffrances subies, ni de l’État, ni de l’agresseur condamné. Néanmoins Human Rights Watch a pu examiner une décision du tribunal de 2012 impliquant l’agression sexuelle d’une fille par un homme, où un tribunal pour enfants avait condamné l’accusé à deux ans de prison et décidé d’une compensation financière qui devait être versée par le coupable à la famille, pour le préjudice moral subi par l’enfant et pour couvrir les frais des soins découlant de l’agression[99].
Lacunes en matière de preuves affaiblissant les arguments de la plaignante
Il y a un problème de preuve : les tests ADN ne sont pas disponibles. Si une victime de violences sexuelles accuse quelqu’un, elle n’aura aucun moyen de le prouver au tribunal. N’importe quel avocat [de la défense] pourra conseiller à son client de nier [les faits], qui à leur tour pourront se transformer en preuve à charge contre la victime [elle-même].
— Me Aïchetou Salma El Moustapha, avocate de l’Association mauritanienne pour la santé de la mère et de l’enfant
Même si les analyses d’ADN ne peuvent pas résoudre toutes les questions en matière de preuve et de consentement dans les affaires d’agressions sexuelles, les survivantes et les assistantes sociales interrogées ont critiqué le fait qu’elles ne sont pas disponibles en Mauritanie. Dans les affaires où des preuves médico-légales existent, et si la survivante connaît ou peut aisément identifier son agresseur présumé, le test ADN pourrait fournir des éléments de preuve scientifiques au soutien des déclarations de la plaignante.
En outre, en l’absence de protocole sur la collecte de preuves médico-légales et leur utilisation au tribunal, les juges ont une large marge de manœuvre pour interpréter à leur guise ou écarter les certificats médicaux lors du procès[100].
Limites de l’assistance juridique et recours aux modes alternatifs de résolution des conflits
|
Khouloud
Khouloud, âgée de 29 ans, est née en Mauritanie mais a grandi au Sénégal, où elle a été scolarisée jusqu’à sa dernière année d’école primaire. Elle vit chez sa sœur, à Nouakchott, avec ses deux enfants en bas âge. Lorsqu’elle s’est confiée à Human Rights Watch, Khouloud était enceinte de son troisième enfant après avoir été violée par son ex-mari. Son état d’exténuation sautait aux yeux. « Je m’inquiète pour mes enfants, qui sont malades parfois et que je n’ai pas les moyens de nourrir, et à propos de ma grossesse actuelle. » À sept mois de grossesse, elle en est arrivée à la conclusion que dénoncer son ex-mari à la police ne mènerait à rien. Khouloud et lui étaient mariés pendant plusieurs années et avaient eu deux enfants lorsqu’il a brusquement quitté la famille et demandé le divorce. Khouloud et ses enfants ont rapidement plongé dans la pauvreté. Ses relations avec son ex-mari se sont détériorées et il est devenu abusif :
Khouloud a décidé de signaler l’incident à un centre proposant des services d’aide directs aux survivantes de violences sexuelles à Nouakchott, en espérant qu’on pourrait l’aider à se procurer un test de paternité : Ils m’ont répondu que les tests de paternité étaient chers et qu’il n’y en avait qu’en Europe. Ils m’ont dit que [mon ex-mari] avait nié la grossesse et que, pour mon intérêt personnel, il valait mieux que je n’en parle pas à un juge. Dans le cas contraire, on m’accuserait de zina et on m’enfermerait[101]. Les assistants sociaux ont dissuadé Khouloud de porter plainte contre son ex-mari. À la place, ils ont essayé résoudre le litige en organisant une conciliation à l’amiable, lors de laquelle son ex-mari s’est engagé à lui verser une pension alimentaire mensuelle. L’avocate du centre avait la possibilité de porter plainte, mais ne l’a pas fait afin de protéger Khouloud. Elle pensait en effet que les chances de gagner le procès étaient nulles : « Notre avocate a refusé de porter plainte parce que Khouloud risquait d’être détenue pour zina », a expliqué Amadou Sy, assistant social du centre de l’Association mauritanienne pour la santé de la mère et de l’enfant, qui a supervisé la conciliation de Khouloud. |
En 2015, la Mauritanie a adopté une loi institutionnalisant l’« aide judiciaire » pour les plaignants et les accusés indigents, dans les affaires civiles et pénales[102]. En théorie, les parties remplissant les conditions peuvent recevoir une assistance financière pour couvrir tous les frais relatifs à une procédure en première instance ou en appel, y compris les honoraires des avocats et si nécessaire des interprètes[103].
Aucune des survivantes que Human Rights Watch a rencontrées n’avait les moyens d’engager un avocat, pourtant aucune n’avait bénéficié de ce programme d’assistance juridique récemment adopté, alors que selon toute apparence, elles y avaient droit. Quelques-unes d’entre elles ont pu obtenir d’être représentées par un avocat grâce à l’assistance d’un des centres fournissant des services d’aide directs aux survivantes de violences sexuelles. Les organisations de défense des droits des femmes ont expliqué qu’elles réglaient la majeure partie des frais de procédures judiciaires des survivantes qu’ils aidaient.
La stigmatisation sociale, le coût des procédures judiciaires, l'improbabilité de toute indemnisation prononcée par le tribunal, le risque d'être poursuivie pour zina et la précarité financière sont autant de facteurs qui poussent de nombreuses familles à préférer les conciliations ou arrangements à l’amiable. Mint Ely a ainsi déclaré à Human Rights Watch : « Les personnes en situation de pauvreté se soumettent à la pression [des arrangements]. Compte tenu de leur précarité, elles préfèrent une indemnisation[104]. »
Si l’accusé a plus de 18 ans, le procureur de la République doit superviser la conciliation entre les parties et le président du tribunal compétent doit authentifier l’accord conclu[105]. Si l’accusé a moins de 18 ans, la conciliation doit être rédigée par écrit, un représentant des services de protection de l’enfance doit l’examiner et un juge doit l’approuver[106].
D’après une assistante sociale, « les policiers suggèrent aux responsables d’accepter un arrangement afin de toucher leur part à travers des dessous-de-table. À la première occasion, lorsque les assistantes sociales sont absentes, ils en profitent pour favoriser un arrangement à l’amiable[107]. »
Inculpation de zina à l’encontre de femmes et de filles
La façon dont les poursuites pour zina sont engagées constitue une discrimination fondée sur le sexe de la personne puisque la grossesse fait office de « preuve ». Les hommes peuvent nier avoir commis l’acte de zina, tandis que pour les femmes cette possibilité est très réduite si on constate qu’elles ont fait une fausse couche ou sont enceintes. D’ailleurs, le personnel des hôpitaux peut dénoncer les femmes qui ont fait une fausse couche ou sont tombées enceintes en dehors du mariage.
Le Comité des Nations Unies pour l’élimination de la discrimination à l’égard des femmes – c’est-à-dire le comité chargé de surveiller et d’évaluer périodiquement l’application de la CEDAW (dit « comité CEDAW ») – et le Comité des droits de l’enfant – le comité chargé de surveiller et d’évaluer périodiquement l’application de la CDE (dit « comité CDE ») – ont tous deux exprimé leur préoccupation du fait que le viol n’était pas défini dans la loi mauritanienne et de la criminalisation des relations sexuelles consensuelles[108].
Le problème ici, c’est l’amalgame entre viol et zina, ainsi que l’amalgame entre les autres formes de violences sexuelles et les atteintes aux bonnes mœurs islamiques.
— Zeïnabou Taleb Moussa, présidente de l’Association mauritanienne pour la santé de la mère et de l’enfant
Des organisateurs communautaires, des activistes, des assistants sociaux et des avocats ont déclaré à Human Rights Watch que les efforts de plaidoyer accomplis au cours des vingt dernières années avaient rendu plus rares, sans les éliminer, les poursuites pour zina ou pour outrage aux bonnes mœurs de filles ou de femmes déclarant avoir été violées ou agressées sexuellement.
Le 6 février 2018, Human Rights Watch a rencontré Maïmouna Mint Taghi, alors ministre des Affaires sociales et de la Famille, qui a déclaré : « Il fut un temps où toute femme qui signalait un viol [incident] était incarcérée pour zina en même temps que le violeur. Aujourd’hui, aucune organisation de la société civile ne peut prétendre que les juges requalifient le viol de zina. Tous les cas de viol signalés font l’objet d’une enquête en tant que tels[109]. »
Contrairement à ces déclarations, Human Rights Watch a rencontré aussi bien des filles que des femmes qui ont été reconnues coupables de zina et emprisonnées, parmi lesquelles plusieurs ont rapporté avoir été violées. Même si le crime de zina s’applique à la fois aux hommes et aux femmes, les affaires récentes que nous avons analysées indiquent que la perspective de l’inculpation de zina peut dissuader de porter plainte les femmes et filles survivantes de violences sexuelles qui voudraient qu’on leur rende justice. [110]
Human Rights Watch a notamment rencontré deux enfants ayant dénoncé un viol qui ont pourtant été poursuivies pour zina. Rouhiya, 17 ans, a rapporté avoir été violée collectivement à 15 ans et inculpée de zina après avoir rapporté l’agression à la police. Elle a passé un certain temps dans un centre alternatif à la détention pour mineurs avant d’être transférée à la prison pour femmes de Nouakchott, bien qu’il soit normalement obligatoire de loger les enfants séparément des détenus adultes lorsqu’il existe des locaux à part pour les accueillir[111]. En raison de son grave état de santé, Rouhiya a été placée en liberté provisoire après avoir passé 24 heures à la prison pour femmes. À l’heure de rédiger ce rapport, les assistants sociaux qui la soutenaient ne savaient pas comment évoluerait son dossier.
Dans une autre affaire, Zeïna, 16 ans, est arrivée du Mali en Mauritanie à l’âge de 14 ans, entre les mains de trafiquants sexuels. Elle a déclaré qu’à 15 ans elle avait été violée à de nombreuses reprises par un homme auprès duquel elle espérait trouver refuge après avoir échappé aux trafiquants qui l’avaient amenée en Mauritanie. Zeïna est tombée enceinte, a été inculpée de zina après avoir accouché et placée sous contrôle judiciaire. Au moment de son entretien avec Human Rights Watch, elle avait l’obligation de pointer chaque semaine dans un commissariat[112].
Les avocats et les activistes interrogés par Human Rights Watch étaient tous d’accord sur le fait qu’actuellement, il est plus rare que les mineures soient inculpées de zina, même celles qui sont enceintes risquent davantage d’être poursuivies, puisque selon la loi nationale, la grossesse est un élément de preuve suffisant pour établir le zina. Les mesures prises éventuellement par le juge d’instruction dépendent dans une grande mesure de la qualification juridique des faits retenue par le procureur de la République.
L’avocat Me Kaber Ould Imejen, qui représentait par le passé des femmes détenues à Nouakchott pour le compte d’une ONG internationale appelée Fondation Noura, a déclaré à Human Rights Watch : « Si une femme est en état de grossesse et n’est pas mariée, c’est automatiquement zina, surtout si elle n’a pas annoncé [immédiatement] qu’elle avait été victime d’une agression sexuelle[113]. »
Quant à Me El Moustapha, elle a déclaré à Human Rights Watch : « Pour les affaires de viol de mineurs, lorsque la fille tombe enceinte, elle est condamnée pour zina, parce que dans l’imaginaire du juge, si la fille tombe enceinte, son corps est mûr – elle peut concevoir un enfant donc, du point de vue de la loi, elle est majeure[114]. » En pareil cas, les juges semblent faire abstraction du fait que la loi mauritanienne définisse un enfant comme une personne de moins de 18 ans[115].
Me Abbad a déclaré à Human Rights Watch : « Il y a peu de cas [d’agressions sexuelles] où la femme n’est pas poursuivie pour zina. Lors de l’étape d’instruction, les juges placent généralement la femme en détention provisoire, ou dans de rares cas, en liberté provisoire, mais sous contrôle judiciaire. Puis [les juges du tribunal] prononcent en général des peines de 3 à 6 mois de prison, fermes ou parfois avec sursis[116]. »
Des avocats ont déclaré à Human Rights Watch que le manque de définition du crime de viol dans la loi nationale et la présence de délits moraux en droit pénal mauritanien laissaient aux juges la possibilité de l’interpréter à leur guise et une grande marge de manœuvre, aux dépens des victimes. D’après Me M’Baye, « certains [juges] ne rendent pas leur jugement en confrontant les preuves à charge et à décharge, mais plutôt avec l’état d’esprit : ‘si tu connais l’agresseur, c’est que tu étais consentante’ »[117].
Contrôle judiciaire imposé pour zina
Comme alternative à la détention provisoire, qui ne devrait être imposée que de façon exceptionnelle selon le droit international relatif aux droits humains, les juges peuvent libérer les défendeurs tout en les maintenant sous contrôle judiciaire jusqu’au procès. Le contrôle judiciaire peut signifier l’imposition de contraintes variées, dont les restrictions de déplacement, le traitement médical obligatoire et le pointage hebdomadaire auprès des agents des forces de l’ordre[118]. Lorsque les juges prononcent des peines avec sursis, ils peuvent étendre les mesures restrictives imposées dans le cadre du contrôle judiciaire.
Human Rights Watch a rencontré cinq femmes et filles qui ont dénoncé un viol, mais ont pourtant été elles-mêmes poursuivies pour zina après avoir signalé leur agression à la police. Celles à qui le tribunal avait accordé la liberté provisoire avant le procès ont été placées sous contrôle judiciaire et obligées de pointer chaque semaine dans un commissariat donné. Rapporter le viol, en soi, constitue un aveu de relations sexuelles, de telle façon que même si la plaignante retire sa plainte pour viol, le procureur de la République peut toujours l’inculper de zina.
Détention imposée pour zina
|
Hissa
« Je me sens mal depuis mon arrivée [en prison] », nous a confié Hissa, 26 ans, emprisonnée pour zina en décembre 2017. Elle avait l’air épuisée et désenchantée dans sa longue melahfa sombre – une robe traditionnelle – qui ne masquait mal le fait qu’elle était enceinte de huit mois. Elle s’est adressée à Human Rights Watch assise sur le sol, face aux machines à coudre de la salle d’activité de la prison pour femmes de Nouakchott. Avant d’être emprisonnée, Hissa vivait à Nouakchott et gagnait sa vie en étant coiffeuse pour femmes et en confectionnant des melahfas. Elle a raconté comment elle a connu son agresseur : C’était un ami qui venait chez moi et me retrouvait à l’école, je passais le brevet. [...] Il a demandé à ma grand-mère l’autorisation d’arranger le mariage, mais ce n’était pas possible. La soirée précédant le début du mois sacré de ramadan, en mai 2017, il a conduit Hissa dans un endroit qu’elle ne connaissait pas et l’a violée. « Ça s’est passé plusieurs fois », a-t-elle précisé. Craignant la réaction de sa famille, Hissa n’a pas parlé de l’incident à ses proches pendant des mois, avant de se rendre compte plus tard qu’elle était enceinte. En décembre 2017, alors que Hissa était à sept mois de grossesse, elle a raconté le viol à sa famille. Son frère aîné l’a emmenée immédiatement au poste de police pour déclarer l’agression, puis à un hôpital où un médecin a confirmé sa grossesse. Peu après, un juge a placé le violeur présumé en garde à vue pendant plusieurs jours. « J’ai été au commissariat, il y avait ma famille et la sienne. Il cherchait la conciliation [à l’amiable]. Mais j’ai découvert à ce moment-là qu’il avait une femme et j’ai refusé. » Le violeur présumé a nié toutes les accusations contre lui et affirmé que Hissa avait consenti à leurs relations sexuelles. Le procureur de la République a alors décidé de les poursuivre tous deux pour zina et de les placer en détention provisoire. « Je ne sais pas pourquoi je suis ici, ni pour combien de temps. J’ai des sentiments de regret. Même si ma famille me téléphone, j’ai du mal à parler à ma propre famille », a-t-elle déclaré à Human Rights Watch. Une semaine après l’entretien, Hissa a accouché au sein de la prison. Elle s’est occupée de son nouveau-né dans la prison pendant presque deux mois, jusqu’à ce qu’en avril 2018 le juge décide de lui accorder la liberté provisoire, ainsi qu’à son violeur présumé. |
En 2010, la Mauritanie a ouvert le premier Centre de réinsertion sociale des enfants en conflit avec la loi (CARSEC)[119]. Au CARSEC, au lieu d’être détenus, les enfants condamnés participent à des cours, des formations professionnelles et des loisirs[120]. L’ONG internationale Terre des Hommes-Italie, qui soutient le centre depuis 2012, estime que d’août 2015 à avril 2018, 201 enfants âgés de 13 à 18 ans inclus sont passés par le centre[121]. La durée moyenne des séjours était de 5,25 mois[122]. Cinq filles ont résidé dans le centre entre 2015 et 2018, dont deux inculpées de zina (Human Rights Watch a rencontré l’une d’elles), une d’infanticide, une de vol et la dernière de consommation de drogue et d’alcool. Pour la même période, les garçons résidant au centre étaient inculpés de viol, d’agression et de vol, d’homicide, de consommation de drogue et d’alcool, ou de vagabondage. Un centre similaire, mais d’une capacité d’accueil beaucoup plus restreinte, a ouvert dans la ville de Nouadhibou, dans le nord du pays, en novembre 2016. Depuis son ouverture en juillet 2018, 54 enfants ont résidé dans le centre, dont trois filles, mais aucune n’était inculpée de zina[123].
Le 1er février 2018, une délégation de Human Rights Watch a visité la prison pour femmes de Nouakchott. Le directeur de la prison, Hamidou Cissokho, nous a déclaré qu’à ce moment-là, 22 femmes étaient détenues, dont 9 inculpées ou reconnues coupables de zina. Human Rights Watch a rencontré trois d’entre elles. On comptait parmi les détenues 17 Mauritaniennes, trois Sénégalaises et deux Marocaines. La Fondation Noura, une ONG internationale apportant un appui juridique et psychosocial aux femmes en détention et à celles qui sortent de prison, estime qu’entre le 19 janvier et le 29 décembre 2017, 64 femmes et filles étaient détenues dans la prison pour femmes de Nouakchott, dont 26 inculpées ou reconnues coupables de zina. Human Rights Watch n’a pas eu accès à des données sur l’autre prison où des femmes sont détenues, celle de Nouadhibou.
Human Rights Watch a constaté que l’établissement pénitentiaire de Nouakchott ne disposait d’aucun espace séparé pour les filles, ni aucun aménagement pour les femmes enceintes, et que les gardiens de prison étaient tous des hommes.
Deux des trois femmes interrogées étaient représentées par un avocat. Des annonces d’ONG proposant d’aider les femmes à trouver un avocat pour les représenter étaient affichées sur le mur de la salle d’activités de la prison. Toutes les détenues interrogées étaient conscientes qu’elles étaient accusées de zina. Human Rights Watch n’a pas pu déterminer si elles avaient toutes subi des violences sexuelles.
L’article 309 du code pénal inflige 100 coups de fouet et un an de prison à tout musulman majeur qui commet le zina et la peine capitale par lapidation si cette personne est mariée ou divorcée. En pratique, la flagellation et la lapidation ne sont plus mises à exécution, et lorsqu’elles sont prononcées contre un accusé, elles peuvent être commuées en peine de prison s’il réussit à contester le jugement devant le Haut conseil de la fatwa et des recours gracieux, créé en 2012[124]. Selon les avocats avec lesquels Human Rights Watch s’est entretenu, cette commutation exige l’intervention de juristes islamiques afin de prouver que la conversion de la peine que demande l’accusé peut être compatible avec la jurisprudence de la charia[125].
Jusqu’à ce que la peine soit officiellement commuée, les femmes n’ont aucune idée du temps qu’elles passeront en prison. Human Rights Watch a rencontré Aïssata, 21 ans, emprisonnée depuis plus d’un an pour avoir commis le zina, sans date de libération définie au moment de l’entretien.
|
Aïssata
« Je souhaite être libérée, et vite ! », a déclaré Aïssata à Human Rights Watch, assise sur le sol de la prison pour femmes de Nouakchott. Au moment de l’entretien, Aïssata, 21 ans, était détenue depuis un an et deux mois. Un assistant social qui rend visite à Aïssata à la prison a déclaré : « Aïssata est arrivée [ici] en décembre 2016 à peu près. Elle a été condamnée au rajoun [lapidation] pour zina et infanticide. Comme la Mauritanie n’applique pas la peine de rajoun, Aïssata est donc détenue sans que sa date de libération soit fixée. Son dossier de libération est entre les mains des oulémas. » Mère de deux enfants, Aïssata a été détenue après avoir perdu son troisième. En 2016, elle a accouché dans un hôpital public de Nouakchott, avant de rentrer chez elle le jour même. Pendant la nuit, le nouveau-né est mort de causes inconnues, a-t-elle déclaré. Le lendemain, Aïssata est retournée à l’hôpital pour demander de l’aide, et depuis, elle n’a pas pu rentrer chez elle. « Ils sont venus me chercher à l’hôpital et m’ont emmenée au commissariat. Je suis restée huit jours au commissariat après le décès de l’enfant », a-t-elle déclaré. Alors que l’enquête criminelle avançait, la police s’est rendu compte que le bébé décédé était né hors mariage. Le procureur de la République l’a inculpée à la fois d’infanticide et de zina. Un juge de première instance a reconnu Aïssata innocente de la mort de son nouveau-né mais coupable de zina. D’après son avocat actuel : Elle a reconnu dans le procès-verbal de la police qu’elle avait commis le zina. Le tribunal de première instance a appliqué la peine de lapidation. La cour d’appel a estimé qu’Aïssata devait être libérée jusqu’à ce que la peine de lapidation soit exécutée. Le procureur a adressé une lettre à la présidence pour avoir la perspective du mufti [la plus haute autorité de Mauritanie en matière de droit islamique] – la réponse est attendue depuis cinq mois. Certains magistrats prononcent toujours des peines de lapidation malgré le fait qu’elles ne sont plus exécutées en Mauritanie. L’assistant social qui soutient Aïssata, affilié à l’Association mauritanienne pour la santé de la mère et de l’enfant, qui aide les détenues de Nouakchott, a confirmé que c’était très courant pour les personnes condamnées pour zina[126]. Séparée de ses enfants et de sa famille, qui lui rend visite de temps en temps, la frustration d’Aïssata était palpable : « Ici, en prison, ma vie est compliquée. Parfois, c’est supportable, mais quand mes codétenues s’en vont, je suis déprimée. Je pleure beaucoup. » À l’heure de la rédaction de ce rapport, Aïssata attendait toujours que les juristes islamiques se prononcent sur son cas. |
III. Manque de financement des centres de prise en charge gérés par les organisations de la société civile
Les organisations de la société civile, particulièrement les groupes nationaux de défense des droits des femmes, jouent un rôle déterminant dans le soutien aux survivantes de violences sexuelles, tant sur le plan financier que logistique, tout au long de leur rétablissement et de la procédure judiciaire.
À Nouakchott, le gouvernement ne gère aucun espace ou refuge d’urgence où les survivantes pourraient être en sécurité. Tous les centres fournissant des services directs aux survivantes de violences sexuelles que Human Rights Watch a identifiés et visités dans la capitale sont gérés par des groupes de la société civile, qui ont des moyens financiers et logistiques limités. Quant à l’État, soit il ne leur apporte aucun financement, soit il ne leur alloue que des subventions limitées, sur des projets ciblés.
Certains centres sont dotés de matériel médical qui leur permet de réaliser sur place des examens physiques simples. Aucun centre n’a la capacité d’accueillir des survivantes pour la nuit. Dans les cas d’urgence, les dirigeantes d’ONG, comme Mint Ely, finissent parfois par héberger les survivantes à leur propre domicile. D’après les représentants de Médicos del Mundo, l’hospitalisation est parfois aussi une stratégie permettant de protéger la survivante d’un retour vers une situation où elle n’est pas en sécurité[127].
Étant donné que la plupart des ONG de défense des droits des femmes dépendent essentiellement de financements ponctuels de projets, alloués surtout par des bailleurs de fonds internationaux, elles ne sont pas équipées pour offrir des services au quotidien. Les centres d’aide aux survivantes de violences sexuelles dépendent de leurs bénévoles et n’ont pas les moyens d’assurer la sécurité physique des personnes qu’ils soutiennent. Les assistants sociaux et les activistes soutenant les survivantes de violences sexuelles ont exprimé leur crainte des représailles contre les survivantes et contre l’équipe qui les aide.
Certaines femmes et filles qui arrivent au bout de leur peine de prison pour délits moraux ont beaucoup de mal à trouver d’autres solutions d’hébergement dans le cas où elles ne peuvent pas retourner en sécurité dans leurs familles ou domiciles. L’État ne prévoit aucune aide transitionnelle pour les femmes sortant de prison. Human Rights Watch a parlé à au moins une survivante qui n’avait d’autre choix que de retourner dans un domicile où elle subit des abus, vu le manque d’options d’hébergement de transition. La Fondation Noura, à Nouakchott, apporte des services d’aide de transition aux ex-prisonnières, tout en appelant l’État à faire en sorte que ce type de services soient accessibles à davantage de personnes[128].
IV. Projet de loi sur les violences fondées sur le genre : une opportunité de changement ?
Le 3 mars 2016, le gouvernement mauritanien a approuvé un projet de loi cadre relative aux violences fondées sur le genre qui vise à « renforcer les mesures nationales pour combattre la violence à l’égard des femmes »[129]. Le projet de loi a été approuvé par le Sénat mauritanien en 2016 (une institution qui depuis a été dissoute), mais rejeté par l’Assemblée nationale par la suite. À l’heure où nous écrivons, il attendait un deuxième vote par cette même chambre[130]. Human Rights Watch a rencontré Hafsa Kane, membre active du Réseau des femmes parlementaires mauritaniennes, qui a plaidé en faveur de l’adoption du projet de loi et organisé plusieurs réunions publiques informelles réunissant des représentants de la société civile et des autorités religieuses. D’après Kane, « un des problèmes que nous avons rencontrés avec cette loi, c’est l’emploi du terme ‘genre’. [...] Dans ce mot ‘genre’, [de nombreux députés qui ont voté contre] voient les questions liées à l’homosexualité (dans un pays où elle est proscrite par la loi). Dans cette loi, au lieu de dire ‘époux’, les auteurs écrivent ‘partenaires’, alors les gens n’arrivent pas à se mettre en connexion avec ces mots. La loi est taxée d’être copiée de l’extérieur[131]. »
À l’heure de la rédaction de ce rapport, Human Rights Watch avait consulté plusieurs versions du projet de loi, mais on ne savait pas clairement quelles dispositions seraient votées par l’Assemblée nationale. S’il était adopté, le projet approuvé le 3 mars 2016 par l’exécutif mettrait en place de nouvelles voies de recours et des services publics d’aide aux survivantes de violences fondées sur le genre, y compris d’agressions sexuelles. La loi prévoit des définitions et des peines pour le viol et le harcèlement sexuel, crée des chambres spécifiques au sein des tribunaux de première instance pour entendre les affaires de violences sexuelles, permet aux plaignantes de fusionner les procédures au pénal et au civil et autorise les organisations de la société civile à saisir les tribunaux au nom des survivantes.
Le projet de loi permet aussi aux juges d’émettre des ordonnances de protection (ordonnances restrictives contre les agresseurs présumés), incite les juges à examiner les preuves médico-légales pour juger les affaires de violences sexuelles, permet d’introduire des preuves ADN, oblige le gouvernement à collecter des données nationales sur les incidents de violences sexuelles et requiert qu’il crée des refuges offrant des solutions d’hébergement à court et long terme, opérés soit par l’État, soit par des organisations de la société civile que l’État habilitera officiellement.
Cependant, ce projet de loi se situe encore loin des normes internationales en matière de droits humains que la Mauritanie s’est engagée à respecter. Il ne respecte pas non plus les éléments recommandés pour la législation sur la violence à l’égard des femmes, qui sont exposés dans le Manuel de législation sur la violence à l’égard des femmes de 2012 ainsi que dans les Lignes directrices sur la lutte contre les violences sexuelles et leurs conséquences en Afrique, qui s’appliquent à tous les États membres de l’Union africaine[132].
Par exemple, la loi n’abroge pas les dispositions du Code pénal qui criminalisent les relations sexuelles consensuelles. Bien que le projet de loi définisse le viol de façon à intégrer la pénétration orale ou anale, il ne tient pas compte du viol commis à l’aide d’un objet et n’inclut pas explicitement le viol conjugal. Il ne pénalise pas les autres formes d’agression sexuelle ni les tentatives de viol. Par ailleurs, le texte contient toujours des punitions comme la lapidation ou la flagellation, qui constituent des traitements inhumains et dégradants[133]. Il ne définit pas plusieurs termes clés auxquels il se réfère, tels que « violences basées sur le genre », « consentement » ou « pratiques inhumaines ». Définir ces termes est indispensable pour que les dispositions de la loi soient applicables.
Par ailleurs le texte exclut de son champ d’application plusieurs autres formes de violences fondées sur le genre, comme les mutilations génitales féminines ainsi que les mariages des enfants, précoces ou forcés, et ne précise pas comment il s’appliquera de concert avec d’autres lois existantes comme le Code général de l’enfance ou le Code pénal.
Même si le texte prévoit la création de tribunaux et d’unités de police spécialisées, il ne prévoit pas de formation obligatoire, régulière et institutionnalisée destinée à tous les fonctionnaires des forces de l’ordre et de la justice, ainsi qu’aux professionnels de santé, sur les violences fondées sur le genre, la sensibilisation aux questions de genre et les obligations de la Mauritanie au regard du droit international. En outre, il ne contient aucune disposition permettant de financer les mesures qu’il établit.
V. Obligations de la Mauritanie au regard du
droit international
La loi mauritanienne combine des principes et règles de procédure issus du droit civil et du droit islamique (charia) et suit les règles d’interprétation de l’école de jurisprudence malékite. La constitution mauritanienne de 1991, dont le dernier amendement date d’août 2017[134], garantit plusieurs droits et libertés fondamentaux et souligne l’attachement du pays aux « principes de la démocratie », tels que définis par « les conventions internationales auxquelles la Mauritanie a souscrit »[135]. L’article 1 dispose que tous les citoyens sont égaux devant la loi, tandis que l’article 13 garantit le droit à un procès équitable et respectueux des procédures et reconnaît à la fois « l'honneur et la vie privée du citoyen » et « l'inviolabilité de la personne humaine »[136].
Les violences sexuelles violent plusieurs droits humains centraux protégés par le droit international, tels que le droit à la vie et à la sécurité de la personne, le droit de ne pas subir de torture ou autres mauvais traitements ainsi que celui de jouir du meilleur état de santé physique et mentale possible.
La Mauritanie est partie à deux traités majeurs sur les droits des femmes : la Convention sur l'élimination de toutes les formes de discrimination à l'égard des femmes (CEDAW)[137] et le protocole de la Charte africaine des droits de l'Homme et des peuples relatif aux droits des femmes en Afrique (le protocole de Maputo)[138]. Le pays a adhéré au protocole de Maputo sans réserves.
La Mauritanie maintient toujours les réserves générales qu’elle a émises vis-à-vis de la CEDAW, jugeant ses dispositions contraires à la loi islamique (charia) et à la constitution mauritanienne[139]. En juillet 2014, le pays a partiellement levé ses réserves pour les limiter à l’article 13(a), qui donne aux femmes et aux hommes un droit égal aux prestations familiales, et à l’article 16, qui pousse les États à éliminer toutes formes de discrimination envers les femmes dans les affaires découlant du mariage et des rapports familiaux, ignorant ainsi les recommandations du Comité CEDAW de les lever pleinement[140].
Par ailleurs la Mauritanie est partie à de nombreux traités relatifs aux droits humains dans le cadre des Nations Unies et du système normatif africain[141], notamment le Pacte international relatif aux droits civils et politiques (PIDCP)[142], le Pacte international relatif aux droits économiques, sociaux et culturels (PIDESC)[143], la Convention contre la torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants (CCT) et son protocole facultatif[144], la Convention relative aux droits de l’enfant (CDE) et son protocole facultatif concernant la vente d'enfants, la prostitution des enfants et la pornographie mettant en scène des enfants[145], la Convention internationale sur la protection des droits de tous les travailleurs migrants et des membres de leur famille[146] et la Convention relative aux droits des personnes handicapées[147].
La Mauritanie a également ratifié la Charte africaine des droits de l'Homme et des peuples (CADHP)[148] et la Charte africaine des droits et du bien-être de l'enfant (CADBEE)[149].
Aussi bien les traités de l’ONU que les traités africains ratifiés par la Mauritanie consacrent les droits détaillés plus haut, reconnaissant que les femmes et les filles ont le droit de vivre sans subir de violence.
Lors du dernier Examen périodique universel de la Mauritanie, sous l’égide du Conseil des droits de l’homme des Nations Unies, en novembre 2015, plus de 20 % des recommandations adressées au pays portaient sur la façon dont il respecte les droits des femmes, dont six qui l’exhortaient à mieux répondre à la prévalence des violences sexuelles au niveau national, ce que la Mauritanie a accepté de commencer à mettre en œuvre[150].
Principe de non-discrimination et droit de vivre sans subir de violences sexuelles
La Mauritanie a l’obligation de prévenir et de condamner toute forme de discrimination, y compris fondée sur le sexe[151]. Les organes internationaux ont établi que les violences à l’égard des femmes fondées sur le genre, c’est-à-dire « la violence dirigée contre une femme parce qu’elle est femme ou affecte les femmes de façon disproportionnée », constituait une forme de discrimination. L’article 2(e) de la CEDAW engage les États à « prendre toutes mesures appropriées pour éliminer la discrimination pratiquée à l’égard des femmes par une personne, une organisation ou une entreprise quelconque ». Le Comité CEDAW a insisté sur les obligations de diligence des États vis-à-vis des fautes, actives ou passives, commises par les acteurs non étatiques[152].
La CEDAW oblige les États à veiller à ce que les femmes jouissent des mêmes libertés et droits fondamentaux que les hommes, notamment du droit à la vie et à la santé physique et mentale, et à garantir leur « plein développement et progrès »[153].
En vertu de la CEDAW et du protocole de Maputo, la Mauritanie est également tenue de « combattre la discrimination à l’égard des femmes, sous toutes ses formes, en adoptant les mesures appropriées aux plans législatif, institutionnel et autre »[154]. L’article 3(4) du protocole de Maputo, à l’instar d’autres normes internationales des droits humains, impose que « les États adoptent et mettent en œuvre les mesures appropriées afin d’assurer la protection du droit de la femme au respect de sa dignité et sa protection contre toutes formes de violence, notamment la violence sexuelle et verbale »[155]. De façon plus spécifique, la CEDAW engage la Mauritanie à formuler « des règles de droit matériel, y compris au niveau constitutionnel, et [concevoir] des politiques gouvernementales, des programmes, des cadres institutionnels et des mécanismes de surveillance destinés à éliminer toutes les formes de violence à l’égard des femmes fondée sur le genre, qu’elles soient commises par des acteurs étatiques ou non étatiques »[156]. En 2014, le comité CEDAW a appelé la Mauritanie à « lancer une réforme judiciaire visant à modifier ou abroger les lois discriminatoires, y compris les dispositions discriminatoires des codes pénal, du statut personnel et de la nationalité »[157].
La Mauritanie doit protéger l’autonomie, l’intégrité corporelle et le droit de vivre sans violence de toutes les personnes et particulièrement des enfants[158] et des femmes[159]. L’article 4(1) du protocole de Maputo prévoit que « toute femme a droit au respect de sa vie, de son intégrité physique et de la sécurité de sa personne. Toutes formes d’exploitation, de punition et de traitement inhumain ou dégradant doivent être interdites[160]. » Le Comité CEDAW a clairement exprimé que « le droit des femmes à une vie exempte de violence fondée sur le genre ne peut être dissocié des autres droits de l’homme, comme le droit à la vie, à la santé, à la liberté et à la sécurité de la personne, le droit à l’égalité et à une égale protection au sein de la famille, le droit à ne pas être soumis à la torture, ou à un traitement cruel, inhumain ou dégradant, et la liberté d’expression, de mouvement, de participation, de réunion et d’association »[161].
Pratiques culturelles néfastes et mesures de prévention
En vertu du protocole de Maputo, de la CEDAW, de la CADBEE et de la recommandation générale conjointe du Comité CEDAW et du Comité CDE, la Mauritanie a l’obligation de s’efforcer de « modifier les schémas et modèles de comportement socio-culturel de l’homme et de la femme en vue de parvenir à l’élimination des préjugés et des pratiques coutumières [néfastes] »[162] qui affectent la santé et le développement des enfants[163] et créent des préjugés à l’encontre des petites filles et des femmes[164].
L’article 21 de la CADBEE interdit explicitement « les coutumes et pratiques préjudiciables à la santé, voire à la vie de l'enfant », notamment les différentes formes de mutilation génitale féminine et la pratique du mariage des enfants[165].
Les lignes directrices de la CADHP appellent les États à entreprendre des campagnes de sensibilisation, en s’efforçant surtout de « prévenir les conséquences des violences sexuelles » et de « lutter contre la perception selon laquelle ces actes constituent une atteinte à l’honneur d’une personne, de sa famille ou de sa communauté »[166].
Coordination des services et collecte des données
Le comité CEDAW et le comité CDE ont tous deux exprimé leur inquiétude face à l’absence de mécanisme permettant de collecter des informations sur l’incidence des violences faites aux femmes et aux enfants. Ils ont recommandé que la Mauritanie entreprenne une étude exhaustive pour réunir une documentation nationale sur les cas d’exploitation et d’abus sexuels[167].
Les Lignes directrices sur la lutte contre les violences sexuelles et leurs conséquences en Afrique de la CADHP (Lignes directrices de la CADHP), qui constituent un instrument normatif clé adopté par la Commission en mai 2017, engagent aussi les États parties à collecter des données ventilées sur la prévalence des violences sexuelles afin d’éclairer les politiques publiques[168]. Le Comité CEDAW a insisté sur le fait que les États doivent « créer un système qui collecte, analyse et publie de façon régulière des données statistiques sur le nombre de plaintes impliquant toute forme de violence à l’égard des femmes fondée sur le genre [...], ventilées par type de violence et relation entre la victime et l’auteur, et prendre en compte les formes croisées de discrimination à l’égard des femmes et toutes les autres caractéristiques sociodémographiques pertinentes, comme l’âge de la victime »[169].
À cet effet, le Manuel sur la poursuite effective en réponse à la violence à l’encontre des femmes et des filles, publié par l’Office des Nations Unies contre la drogue et le crime en 2014 (Manuel 2014 UNODC), énonce que « les ministères publics ont le devoir de collecter des données statistiques et de partager ces données. Ces données administratives pénales générées par le ministère public devront être ventilées en fonction du sexe, de l’âge et d’autres facteurs comme l’origine ethnique[170]. »
Les Lignes directrices de la CADHP appellent également les États parties à « assurer la bonne coordination et coopération entre les différent.es acteur.rices engagé.es dans la protection et le soutien aux victimes de violences sexuelles, y compris entre les services de l’État, les organisations de la société civile [...], les organisations internationales et tou.tes les partenaires pertinent.es »[171]. Autrement dit, la Mauritanie ne peut plus compter uniquement sur les activités proposées par les organisations de la société civile, mais doit commencer à jouer un rôle actif pour favoriser les « synergies » entre les différents acteurs[172].
De la même façon, le comité CEDAW a appelé les États parties à « mettre en place un mécanisme ou un organisme, ou en mandater un qui existe déjà, afin de coordonner, surveiller et évaluer régulièrement la mise en place et l’efficacité, aux niveaux national, régional et local, des mesures, notamment celles qui font l’objet de préconisations dans la présente recommandation [Recommandation générale n°35], ainsi que des autres normes ou principes directeurs internationaux et régionaux applicables, en vue de prévenir et d’éliminer toutes les formes de violence à l’égard des femmes fondée sur le genre »[173].
Droit à la vie privée et à l’autonomie corporelle
Criminaliser les relations sexuelles consensuelles entre adultes (à travers le crime de zina, comme le montre ce rapport) est contraire à divers droits humains protégés par le droit international relatif aux droits humains, notamment aux droits à la non-discrimination, à l’autonomie physique, à la santé physique et mentale, à la vie privée, à la liberté et à la sécurité de la personne.
De plus, les inculpations de zina constituent une discrimination se fondant sur le sexe de la personne puisque la grossesse sert de « preuve » de l’infraction (voir plus haut la section sur les poursuites pour zina).
Le comité CEDAW a appelé à abroger la législation criminalisant l’adultère et toutes les autres dispositions touchant les femmes de façon disproportionnée, notamment celles qui entraînent un recours à la peine capitale de façon discriminatoire envers les femmes[174].
Le Comité des droits de l’Homme – le comité chargé de surveiller et d’évaluer périodiquement l’application du PIDCP – considère également qu’au nom de l’article 9 du PIDCP, toute personne arrêtée ou détenue parce qu’elle est inculpée d'un crime doit être présentée dans les 48 heures devant un juge qui pourra examiner la légalité et la nécessité de sa détention[175].
De plus, le fait de soumettre des filles mineures, en raison d’une activité sexuelle, à une détention provisoire et un emprisonnement avec des femmes adultes, viole le principe selon lequel c’est l’« intérêt supérieur de l’enfant » qui doit gouverner les actions de l’État envers les enfants, qui ne devraient n’être détenus qu’en dernier recours, séparés des adultes et pour la durée la plus courte possible[176]. La privation de liberté a un effet négatif sur la capacité des enfants à exercer d’autres droits fondamentaux, dont le droit à l’éducation, la santé et l’unité familiale[177].
Droit à la santé, soins médicaux et examens médico-légaux
En vertu de l’article 12 du PIDESC, la Mauritanie a l’obligation de reconnaître « le droit qu'a toute personne de jouir du meilleur état de santé physique et mentale qu'elle soit capable d'atteindre », y compris de la santé sexuelle et reproductive[178].
Les Lignes directrices de la CADHP appellent les États à former les professionnels de la santé pour qu’ils puissent réagir de façon appropriée aux incidents de violences sexuelles[179] et exigent que les survivantes aient accès à des « tests de dépistage du VIH/SIDA et de toute autre IST [...] gratuits et de qualité »[180]. Le comité CEDAW souligne que les États doivent garantir « l’accès [...] à une aide financière, à une aide juridictionnelle de qualité, gratuite ou à prix modique, ainsi qu’à des services médicaux, psychosociaux psychologiques » et que « les services de soins de santé devraient pouvoir traiter les traumatismes et proposer, au moment opportun, des services complets de santé mentale, sexuelle et procréative, en particulier une contraception d’urgence et une prophylaxie post-exposition au VIH »[181].
En outre, l’article 14 (2)(c) du protocole de Maputo dispose que les États doivent, a minima, « protéger les droits reproductifs des femmes, particulièrement en autorisant l’avortement médicalisé, en cas d’agression sexuelle, de viol, d’inceste et lorsque la grossesse met en danger la santé mentale et physique de la mère ou la vie de la mère ou du fœtus »[182].
Le comité CEDAW a qualifié la poursuite forcée de la grossesse, la criminalisation de l’avortement, le fait d’empêcher ou de retarder l’avortement sûr ou les soins post-avortement, de formes de violence fondée sur le genre qui, selon les circonstances, peuvent constituer des tortures ou traitements inhumains et dégradants[183]. Il appelle également à abroger les dispositions qui criminalisent l’avortement et à fournir « au moment opportun, des services complets de santé mentale, sexuelle et procréative » [184]. De la même façon, le comité CDE exhorte les États à « dépénaliser l’avortement afin que les adolescentes puissent accéder à l’avortement médicalisé et bénéficier de services après l’avortement, et de modifier leur législation de manière à ce que la prise en compte de l’intérêt supérieur des adolescentes enceintes soit garantie et à ce que leur opinion soit toujours prise en considération et respectée dans les décisions touchant à l’avortement »[185].
Les Lignes directrices de la CADHP appellent les États à veiller à « l’application par les services médico-légaux et les services judiciaires de standards internationaux en matière de collecte, d’utilisation, de conservation et d’archivage de preuves relatives aux actes de violences sexuelle » et à « prendre les mesures nécessaires pour étendre l’habilitation à la collecte de preuves à certains personnels médicaux, tels que les infirmier.ères et les sages-femmes », afin de réaliser ce type d’analyses en tenant compte du manque de personnel médical dans certaines zones[186].
Le manuel 2014 de l’UNODC prévoit lui aussi que « les procureurs, dans la mesure du possible, doivent veiller à ce que la collecte de preuves médicales et médico-légales soit faite rapidement [idéalement dans un délai de 72 heures], qu’elle soit gratuite et qu’elle ne soit pas faite de manière à causer une seconde victimisation de la victime. Cependant, les procureurs ne doivent pas dépendre de ces preuves pour faire avancer les poursuites judiciaires[187]. »
Signalement et devoirs des policiers, procureurs et juges d’instruction
Le Manuel sur les réponses policières efficaces à la violence envers les femmes, publié par l’Office des Nations Unies contre la drogue et le crime en 2010 (Manuel 2010 UNODC), recommande que dans les cas de violences sexuelles, les policiers prennent des mesures pour « respecter la victime, son intimité et le traumatisme qu’elle a subi, tout en limitant au maximum l’intrusion dans sa vie »[188]. Il remarque qu’il est « souhaitable que les postes de police disposent de locaux privés et calmes où les entretiens puissent avoir lieu »[189]. Il estime aussi qu’« il faut que les agents comprennent qu’ils sont là pour aider, non pour juger, et qu’il faut toujours traiter les femmes sans préjugés ni discrimination »[190].
Dans les affaires impliquant des enfants, le manuel 2010 de l’UNODC invite les enquêteurs « à toujours utiliser, devant les enfants, un langage simple qui tienne compte de leur âge, de leur maturité apparente et de leur développement intellectuel, et à vérifier que l’enfant comprend bien chaque mot qu’ils utilisent »[191].
Quant au manuel 2014 de l’UNODC, il propose des directives taillées sur mesures pour les ministères publics. Il énonce que « les procureurs devraient traiter les victimes avec courtoisie, dignité, respect et avec une sensibilité particulière au traumatisme qu’elles ont subi » et qu’ils « doivent être capables d’assister et de soutenir les victimes traumatisées et prêts à les renvoyer éventuellement vers les services d’aide appropriés »[192]. Il énonce clairement que les affaires de violence fondée sur le genre ne font pas figure d’exception : « Une fois que la victime fait un rapport à la police, l’État a la responsabilité d’enquêter sur l’affaire, d’inculper l’auteur de l’infraction s’il y a suffisamment de preuves et enfin de le tenir responsable en sanctionnant son comportement criminel[193]. »
Au cours de l’enquête, le manuel 2014 UNODC souligne que « les procureurs doivent se tenir prêts à objecter à toute preuve liée à un ‘défaut’ de personnalité de la victime (par exemple, son usage de narcotiques) qui n’affecte pas directement l’incident qui fait l’objet de l’affaire » et précise que « le fait qu’une victime n’ait pas consenti à l’examen médico-légal, qui est long et intrusif, ne doit pas donner lieu au rejet automatique de son dossier »[194].
Le manuel 2014 de l’UNODC demande également que « les procureurs coopèrent avec la police sur les affaires [de violence fondée sur le genre] pour veiller à ce que les efforts policiers se concentrent sur la constitution d’un dossier solide et non pas sur le discrédit qu’ils pourraient jeter sur la victime »[195]. De plus, « dans les affaires de violences sexuelles, au moment d’examiner si toutes les preuves sont disponibles, les procureurs doivent déterminer si l’affaire se centre sur la question du consentement [à la relation sexuelle qui fait l’objet de l’examen judiciaire] ou sur celle de l’identité [de l’agresseur] »[196].
Par ailleurs les Lignes directrices de la CADHP demandent aux États de former de façon appropriée le personnel « de la police, de l’armée et de la gendarmerie, les services de douane et de renseignement, les sapeurs-pompiers, le personnel déployé dans des opérations de maintien de la paix ; les juges, les magistrat.es, les auxiliaires de justice [...] » afin qu’ils soient aptes à traiter les affaires de violences sexuelles[197]. De même, le comité CEDAW pousse les États à « prévoir un renforcement des capacités, une éducation et une formation obligatoires, régulières et appropriés pour le personnel judiciaire, les avocats et les agents des services de répression, en particulier le personnel médico-légal, les législateurs et les professionnels des soins de santé, notamment dans les domaines de la santé sexuelle et procréative »[198]. Les Lignes directrices de la CADHP exigent aussi que les États « [prennent] les mesures nécessaires pour que des travailleur.ses sociaux.les spécifiquement formé.es soient intégré.es de manière permanente dans les commissariats et les gendarmeries afin de prendre en charge et d’orienter les victimes de violences sexuelles [...] » et les encouragent à créer des unités spécialisées au sein de l’instruction et du ministère public[199].
L’article 8(e) du protocole de Maputo exige des États qu’ils garantissent « une représentation équitable femmes dans les institutions judiciaires et celles chargées de l’application de la loi », ce qui inclut les commissariats, les contingents de la garde nationale et les services judiciaires.
Accès effectif des survivantes aux tribunaux et droit à un recours judiciaire efficace
Selon l’article 14(1) du PIDCP, la Mauritanie doit garantir un procès équitable aux survivantes de violences sexuelles qui demandent justice[200]. L’article 8(a) du protocole de Maputo garantit aux femmes, à l’égal des hommes, « l’accès effectif à l’assistance et aux services juridiques et judiciaires »[201].
Le comité CEDAW appelle les États parties à « garantir un accès effectif des victimes aux cours et tribunaux et veiller à ce que les autorités règlent de manière appropriée toutes les affaires de violence à l’égard des femmes fondée sur le genre, en appliquant le droit pénal et, s’il y a lieu, les poursuites d’office, pour traduire en justice les auteurs présumés de manière juste, impartiale, rapide et opportune, et leur imposer des sanctions appropriées ». Il demande aussi que les frais judiciaires soient épargnés aux victimes/survivantes[202].
Tout au long des procédures judiciaires, les Lignes directrices de la CADHP demandent que « les États [garantissent] l’irrecevabilité de l’invocation du comportement sexuel antérieur et postérieur de la victime, y compris les questions éventuelles concernant sa virginité, ou des arguments tenant à la dénonciation tardive des faits par la victime, comme élément d’appréciation des éléments constitutifs des violences sexuelles ou comme circonstance atténuante »[203]. De même, la résolution de l’Assemblée générale de l’ONU sur le renforcement des mesures en matière de prévention du crime et de justice pénale visant à combattre la violence à l’égard des femmes exige « qu’il soit interdit d’exposer la vie sexuelle du plaignant dans des procédures civiles ou pénales (quand elle n’a pas de lien avec l’affaire), et qu’aucune présomption défavorable ne soit tirée du seul fait d’un délai, quelle qu’en soit sa durée, entre le moment où une infraction sexuelle aurait été commise et le moment où elle est dénoncée »[204].
Le Manuel de législation sur la violence à l’égard des femmes publié par UN Women en 2012 appelle également à inscrire dans la loi l’interdiction, pour les tribunaux, de tirer des conclusions d’un délai, si long soit-il, entre le moment de la violence et le moment où elle a été reportée. Il note que le temps écoulé avant la plainte concernant la violence à l’égard d’une femme est souvent interprété comme la preuve que la plaignante n’est pas fiable. Pourtant, si les survivantes tardent souvent à déclarer les actes de violence aux autorités, leurs raisons peuvent être diverses : crainte d’être stigmatisée, humiliée ou de ne pas être crue, menace de vengeance, dépendance financière ou affective à l’égard de l’auteur des actes de violence, manque de confiance dans les institutions responsables ou impossibilité de s’adresser à elles parce qu’elles sont géographiquement éloignées ou qu’il n’y a pas de personnel de justice pénale compétent[205].
Le droit des survivantes à un recours efficace est consacré par de nombreux instruments internationaux relatifs aux droits humains qui engagent la Mauritanie[206]. L’article 12(1) du protocole de Maputo exige explicitement que les États « [fassent] bénéficier les femmes victimes d’abus et de harcèlements sexuels de conseils et de services de réhabilitation ». L’observation générale n°4 de la CADHP concernant le droit à réparation des victimes de torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants incite les États à adopter « une approche [...] holistique de la justice » et « une approche de la réparation axée sur la victime »[207].
De même, le comité CEDAW a incité les États à « prévoir des réparations appropriées pour les femmes victimes de violence fondée sur le genre, [y compris] la réparation en espèces et des prestations de services légaux, sociaux et sanitaires, notamment en matière de santé sexuelle, procréative et mentale en vue d’une guérison complète, ainsi que des garanties de non-répétition [...] »[208]. Il a souligné que « ces réparations devraient être adéquates, rapidement accordées, holistiques et proportionnées à la gravité du préjudice subi »[209]. À cet effet, le comité CEDAW demande aux États de « prévoir des services spécialisés d’assistance aux femmes comme des services d’assistance téléphonique gratuits 24 heures sur 24, ou un nombre suffisant de centres d’urgence, d’aide et d’orientation sécurisés et bien équipés, ainsi que des foyers d’hébergements pour les femmes, leurs enfants et d’autres membres de leur famille » et de « créer des fonds de réparation distincts ou prévoir des fonds spéciaux pour la violence à l’égard des femmes fondée sur le genre dans le budget des fonds existants »[210].
Enfin les Lignes directrices de la CADHP, en adéquation avec la Recommandation générale n°35 du comité CEDAW, alertent sur le danger que représente le recours aux méthodes de résolution alternative des litiges, demandant que les États « prennent des mesures visant à interdire le traitement des affaires de violences sexuelles par l’intermédiaire de modes alternatifs de résolution des conflits tels que la médiation ou la conciliation, avant et pendant les procédures civiles et pénales, lorsqu’ils ne respectent pas les droits des victimes et notamment des femmes et des filles »[211].
Remerciements
Les recherches pour ce rapport, ainsi que sa rédaction, ont été réalisées par Candy Ofime, titulaire d’une bourse Leonard H. Sandler au sein de la division Moyen-Orient et Afrique du Nord de Human Rights Watch. Amna Guellali, chercheuse senior pour la Tunisie et l’Algérie au sein de la division Moyen-Orient et Afrique du Nord, a apporté son soutien aux recherches à Nouakchott. Le rapport a été revu et corrigé par Eric Goldstein, directeur adjoint de la division Moyen-Orient et Afrique du Nord, par Clive Baldwin, conseiller juridique senior, et par Tom Porteous, directeur adjoint de la division Programmes. Les révisions spécialisées ont été assurées par Rothna Begum, chercheuse sur le Moyen-Orient et l’Afrique du Nord au sein de la division Droits des femmes, par Bill Van Esveld, chercheur sur le Moyen-Orient et l’Afrique du Nord au sein de la division Droits des enfants, et par Diederik Lohman, directeur de la division Santé et droits humains. Une stagiaire de la division Moyen-Orient et Afrique du Nord, Rawan Abushahla, a contribué au travail de recherche.
L’assistance à la production était assurée par une associée de la division Moyen-Orient et Afrique du Nord ainsi que par Fitzroy Hepkins, responsable administratif, Jose Martinez, coordonnateur administratif senior, et Ivana Vasic, conceptrice graphique. La traduction du rapport en français a été réalisée par Zoé Deback, et révisée par Peter Huvos et Candy Ofime.
La présidente de la Commission nationale des droits de l’Homme de Mauritanie, Irabiha Abdel Wedoud, a apporté ses conseils et facilité nos contacts avec les ministères concernés. Maïmouna Mint Taghi, alors ministre des Affaires sociales et de la Famille, a rencontré notre équipe de recherche et discuté avec nous de nos conclusions préliminaires.
Nous avons reçu les conseils et l’aide de nombreux acteurs mauritaniens et internationaux travaillant dans le domaine des droits des femmes et des violences sexuelles (organisations non gouvernementales, activistes, avocats, assistants sociaux et professionnels de santé) ainsi que de diplomates et d’experts étrangers. Human Rights Watch voudrait remercier tout particulièrement Aminetou Mint Ely et l’équipe de l’Association des femmes chefs de famille, qui ont mis en contact l’équipe de recherche avec des survivantes et facilité de nombreuses visites de centres apportant une aide directe aux femmes et aux filles à Nouakchott et à Rosso, ainsi que Zeïnabou Taleb Moussa et l’équipe de l’Association mauritanienne pour la santé de la mère et de l’enfant, qui nous ont mis en contact avec des survivantes mineures et facilité notre visite à la prison pour femmes de Nouakchott, et enfin les membres de l’Association mauritanienne pour la santé et le développement des femmes et enfants handicapés, du Comité de solidarité avec les victimes de violations des droits de l’Homme en Mauritanie et de la Fondation Noura, qui nous ont mis en contact avec des survivantes.
Le bureau du Fonds des Nations Unies pour la population en Mauritanie, le Réseau des femmes parlementaires mauritaniennes ainsi que les avocats mauritaniens Me Fatimata M’Baye, Me Ahmed Ould Bezeid El Mamy et Me Jemal Abbad nous ont fait part de leur expertise sur les droits des femmes, les violences sexuelles et le droit national, trouvant le temps de nous aider pour le suivi.
Amparo Fernández del Río, coordonnatrice du bureau de Médicos del Mundo en Mauritanie, et Marie-Charlotte Bisson, qui dirige la délégation de Terre des Hommes-Lausanne dans le pays, ont toutes deux fourni de précieux commentaires lors de la rédaction du rapport.
Par-dessus tout, nous voudrions remercier les survivantes de violences sexuelles et les membres de leur famille, dont nous respectons et admirons la résistance à l’adversité et le courage, et qui se sont ouverts à nous pour confier leurs expériences difficiles et souvent traumatiques, dans l’espoir que leur histoire contribuera à apporter des réformes qui aideront d’autres personnes.
Glossaire : acronymes et terminologie
Acronymes
|
CADBEE |
Charte africaine des droits et du bien-être de l'enfant |
|
CADHP |
Commission africaine des droits de l’Homme et des peuples |
|
CDE |
Convention relative aux droits de l’enfant |
|
CEDAW (ou CEDEF) |
Convention sur l'élimination de toutes les formes de discrimination à l'égard des femmes |
|
CNDH |
Commission nationale des droits de l’Homme |
|
HCDH |
Haut-Commissariat des Nations Unies aux droits de l’Homme |
|
MGF |
Mutilations génitales féminines |
|
PIDCP |
Pacte international relatif aux droits civils et politiques |
|
PIDESC |
Pacte international relatif aux droits économiques, sociaux et culturels |
|
OMS |
Organisation mondiale de la santé |
|
ONU |
Organisation des Nations Unies |
|
UNFPA |
Fonds des Nations Unies pour la population |
|
UNICEF |
Fonds des Nations Unies pour l’enfance |
Terminologie
Agression sexuelle : Violation de l’intégrité corporelle et de l’autonomie sexuelle d’une personne, y compris le viol et les formes d’agression sexuelles sans pénétration, pouvant se produire dans des circonstances de coercition.
Enfant : Personne âgée de moins de 18 ans.
Viol : Toute intrusion physique de nature sexuelle sans consentement ou dans des circonstances de coercition. Une « intrusion physique » signifie la pénétration, même limitée, de toute partie du corps de la victime (ou de l’auteur des violences par la victime) par un organe sexuel, ou bien de l’orifice anal ou génital de la victime par n’importe quel objet ou partie du corps.
Violence sexuelle : Tout acte de nature sexuelle non consenti, la menace ou la tentative de cet acte, ou le fait de contraindre autrui à se livrer à un tel acte sur une tierce personne. Les violences sexuelles ne se limitent pas à la violence physique et n’induisent pas nécessairement de contact physique. Elles incluent notamment le mariage forcé, la mutilation génitale féminine, le harcèlement sexuel, l’agression sexuelle, le viol, les tests de virginité non consentis et le trafic d’êtres humains en vue de l’exploitation et de l’esclavage sexuels[212].
Zina : Relations sexuelles consensuelles en dehors des liens du mariage, punies par la loi mauritanienne[213].



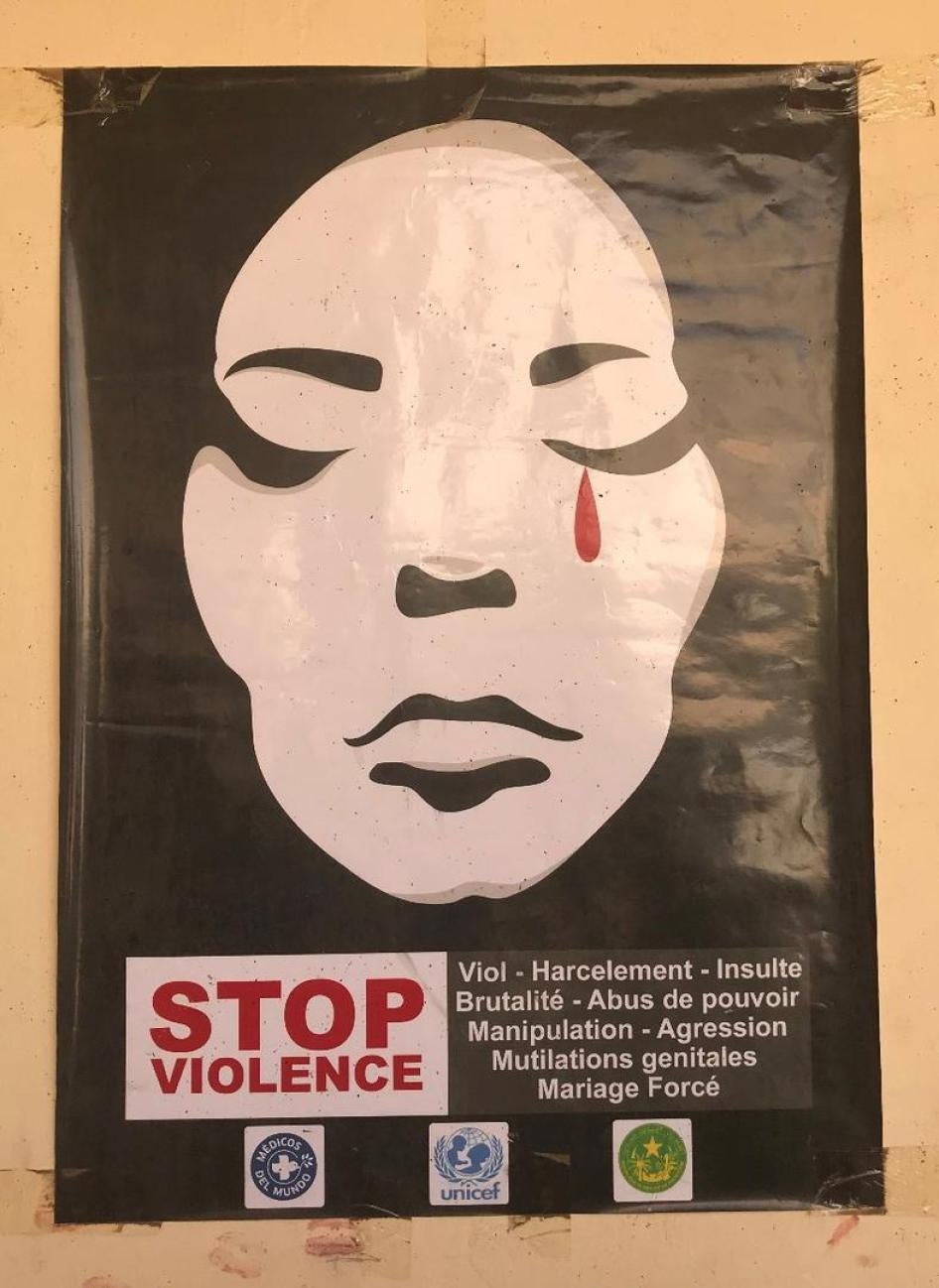


![Aminétou Mint Ely [au centre, munie d’un téléphone], présidente de l’Association des femmes chefs de famille, et l’équipe d’un centre d’appui aux femmes et filles survivantes de violences fondées sur le genre géré par cette association, Rosso, Mauritanie.](/sites/default/files/styles/embed_xxl/public/multimedia_images_2018/201809mena_mauritania_photo4.jpg?itok=-KZ2-rkI)

