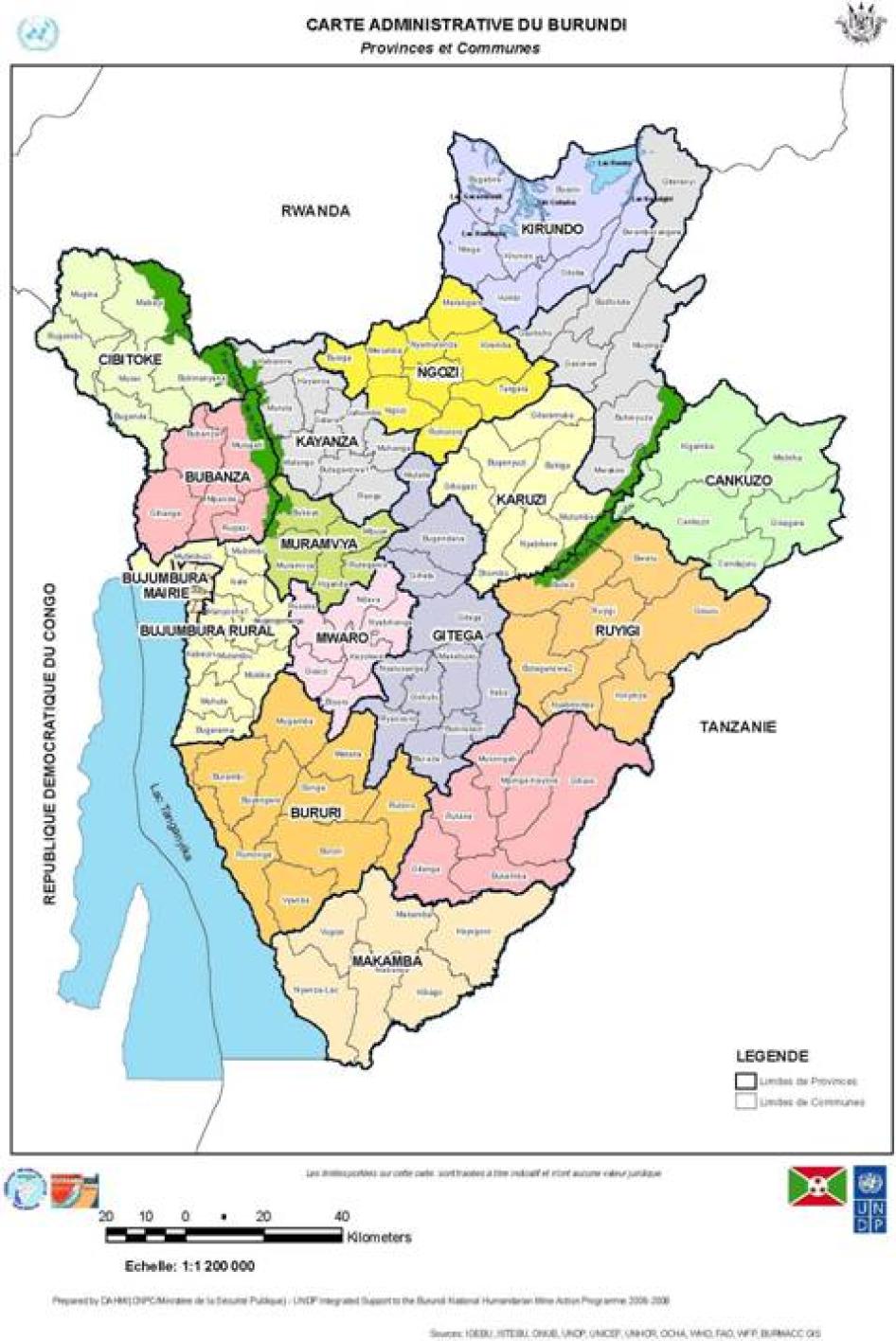La « justice » populaire au Burundi
Complicité des autorités et impunité
Carte du Burundi
© Programme des Nations Unies pour le Développement au Burundi
I. Résumé
« Si un voleur vole, on n’a pas besoin d’un procès. Il est tué sur place. »
‒ C.I., commune de Butaganzwa, province de Ruyigi, 7 juillet 2009.
Simon Ruberankiko a été brûlé vif par ses voisins le 1er août 2009. Ruberankiko, un homme séropositif de 54 ans, malade au point de ne plus pouvoir cultiver ses propres champs, était sorti furtivement de chez lui la nuit pour voler de la nourriture dans les champs d’un voisin. Furieux qu’il ait volé un régime de bananes, des habitants de la localité l’ont attrapé, battu et recouvert d’herbe sèche à laquelle ils ont mis le feu. Quelques jours auparavant, un autre voleur présumé avait été brûlé vif à quelques kilomètres de là. Personne n’a été arrêté pour aucun des deux meurtres.
Le meurtre de Simon Ruberankiko a eu lieu sur une colline[1] rurale de Muyinga, l’une des provinces du Burundi où la « justice populaire »[2] est la plus courante. À la mi-2009, en l’espace de quatre mois, au moins neuf personnes ont été tuées dans des circonstances similaires à Muyinga, et une dixième a failli subir le même sort, faisant de Muyinga l’une des provinces les plus dangereuses du Burundi pour les personnes accusées de méfaits.
Dans un premier temps, la police a fait montre de quelques velléités d’enquêter sur le meurtre de Ruberankiko mais elle a rapidement renoncé en l’absence de toute assistance des administratifs à la base (responsables de l’administration locale) qui lui donnaient l’impression de protéger les meneurs du groupe de lyncheurs. La plupart des agressions liées à la « justice » populaire —dont au moins 74 meurtres sur l’ensemble du pays en 2009 et au moins 59 cas où les victimes ont été blessées—n’ont donné lieu à aucune enquête policière.
Ces personnes ont subi la vindicte populaire pour divers délits présumés, notamment pour adultère, vol simple (commis sans violence ou autres circonstances aggravantes), vol à main armée, viol et meurtre. Lorsque les chercheurs de Human Rights Watch et l’Association pour la Protection des Droits Humains et des Personnes Détenues(APRODH) ont demandé aux habitants—dont certains ont révélé d’eux-mêmes qu’ils avaient participé aux meurtres—d’expliquer pourquoi ces personnes soupçonnées de délits étaient si fréquemment tuées plutôt que d’être remises à la police, les réponses étaient presque toujours identiques. Les gens ont déclaré qu’ils n’avaient plus confiance dans les forces de police ni dans le système judiciaire qui sont paralysés par la corruption, l’incompétence et un manque de moyens. Le même commentaire revenait souvent : « Lorsque nous appréhendons des voleurs et les remettons à la police, ils sont libérés deux ou trois jours plus tard. Alors nous avons décidé de nous charger nous-mêmes de la justice. »
Le fait que la justice populaire fasse si rarement l’objet d’une enquête, et encore plus rarement d’un châtiment, montre une acceptation implicite de cette pratique par les autorités de l’État. Aux termes du droit international, l’État est tenu de garantir la sécurité de tous ses citoyens, y compris de ceux qui sont soupçonnés de délits. Mais certains responsables, en particulier au niveau local, participent eux-mêmes aux actes de justice populaire. D’autres ferment les yeux. Mal formés, débordés et sous-équipés, les policiers se mettent dans bien des cas en défaut d’ouvrir des enquêtes. Parfois, ils expriment ouvertement leur soutien à ceux qui sont prêts à se charger de rendre justice eux-mêmes : un chef de poste de la police à Mutaho, dans la province de Gitega, a déclaré à Human Rights Watch et à l’APRODH que toute personne qui attrapait quelqu’un en flagrant délit de vol la nuit pouvait légitimement tuer le voleur.
Les meurtres de présumés criminels décrits dans le présent rapport ont lieu dans le contexte d’un pays émergeant d’un conflit et rongé par une effroyable pauvreté. La guerre civile de 1993-2009 a détruit les infrastructures et affaibli les institutions publiques, ainsi que la confiance envers l’administration publique. Elle laisse derrière elle un appareil judiciaire en proie aux difficultés et des forces de police qui ont dû être reconstruites en repartant de zéro.
Les Burundais espéraient que les élections démocratiques de 2005 et la fin de la plupart des combats en 2006 déboucheraient sur une meilleure sécurité, une justice impartiale et un niveau de vie plus élevé. Même si le sentiment de sécurité de la majeure partie des Burundais s’est légèrement amélioré, le Burundi continue d’être confronté à une combinaison explosive de facteurs, à savoir la pauvreté, l’absence de forces de police efficaces, la circulation de dizaines de milliers d’armes légères, ainsi que l’insuffisance de perspectives économiques et éducatives, en particulier pour les milliers de jeunes ex-combattants que la guerre a laissés dans son sillage. Ces facteurs empêchent tout recul des différents types de criminalité, du vol simple au meurtre.
Aucune statistique fiable sur la justice populaire au Burundi n’existait avant 2008, moment où la mission des Nations Unies au Burundi—qui avait prêté attention au problème et ouvert des enquêtes sur certains cas dès son arrivée dans le pays en 2004—a commencé à rassembler systématiquement des données sur ce type de meurtres et de passages à tabac. En dépit du manque de données, la plupart des observateurs burundais ont toutefois laissé entendre à Human Rights Watch et à l’APRODH que la justice populaire était rare avant la guerre civile qui a touché le pays de 1993 à 2009 et que le phénomène est apparu et a pris de l’ampleur pendant la guerre et après celle-ci. La guerre a rendu la population insensible à la violence, ont-ils expliqué. Parce que la fin de la guerre n’a pas débouché rapidement sur l’instauration de l’État de droit, et parce que le système judiciaire demeure corrompu et miné par un manque de moyens, les Burundais victimes de délits ne s’attendent ni à une protection de la police, ni à une justice dispensée par les tribunaux, et ils préfèrent souvent recourir à la force pour se protéger. Dans ce contexte, la justice populaire est devenue une pratique courante dans la plupart des régions du pays.
Le Président Pierre Nkurunziza a dénoncé la justice populaire, mais les prises de position contradictoires exprimées par les hautes autorités burundaises atténuent la force de son message. La population garde encore clairement en mémoire les encouragements manifestes à la justice populaire de l’ex-président Domitien Ndayizeye, au pouvoir de 2003 à 2005. Au sein de l’administration actuelle, le porte-parole de la police nationale, Pierre Channel Ntarabaganyi, a fait l’éloge des actions de foule entreprises par la population pour protéger la sécurité publique, et certains chefs de la police locale et administratifs à la base ont adopté un discours similaire. Ces déclarations et actions de responsables sont parfois le reflet des efforts qu’ils déploient pour se poser en « durs qui répriment la criminalité » et renforcer ainsi le soutien de la population à leur égard ; dans d’autres cas, elles reflètent le sentiment apparemment sincère qu’en l’absence de solutions efficaces venant d’en haut pour réprimer la criminalité, « les voleurs méritent la mort ».
Le présent rapport démontre que la justice populaire et la réponse qu’y apporte le gouvernement constituent des violations des droits humains principalement à deux niveaux. Tout d’abord, les responsables de l’État jouent un rôle direct dans certains meurtres et passages à tabac ; ils y contribuent directement, par exemple en mettant sur pied des « comités de sécurité » non formés, autorisés à opérer en marge de la loi ; ou ils demeurent sans réaction, laissant les lynchages avoir lieu. Ensuite, dans presque chaque cas analysé par Human Rights Watch et l’APRODH, les enquêtes de la police et de l’appareil judiciaire sur des actes de justice populaire se sont avérées insuffisantes ou n’ont jamais vu le jour.
Aux termes du droit burundais et du droit international, les victimes d’infractions ont droit à la justice, notamment à l’ouverture d’enquêtes par le gouvernement, tandis que les auteurs présumés d’infractions ont droit au respect des droits de la défense et à un procès équitable. Dans bon nombre de cas, le Burundi ne garantit aucun de ces droits. Lorsque des présumés délinquants sont assassinés, leurs familles se voient privées de justice car les responsables ne sont pas poursuivis, ce qui crée un cycle de violence et d’impunité. Dans les cas analysés dans le présent rapport, l’État a soit encouragé, soit fermé les yeux, soit omis d’enquêter sur les meurtres de présumés malfaiteurs.
Les facteurs qui contribuent à la justice populaire, en particulier ceux liés au fonctionnement de la police et du système judiciaire, soulèvent également de sérieuses inquiétudes sur le plan des droits humains. Le gouvernement burundais a pris des mesures insuffisantes visant à créer des forces de police et un appareil judiciaire capables de commencer à regagner la confiance de la population. Certaines réformes sont en cours, et le Burundi a sollicité avec succès le soutien considérable de bailleurs de fonds afin d’améliorer et de moderniser ces deux institutions, mais une mauvaise utilisation de l’aide apportée ainsi que la corruption diminuent l’efficacité du soutien des bailleurs.
Human Rights Watch et l’APRODH recommandent au gouvernement de mettre un terme à l’impunité pour les auteurs de lynchages, lesquels devraient répondre de leurs actes à l’instar d’autres responsables de crimes graves plutôt que de voir leurs actes justifiés et excusés. Avec l’appui d’organisations nationales et internationales, le gouvernement devrait également entreprendre une vaste campagne d’éducation populaire visant à la fois à mieux faire comprendre au public le système de justice pénale et à décourager la justice populaire. Les bailleurs de fonds devraient examiner le soutien qu’ils apportent à la police et au secteur judiciaire et prendre des mesures pour s’assurer que la corruption et la mauvaise gestion n’empêchent pas les ressources d’arriver jusqu’à la population burundaise et d’améliorer la sécurité publique.
II. Recommandations
Au Ministère de la SécuritéPublique et à la Police Nationale du Burundi
- Déclarer clairement et publiquement que les actes de justice populaire sont illégaux et seront poursuivis dans le cadre de la pleine application de la loi, débouchant sur l’ouverture sans délai d’enquêtes approfondies et impartiales et sur l’arrestation des auteurs, en particulier des « meneurs ».
- Délivrer un ordre à l’intention de tous les policiers leur enjoignant de respecter le droit de tous les présumés criminels à ce que leur dossier fasse l’objet d’une enquête approfondie.
- Adresser une déclaration aux administratifs à la base les avertissant que la police contrôlera le rôle qu’ils jouent dans les cas de justice populaire et qu’elle arrêtera ceux qui sont complices d’actes de justice populaire ou cherchent à les couvrir.
- Punir ou poursuivre comme il convient tous les policiers, indépendamment de leur grade, qui se mettent en défaut de prendre toutes les mesures possibles et appropriées pour protéger de la vindicte populaire les personnes soupçonnées d’infractions.
- Intensifier la présence de la police et améliorer l’efficacité avec laquelle elle répond à la criminalité dans des zones où la justice populaire est plus répandue, en particulier dans les régions rurales ou mal desservies du Burundi.
- Renforcer la police de proximité et la connaissance des communautés par les policiers en réduisant la fréquence des transferts de policiers d’une localité à l’autre.
- Veiller à ce que les policiers soient suffisamment rémunérés pour leur travail, à ce qu’ils aient les outils et moyens nécessaires pour assurer un maintien de l’ordre efficace et à ce que la présence de la police sur terrain fasse l’objet d’un contrôle permanent.
- Contrôler l’utilisation des véhicules et du matériel de communication de la police afin de s’assurer qu’ils servent à des fonctions de maintien de l’ordre et non à un usage personnel ou autre usage abusif. Marquer les véhicules de police afin que toute mauvaise utilisation puisse être identifiée facilement.
- Utiliser l’Inspection générale du Ministère de la Sécurité publique, la Brigade Anti-c orruption de la police, ainsi que les informations émanant des organisations non gouvernementales (ONG), pour identifier les policiers soupçonnés de corruption, en particulier de solliciter des pots-de-vin en échange de la libération de personnes placées en garde à vue. Mener des enquêtes approfondies sur ces policiers. Ceux qui sont impliqués devraient faire l’objet de sanctions disciplinaires appropriées, entre autres d’un licenciement, et ceux qui sont accusés de corruption devraient être poursuivis devant la Cour Anti-corruption.
Au Ministère de la Justice et au Parquet Général
- Adresser une déclaration aux responsables locaux et de la police les informant que toutes les accusations crédibles d’infractions devraient donner lieu sans délai à des enquêtes approfondies et impartiales, qu’une plainte ait été déposée ou pas, et que tous les suspects ont droit à des procédures équitables dans le système de justice pénale.
- Ouvrir des enquêtes sur les actes de justice populaire et engager des poursuites à l’encontre des auteurs présumés, y compris dans les cas où la police n’ouvre pas d’enquête.
- Engager les poursuites appropriées à l’encontre des policiers et fonctionnaires de l’administration qui sont complices d’actes de justice populaire ou cherchent à les couvrir.
- Travailler en collaboration avec les responsables de l’administration pour planifier et mener à bien une campagne de sensibilisation du public visant à réduire le nombre d’actes de justice populaire en informant le public des procédures pénales, du rôle des victimes et des témoins dans la progression des enquêtes, ainsi que des droits de la défense.
- Utiliser l’Inspection de la Justice et la Brigade Anti-c orruption de la police pour enquêter sur les magistrats soupçonnés de corruption, entre autres de solliciter des pots-de-vin en échange de la libération de suspects présumés. Engager les poursuites appropriées à l’encontre de ces magistrats devant la Cour Anti-corruption.
- Contrôler l’utilisation des véhicules du Ministère de la Justice et du Parquet pour s’assurer qu’ils sont employés pour les besoins de la justice et non pour un usage personnel ou autre usage abusif.
- Utiliser les visites de terrain effectuées par des membres de la Cour Suprême pour encadrer les cours et tribunaux de province en tant que mécanisme servant à souligner la responsabilité qui incombe aux magistrats de réprimer les actes de justice populaire.
Au Conseil des Ministres et au Parlement
- Mettre sur pied une commission composée de responsables de la justice, de la police et de l’administration, chargée d’élaborer une stratégie nationale de réaction face à la justice populaire. Ladite stratégie devrait inclure des campagnes de sensibilisation du public, des stratégies pour assurer l’application des lois pertinentes, des mécanismes permettant d’améliorer la collaboration et la communication entre la police et le personnel judiciaire, ainsi que des réformes juridiques pertinentes.
- S’assurer que le projet de loi réformant le Code de Procédure pénale apporte des clarifications quant à la responsabilité de la police d’enquêter sur les infractions.
À l’administration locale (à savoir les administrateurs communaux, les chefs de zone ou de secteur, les chefs de colline ou de quartier, les nyumbakumis et les conseillers locaux) et aux Bashingantahe
- Ne pas agresser ou infliger d’autres mauvais traitements aux personnes soupçonnées d’infractions.
- Prendre toutes les mesures nécessaires pour décourager et prévenir la justice populaire.
- Aider les responsables de la police et de l’appareil judiciaire dans le cadre des enquêtes sur les actes de justice populaire.
- Travailler en étroite collaboration avec la police pour mettre sur pied des systèmes opérants pour s’attaquer à la criminalité, en particulier dans les zones rurales où les mécanismes de maintien de l’ordre et de justice sont insuffisants.
- Travailler en conjonction avec les autorités judiciaires pour sensibiliser le public au sujet des procédures pénales.
- Aider, dans la mesure du possible, les habitants de la circonscription à avoir accès au système judiciaire, par exemple en fournissant un transport aux victimes et aux témoins de délits jusqu’aux bureaux de police communaux et provinciaux et jusqu’aux tribunaux.
Au Bureau intégré des Nations Unies au Burundi (BINUB) et aux agences de l’ONU au Burundi, à savoir le Haut-Commissariat aux droits de l’homme (HCDH) et le Programme des Nations Unies pour le développement (PNUD)
- Identifier les régions les plus affectées par la justice populaire et cibler les responsables de la police et de la justice dans ces régions pour leur offrir une formation et une assistance afin d’améliorer la sécurité publique et l’administration de la justice.
- Contribuer aux efforts déployés par les organisations non gouvernementales burundaises et internationales et les médias burundais pour mener des campagnes de sensibilisation dénonçant la justice populaire.
- Recourir à des conseillers de police du BINUB pour apprendre aux policiers burundais à réagir comme il convient aux actes de justice populaire. Veiller à ce que les formations dispensées aux policiers comprennent des volets portant sur l’obligation de la police d’enquêter sur tous les délits graves, qu’une plainte ait ou non été déposée, et sur l’obligation d’accorder aux criminels présumés qui sont victimes de violences les mêmes protections qu’à tous les autres citoyens.
- Améliorer le contrôle de l’utilisation de tous les fonds ou autres ressources (notamment les véhicules et le matériel de communication) mis à la disposition de la Police Nationale du Burundi afin de s’assurer que ces moyens sont utilisés de manière appropriée et non à des fins personnelles. Conditionner de nouvelles fournitures d’équipement à la mise en place de mécanismes de contrôle efficaces.
- Contrôler les activités des institutions qui ont le pouvoir d’enquêter sur la corruption, à savoir le Parquet Anti-corruption, la Cour Anti-corruption, l’Inspection générale du Ministère de la Sécurité publique et l’Inspection de la Justice, afin de s’assurer que les fonds et ressources fournis à ces institutions sont gérés correctement et débouchent sur des résultats.
- Accélérer la création d’un numéro de téléphone d’urgence (« ligne verte ») comme cela a été proposé, qui permettrait aux habitants d’appeler gratuitement la police.
Aux bailleurs de fonds bilatéraux de la police et du secteur judiciaire du Burundi, dont les Pays-Bas, la Belgique, la France, le Royaume-Uni, la Suède et l’Union européenne
- Fournir un soutien ciblé sur le plan de la logistique, du logement et des ressources destinés aux policiers travaillant en milieu rural et dans les zones urbaines périphériques où la justice populaire est fréquente. S’assurer que tous les fonds et autres moyens offerts à la police parviennent à ces zones rurales et périphériques.
- Améliorer le contrôle de l’utilisation de tous les fonds ou autres ressources (notamment les véhicules et le matériel de communication) mis à la disposition de la Police Nationale du Burundi afin de s’assurer que ces moyens sont utilisés de manière appropriée et non à des fins personnelles. Conditionner de nouvelles fournitures d’équipement à la mise en place de mécanismes de contrôle efficaces.
- S’assurer que le soutien apporté à la police et au secteur judiciaire comprend un important volet consacré au renforcement et à la garantie d’indépendance de l’Inspection générale du Ministère de la Sécurité publique et de l’Inspection de la Justice.
- Appuyer le travail que réalisent les organisations non gouvernementales opérant au Burundi sur la corruption, le contrôle budgétaire et la transparence dans l’utilisation des fonds fournis par les bailleurs à l’intention des forces de police et du gouvernement du Burundi à tous les niveaux.
- Veiller à ce que les formations dispensées aux policiers comprennent des volets portant sur l’obligation de la police d’enquêter sur toutes les infractions graves, qu’une plainte ait ou non été déposée, et sur l’obligation d’accorder aux criminels présumés qui sont victimes de violences les mêmes protections qu’à toutes les autres personnes.
III. Méthodologie
Human Rights Watch et l’APRODH, organisation non gouvernementale burundaise de défense des droits humains, ont réalisé plus de 250 entretiens sur la justice populaire, la majeure partie entre juillet 2009 et janvier 2010. Les recherches intensives sur le terrain se sont concentrées dans les provinces identifiées comme présentant un grand nombre de cas de justice populaire : Bujumbura Mairie, Bujumbura Rural, Gitega, Muyinga, Ngozi et Ruyigi. Plusieurs incidents survenus dans d’autres provinces, dont Bubanza et Kirundo, ont également été examinés. Pour les neuf provinces restantes dans lesquelles des recherches intensives n’ont pas été entreprises sur le terrain, des observateurs de l’APRODH ont recueilli des données élémentaires qui ont été utilisées pour confirmer ou compléter des informations reçues des médias, d’autres organisations non gouvernementales et de la mission de l’ONU au Burundi.
Human Rights Watch et l’APRODH ont visité des dizaines de lieux qui avaient été le théâtre d’actes de justice populaire, s’entretenant avec 12 victimes, 26 membres des familles de victimes, 20 auteurs présumés ou déclarés et des dizaines de témoins afin de chercher à expliquer pourquoi les agressions avaient eu lieu, comment les autorités avaient réagi et quel impact les agressions avaient eu sur les personnes et la communauté.
Les chercheurs ont également interviewé trois gouverneurs, trois conseillers de gouverneurs, six commissaires de la police, dix chefs de poste de la police, 19 officiers de police judiciaire, 11 membres du personnel judiciaire, 49 administratifs à la base (responsables locaux), sept représentants d’organisations non gouvernementales (ONG) burundaises et internationales, quatre représentants d’importantes organisations internationales bailleuses de fonds, cinq fonctionnaires de l’ONU, un général de l’armée burundaise et un représentant du Service National du Renseignement (SNR). Ils ont aussi interviewé les chefs de cabinet du Ministère de la Sécurité publique et du Ministère de la Justice, le Procureur Général près la Cour Anti-corruption, le Directeur Général de la Police Nationale, le Ministre de la Bonne Gouvernance et de la Privatisation, ainsi que le Premier Vice-Président du Burundi.
IV. Aperçu des structures administratives, policières et judiciaires locales du Burundi
Diverses structures administratives, policières et judiciaires sont mentionnées tout au long du présent rapport. La façon dont elles fonctionnent et interagissent est décrite brièvement ci-dessous.
Structures administratives
Le Burundi est divisé en 17 provinces—16 provinces principalement rurales, considérées collectivement comme « l’intérieur » du pays, et la capitale, Bujumbura Mairie. Chaque province est dirigée par un gouverneur nommé par le président, à l’exception de Bujumbura Mairie qui a un maire également nommé.
Chaque province est divisée en cinq à treize communes, dirigées par des administrateurs communaux élus. L’administrateur communal est appuyé par un conseil communal composé de 25 membres élus et par deux à cinq chefs de zone, chacun étant responsable d’aider l’administrateur dans la gouvernance d’une certaine section du territoire communal. Les zones sont elles-mêmes subdivisées en collines (parfois appelées secteurs), lesquelles sont les plus petites unités administratives reconnues par la loi au Burundi. Chaque colline est dirigée par un chef de colline élu et un conseil de colline composé de cinq membres. (Bujumbura et plusieurs autres grandes villes sont divisées en quartiers plutôt qu’en collines ; ces quartiers sont dirigés par des chefs de quartier.)
Il existe des unités administratives plus petites mais elles ne sont pas officiellement reconnues par la loi. À certains endroits, chaque groupe de 10 ménages est dirigé de façon plus ou moins informelle par un nyumbakumi. Cette personne, élue par les habitants, fournit des rapports au chef de colline sur les incidents affectant la sécurité ou d’autres incidents importants survenus dans son quartier immédiat.
Les Bashingantahe (mushingantahe au singulier) jouent également un rôle dans l’administration locale, en particulier dans la résolution des conflits. Traditionnellement, les bashingantahe sont des « sages » de la localité (aujourd’hui quelques femmes figurent parmi eux), des personnes qui jouissent d’une excellente réputation morale et qui sont officiellement investies par leurs communautés du pouvoir d’arbitrer des conflits. L’institution des bashingantahe a été altérée par des décennies de colonialisme, de dictature et de guerre, mais dans certaines régions, elle a conservé ses caractéristiques fondamentales, et dans d’autres, elle est en passe d’être ressuscitée, bien que la pertinence des bashingantahe ne soit pas acceptée par tous.[3]L’Accord d’Arusha de 2000—pierre angulaire d’une série d’accords de paix qui ont finalement mis un terme à la guerre civile au Burundi—reconnaît le statut des bashingantahe et propose qu’ils opèrent à l’échelon de la colline et « rend[ent] la justice dans un esprit de conciliation ». Cette disposition est écrite dans la loi mais le rôle des bashingantahe n’est pas clairement défini.[4]
Structures de police
Officiellement créée le 31 décembre 2004 dans le cadre d’un accord de paix qui a regroupé les anciens membres de la police judiciaire, les gendarmes, les soldats et les rebelles, la Police Nationale du Burundi (PNB) est une force civile opérant sous l’autorité du Ministère de la Sécurité Publique. Elle est structurée en quatre commissariats : la Police de la Sécurité Intérieure (PSI), la Police Judiciaire (PJ), la Police Pénitentiaire, et la Police de l’Air, des Frontières et des Étrangers (PAFE). Chaque commissariat compte un commissaire en chef, basé à Bujumbura et relevant directement de l’autorité du directeur général de la Police Nationale, lequel relève pour sa part de l’autorité du ministre de la sécurité publique.
Les officiers de la police judiciaire (OPJ) et les officiers de la police de la sécurité partagent la responsabilité de la prévention et de la répression de la criminalité de droit commun et sont donc ceux qui sont le plus régulièrement et le plus directement en contact avec la population. La police judiciaire enquête sur les infractions commises, interroge les suspects et fournit des preuves au ministère public.[5] La police de la sécurité surveille les lieux publics, appréhende les malfaiteurs et, conjointement avec les OPJ, exécute les mandats de perquisition et les mandats d’arrêt délivrés par le procureur.[6]
Le Burundi est divisé en cinq commissariats régionaux de police, chacun dirigé par un commissaire régional qui coordonne les activités policières dans trois ou quatre provinces. Chaque chef-lieu de province est le siège d’un commissariat central de police, dirigé par un commissaire assisté par des sous-commissaires pour chacun des quatre commissariats fonctionnels (PSI, PJ, PAFE et Police pénitentiaire). De même, chaque commune a un poste de police dirigé par un chef de poste et des sous-chefs qui représentent la police judiciaire et la police de la sécurité. Le sous-chef de la police judiciaire est souvent le seul officier de police judiciaire (OPJ) dans une commune déterminée, et par conséquent, le seul officier de police autorisé à mener des enquêtes. Plusieurs communes n’ont pas d’OPJ et dépendent de la visite d’OPJ basés au commissariat provincial. La plupart des postes de police ne disposent pas de véhicules.
Dans chaque commune, les agents de la police de la sécurité intérieure sont dispersés entre plusieurs positions, composées généralement de trois policiers chacune. Ces derniers vivent généralement sous tente et changent de position après des périodes de plusieurs semaines. Les agents de police basés dans les positions ne disposent généralement pas de véhicules ni de matériel de communication autre que leurs propres téléphones portables.
Structures judiciaires
Le procureur général de la république est basé à Bujumbura et relève de l’autorité du ministre de la justice.
Chaque province est dotée d’un parquet, dirigé par un procureur de la république qui est assisté par un certain nombre de substituts, choisis parmi des magistrats-enquêteurs. Chaque affaire qui est transférée au parquet est attribuée au procureur ou à un magistrat, qui complète les enquêtes de police et peut soit classer l’affaire, soit la porter devant un tribunal.
Chaque parquet correspond à un tribunal de grande instance, qui connaît des affaires portant sur les infractions commises dans la province où il exerce sa compétence. Ce tribunal est présidé par un jury de magistrats du siège. Le tribunal évalue les requêtes déposées par les procureurs aux fins de placer des suspects en détention préventive. À l’issue d’un procès, il prononce un jugement et fixe la peine. Les affaires peuvent faire l’objet d’un recours devant trois cours d’appel situées sur le territoire burundais, et en dernier ressort, devant la Cour suprême, située à Bujumbura.
Chaque commune est dotée d’un tribunal de résidence. Ces tribunaux locaux n’ont compétence que pour juger les affaires civiles, non pas les affaires pénales. Les victimes et les justiciables sont donc souvent obligés de parcourir de longues distances pour se rendre au chef-lieu de la province afin d’être entendus.
Étude de cas 1 : Participation et négligence de responsables locaux dans des actes de justice populaire à Buraza, province de Gitega, juillet 2009
Léocadie Irankunda, mère de trois enfants—et enceinte d’un quatrième—pratique l’agriculture de subsistance à Buraza, dans la province de Gitega. Le 21 juillet 2009, elle a hébergé pour la nuit Cyprien Habonimana, un homme de la colline où elle avait grandi avant de se marier.
Cette nuit-là, la maison d’un des voisins d’Irankunda a été cambriolée. Selon un habitant qui a pris part au lynchage :
Les voleurs sont arrivés la nuit et ont forcé la porte. Ils ont passé à tabac un vieil homme et son fils, les ont ligotés et ont tout emporté—houes, calebasses. Les enfants qui étaient dans l’autre chambre sont venus me chercher. Je suis allé détacher la famille. Le vieux a poussé des cris et des gens des cinq sous-collines avoisinantes sont arrivés avec des torches.
Nous avons poursuivi les voleurs à travers la vallée. Les gens en ont attrapé un et l’ont battu. Malheureusement l’un des deux est mort. L’autre [une femme] est encore vivante.[7]
Le présumé malfaiteur qui avait été attrapé était Habonimana. Il a été pris devant un bar du coin et les habitants ont commencé à le frapper avec des gourdins. Un habitant a déclaré qu’environ 2 000 personnes étaient arrivées et avaient soit participé, soit assisté au passage à tabac.[8]
Pendant que Habonimana était passé à tabac, d’autres habitants, dont un membre élu du conseil de colline (aussi nommé à la fonction de mushingantahe), se sont rendus chez Irankunda, qu’ils soupçonnaient de complicité dans le vol. Ils ont enfermé son époux dans la maison, où il a déclaré avoir été gardé « comme un prisonnier », tandis qu’Irankunda était « arrêtée ». (Ceux qui gardaient le mari d’Irankunda ont profité de la situation pour voler 350 000 francs burundais – soit environ 300$US – dans la maison.)[9]
Irankunda a été emmenée devant le bar du coin, déshabillée et torturée par ses voisins – y compris par le membre du conseil de colline, un agent de l’État – tout en étant interrogée sur ses relations avec Habonimana et son prétendu rôle dans la planification du cambriolage. Un autre responsable local, un nyumbakumi, est resté là à regarder Irankunda être battue, sans prévenir la police ou des responsables d’un rang plus élevé. Des membres de la foule ont frappé Irankunda à la tête avec une machette et avec des pierres, ils ont entaillé son vagin avec un couteau et ont mis le feu à sa main droite. Elle a fini par perdre connaissance.
Un responsable communal est finalement arrivé, a pu contacter la police et mettre fin à l’agression mais ce faisant, il a lui-même reçu des coups. Il a emmené Irankunda et Habonimana à l’hôpital, où Habonimana est décédé le lendemain des suites de ses blessures, provoquées entre autres par des coups de gourdin et des brûlures.[10]
Irankunda a passé environ six semaines à l’hôpital. L’officier de police judiciaire (OPJ) de Buraza a arrêté trois suspects sur la base de la déposition qu’il avait reçue d’un témoin mais il n’a pas mené d’enquête complémentaire pour corroborer les éléments de preuve. Alors que les suspects étaient détenus au cachot de la localité, 50 à 60 habitants ont organisé un sit-in, réclamant leur libération. Selon un fonctionnaire, « Ils disaient que la population devrait faire justice elle-même parce que les voleurs viennent souvent ici ».[11]
Les suspects ont été remis en liberté provisoire et le parquet de Gitega n’a pas mené d’enquête approfondie pour compléter le dossier de la police. Un magistrat a informé Human Rights Watch que bien que l’un des suspects initiaux lui ait donné le nom des auteurs, un manque de carburant le mettait dans l’impossibilité de se rendre sur le terrain pour mener son enquête et arrêter les suspects.[12]
Irankunda a pu quitter l’hôpital début septembre et elle a immédiatement été emprisonnée à Buraza. Elle a signalé aux chercheurs de Human Rights Watch qu’elle avait passé un mois en détention sans avoir été informée des charges portées à son encontre. En octobre, elle a comparu devant un procureur qui a constaté qu’elle souffrait encore sérieusement de ses blessures et lui a demandé qui l’avait torturée. Au lieu d’inculper Irankunda, il l’a libérée et a émis des citations à comparaître à l’adresse des personnes qu’elle avait désignées comme l’ayant arrêtée et battue. Il a chargé Irankunda de donner les citations à l’administrateur communal, qui à son tour les remettrait aux auteurs des faits.
Selon Irankunda, lorsqu’elle a apporté les citations à comparaître à l’administrateur, cette dernière les a déchirées devant elle, déclarant, « Ces gens de Gitega n’ont rien à dire sur ce qui arrive ici ». L’administrateur a rappelé à Irankunda qu’elle avait déjà accepté de l’argent des auteurs pour s’assurer qu’ils ne seraient pas poursuivis et lui a expliqué que dans tous les cas, la population n’accepterait pas l’arrestation des auteurs des faits.[13] À l’approche des élections de 2010, d’un point de vue politique, ces arrestations se révéleraient impopulaires pour les administrateurs au sein de leur électorat.
En novembre, Irankunda est retournée voir le procureur pour expliquer ce qui était arrivé. Il a promis d’effectuer prochainement une mission à Buraza et d’arrêter lui-même les suspects.[14] À ce jour, il ne l’a pas fait.
Interrogé sur la raison pour laquelle la justice populaire est fréquente à Gitega, le commissaire provincial de la police Eustache Ntagahoraho a expliqué à Human Rights Watch :
La population n’est pas sensibilisée. Les gens pensent que si quelqu’un est pris en flagrant délit de vol, ils doivent le tabasser. La population nous accuse d’attraper les gens et de les libérer ensuite ; elle se sert de cela comme justification.[15]
Lorsque les chercheurs de Human Rights Watc h ont rencontré Irankunda en décembre 2009, elle continuait à souffrir de douleurs à la hanche et à la tête, ce qui rendait difficile son travail dans les champs. Irankunda a confié aux chercheurs qu’elle espérait que les coups n’aient pas causé de lésions au fœtus. Selon son époux, elle souffre également de problèmes de mémoire : récemment, elle s’est perdue et n’arrivait plus à retrouver le chemin pour rentrer chez elle.[16]
V. Le maintien de l’ordre au Burundi: Impunité, corruption et incidence sur la justice populaire
En 2008, sur la base d’une série de réunions de groupes de consultation (« focus groups ») réalisées à travers tout le pays, le Centre d’Alerte et de Prévention des Conflits (CENAP), organisation non gouvernementale burundaise, a publié un rapport sur les défis qui se posent à la consolidation de la paix. Le CENAP a constaté :
La question de l’impunité a été longuement débattue au cours des rencontres, cette pratique étant un terreau fertile à l’aggravation constatée des actes de violences, des attaques à main armée, etc. Par conséquent, les citoyens hésitent de moins en moins à se faire justice eux-mêmes, comme cela l’a été longuement rappelé dans les communes de Bubanza, Rugombo et Giteranyi. Ainsi, l’absence d’une justice efficace et digne de confiance pour les citoyens serait en partie responsable des actes de justice populaire et de vengeance qui se répandent dans le pays, contribuant ainsi à attiser un climat d’insécurité.[17]
Le degré de confiance dans la Police Nationale du Burundi (PNB) est particulièrement bas. Une série de groupes de consultation organisés en 2007 par l’organisation internationale DanChurchAid (DCA) et le Conseil National des Églises du Burundi (CNEB) ont relevé un mécontentement général face à l’incapacité de la police à assurer la sécurité des Burundais. Selon leur rapport :
La police ne passe pas pour être très efficace en ce qui concerne la protection de la communauté contre la criminalité. Même si un malfaiteur est attrapé, le sentiment qui prévaut est qu’il sera libéré quinze jours plus tard et qu’il collabore avec la police ou l’armée. Les gens sont généralement portés à croire que [...] la police prête des armes aux délinquants.[18]
Selon des études réalisées par le CENAP,[19] la confiance dans la police a légèrement augmenté entre 2007 et 2009, mais certains éléments semblent indiquer qu’elle a de nouveau connu une régression au cours des derniers mois, alors que la PNB se trouve aux prises avec des scandales de mauvaise gestion et de corruption.[20] Le Burundi est l’un des pays les plus corrompus du monde[21] et une organisation de la société civile burundaise, l’Observatoire de Lutte contre la Corruption et les Malversations Économiques (OLUCOME), a identifié un certain nombre de graves scandales de corruption impliquant la police. Parmi les cas récents figurent les listes de « policiers fictifs » qui étaient décédés ou avaient quitté les forces de police mais dont les salaires continuaient à être versés à des plus hauts gradés, ainsi que les irrégularités dans l’approvisionnent public qui ont débouché sur la fourniture d’aliments pourris aux agents de police de rang inférieur.[22]
Les entretiens de Human Rights Watch et de l’APRODH avec des dizaines de Burundais en milieu rural et dans les zones urbaines pauvres et marginalisées de Bujumbura viennent renforcer les conclusions de ces études, selon lesquelles beaucoup ont très peu confiance dans la capacité de la police et de l’appareil judiciaire à assurer la sécurité publique.[23]Lorsque la police se met en défaut de réprimer la criminalité, la population, qui après des années de guerre est versée dans l’usage de la violence pour résoudre les problèmes, se charge elle-même de faire justice. Les responsables locaux, qui croient à la même logique de violence ou espèrent soigner leur image en se présentant aux yeux de leur électorat comme étant « intransigeants en ce qui concerne la criminalité », sont parfois parmi les meneurs et comptent bénéficier de cette même impunité qui, au départ, provoque la justice populaire.
Même lorsque la police et les autorités judiciaires s’efforcent de prévenir la criminalité et de mener des enquêtes, le fait que le public ne comprenne pas bien les procédures juridiques contribue à la justice populaire. Une fois que quelqu’un a été arrêté, cette personne est souvent présumée coupable par la population. Si le suspect est remis en liberté provisoire ou est libéré faute de preuves, bon nombre de Burundais, surtout en milieu rural, ont du mal à percevoir cette libération autrement que comme la manifestation de la corruption ou de l’incompétence de la police et des magistrats, en partie parce que la corruption est en fait extrêmement répandue.[24]
Les systèmes de justice parallèle, mis en place par les groupes rebelles pendant les 16 ans de guerre civile qui ont frappé le Burundi, ont habitué certains Burundais à une forme de justice plus « expédiente » que celle rendue par les tribunaux. Lorsque la guerre a éclaté, il s’agissait d’un conflit opposant les groupes rebelles hutus à une armée dominée par les Tutsis mais elle s’est ensuite muée en lutte reposant davantage sur des critères politiques qu’ethniques. Les deux principaux groupes rebelles – le Conseil National pour la Défense de la Démocratie-Forces pour la Défense de la Démocratie (CNDD-FDD) et les Forces Nationales de Libération (FNL) – ont instauré des administrations parallèles dans certaines régions. Le CNND-FDD l’a fait jusqu’à ce qu’il remporte les élections nationales en 2005 ; Ruyigi, une province qui a été le théâtre de nombreux cas de justice populaire, était l’une des régions dont il a contrôlé une partie du territoire jusqu’à la fin de la guerre. Dans une grande partie de Bujumbura Rural, les FNL ont servi de voie alternative à la justice pas plus tard que jusqu’en 2008, parfois dans le cadre d’ « arrangements » officieux en vertu desquels la police nationale maintenait l’ordre le jour et les FNL la nuit. Les FNL ont poursuivi les combats jusqu’à ce qu’ils se convertissent en parti politique d’opposition en 2009.
Les deux groupes rebelles battaient souvent les voleurs qu’ils plaçaient en garde à vue et à l’occasion, ils les exécutaient—parfois après un simulacre de « procès », parfois sommairement. En 2009, la première année au cours de laquelle ces systèmes de justice parallèle n’existaient plus, Human Rights Watch et l’APRODH ont recueilli des informations sur un grand nombre de morts par lynchage dans des communes qui avaient été des bastions rebelles.[25] Dans l’un des cas, à Kanyosha (Bujumbura Rural), un habitant a expliqué pourquoi ils avaient pris la décision de rendre justice eux-mêmes et avaient tué un voleur présumé de chèvres : « Dans le passé, les gens emmenaient les voleurs devant les FNL qui les battaient et leur faisaient payer une amende. Maintenant, s’il y a un vol pendant la journée, les gens emmènent la personne à la police mais si cela se passe la nuit, ils la passent à tabac. »[26]
Les recherches de Human Rights Watch et de l’APRODH tendent à démontrer que les conditions suivantes contribuent à la justice populaire.
Inefficacité de la police en matière de maintien de l’ordre et de sécurité
« La police a peur de venir ici la nuit. »[27]
– Un habitant de Bujumbura Rural
La Police Nationale Burundaise (PNB) est un corps de police jeune, constitué fin 2004 pour intégrer les anciens membres de la police judiciaire, les gendarmes, les soldats et les rebelles. La PNB compte 18 000 officiers, brigadiers et agents. Près de la moitié de la police est composée d’ex-rebelles, qui ont eu très peu de formation professionnelle.[28]
Consciente de ses faiblesses, la PNB a sollicité un soutien sur le plan de la formation et des ressources matérielles auprès d’un certain nombre de bailleurs de fonds et d’organisations partenaires, mais dans bon nombre de cas, elle n’a pas véritablement mis à profit ces ressources. Un maintien de l’ordre inefficace donne à beaucoup de Burundais le sentiment que la sécurité s’est très peu améliorée depuis la fin des violents combats en 2006.[29]
Répartition des effectifs
Un audit de police réalisé fin 2008 par une équipe de la police fédérale belge à l’invitation du Ministère burundais de la Sécurité Publique a identifié de nombreuses lacunes dans l’efficacité de la PNB et fourni des recommandations circonstanciées. L’audit note, par exemple, que la répartition des policiers sur l’ensemble du territoire et entre les différentes branches de police semble « aléatoire » plutôt que de répondre à de véritables besoins en matière de sécurité.[30] Il soutient que le nombre total de policiers que compte le Burundi est en principe suffisant pour répondre aux besoins sécuritaires mais les policiers sont concentrés dans les centres urbains, et beaucoup d’entre eux se consacrent à « garder » les commissariats de police provinciaux et régionaux.[31]
Le Directeur de la police Fabien Ndayishimiye a expliqué à Human Rights Watch que la concentration des policiers dans les commissariats avait été une réponse aux circonstances critiques imposées par la guerre civile au Burundi et que depuis la fin du conflit en avril 2009, les efforts visant à redistribuer les policiers avaient déjà commencé.[32] Mais fin 2009, la présence de la police dans les collines rurales demeurait limitée. Ceci est dû en partie à des limitations logistiques. Malgré de nombreuses discussions au Ministère de la Sécurité Publique sur le passage à un système de police de proximité, les policiers continuent à loger dans des casernes plutôt que d’être intégrés au sein même des communautés. Dans les positions rurales de la police, les agents vivent sous tente. Ndayishimiye a informé Human Rights Watch qu’il était peu probable que cela change à brève échéance. Les conditions de vie difficiles dans ces positions rurales ont un effet négatif sur le moral des policiers et les poussent souvent à préférer être basés dans des zones urbaines qu’en milieu rural, tandis que les difficultés logistiques rencontrées pour fournir des vivres et du matériel aux positions rurales n’incitent pas les commissaires de police provinciaux à insister sur une plus grande décentralisation.[33]
L’absence de policiers sur le terrain semble être un facteur qui pousse les communautés rurales à se charger elles-mêmes de rendre justice. Les effectifs policiers insuffisants figurent parmi les préoccupations soulevées par un certain nombre de responsables de la police et de l’administration lors d’entretiens avec Human Rights Watch et l’APRODH, entre autres dans les communes de Gashoho (province de Muyinga), Gisuru (province de Ruyigi) et Nyamurenza (province de Ngozi), qui ont toutes été le théâtre de multiples morts par lynchage en 2009.[34]
Ainsi, sur le marché de Benga à Isale (Bujumbura Rural), où un voleur présumé de motos avait été battu à mort (et un second avait échappé de justesse au même sort) en janvier 2009, un habitant a expliqué : « Lorsque les gens l’ont attrapé, ils étaient en colère. Il n’y a pas de position de police dans les environs. Alors les gens ont décidé de les punir. Il y avait eu dernièrement des vols, des embuscades tendues à des motos et des voitures—les gens en avaient assez. Nous croyons que justice a été rendue. » Un autre a ajouté : « Personne n’a essayé de leur sauver la vie. Si quelqu’un avait voulu le faire, il aurait eu peur parce qu’il aurait aussi été tabassé. »[35]
Conditions nocturnes difficiles
Tant en zones rurales qu’urbaines, le manqué de présence policière se remarque particulièrement la nuit. La nuit où un meurtre par lynchage a eu lieu à Bujumbura Rural, la police n’est pas intervenue alors que le bruit que faisait la foule pouvait être entendu à plusieurs kilomètres de là et a duré plusieurs heures ; une personne qui vivait dans le voisinage a déclaré n’avoir pas pu fermer l’œil de la nuit à cause du bruit d’une « chasse [qui] s’est poursuivie toute la nuit ».[36]Un habitant de Bujumbura Rural a expliqué : « Malgré le bruit qu’elle entendait, la police n’est pas venue cette nuit-là parce qu’il faisait noir. La police a peur de venir ici la nuit parce qu’il n’y a pas d’électricité. » [37]
De même, les habitants de la commune de Cibitoke à Bujumbura—un quartier urbain à forte densité de population et particulièrement exposé à la criminalité, se trouvant en dehors du réseau électrique de la ville et plongé dans l’obscurité absolue la nuit—ont confié à Human Rights Watch qu’ils se sentaient abandonnés par la police.[38]En septembre 2009, un voleur notoire surnommé « King Kong » a été pris en flagrant délit alors qu’il volait des appareils ménagers sur la 15e Avenue à Cibitoke. Il a été cerné par les habitants et battu à mort. Un jeune homme qui a avoué avoir participé au meurtre a expliqué à Human Rights Watch : « Nous appelons la police pour qu’elle vienne nous aider et elle ne vient jamais. Alors parfois nous devons punir [les voleurs] nous-mêmes. La police arrive quand la bataille est terminée. »[39]En décembre, dans la même rue, un homme pris en train de voler un téléviseur a été brûlé vif en utilisant un pneu placé autour de son cou, réminiscence des techniques employées pour « nettoyer ethniquement » Cibitoke pendant la guerre civile au Burundi (voir encadré plus loin). Une femme de Mutakura, un quartier de Cibitoke situé non loin de là et où trois meurtres par lynchage ont eu lieu dans la même rue entre la mi-2008 et la mi-2009, a expliqué tout simplement : « Ici à Cibitoke, quand les gens attrapent un voleur, ils le tuent directement. »[40]
Manque de motivation et de moyens
Même dans les quartiers où la présence policière semblait être assurée par suffisamment d’effectifs, les gens considéraient que les policiers étaient inefficaces. À Buterere, une commune de Bujumbura où au moins trois présumés voleurs ont été tués en 2009, un responsable a expliqué en parlant de l’un des cas : « Les gens l’ont tué parce qu’il y avait beaucoup de vols—ils avaient décidé d’éliminer tous les voleurs. Ils ont vu que le gouvernement ne pouvait pas contrôler le quartier. Je ne sais pas pourquoi le gouvernement ne peut pas le contrôler. La présence policière est suffisante mais souvent, les policiers ne parviennent pas à attraper les voleurs. »[41]
Le manque de moyens de transport et de technologies de la communication compte parmi les facteurs qui entravent l’efficacité de la police. La plupart des policiers ne disposent d’aucun appareil de communication. Par conséquent, s’ils rencontrent des problèmes de sécurité, ils n’ont aucun moyen d’appeler des renforts.[42]Même si les policiers étaient en mesure d’appeler des renforts, les responsables de la police communale n’ont généralement pas accès à des véhicules à moteur, en particulier en dehors de Bujumbura, limitant ainsi leur capacité à organiser une réaction rapide.[43]Les véhicules attribués aux commissariats de police provinciaux sont rarement mis à disposition pour le maintien de l’ordre au niveau local. Un certain nombre de véhicules fournis par des bailleurs de fonds en 2008 avaient déjà été accidentés dans des collisions fin 2009 ; d’autres véhicules ne pouvaient pas être utilisés faute d’accès à du carburant.[44]L’OLUCOME a rapporté qu’un certain nombre de véhicules de police étaient également utilisés à des fins personnelles ou pour des activités politiques partisanes organisées par le parti au pouvoir, le Conseil National pour la Défense de la Démocratie—Forces pour la Défense de la Démocratie (CNDD-FDD).[45]
Comportement criminel de certains policiers
Enfin, le manque de discipline et le comportement illicite de certains policiers contribuent également à l’incapacité à assurer la sécurité publique. Comme l’a expliqué un administrateur communal : « Il faut que les policiers réorganisent leur façon de travailler. Certains s’en vont boire un verre le soir alors qu’ils sont censés patrouiller. »[46]
Pire encore, des policiers sont eux-mêmes impliqués dans des activités criminelles. À certains endroits, la police ne sera donc pas considérée comme une force capable de juguler la criminalité. Certains policiers participent à des bandes armées la nuit ; d’autres louent leurs uniformes et leurs armes aux voleurs.[47]Des participants à l’étude réalisée en 2008 par le CENAP se sont plaints du fait que les policiers qui participent à des délits ne sont pas suffisamment sanctionnés ; au lieu de cela, « leurs supérieurs se contenteraient de les muter dans des services éloignés des endroits où ils ont commis des crimes. »[48]Une femme de la commune de Cibitoke qui avait été témoin du meurtre d’un présumé délinquant—et affirmait qu’il se justifiait—a signalé à Human Rights Watch : « Il y a une position de police dans les environs mais parfois, ils travaillent avec les bandits parce qu’ils sont pauvres, eux aussi. »[49]
Le comportement des policiers ne constitue pas vraiment une surprise, étant donné le salaire peu élevé et des conditions qui peuvent souvent être démoralisantes. En mai 2009, les policiers ont reçu des rations alimentaires pour juste un peu plus de quinze jours et on les a laissés se débrouiller le restant du mois. Le porte-parole de la police, Ntarabaganyi, a déclaré aux journalistes qu’il fallait attribuer cela à un manque de moyens et à des retards des fournisseurs.[50]
Inefficacité des enquêtes de la police et des parquets
Beaucoup de Burundais jugent la police inefficace non seulement dans la prévention des délits, mais également dans la conduite des enquêtes. Le système judiciaire est la cible de critiques analogues.
Un facteur important qui entrave la conduite des enquêtes, surtout en milieu rural, est le manque de moyens de transport. Bien que les postes de police soient éparpillés sur l’ensemble des communes, les officiers de police judiciaire (OPJ)—les seuls habilités à enquêter sur des infractions—sont en général basés uniquement au centre de la commune, et la plupart des communes ne disposent que d’un officier de police judiciaire, qui n’a pas de véhicule. Un responsable provincial a expliqué : « Les OPJ manquent de moyens de transport. Parfois ils doivent marcher pendant des heures pour enquêter sur une affaire et alors, ils y renoncent. »[51]Les policiers burundais expérimentés ont appris à travailler dans des situations où les moyens sont rares mais bon nombre des OPJ bien formés ont été mis à la retraite afin de remplir les quotas ethniques et politiques et les nouveaux arrivants ont reçu peu de formation.[52]
En septembre 2008, le BINUB a fourni un nouveau véhicule à chaque commissariat provincial de la police judiciaire.[53]Mais le Ministère de la Sécurité Publique a refusé que le BINUB fasse des marques sur le flanc de chaque véhicule pour indiquer à quel commissariat de police ils appartenaient, marquant un rejet évident de toute transparence et donnant à penser que les véhicules pourraient être utilisés à des fins autres que des enquêtes de la police judiciaire.[54]
D’autres besoins élémentaires des officiers de la police judiciaire communale ne sont pas satisfaits, les empêchant de faire leur travail. Pendant la plus grande partie de l’année 2009, le gouvernement burundais n’a pas fourni de papier aux OPJ, ni cherché à conclure un arrangement officiel avec une organisation donatrice dans ce but. Afin de faire en sorte que les OPJ puissent mettre par écrit les résultats de leurs enquêtes, le BINUB et des ONG internationales sont intervenues au pied levé et ont fait des dons de papier.[55] Un représentant d’une organisation donatrice était d’avis que le Ministère de la Sécurité Publique sous-estime souvent le travail de la police judiciaire, omettant de lui procurer les moyens nécessaires pour effectuer le travail qui est requis d’elle.[56]
Les fréquents changements de personnel donnent également lieu à des enquêtes lacunaires.[57]Souvent, les OPJ ne restent pas dans la même commune suffisamment longtemps pour se familiariser avec la situation en matière de sécurité et lorsqu’un OPJ est transféré dans une autre commune, dans bien des cas, il n’y a pas de « remise et reprise » : les OPJ ont tendance à ne remettre aucun de leurs dossiers à leurs successeurs. Les enquêtes sur les anciennes affaires sont donc simplement classées sans suite ou doivent recommencer à zéro.[58]Comme s’en ait plaint une femme de Ngozi : « La police travaille bien mais il y a trop de transferts de policiers. Les nouveaux qui arrivent ne connaissent pas la situation. Il serait bon qu’ils passent au moins entre six mois et un an ici, mais certains restent moins d’un mois. »[59]
Lorsque la police arrête un suspect, elle dispose, aux termes de la loi, de sept jours pour ouvrir une enquête préliminaire avant de devoir soit présenter le dossier et le suspect au parquet, soit libérer le suspect, même si l’enquête peut se poursuivre. Lorsque les dossiers sont remis au parquet, la communication médiocre entre la police et les responsables judiciaires fait que les procureurs fournissent souvent peu d’efforts pour comprendre un dossier de police incomplet ou embrouillé.[60]Le Premier Vice-président Yves Sahinguvu a reconnu ce problème, expliquant à Human Rights Watch : « Nous avons demandé [à la police et aux parquets] de travailler ensemble – lorsque le parquet estime qu’un dossier est vide, il libère parfois la personne plutôt que de contacter l’OPJ. Nous nous entretenons avec les magistrats à ce propos et leur disons qu’ils devraient demander des éléments complémentaires à la police. »[61]
Les procureurs, à l’instar de la police, ont du mal à mener leurs enquêtes à cause du manque de moyens adéquats, entre autres des véhicules et du carburant. En 2008, le BINUB a fourni un véhicule à chaque parquet provincial. Le Ministère de la Justice fournit 100 litres de carburant par mois, à utiliser dans le cadre des enquêtes.[62]Cependant, un magistrat s’est plaint du fait que cette quantité était insuffisante (ou peut-être mal utilisée), expliquant : « Si le procureur doit se rendre à Bujumbura ce mois-là, la provision est épuisée et donc, nous avons un problème pour nous rendre dans les collines pour mener les enquêtes. »[63]
L’incapacité tant de la police que des procureurs à mener des enquêtes efficaces fait naître chez certains Burundais, en particulier dans les zones rurales, le sentiment qu’ils n’ont absolument aucun accès à la justice et qu’en fait, le système judiciaire est inexistant. Une femme a confié à un chercheur universitaire :
Si je rencontrais quelqu’un qui m’a fait du mal, et si nous avions un système judiciaire, je pourrais emmener cette personne devant le tribunal et la loi saurait comment punir cette personne. Mais il n’y a pas de système judiciaire ici pour étudier la question du châtiment.[64]
Libération de suspects
En juillet 2009, deux hommes ont été attrapés à Kanyosha, une commune semi-rurale située à la périphérie de Bujumbura, alors qu’ils transportaient deux fusils d’assaut AK-47 dans un sac. Un groupe de gens a soupçonné les deux hommes de vouloir commettre un vol à main armée et il a décidé de faire justice lui-même. Deux habitants qui ont participé au meurtre de ces hommes ont expliqué leur manière de voir à Human Rights Watch et à l’APRODH :
Nous avons entendu des cris d’alarme. Comme nous étions organisés, nous avons réussi à attraper les bandits armés. Nous avons décidé de les tuer parce que si nous les attrapons et que nous les emmenons à la police, ils seront libérés. Tout le monde était d’accord pour dire qu’il fallait les tuer... Nous les avons tués avec des bâtons et des pierres... La police est arrivée après qu’ils étaient morts.
Les hommes ont ensuite mentionné une affaire survenue en 2008 où un voleur, armé d’une grenade et cherchant à attaquer une maison pour la cambrioler, a été attrapé et remis à la police. Il a été libéré quelques jours plus tard. C’est à ce moment, ont-ils dit, que « Nous avons décidé d’éliminer ces gens sur le champ ».[65]
Les Burundais se sont régulièrement plaints du fait que la police libère les détenus, soit sans les inculper, soit provisoirement,[66] même lorsqu’il existe des éléments de preuve suffisants démontrant qu’ils ont commis des délits. Dans certains cas, la corruption ou l’incompétence débouche sur une libération injustifiée. Mais dans d’autres cas, les mises en liberté peuvent découler du strict respect de la procédure pénale. Pour le citoyen de la rue qui n’est pas initié à la procédure pénale, il est difficile de faire cette distinction.[67]
Il ressort clairement des entretiens effectués par Human Rights Watch et l’APRODH que le sentiment que les libérations injustifiées surviennent fréquemment a contribué à la justice populaire. Un administratif d’une commune de Muyinga a expliqué à Human Rights Watch et à l’APRODH : « La justice populaire est un nouveau comportement ici, dû au mauvais comportement de la police de Muyinga—elle libère les suspects après deux ou trois semaines. Maintenant, lorsque la population attrape quelqu’un, elle le tue automatiquement sans le traduire en justice. »[68]
Corruption
Human Rights Watch et l’APRODH ont reçu plusieurs témoignages à propos de présumés malfaiteurs qui avaient pu sortir de détention et éviter des poursuites en versant des pots-de-vin. Le président de l’OLUCOME, qui opère un numéro d’urgence (« ligne verte ») réservé aux plaintes pour corruption, a signalé à Human Rights Watch que l’organisation reçoit de fréquentes plaintes au sujet de policiers qui réclament de l’argent, ajoutant : « C’est devenu comme un mode de vie. »[69]
Bon nombre de plaintes enregistrées par l’OLUCOME ont été déposées par des personnes qui ont versé des pots-de-vin après avoir été arrêtées arbitrairement ou menacées d’arrestation arbitraire. Il est peu probable que les individus qui ont vraiment commis des délits et ont ensuite versé de l’argent le signalent. Il est donc difficile d’évaluer l’ampleur du problème. Par ailleurs, dénoncer la corruption au Burundi est une entreprise dangereuse ; un célèbre militant anti-corruption a été assassiné en avril 2009 et d’autres ont été emprisonnés, envoyant un message clair aux simples citoyens qui pourraient dénoncer la corruption.
Toutefois, les victimes de délits interrogées par Human Rights Watch et l’APRODH ont exprimé l’opinion quasi unanime que si un malfaiteur en a les moyens, il peut facilement payer pour mettre fin à sa détention et éviter des poursuites, et certains fonctionnaires de l’administration en conviennent. Un administrateur communal de Bujumbura a déclaré :
Nous nous lamentons tous sur la façon dont la police judiciaire opère. Parfois, la [police] libère des bandits et des criminels—mais ceux qui ont commis des infractions mineures croupissent en prison. Les familles des criminels offrent quelque chose et si elles donnent quelque chose, l’OPJ les libère. Vous pouvez avoir tué quelqu’un mais si vous me donnez un petit quelque chose au cours de l’interrogatoire, je peux changer le procès-verbal et réorienter le dossier.[70]
L’opinion selon laquelle quiconque peut soudoyer pour éviter d’être poursuivi a des conséquences. À Gashoho, dans la province de Muyinga, Melchior Ntirandekura, considéré comme un « bandit notoire », a été brûlé vif par une foule pour avoir fait partie d’une bande qui s’est livrée à un viol, un vol à main armée et une agression le 26 juillet 2009. Les habitants de la localité ont déclaré qu’il avait été arrêté à de nombreuses reprises au cours des dernières années mais ils pensaient qu’il avait chaque fois soudoyé les policiers pour pouvoir s’en sortir. La conviction qu’il avait échappé à la justice à de multiples reprises et le ferait encore a contribué à la décision prise par la foule de le tuer.[71]
De même, un jeune homme répondant au nom de Nzeyimana a été tué par la foule aux alentours du 21 juin 2009 à Giteranyi, dans la province de Muyinga, après avoir lancé une grenade et tué deux personnes lors d’une cérémonie de mariage. Selon un responsable local, il avait été emprisonné deux fois précédemment pour avoir jeté des grenades mais avait été relâché chaque fois par la police de Muyinga, en dépit des lourdes preuves à son encontre. Les voisins ont commencé à le soupçonner de verser des pots-de-vin à la police. Selon le responsable, plusieurs milliers d’habitants ont participé à sa lapidation ou y ont assisté sans rien faire.[72]
Le niveau élevé de corruption semble pouvoir être mis en corrélation avec le nombre élevé de cas de justice populaire. Une agence de presse burundaise a identifié Muyinga comme présentant un niveau de corruption élevé tant parmi la police que parmi la magistrature.[73]À Gisuru, dans la province de Ruyigi, où au moins cinq personnes ont été tuées par lynchage en 2009 et une autre brutalement passée à tabac, l’officier de police judiciaire a été transféré en juillet sur présomption de corruption ; la personne qui occupait le poste avant lui avait été mutée pour les mêmes raisons.[74]D’autres communes de Ruyigi ont également été mentionnées comme ayant des niveaux importants de corruption et de justice populaire.[75]
Le commissaire de police Louis Nkurikiye a reconnu que la corruption des policiers était l’une des causes premières de la justice populaire. Il a souligné par ailleurs que parfois les officiers de police judiciaire qui reçoivent des pots-de-vin ne libèrent pas immédiatement le détenu mais ils renvoient au procureur un dossier complètement vide de preuves, obligeant le magistrat à libérer le détenu.[76]
Le système judiciaire également est largement considéré comme étant corrompu.[77] La loi burundaise autorise la police à maintenir des détenus en garde à vue pendant sept jours et de mener une enquête préliminaire avant d’inculper officiellement un suspect d’un délit. À ce moment, le dossier est renvoyé au parquet et le détenu est transféré dans une prison. Les recherches de Human Rights Watch et de l’APRODH ont révélé que les magistrats qui reprennent les enquêtes sont parfois cités pour avoir ordonné la libération de détenus suite à des pots-de-vin.[78] Certains magistrats ont également accepté de l’argent en l’échange de la libération de prisonniers déjà reconnus coupables et condamnés.[79] Un responsable de la police s’est plaint :
La population est fâchée parce que la police arrête souvent des personnes, y compris des personnes prises en flagrant délit, et les renvoie devant des magistrats, et les magistrats sont corrompus, et les personnes sont libérées et reviennent dans leurs collines. Alors les gens perdent confiance en la justice.[80]
Un employé du Ministère de la Justice a expliqué la corruption de l’appareil judiciaire par le fait que les juges eux-mêmes versent des pots-de-vin pour obtenir certains postes. Il a signalé : « Actuellement, vous devez payer un million de francs burundais [environ 850$] pour obtenir un emploi au tribunal de grande instance. Vous donnez cet argent à un ‘sponsor’ qui vous fait entrer dans le système. Et la première chose que les magistrats essaieront de faire une fois qu’ils entrent dans le système est de récupérer l’argent qu’ils ont versé [en réclamant des pots-de-vin aux suspects]. »[81] Le Chef de Cabinet du Ministère de la Justice a nié avec véhémence ces accusations de corruption.[82]
Il arrive aussi que des détenus soient libérés, soit par la police, soit par le parquet, parce qu’ils ont des contacts politiques.[83]À Kanyosha (Bujumbura Rural), Nestor Nduwayezu a été tué après avoir apparemment participé à une tentative de meurtre sur la personne d’Adolphe Banyikwa, un membre important du parti d’opposition FNL, en juin 2009. Les habitants de la colline où l’incident s’est produit—dont la plupart sont des partisans des FNL—soupçonnaient Nduwayezu de travailler pour les services de renseignement burundais. Un membre des FNL au courant de l’incident a expliqué : « La population savait que si la police intervenait [pour arrêter Nestor], le lendemain il serait libéré. »[84]
D’autres libérations discutables de suspects sont le résultat à la fois d’une insuffisance de moyens et d’un piètre jugement de la part de la police. En octobre 2008, dans la province de Kirundo, un présumé meurtrier a été autorisé à rentrer chez lui pour aller chercher de la nourriture parce que la police ne reçoit pas de rations pour nourrir les détenus (leurs familles sont censées se rendre dans les cachots et leur en donner). Le suspect a alors été tué par des habitants de la localité.[85]Le porte-parole de la police Pierre Chanel Ntarabaganyi a signalé à Human Rights Watch que l’incapacité des postes de police à nourrir les détenus était l’une des principales raisons pour lesquelles les détenus étaient libérés. Il a évoqué ce problème comme une des causes principales de la justice populaire.[86]
Méconnaissance des raisons légitimes d’une libération
Les détenus sont souvent libérés, sans faire l’objet d’une inculpation ou provisoirement, pour des raisons légitimes. La plupart des Burundais, ne connaissant pas le contenu des lois régissant la procédure pénale, présument que toute libération de prisonnier est un signe de corruption ou, au mieux, d’un désintérêt de la police pour la sécurité publique dans leur région.[87] Comme nous l’expliquons plus loin, la police est tenue par la loi de mener des enquêtes sur tout délit apparent, même en l’absence de plainte, mais souvent dans la pratique, elle ne le fait pas. Beaucoup de gens n’ont pas conscience que concrètement, les victimes et les témoins doivent se présenter, tout d’abord au niveau communal, puis au niveau provincial, pour fournir des éléments de preuve à charge d’un suspect.[88] Cette méconnaissance de la loi, conjuguée au fait que la police n’ouvre pas souvent d’enquête si une plainte n’a pas été officiellement déposée, contribue à la justice populaire. Comme l’a expliqué à Human Rights Watch un administrateur communal à Ngozi : « Si un criminel est appréhendé et traduit en justice, quelques jours plus tard ou une semaine plus tard, il est libéré, et il revient et commet le même délit. La population ne comprend pas pourquoi il n’y a pas de justice et elle décide de s’en charger elle-même. »[89]
Le fait de ne pas comprendre le système judiciaire ne contribue pas seulement en soi à la justice populaire mais crée également un vide sur le plan de la lutte contre l’impunité qui permet à la corruption de prospérer. Le commissaire de police Louis Nkurikiye a expliqué : « Lorsqu’un suspect est arrêté, la population pense que c’est terminé—qu’il ne faut pas venir apporter de preuves à charge de la personne. Lorsqu’il n’y a pas beaucoup d’éléments de preuve, si un suspect donne un peu d’argent à un OPJ, il est libéré. »[90]
Lors de cours de formation pour la police, le Ministère de la Sécurité Publique a insisté sur le fait qu’un élément important de toute enquête policière est de rechercher activement des témoins du délit disposés à témoigner.[91] Ne tenant pas compte de ces formations, la police tend à mettre trop l’accent sur la réticence des victimes et des témoins à venir déposer. Mais ce manque d’assistance du public contribue effectivement d’une part à l’impossibilité pour la police de mener correctement ses enquêtes et d’arrêter des suspects et d’autre part, à la libération des suspects sans qu’aucune charge ne soit retenue contre eux.
De nombreux responsables ont également dénoncé d’autres obstacles, à la fois logistiques et psychologiques, qui empêchent les victimes de porter plainte. Le manque de moyens de transport constitue l’un de ces obstacles. Aucune agence de l’État n’est responsable de l’accès des victimes et témoins à la justice, alors que beaucoup vivent à des heures de marche d’un poste de police et ne peuvent se payer aucun autre moyen de transport.[92] Dans la commune de Gisuru, en province de Ruyigi—la deuxième commune la plus grande du Burundi, où au moins cinq présumés criminels ont été tués en 2009, soit le plus grand nombre enregistré—un responsable a déclaré que le manque de moyens de transport jusqu’aux tribunaux représentait un sérieux obstacle à la justice.[93]
En l’absence de tout système de protection des témoins, la crainte des représailles constitue également un obstacle à la justice. Un commissaire de police de Ngozi a expliqué : « La population rend justice elle-même parce qu’elle a peur de venir témoigner. Nous arrêtons des personnes en vertu de mandats d’arrêt et les renvoyons devant le procureur. Si la population ne vient pas témoigner, le procureur libère ces personnes. La population se met en colère et dit que le système judiciaire et la police ne font pas ce qu’ils sont censés faire. Puis, si les gens attrapent un criminel, ils font justice eux-mêmes. »[94]
Un autre responsable à Ngozi a relevé :
Nous pouvons faire des « sensibilisations » mais la population est fâchée contre les autorités, elle dit que les autorités ne punissent pas suffisamment. Si nous disons aux gens de ne pas tuer les bandits, mais plutôt de les capturer et de les emmener à la police, ils ne veulent pas écouter parce qu’ils voient des bandits qui sont capturés et puis libérés. Ils sont libérés parce que la population ne vient pas témoigner contre eux ; elle pense que si un suspect est mis en prison, c’est fini. Nous essayons de sensibiliser les gens pour qu’ils viennent porter plainte mais parfois, ils ont peur.[95]
À cause de la piètre communication entre la police, le parquet et le public, la confusion règne souvent au sujet des raisons pour lesquelles un détenu particulier a été libéré. Un officier de police de Ngozi s’est plaint : « Nous avons beaucoup d’affaires où nous transmettons les dossiers au procureur et ensuite les suspects sont libérés deux ou trois mois plus tard et nous ne savons pas pourquoi. Les magistrats sont au-dessus de nous ; nous ne pouvons pas aller leur demander. »[96] Une fonctionnaire du BINUB a fait savoir qu’elle avait soulevé le problème auprès des responsables judiciaires de la province de Makamba, leur suggérant d’informer la police et les administrateurs communaux des raisons pour lesquelles les détenus étaient libérés, afin qu’à leur tour, ils puissent expliquer ces libérations à la population. Les responsables ont répondu qu’ils « n’avaient pas de comptes à rendre » à la police et aux administrateurs communaux, rejetant l’idée émise par la fonctionnaire du BINUB qu’une communication accrue servirait l’intérêt de la sécurité publique.[97]
Même lorsque des suspects sont poursuivis, reconnus coupables et purgent leur peine, un gouverneur a déclaré que les habitants avaient malgré tout du mal à accepter leur libération, y voyant la preuve que le système judiciaire ne fonctionnait pas. Il a expliqué : « Nous devons les préparer psychologiquement à réintégrer dans la communauté les gens qui ont commis des délits. »[98]
Note sur les accusations de « sorcellerie » et la justice populaire
Outre les dizaines de présumés malfaiteurs qui ont été tués ou violemment passés à tabac par la foule en 2009, des groupes d’habitants ont également attaqué des présumés « sorciers » dans des dizaines de cas.[99] Ces présumés sorciers sont souvent accusés d’utiliser des fétiches (objets considérés comme chargés de pouvoirs maléfiques) pour provoquer des maladies ou morts « mystérieuses », auxquelles beaucoup de Burundais des zones rurales ne trouvent aucune autre explication immédiate.[100] Ces agressions, bien qu’inquiétantes, ne sont pas couvertes par le présent rapport pour diverses raisons. Premièrement, Human Rights Watch et l’APRODH estiment qu’il est difficile d’établir si l’attaque reflète la profonde conviction que la victime est un sorcier ou s’il s’agit d’un prétexte pour éliminer un rival, généralement en raison d’un conflit foncier.[101] Deuxièmement, les améliorations des systèmes policier et judiciaire qui sont nécessaires pour réduire les actes de justice populaire ne suffiraient pas pour éliminer les cas où les personnes tuent ceux qu’elles soupçonnent sincèrement de se livrer à la sorcellerie ; des initiatives en matière d’éducation à long terme s’avèrent également nécessaires.
Troisièmement, Human Rights Watch et l’APRODH n’ont pas connaissance de statistiques portant sur la réaction de la police face aux meurtres de sorciers présumés. La police semble toutefois faire preuve de plus d’initiative pour enquêter sur ces meurtres que sur ceux de voleurs présumés. Au cours de ces recherches, Human Rights Watch et l’APRODH ont discuté des meurtres liés à la sorcellerie avec un certain nombre de responsables de la police et de l’administration ; aucun n’a tenté d’excuser ces meurtres, bien que leurs enquêtes n’aboutissent souvent à aucun résultat.
Sécurité et justice dans une société sortant d’un conflitLe Burundi vient juste de sortir de la guerre. Les jeunes ont vu beaucoup de mauvaises choses. Ils n’ont pas encore vu qu’il existe d’autres alternatives pour résoudre les problèmes. Certains ont été combattants, d’autres ont été témoins de violences, certains ont perdu des êtres chers, et je pense que cela les a affectés. --Un responsable provincial, Ruyigi, 7 juillet 2009.
Plusieurs Burundais interrogés pour le présent rapport ont déclaré que la justice populaire avait augmenté à cause de la « crise », terme utilisé pour décrire les pires années de la guerre civile au Burundi.[102] La guerre, a confié un gouverneur à Human Rights Watch, a détruit la confiance que les Burundais avaient dans les institutions et a créé un contexte où il était de plus en plus probable qu’ils se chargent eux-mêmes de faire justice.[103] En octroyant de facto l’impunité aux auteurs d’actes de justice populaire et en se mettant en défaut d’améliorer de façon considérable la sécurité publique, le gouvernement n’a pas pris les mesures nécessaires pour mettre fin à ce phénomène dans le contexte de l’après-guerre.
Les études semblent indiquer, et ce n’est guère étonnant, que la guerre a eu un profond impact sur la santé psychosociale des Burundais et que ce traumatisme est profondément enraciné.[104] Par ailleurs, la guerre a désensibilisé les gens à l’usage de la violence comme moyen de résoudre les problèmes, entre autres ceux liés à des conflits portant sur la terre, la propriété ou la famille.[105] L’extrême pauvreté, provoquée en partie par la guerre, a gonflé les enjeux de ces différends.[106] Une étude récente semble indiquer que le sentiment de sécurité de la plupart des Burundais a augmenté depuis la fin des principaux combats en 2005.[107] Mais les recherches de Human Rights Watch et de l’APRODH ont indiqué que lorsque ce sentiment fragile de sécurité est menacé, une violence disproportionnée est souvent considérée comme une réponse acceptable.
Bien que les statistiques disponibles soient insuffisantes pour tirer des conclusions au sujet d’un lien causal entre le conflit passé et la justice populaire actuelle, cette dernière semble souvent survenir dans des zones qui avaient été lourdement affectées par la guerre. Ruyigi , la province la plus touchée par la justice populaire, a été un important champ de bataille entre 2001 et 2004. Un responsable local de la commune de Nyabistinda, où quatre présumés criminels ont été tués en 2009, a précisé : « Il s’agit d’une région qui a été très affectée par la guerre. Les gens ont vu des choses terribles, et maintenant quand quelque chose arrive, ils recourent immédiatement à la violence. »[108]
De même, la commune de Cibitoke à Bujumbura est rongée par la justice populaire, avec au moins cinq meurtres entre septembre 2008 et décembre 2009. Le chef de poste de Cibitoke a expliqué à Human Rights Watch : « Le phénomène qui consiste à ce que les gens se fassent justice est lié à la crise. Pendant cette période, on tuait comme on voulait. Ici à Cibitoke, c’était grave. C’était plein de jeunes délinquants qui se livraient à des meurtres ethniques. La sensibilisation finira par changer cela mais c’est comme si les gens continuaient à vivre la crise. »[109]
Effectivement, Cibitoke est l’un des endroits où ont eu lieu le plus fréquemment des meurtres par lynchage—meurtres en public à caractère ethnique, commis par des groupes de jeunes que les politiciens organisaient en milices—lors d’une vague antérieure de lynchages entre 1993 et 1996. Bon nombre de Burundais ont assisté à leurs premiers lynchages lors des premières années de guerre. À Bujumbura, des milices de jeunes attrapaient régulièrement des jeunes du groupe ethnique opposé dans la rue ou dans des bus publics et elles les battaient à mort en public ou leur faisaient subir le « supplice du collier », une forme horrible de mise à mort publique qui consiste à passer un pneu autour du cou de la victime et à y mettre le feu.[110] Éric Niyonzima, un voleur présumé, a été brûlé vif de cette manière à Cibitoke en décembre 2009.
Le rôle particulier joué par les ex-combattants dans la justice populaire a été mis en évidence par plusieurs responsables. Interrogés sur la raison pour laquelle la justice populaire était un phénomène fréquent à Bujumbura Rural, un responsable local de la colline Burenza a expliqué : « C’est lié aux conséquences de la guerre. C’est un endroit qui a été très affecté. Le dernier coup de feu de la guerre a probablement été tiré à Burenza. Il y a beaucoup d’anciens rebelles, des ex-FDD et des ex-FNL qui sont revenus... Quand ils attrapent un voleur, ils ne veulent pas l’emmener à la police—ils ont les réflexes de la guerre. » Il a ajouté que les ex-combattants composaient la majorité de la population masculine de sa colline.[111]
Un haut fonctionnaire de Bujumbura Rural s’est fait l’écho de cette évaluation : « Le phénomène s’est amplifié avec la guerre. Il est devenu banal. Il n’y avait que quelques cas très isolés avant. Maintenant, pour se protéger, la population met sa confiance dans des criminels qui réagissent plus rapidement que la police, comme les ex-FNL et les ex-FDD : ceux qui sont en mesure d’éliminer des gens très rapidement. » [112]
Un responsable de la police a déclaré que le nombre élevé d’ex-combattants au Burundi—des hommes jeunes qui se sont habitués à tuer tout au long de la guerre—constitue un facteur. Il a expliqué : « Quand la foule veut rendre justice elle-même, tuer est facile car il y a tellement de combattants démobilisés. Avant, tuer quelqu’un était vu comme quelque chose de très grave. Cela a changé avec la guerre. Tuer, c’est normal. » [113]
En l’absence de tout mécanisme permettant de réclamer des comptes pour les crimes de guerre perpétrés dans le passé, les griefs liés à la guerre et restés sans réponse peuvent également jouer sur le plan de la justice populaire. Dans la province de Cibitoke, Ismaïl Mvuyekure, qui aurait été chef d’une bande de voleurs armés, a été battu à mort en juillet 2009. Selon les informations recueillies par l’APRODH, Mvuyekure avait été recruté par l’armée dans les années 1990 pour tuer des Hutus soupçonnés d’appuyer les rebelles. Lorsque le processus de paix a commencé à progresser, il s’est tourné vers le banditisme armé. Comme les habitants voulaient se venger de lui pour ses activités durant la guerre, ils n’ont pas hésité à le tuer lorsqu’ils l’ont attrapé en train de voler en 2009.
Le fait que la guerre civile au Burundi ait pu contribuer à la proportion élevée d’actes de justice populaire une fois le pays sorti du conflit ne justifie aucunement le phénomène, ni l’inaction dont font preuve les responsables de la police et de l’administration pour s’y attaquer. Par contre, cela semble indiquer que l’une des priorités du gouvernement burundais et autres parties prenantes devrait être d’élaborer une réponse cohérente à la justice populaire. Une analyse des causes profondes du problème pourrait aider à concevoir des interventions visant certaines provinces et communes (par exemple celles qui ont été le plus affectées par la guerre) et certains groupes (par exemple les ex-combattants). |
Étude de cas 2 : Suspects livrés à la foule, Gisuru, province de Ruyigi, septembre 2009
Le lynchage en septembre 2009 à Gisuru de deux policiers qui étaient soupçonnés de vol a attiré l’attention des médias nationaux et internationaux, ceci en grande partie à cause des déclarations faites par le porte-parole de la police, Pierre Channel Ntarabaganyi, dans les médias après les meurtres, dans lesquelles il disait devoir « remercier la population pour s’être impliquée dans l’assainissement de la paix et de la sécurité ».[114] Les recherches de Human Rights Watch et de l’APRODH ont révélé qu’outre les déclarations de Ntarabaganyi, des responsables de l’État avaient pris d’autres mesures qui reflétaient un respect insuffisant des droits élémentaires des personnes soupçonnées de délits.
Le 5 septembre 2009, une attaque à main armée a eu lieu à la colline Muhindo dans la commune de Gisuru, en province de Ruyigi. Le lendemain matin, des habitants de la localité se sont retrouvés face à deux policiers qui n’étaient pas en service, Oscar Barasokoroza et Antoine Nzeyimana, et qui ont été soupçonnés du vol. Un planton de la commune a récupéré un fusil que l’un d’eux avait apparemment jeté dans les buissons et les habitants ont trouvé des grenades dans les poches de l’autre.
Les habitants ont désarmé les policiers et ont commencé à les passer à tabac, les traînant en direction de la brigade de police de Gisuru, indiquant apparemment une intention de les remettre à la police. La foule se faisant plus dense, les coups sont devenus de plus en plus violents. Les habitants de Muhindo ont été rejoints par ceux de Murehe, où un autre jeune homme soupçonné de vol à main armée, Dominique Harutimana, avait été battu à mort exactement au même endroit en janvier 2009. Le mouvement les emmenant vers la brigade de police s’est arrêté lorsque des centaines de personnes se sont rassemblées pour jeter des pierres.
Selon des témoins, le planton communal a tiré en l’air avec le fusil confisqué pour essayer de faire cesser les violences et alerter la police. Celle-ci a entendu les coups de feu et est arrivée de la brigade voisine. L’administrateur communal et son conseiller sont également arrivés dans une camionnette appartenant à la commune.
À ce stade, selon des témoins, les deux victimes agonisaient par terre. Cependant, au lieu de chercher à les aider, comme l’a expliqué un témoin : « L’administrateur communal est arrivé et puis il est monté dans le véhicule avec la police pour partir à la recherche de deux autres voleurs. Les deux policiers étaient en train d’agoniser et personne n’a essayé de les emmener à l’hôpital. »[115]
Après le départ d’un groupe de responsables dans la camionnette de la commune—éliminant toute possibilité de sauver éventuellement la vie à Barasokoroza et Nzeyimana—le chef de poste de Gisuru a commencé à interroger les victimes agonisantes devant la foule en colère. Un deuxième témoin a décrit les événements à Human Rights Watch et à l’APRODH :
Une énorme foule en colère était rassemblée ici. Le chef de poste a dit à la foule, ‘Vous ne devriez pas les tuer, je vais les emmener au poste de la police’. La population a répondu, ‘Vous allez juste les relâcher comme d’habitude’. Les gens ont continué à jeter des pierres. Le chef de poste a commencé à les interroger et la population a continué à les tabasser. Chaque fois que le chef de poste marchait jusqu’à la route pour voir si le véhicule revenait, la population se remettait à les battre avec des bâtons et des pierres. Lorsque le véhicule est arrivé, les deux étaient déjà morts.[116]
Dans le véhicule se trouvaient Donatien Manirakiza, ex-combattant FNL, et Bigirimana, un commerçant, qui avaient apparemment été dénoncés tous les deux par les victimes mourantes. Manirakiza a expliqué à Human Rights Watch et à l’APRODH qu’il avait été ramassé alors qu’il achetait du manioc. Il a signalé que la camionnette transportait des soldats, des policiers, le conseiller de l’administrateur communal, ainsi que deux combattants démobilisés du CNDD-FDD, l’ex-groupe rebelle aujourd’hui au pouvoir.[117] Manirakiza a été ligoté avec les bras derrière le dos ; il a également déclaré qu’on lui avait attaché une corde autour du cou. Les marques de corde sur les bras et dans le cou étaient visibles lorsqu’il a été interrogé par l’APRODH un mois plus tard.[118]
Selon Manirakiza :
Ils ont discuté et ont décidé de m’emmener à [un endroit qu’ils appellent ] « Kwi Bambiro ». C’est une expression kirundi qui signifie « le lieu de la crucifixion ». C’était là qu’ils avaient tué les autres.
J’ai vu les deux corps par terre et une foule de policiers, de soldats et de civils... Un des combattants démobilisés, aidé par la police, m’a sorti du camion en tirant sur la corde que j’avais autour du cou.
J’étais ligoté et assis par terre. Le chef de poste et le chef militaire ont commencé à m’interroger. Ils ont demandé si je connaissais les deux victimes et m’ont montré leurs badges. J’ai dit que j’en connaissais une parce qu’elle avait travaillé à une position près de chez moi. Pendant qu’ils me posaient des questions, d’autres personnes ne cessaient de me frapper avec des bâtons et de me lancer des pierres.
Le commissaire de la police provinciale est arrivé avec l’officier de police judiciaire. Je ne voyais pas très bien parce que j’avais reçu une pierre dans l’œil mais j’entendais les gens qui disaient, ‘Si nous ne le tuons pas maintenant, il va porter plainte contre nous ou chercher à se venger.’ Quelqu’un, je ne sais pas qui, a jeté une grosse pierre. J’ai perdu connaissance et je me suis réveillé à l’hôpital.[119]
La déclaration de Manirakiza soulève de sérieuses inquiétudes quant à l’action de la police et des responsables de l’administration qui, plutôt que de suivre la procédure adéquate—qui aurait été d’emmener directement Manirakiza au cachot communal et de le remettre à l’officier de police judiciaire en vue d’un interrogatoire[120]—l’ont au fond livré aux mains d’une foule en colère qui avait déjà tué deux suspects. Les autorités ont expliqué à l’APRODH qu’ils avaient emmené Manirakiza sur le lieu des meurtres parce qu’ils voulaient qu’il soit identifié par les deux policiers et ils ne s’étaient pas rendu compte que les deux hommes étaient déjà morts.[121] (Bigirimana est resté dans le véhicule pendant l’agression sur Manirakiza et s’en est sorti indemne.[122]) Étant donné que les responsables avaient vu les attaques qui visaient les suspects et auraient pu prévoir que Manirakiza subirait le même traitement aux mains de la foule, leur décision traduit un profond mépris et une grave négligence par rapport à la sécurité de Manirakiza.
Les responsables se sont apparemment rendu compte de leur erreur et à un certain moment pendant l’interrogatoire, le chef de poste a essayé de sauver la vie à Manirakiza en l’emmenant dans un bâtiment.[123] Il a également téléphoné au procureur de la province et au commissaire de police. Ce dernier est arrivé et est parvenu à disperser la foule et à transporter Manirakiza dans un lieu sûr.[124]
Manirakiza a été hospitalisé pendant deux semaines, pour ensuite être emprisonné pendant cinq jours avant d’être totalement disculpé. Il a identifié deux personnes qui avaient mené l’agression contre lui et un magistrat a délivré deux citations à comparaître. Fait extraordinaire, le magistrat a remis les citations à Manirakiza afin qu’il les remette lui-même à ses agresseurs. Manirakiza a confié à Human Rights Watch et à l’APRODH qu’il ne comprenait pas pourquoi c’était sa responsabilité. Il a déclaré : « C’est le système judiciaire qui devrait les poursuivre... Je ne peux pas suivre le dossier tout seul. Mais jusqu’à présent, la justice n’a rien fait. »[125]
Après les meurtres, le porte-parole de la police, Pierre Channel Ntarabaganyi, a déclaré franchement aux journalistes : « Je peux émettre une critique envers la population qui a appliqué la justice populaire, ce qui est défendu par la loi. Mais d’autre part, je dois remercier la population pour s’être impliquée dans l’assainissement de la paix et de la sécurité qui venaient d’être troublées par les deux policiers égarés. »[126]Ntarabaganyi a confirmé à Human Rights Watch en décembre qu’il s’en tenait toujours à cette déclaration.[127] Un responsable de la justice qui était opposé à la justice populaire s’est plaint : « Les commentaires du porte-parole de la police ont incité la population à se faire justice. »[128]
VI. Implication et complicité des autorités dans des actes de justice populaire
L’implication et la complicité de responsables de l’État dans la justice populaire donnent lieu à de graves violations des droits humains. En participant à des actes de justice populaire, ou en tolérant, facilitant et couvrant de tels actes, les agents de l’État sont responsables de la perte de vies humaines. Ils privent également les présumés criminels de leur droit à des procédures et à un procès équitables, abusent de leur pouvoir et se mettent en défaut de protéger comme il convient une population dont ils sont chargés d’assurer la sécurité.
Dans les cas identifiés par Human Rights Watch et l’APRODH, les responsables qui semblent être le plus fréquemment impliqués dans des actes de justice populaire sont les élus locaux tels que les nyumbakumis (personnes responsables de 10 ménages), les chefs de colline, ainsi que les membres du conseil de colline et du conseil communal. Des bashingantahe, des « sages » investis au niveau local dans le cadre de cérémonies traditionnelles (ou dans certains cas élus) et qui résolvent les conflits et disposent d’un statut spécial reconnu par l’État, ont aussi été mentionnés par des témoins et des victimes. Ces responsables ont joué un rôle direct dans un certain nombre de meurtres par lynchage et ne sont presque jamais poursuivis.
Même si ce n’est guère fréquent, il arrive que des policiers, des soldats et des administrateurs communaux soient aussi directement impliqués dans certaines affaires. Dans les cas analysés par Human Rights Watch et l’APRODH en 2009, la police avait beaucoup plus tendance à tenter de juguler la violence populaire qu’à y participer. Même si ces interventions policières positives devraient être reconnues, elles ont généralement été suivies d’une absence d’enquête sur les responsables. Bien que le manque de moyens contribue à cette inaction, le manque de volonté de la part des responsables de l’État, conjugué à la corruption et au mauvais usage des ressources de l’État, aide aussi à expliquer pourquoi la justice populaire persiste. Dans certains cas, la police a activement couvert les lyncheurs et les responsables de l’administration ont fait de même.
Certains fonctionnaires de l’État ont également encouragé la justice populaire par leurs déclarations publiques, et d’autres par leur soutien inconditionnel à des « comités de sécurité » non officiels qui tendent à recourir à la violence (voir plus loin, Étude de cas 3).
Le Président Pierre Nkurunziza, élu en 2005, a, et c’est tout à son honneur, dénoncé la justice populaire,[129] se démarquant ainsi de son prédécesseur, le Président Domitien Ndayizeye, dont le porte-parole Pancrace Cimpaye, dans une déclaration publique de 2004 non désavouée, encourageait les Burundais à tuer les voleurs. Bien que de tels meurtres n’aient en principe jamais été légaux, ils ont été qualifiés par les Burundais de « loi » ou de « politique » et la tolérance dont a fait preuve le gouvernement Ndayizeye à l’égard de la violence populaire continue d’influencer les Burundais : une personne qui avait été témoin d’un meurtre et cherchait à le défendre a expliqué : « Le Président Nkurunziza a changé cette politique mais les gens l’ont toujours dans la tête. »[130] Un volontaire de la Croix-Rouge àBujumbura a signalé à Human Rights Watch : « Les gens se disent, ‘En tout cas, on se sent mieux si on les tue nous-mêmes, et on justifie cela avec l’ancienne loi, même si la loi a changé’. »[131]
En ce qui concerne l’administration actuelle, la déclaration du porte-parole de la police nationale Pierre Channel Ntarabaganyi louant les auteurs du meurtre de deux policiers soupçonnés d’un délit à Gisuru (voir plus haut, Étude de cas 2) démontre la position ambigüe du gouvernement burundais par rapport à la justice populaire.
Rôle direct de responsables locaux
En juin 2009, un homme répondant au nom de Nzeyimana a été battu à mort dans la commune de Buhinyuza, en province de Muyinga. Parmi ses présumés agresseurs se trouvait le chef de colline, Ernest Macumi. Nzeyimana était apparemment soupçonné d’intentions criminelles uniquement parce qu’il errait ci et là à Rugazi, une colline où les gens ne le connaissaient pas et où des vols avaient été commis récemment. Il était environ 20 heures et il se rendait chez son grand-père qui vivait dans les environs, à Rugongo.[132]
Selon la police communale, les habitants ont « attrapé » Nzeyimana et l’ont emmené devant le chef de colline, Macumi. Macumi, qui aurait été ivre au moment de l’incident, a envoyé un ami chercher une corde pour attacher Nzeyimana. Macumi s’est servi de la corde pour ligoter Nzeyimana et, avec quelques-uns de ses acolytes, l’a battu à mort avec différents objets, dont des chaussures et des bâtons.[133]
Macumi a ensuite fui la commune, se réfugiant probablement en Tanzanie voisine. La police a arrêté cinq suspects, dont l’homme qui possédait la propriété où Nzeyimana avait été tué.[134] Ils ont été transférés au parquet le 30 juin et ont reconnu avoir été témoins du crime mais ont nié toute participation.[135] Depuis leur libération provisoire le 23 juillet, aucun progrès n’a été enregistré dans le cadre de cette affaire.[136]
Le meurtre de Nzeyimana est l’un des divers cas où des responsables locaux, y compris des élus, auraient participé directement à des actes de justice populaire. Les autorités impliquées dans ces affaires, à l’exception des affaires à caractère politique analysées plus loin, n’étaient généralement pas de hauts responsables mais ils occupaient néanmoins des postes leur conférant des pouvoirs. Parmi eux figurent un membre d’un conseil communal, des chefs de colline, des membres des conseils de colline, des bashingantahe et des nyumbakumis. Les responsables locaux, qui en général n’ont pas beaucoup eu accès à l’éducation formelle et ont une compréhension limitée de la loi, semblent souvent participer aux actes de justice populaire pour les mêmes raisons que l’ensemble de la population—mécontentement par rapport à la police et au secteur judiciaire, et conviction que les gens doivent se protéger eux-mêmes.[137] Les ambitions électorales et le désir de donner l’impression de prendre des mesures contre la criminalité peuvent constituer un autre facteur. Human Rights Watch et l’APRODH n’ont pu interroger aucun responsable local qui reconnaissait avoir participé directement à des lynchages.
Célestin Karenzo, un jeune homme de la commune de Buterere (Bujumbura), est l’une des victimes d’actes de justice populaire dans lesquels des fonctionnaires de l’État ont été impliqués. Soupçonné de complicité de vol, il a été battu par un groupe d’habitants de Buterere en avril 2009. Selon Karenzo, un membre du conseil communal faisait partie de ce groupe. Lorsque l’APRODH et Human Rights Watch ont vu Karenzo plusieurs jours après son passage à tabac, il présentait de graves blessures sur tout le visage, à la tête et à la mâchoire.[138] Karenzo n’a pas porté plainte et les responsables locaux n’ont pas ouvert d’enquête sur le passage à tabac.
Léocadie Irankunda a survécu aux coups que lui a administrés à Buraza, en province de Gitega, un groupe au sein duquel se serait trouvé un mushingantahe membre du conseil de colline. Son ami, Cyprien Habonimana, a perdu la vie lors du passage à tabac (voir plus haut, Étude de cas 1). Le membre du conseil de colline impliqué n’a jamais été arrêté.[139]
À Mwumba, dans la province de Ngozi, deux hommes ont été violemment passés à tabac en mai 2009 après avoir été pris en flagrant délit de vol de café dans un magasin tenu par le fils d’un chef de colline. Les témoignages relatifs à cet incident diffèrent. Un témoin a signalé que le chef de colline était le premier responsable du passage à tabac, ayant frappé les suspects avec des branches d’arbre et ayant ordonné à d’autres spectateurs de l’aider. Selon le témoin, le chef de colline a ensuite donné de fausses informations à la police, prétendant qu’il s’agissait d’un cas de justice populaire. Le fils du chef de colline, par contre, a expliqué à Human Rights Watch que c’étaient les habitants en colère qui avaient spontanément battus les deux hommes, et que lui aussi avait participé au passage à tabac. Il a ajouté qu’il aurait bien voulu que les voleurs soient tués, déclarant : « Si vous tuez un voleur, vous ne violez aucune loi. »[140]
La police, semblant entériner ce raisonnement, n’a procédé à aucune arrestation.[141] Lors de visites effectuées à Mwumba, Human Rights Watch et l’APRODH n’ont pu localiser le chef de colline pour entendre ses commentaires. Le chef de la police communale a déclaré qu’il ne pensait pas que des responsables locaux aient été impliqués mais qu’il n’avait pas mené d’enquête parce que les deux victimes n’avaient pas porté plainte.[142]
Un membre du conseil de colline aurait figuré parmi les responsables du meurtre de Gratien Masabarakiza, un présumé voleur de pommes de terre, survenu dans la commune de Ruyigi en août 2009. Selon deux témoins, un voisin a remarqué le 24 août que des pommes de terre avaient été volées dans ses champs la nuit antérieure. Lui et d’autres hommes ont formé un groupe pour enquêter. Le lendemain, quatre hommes, dont un membre du conseil de colline, se sont rendus chez Masabarakiza, où ils ont procédé à une perquisition illégale. Masabarakiza s’est enfui pendant qu’ils fouillaient sa maison. Ils l’ont poursuivi sur le versant d’une colline et dans une vallée, ralliant la population, jusqu’à ce qu’une foule énorme se forme et tue Masabarakiza. Trois hommes ont été arrêtés et inculpés de meurtre, et bien qu’ils aient été remis en liberté provisoire, le dossier reste ouvert. Cependant, en février 2010, le membre du conseil de colline n’avait toujours pas été arrêté ni inculpé.[143]
L’épouse de Masabarikiza a déclaré que les accusés avaient payé pour être relâchés et qu’à leur libération, ils s’étaient vantés d’avoir tué son mari. La mère de Masabarikiza a déclaré : « J’aurais été prête à planter plus de pommes de terre la saison prochaine pour en rendre à la victime du vol. Mais ils ne peuvent pas me rendre mon fils. »[144]
Parmi d’autres incidents examinés en 2009 auxquels auraient participé directement des fonctionnaires de l’administration figuraient notamment les cas suivants :
- Dans la province de Ruyigi, un nyumbakumi et un mushingantahe ont été arrêtés pour avoir battu à mort Pascal Gasindi, un homme pris en flagrant délit de vol à Gisuru en juin 2009.[145] Ils ont été libérés par la suite, bien qu’un responsable de la police ait signalé à Human Rights Watch qu’ils avaient avoué leur crime.
- Un nyumbakumi a été cité parmi ceux qui auraient tué Cayega et Ndireguheka, deux voleurs présumés de bicyclettes, à Kinyinya (voir plus loin, Étude de cas 3). Il a été arrêté mais libéré par la suite.[146] Un sous-chef de colline, également soupçonné des meurtres, aurait fui en Tanzanie.[147]
- Le 15 juin, un membre d’un groupe ayant tenté de commettre un vol à main armée a été capturé et battu à mort à Rubenga, dans la commune de Giteranyi, en province de Muyinga. Un témoin a déclaré que plusieurs nyumbakumis étaient présents lors du passage à tabac et n’avaient pas cherché à y mettre fin. Aucun de ces individus n’a été arrêté ni interrogé, et aucun n’a fourni des informations à la police.[148]
- Un chef de secteur et un chef de colline ont été accusés d’avoir été parmi les meneurs lors du meurtre d’un voleur présumé dans la province de Bubanza en juillet. Ils ont été arrêtés en même temps que six autres personnes.[149] Le chef de secteur a ensuite été libéré après avoir été disculpé par plusieurs de ses coaccusés qui ont avoué le crime ; le chef de colline demeurait en détention préventive en janvier 2010, inculpé de « manquement à la solidarité publique » (ayant été présent sur le lieu du crime sans avoir cherché à le prévenir ou à le signaler).[150]
Contrairement aux responsables de l’administration, la participation directe de policiers et de soldats à des lynchages n’est que rarement citée. Ils ont battu et maltraité des détenus et autres civils dans certains cas n’impliquant pas la participation d’une foule—donnant des exemples négatifs au public sur la manière de traiter des suspects—mais semblent avoir beaucoup moins tendance que leurs homologues de l’administration à se joindre à une foule ou à inciter directement une foule.
Human Rights Watch et l’APRODH n’ont reçu qu’une seule information digne de foi concernant l’implication directe de la police dans un acte de justice populaire en 2009. À Ryansoro, dans la province de Gitega, des responsables de l’ONU ont signalé qu’un détenu soupçonné de viol avait été passé à tabac par un groupe dans lequel se trouvaient des policiers et des civils.[151] Un commissaire de police a toutefois déclaré que la police de Ryansoro prétendait n’avoir joué aucun rôle dans le passage à tabac, affirmant qu’elle était intervenue pour le délivrer de la foule.[152]
De même, des soldats de l’armée burundaise, la Force de Défense Nationale (FDN), ont été cités dans des affaires de justice populaire en 2007 et début 2008, mais pas du tout en 2009. Jusqu’à la mi-2008, les soldats ont procédé régulièrement à des arrestations et détentions illégales de civils ; certains de ceux-ci ont été passés à tabac en public. Par exemple, fin 2007, cinq Tanzaniens ont été arrêtés par un groupe de soldats et de civils dans la province de Makamba sur présomption de braconnage. Ils ont été violemment passés à tabac et l’un d’eux est décédé des suites de ses blessures.[153]
De tels cas ont considérablement diminué fin 2008. Suite à la campagne menée par les organisations nationales et internationales de défense des droits humains visant à presser la FDN de mettre fin aux arrestations de civils, la FDN a émis des ordres clairs aux commandants des camps militaires leur signifiant que la détention de civils était interdite.
La justice populaire comme manifestation de la violence politique
Dans plusieurs cas, la police, les responsables de l’administration et les dirigeants des partis politiques ont mobilisé les foules pour se livrer à des violences pour des raisons politiques.[154] Des membres des FNL, un ancien mouvement rebelle devenu parti politique en avril 2009, ont été victimes de ce type de violences organisées par le parti au pouvoir, le CNDD-FDD. Deux incidents de ce genre ont eu lieu en décembre 2008.[155]
Dans le premier de ces incidents, survenu à Kayogoro, en province de Makamba, des membres des FNL ont organisé un meeting non autorisé, menacé les habitants afin de les forcer à y participer et retenus comme otages pendant plusieurs heures deux policiers et un civil qu’ils soupçonnaient d’ « espionner » leur meeting.
Des renforts de police ont dispersé le meeting et commencé à arrêter des participants présumés. Les dirigeants provinciaux et communaux du CNDD-FDD ont rallié les habitants de la localité qui étaient en colère à cause du comportement des FNL et ils ont poussé un groupe de personnes—principalement des ex-combattants des FDD—à ligoter et à battre les membres des FNL. Des témoins ont raconté que le chef de poste et l’administrateur communal étaient restés là à regarder les passages à tabac et avaient laissé faire. Les deux responsables ont par la suite déclaré à Human Rights Watch que les victimes avaient été battues par « la population », cherchant à masquer la nature politique des passages à tabac.[156]
Dans un deuxième incident, la police, l’administrateur communal et des sympathisants du CNDD-FDD de Nyamurenza, en province de Ngozi, ont mobilisé une foule pour attaquer des membres des FNL qui avaient apparemment tenu une réunion illégale. Au moins neuf présumés membres des FNL ont été brutalement roués de coups ; l’un d’eux a reçu des soins médicaux pour ses blessures et portait encore des traces plusieurs mois plus tard.[157] Aucun des auteurs des faits n’a dû répondre de ses actes.
Ce type de comportement adopté par des fonctionnaires de l’État peut influencer le public. Un mois plus tard, en février 2009, des habitants de Nyamurenza, sans aucune incitation de la part d’agents de l’État, ont battu à mort trois voleurs présumés. Selon l’administrateur communal, la police était sur place, apparemment incapable d’arrêter la foule en colère.[158]
Soutien inconditionnel aux « comités de sécurité » non formés
Même lorsque des responsables locaux ne sont pas directement impliqués dans des actes de justice populaire, leurs réactions face à la criminalité créent souvent des conditions qui peuvent favoriser la perpétration de ce type de meurtres.
Dans plusieurs communes, les responsables locaux ont organisé des « comités de sécurité » non officiels. Ceux-ci sont différents des comités de sécurité officiels reconnus par la loi, qui sont composés de responsables locaux de la police et de l’administration qui se réunissent chaque semaine pour discuter de la manière d’aborder la prévention de la criminalité. Les comités de sécurité non officiels, organisés au niveau de la colline mais approuvés par des autorités communales, sont généralement composés d’hommes jeunes qui procèdent à des arrestations au nom de la police.[159] Human Rights Watch et l’APRODH ont recueilli des informations sur les activités de ces comités dans certaines parties de Ruyigi, Ngozi et Bujumbura Rural, mais ils pourraient aussi exister ailleurs.
C’est dans la province de Ruyigi que les comités de sécurité informels ont été mentionnés le plus souvent—et semblaient être les plus enclins à avoir recours au lynchage des présumés malfaiteurs. Dans cette province en mai 2009, dans la commune de Kinyinya, des témoins ont déclaré qu’un comité de sécurité comprenant des « hommes jeunes et forts » avait arrêté Cageya et Jean-Marie Ndireguheka, deux hommes qu’il soupçonnait d’avoir volé un vélo, et les avait battu à mort (voir plus loin, Étude de cas 3). Ce comité a reçu le soutien de l’administration locale, qui a ensuite essayé de dissimuler le rôle joué par le comité dans ces meurtres.
Un « comité de sécurité » similaire a arrêté et tué Dominique Harutimana, 25 ans, à Gisuru dans la province de Ruyigi en janvier 2009. Lorsque les habitants ont appris que Harutimana avait apparemment caché plusieurs armes dans la brousse, ils l’ont soupçonné de planifier un méfait, l’ont « arrêté » chez lui tôt le matin et l’ont battu à mort. Son père a expliqué à Human Rights Watch et à l’APRODH : « La population est arrivée à six heures du matin pour chercher Dominique. Il y avait plus de 20 personnes – c’était comme une attaque militaire. Ils m’ont dit de réveiller Dominique et l’ont ligoté avec une corde, les bras derrière le dos... Plus tard, quelques-uns de ceux qui l’avaient emmené sont venus me dire qu’il fallait que j’aille chercher le corps parce que mon fils était mort. » [160]
Un jeune homme qui était membre de ce « comité » a précisé qu’ils avaient également arrêté et tué des voleurs présumés au cours des années précédentes.[161]Bien qu’il ait nié avoir participé au passage à tabac, il a déclaré à Human Rights Watch : « Justice a été faite. Ils [les autorités] devraient autoriser la population à punir directement ceux qui commettent des crimes, parce que la justice les libère simplement. »
Le groupe qui avait battu Harutimana a fini par l’emmener à la brigade de police ; il est décédé peu de temps après. Aucune arrestation n’a eu lieu en dépit de preuves largement suffisantes indiquant qui avait participé au passage à tabac. L’officier de police judiciaire de Gisuru a affirmé : « Nous n’avons pas réussi à trouver les auteurs. »[162] Pour la famille de Harutimana, cela ressemblait à une autorisation de tuer tacite, voire explicite, délivrée par les autorités. La sœur de Harutimana, une adolescente, a confié à Human Rights Watch et à l’APRODH : « Cela me rend triste qu’il ait été tué, mais c’était toute la population contre lui. Nous ne pouvions rien y faire. »[163]
Dans la commune de Tangara, en province de Ngozi, un officier de police a expliqué à Human Rights Watch que les responsables de l’administration mobilisent souvent la population pour effectuer des chasses à l’homme afin de débusquer des criminels présumés, ceci sans en informer la police. Ce fut le cas en décembre 2008 : après qu’un vélo et des vêtements eurent été volés dans une habitation, le chef de colline a organisé des comités de recherche le lendemain, sans en informer la police. Cette nuit-là, des habitants ont attrapé et battu à mort un voleur présumé, Kitamosa Manirambona.[164] L’officier de police a déclaré qu’après de tels incidents, « la population et les responsables locaux se couvrent. »[165]
Étant donné la fréquence de la violence populaire au Burundi, le manque de présence policière pour assurer un comportement conforme à la loi aggrave le risque de voir ces comités locaux de recherche—composés de victimes en colère—recourir à la violence lorsqu’ils trouvent un suspect. Un chef de zone de Tangara a décrit un autre meurtre de cette nature à l’occasion duquel les autorités locales avaient organisé une chasse à l’homme et avaient ensuite laissé les gens se débrouiller : « Ce soir-là, la police est arrivée tardivement parce qu’il faisait nuit. Pendant ce temps, la population avait tabassé les voleurs parce qu’elle était en colère—et parce que quand il n’y a personne de l’administration, la population a tendance à faire ce qu’elle veut. »[166]
À Nyamurenza, dans la province de Ngozi, les hommes se relaient pour effectuer des patrouilles de sécurité pendant la nuit.[167] Le 23 février 2009 aux alentours de 18 heures, un informateur a signalé au chef de colline que ses amis planifiaient de commettre un vol à main armée cette nuit-là. Le chef de colline en a informé les trois policiers basés dans une position de police locale. Sans consulter leurs supérieurs—peut-être en raison des problèmes de communication décrits plus haut—deux d’entre eux ont décidé d’appréhender les voleurs présumés, tandis que le troisième restait à la position. Les deux policiers en question ont mobilisé un groupe d’habitants de la localité, que des témoins ont estimé être composé de 50 à 100 hommes, qui se sont rendus à la maison visée et se sont cachés dans les buissons, tendant une « embuscade » aux voleurs. Selon un témoin, l’intention était d’arrêter les voleurs, pas de les tuer, mais aucun plan d’urgence n’avait été prévu si les voleurs venaient à résister à leur arrestation. Lorsque les voleurs ont été pris, l’un d’eux a tué d’un coup de couteau l’habitant qui l’avait attrapé. D’autres habitants ont alors battu et lapidé trois des autres voleurs, jusqu’à ce que mort s’ensuive, tandis que la police restait là impuissante.[168]
À Mubimbi, dans la province de Bujumbura Rural, l’administrateur communal avait donné pour instruction aux habitants d’arrêter un voleur bien connu, Salvator Bitwi, s’il le voyait dans le voisinage. C’est ce que les habitants ont fait mais ils l’ont battu à mort plutôt que de le remettre aux mains de la police.[169] Comme l’a expliqué un responsable communal : « Il a été tabassé parce que les gens savaient depuis longtemps que c’était un voleur. Ils ne voulaient pas l’emmener à la police parce qu’ils en avaient assez de lui et de sa bande. »[170] En dehors du rôle joué par les autorités dans l’organisation du comité de sécurité qui a tué Bitwi, un officier de police a également joué un rôle en libérant les auteurs de ce meurtre, comme expliqué plus loin.
Il arrive que les autorités rendent obligatoire la participation à ces groupes. À Nyabitsinda, en province de Ruyigi, un habitant a signalé que les hommes étaient obligés d’effectuer des rondes de nuit par groupes de trois ou quatre. Il a expliqué que ceux qui n’y participaient pas étaient condamnés à une amende par l’administration locale.[171]
Parfois, l’administration ne semblait pas organiser elle-même les rondes mais les responsables de l’administration étaient au courant et ne donnaient pas l’impression de prendre des mesures pour s’assurer que les rondes ne débouchent pas sur des meurtres ou autre type de violences.[172] Ce fut le cas dans la province de Gitega, qui en 2009 était fréquemment la proie d’un groupe de bandits armés dirigé par Cédric Mazoya, lui aussi considéré comme un « bandit notoire ».[173] Mazoya appartenait au groupe ethnique Twa, qui représente environ un pour cent de la population burundaise et a, au cours de son histoire, fait l’objet de discriminations.[174] Il semble que la principale activité de sa bande était de commettre des vols à main armée—parfois avec la complicité de la police[175]—mais il se posait également en « libérateur du peuple Batwa ».[176]
En réaction, des habitants des communes affectées ont organisé des rondes de nuit à la recherche des bandits. Ceux qui participaient à ces rondes étaient parfois jusqu’à 30 et étaient armés de machettes et de barres de fer.[177]
Le 10 septembre 2009, un groupe de Batwa rentrait à Giheta aux alentours de 5h30 du matin après une réunion de famille qui avait eu lieu dans une commune voisine. L’un d’eux a décrit les événements qui ont suivi :
Nous revenions de la fête [lorsque] les gens de Bihororo, armés de machettes, nous ont tendu une embuscade à la rivière. Nous avons eu peur et sommes partis en courant. Ils étaient une trentaine au départ et nous aussi nous étions une trentaine, en comptant les femmes et les enfants. Les gens nous ont pourchassés et nous ont interceptés. Plein d’autres personnes les ont rejoints et nous ne pouvions plus nous enfuir. Ils ont commencé à nous tabasser. C’était presque tout le village qui était là. Des vols avaient lieu depuis plusieurs jours et ils nous soupçonnaient. [...] Ils nous ont ligotés et battus. [...] Quelqu’un de notre groupe a été tué. Il était arrivé le dernier et a vu que les autres avaient déjà été roués de coups. Il a demandé pourquoi et ils ont commencé à le battre aussi. Il s’est enfui et ils l’ont pourchassé. Lorsqu’ils l’ont ramené 20 minutes plus tard, c’était presque un cadavre. [...] J’ai des maux de tête maintenant et je ne peux rien porter sur la tête.[178]
L’homme qui a été tué avait 18 ans et s’appelait Jean Bukuru. Parmi les victimes des passages à tabac figuraient un garçon de 12 ans et une fille de 17 ans.[179] La mère de Bukuru, elle aussi passée à tabac, l’a regardé mourir sous ses yeux ; elle a confié à Human Rights Watch et à l’APRODH : « J’ai vu mon fils se faire tuer. Je ne pouvais rien faire d’autre que pleurer. Personne ne pouvait rien faire. »[180]
Certains groupes de « sécurité » composés de jeunes sont actuellement affiliés à des partis politiques, que ce soit au parti au pouvoir, le CNDD-FDD, ou à divers partis d’opposition. Fréquents à l’intérieur du pays, ils pourraient présenter un risque particulier dans le sens où même en l’absence d’enjeux politiques, ils pourraient déclencher la vindicte populaire car ils considèrent que leur rôle est d’ « assurer la sécurité ». Jusqu’à présent, ils ne semblent pas avoir fréquemment été les auteurs d’actes de justice populaire, mis à part le rôle joué dans les incidents politiques mentionnés plus haut. Néanmoins, dans la commune de Gihogazi, en province de Karusi, un voleur présumé aurait été violemment battu le 28 août 2009 par des membres de l’Imbonerakure, la ligue des jeunes du CNDD-FDD. (Les motifs du passage à tabac ne semblent pas avoir été politiques.)[181] Les jeunes du CNDD-FDD effectueraient également des patrouilles de nuit à Gashoho, dans la province de Muyinga, rappelant leur comportement peu avant que le CNDD-FDD ne remporte les élections de 2005.[182]
Alors que les élections de la mi-2010 approchent et que les groupes de jeunes partisans deviennent de plus en plus présents et actifs, ces groupes risquent de jouer un rôle accru dans les actes de vindicte populaire, d’autant plus que ces passages à tabac et meurtres sont souvent accueillis positivement par les habitants qui ont été victimes de délits.
Négligence des autorités
Les difficultés rencontrées par les autorités locales et la police pour prévenir ou juguler la vindicte populaire déjà en cours ne peuvent être sous-estimées. Dans un certain nombre d’incidents, dont certains sont analysés plus loin, les officiers de police ou les responsables locaux ont cherché à interrompre des lynchages et ont eux-mêmes été blessés. Toutefois dans d’autres cas, les fonctionnaires se sont de toute évidence mis en défaut de protéger les victimes de la vindicte populaire.
Par exemple, le BINUB a rapporté qu’en août 2009 dans la province de Bururi, « un homme aurait été passé à tabac par un groupe d’individus non identifiés qui l’ont accusé de vol. L’homme avait été abandonné grièvement blessé, et le chef de quartier serait passé à côté mais ne lui aurait pas porté secours. La victime est décédée quelques heures plus tard. »[183] Les autorités judiciaires ont ouvert une enquête sur le passage à tabac mais n’avaient procédé à aucune arrestation au moment de la rédaction du présent rapport. Aux termes de la loi burundaise, un fonctionnaire qui se met en défaut de porter assistance dans ce genre de situation peut être poursuivi pour « manquement à la solidarité publique ».[184]
Étude de cas 3 : La justice populaire rendue par les « comités de sécurité » de jeunes, Kinyinya, province de Ruyigi, mai 2009
La commune de Kinyinya à Ruyigi, voisine de Gisusu, s’étend le long de la frontière tanzanienne dans une région connue pour son taux élevé de criminalité, avec notamment des réseaux transfrontaliers de voleurs qui tendent des embuscades aux véhicules. En mai 2009, des embuscades de ce type sont survenues fréquemment. La nuit du 11 mai, un délit beaucoup moins grave a eu lieu : un vélo a été volé dans une remise appartenant à Véronique Nyandwi, sur la colline de Rusange, proche du centre de Kinyinya. Selon Nyandwi, deux passants lui avaient demandé de laisser leurs vélos là pour la nuit. Lorsqu’ils sont revenus le lendemain matin, un des vélos avait disparu.
Craignant d’être accusée de complicité de vol, Nyandwi a envoyé quelqu’un alerter le chef de colline à Muvumu, juste de l’autre côté de la route. Ce soir-là, un « comité de sécurité », que les habitants ont décrit comme étant composé « de jeunes hommes forts » est parti à la recherche des voleurs pour récupérer le vélo. Selon l’officier de police judiciaire de Kinyinya, le chef de colline avait donné l’ordre au comité de sécurité de mener les recherches.[185] L’administrateur communal a été jusqu’à nier l’existence du comité de sécurité, mais les habitants et d’autres responsables ont tous reconnu qu’il existait et déclaré que la police et les autorités administratives faisaient régulièrement appel à ses services pour aider à procéder à des arrestations.[186]
Le groupe de jeunes a identifié deux suspects, deux jeunes répondant aux noms de Cayega et de Jean-Marie Ndireguheka. Selon la mère de Cayega, « ils sont venus la nuit et ont menacé de brûler notre maison si nous ne disions pas où était Cayega. [...] Ils étaient nombreux. La parcelle était remplie de jeunes, et certains étaient ivres ». On ne sait pas exactement où Cayega a été emmené cette nuit-là mais sa mère a expliqué que le comité de sécurité des jeunes l’avait ramené chez elle le lendemain matin, ainsi que Ndireguheka. Il avait l’air d’avoir passé la nuit dans de l’eau sale et présentait des blessures aux bras et aux jambes. (Lorsque les jeunes sont venus chercher Ndireguheka, a dit sa mère, « ils ont emmené mon fils comme s’ils emmenaient une vache à l’abattoir ».[187])
Le comité de sécurité des jeunes et d’autres habitants, dont au moins un responsable, un nyumbakumi, semblent avoir essayé d’obtenir des aveux des deux hommes et d’établir où le vélo était caché. Selon la mère de Cayega, « le nyumbakumi menaçait, ‘Nous allons t’emmener à Ijenda pour t’enterrer ». (Ijenda est une colline avoisinante où, d’après la mère, « la population a la réputation d’être brutale ».)[188]
Au lieu de cela, le groupe les a emmenés dans un petit bois juste de l’autre côté de la route. Là, les passages à tabac se sont poursuivis jusqu’à ce que les deux hommes meurent. Leurs corps ont été jetés dans un trou creusé dans le sol et recouverts de terre.[189]
Le gouverneur de Ruyigi, Cyriaque Nshimirimana, a condamné publiquement les meurtres. Il a déclaré à Human Rights Watch que la complicité des autorités locales était évidente vu que pendant une semaine, personne n’avait signalé les meurtres à la police.[190] Un responsable judiciaire de Ruyigi a également fait allusion à l’affaire en parlant de « complicité de l’administration » et d’une probable « couverture de la police ».[191] La police—qui avait probablement une petite idée de ce qui était arrivé, étant donné que l’incident avait eu lieu sur une route principale à deux kilomètres seulement du poste de police—a tardé à lancer l’enquête. Lorsqu’elle l’a enfin fait, elle a arrêté un groupe de sept personnes, dont le chef de colline, qui avait apparemment autorisé le comité de sécurité à effectuer les arrestations, le nyumbakumi, ainsi que le chef du comité de sécurité des jeunes. Mais selon un officier de police, « quelque 500 personnes sont venues protester devant la commune, réclamant leur libération, et nous avons dû les libérer ».[192]
Seul un suspect a été transféré en prison, un ex-combattant CNDD-FDD répondant au nom de Didace Ntamirukiro. Selon Ntamirukiro, que Human Rights Watch a interviewé à la prison de Ruyigi :
Le lendemain matin à 1h [après les autres arrestations], le chef de poste est venu chez moi avec un autre policier, il m’a réveillé et m’a frappé. Il a dit : ‘Explique pourquoi tu as tué ces gens’. Ils m’ont à nouveau frappé – tous les deux – et ont fouillé ma maison. Puis ils m’ont emmené au poste de police et m’ont mis au cachot. Les autres qui avaient été arrêtés étaient là aussi.
Deux jours plus tard, les gens sont venus protester et ont dit : ‘Si vous arrêtez ces gens, vous devriez arrêter tout le monde’. Le jour même, le chef de poste a libéré les autres. Le chef de poste m’a demandé 30 000 Fbu [environ 25$] pour être libéré. J’ai refusé. Je ne sais pas si les autres ont payé quelque chose.[193]
Lorsque Human Rights Watch et l’APRODH ont visité Kinyinya en août 2009, la police semblait procéder à une reconstitution des faits. Selon l’officier de police judiciaire, les seuls responsables des meurtres étaient Ntamirukiro et une autre personne—un sous-chef de colline (assistant du chef de colline, poste d’élu) qui s’est enfui par la suite en Tanzanie. Selon lui, il n’y avait pas eu de foule.[194] Cette version est en contradiction avec sept autres témoignages recueillis par Human Rights Watch et l’APRODH pendant cette visite ainsi que lors de visites précédentes et ultérieures. L’intention semblait être de faire une fois pour toutes table rase de l’idée que des responsables locaux aient pu, de quelque façon que ce soit, être impliqués dans les meurtres ou en être complices.
Aucun agent de l’État n’a dû répondre de complicité dans les actes criminels perpétrés par le comité de sécurité des jeunes. L’administrateur communal Rémy Nsengiyumva a nié l’existence de ce comité. Lorsqu’on lui a demandé si une bande de jeunes avait été organisée pour rechercher les suspects, il a simplement répondu : « Cela ne se fait pas. »[195]
Toutefois, le chef de colline a confié à Human Rights Watch et à l’APRODH : « Oui, il existe. Ils ne sont pas organisés de manière officielle. Ce sont des jeunes hommes forts qui sont bien connus sur la colline. Lorsqu’il y a un vol à main armée, ils interviennent parce que nous n’avons pas assez de policiers. »[196] Un autre habitant a révélé que le groupe était en fait organisé plus officiellement et coordonné par les autorités communales.[197]
Le père de l’une des victimes a fait allusion au groupe en qualifiant ses membres de « jeunes gardiens de la paix », une référence aux milices locales d’autodéfense créées par le gouvernement pendant la guerre civile au Burundi. Bien que les milices aient été officiellement démantelées, elles semblent avoir tout simplement pris une nouvelle forme à Kinyinya.[198]Un habitant a déclaré qu’il y en avait « cinq par colline » et que ces groupes étaient souvent « sollicités par l’administration pour aider à résoudre les problèmes lorsque la police n’était pas disponible ».[199]
L’officier de police judicaire Gilbert Ninteretse a également révélé que le comité de sécurité existait et que le chef de colline lui avait donné l’ordre d’effectuer des arrestations. Lorsqu’on lui a rappelé que des arrestations de ce type étaient illégales, il a soutenu ne pas voir ce qu’elles avaient de mal, expliquant : « C’est le système ici—nous travaillons avec des comités de sécurité de jeunes. Ils font la même chose à Gisuru. Normalement, nous collaborons bien avec eux. »[200]
Les parents de Cayega et de Ndireguheka tenaient les autorités pour responsables des meurtres. Ils ont déclaré avoir peu d’espoir que justice soit faite étant donné que les auteurs étaient proches des dirigeants de la commune. La mère de Ndireguheka, une veuve, a confié que la mort de son fils l’avait laissée dans une situation de pauvreté effroyable. À la question de savoir si elle réclamait activement justice pour le meurtre de son fils, elle a répondu avec regret : « Vers qui puis-je me tourner pour réclamer justice ? Je ne peux rien faire contre ces gens. Ils se chargent de punir les gens à la place de l’administration. L’administration leur a peut-être dit de tuer les voleurs. »[201]
Des mois plus tard, en dépit des promesses des autorités administratives selon lesquelles elles prendraient des dispositions pour que la Croix-Rouge exhume les corps afin de permettre un enterrement digne, ils se trouvaient toujours dans la fosse commune. La mère de l’une des victimes, montrant la fosse commune, a noté tristement : « C’était le seul enfant qui me restait. J’en avais cinq. Tous les autres sont morts quand ils étaient petits. »[202]
VII. Absence d’enquêtes et de poursuites engagées par les autorités dans les cas de justice populaire
Je continue à vouloir que la police fasse une enquête. Des gens volent des millions et sont libérés—je ne sais pas pourquoi mon frère a été tué pour un simple vélo.
– Le frère d’une victime de la vindicte populaire, commune de Tangara, province de Ngozi, 23 juillet 2009.
Lorsque des individus décident de faire justice eux-mêmes au Burundi, ils peuvent généralement compter sur le fait qu’ils ne devront pas rendre compte de leurs actes. Les auteurs de lynchages sont très rarement appréhendés ou poursuivis. L’expérience de Merida Ndikumana est plus typique ; son fils, Omer Cimpaye, a été lynché par une foule dans la province de Ruyigi en avril 2009. Elle a expliqué ce qui est arrivé lorsque son fils a été tué :
J’étais à la maison. Des gens sont venus me dire que mon fils avait été tué et qu’il faudrait que je trouve une natte pour procéder à son enterrement. Je me suis rendue au marché et j’ai trouvé son corps. Personne ne m’a vraiment expliqué ce qui était arrivé. Ils m’ont dit qu’ils ne savaient pas comment il avait été tué. La police m’a simplement déclaré qu’il y avait eu une bagarre avec quelqu’un d’autre. Mon fils avait 23 ans. Il était encore jeune. [...] La police n’a pas fait d’enquête pour trouver qui l’avait tué. La seule chose qu’elle a faite a été de venir me dire d’aller chercher le corps et de l’enterrer.
Je ne sais pas pourquoi la police n’a pas fait d’enquête. C’était pendant la journée, il y avait beaucoup de monde. Je ne sais pas pourquoi ils n’ont pas trouvé les responsables. J’aurais aimé que la police puisse identifier les gens qui ont fait ça. Aucun [officier de police judiciaire] n’est venu me parler.[203]
Lorsqu’un autre proche s’est rendu à la police pour voir où en était l’affaire, il a eu une réponse décevante : « La police en savait beaucoup mais ils disaient, ‘l’affaire est déjà terminée, l’enquête est bouclée. Puisqu’ils sont morts tous les deux, il n’y a aucune raison de continuer—les autorités communales ont décidé de ne pas donner suite’ ».[204]
Bien trop souvent, et dans toutes les provinces où Human Rights Watch et l’APRODH ont effectué des recherches, la police ou les autorités communales prenaient régulièrement la décision de ne pas « donner suite » aux enquêtes sur des actes de vindicte populaire. C’est arrivé même lorsque les victimes étaient vivantes et auraient facilement pu être interrogées. À Gitobe, dans la province de Kirundo, Jocelyne Nshimirimana a été violemment passée à tabac en juin 2009 et poignardée trois fois aux jambes parce qu’elle avait été prise en train de voler des bananes dans un champ. Nshimirimana a été hospitalisée dans un centre de santé. Là, elle a donné à la police les noms de ses agresseurs. L’officier de police judiciaire de Gitobe a affirmé à Human Rights Watch qu’il avait transmis à la police locale et au chef de la colline Tonga le nom des suspects à arrêter. Il a signalé que malheureusement, les suspects semblaient avoir pris la fuite.[205]
Pourtant, selon le chef de colline, la police ne lui a jamais fourni aucun nom et personne n’avait fui la colline.[206] Des habitants ont révélé que la police n’avait jamais ouvert aucune enquête pour identifier les agresseurs de Nshimirimana.[207]Les noms fournis par l’OPJ de Gitobe à Human Rights Watch et à l’APRODH ne correspondaient même pas à ceux cités par Nshimirimana. On ne sait pas clairement si l’OPJ faisait intentionnellement obstacle à l’enquête ou s’il n’était tout simplement pas intéressé par l’affaire. Nshimirimana a déclaré à Human Rights Watch et à l’APRODH qu’elle aurait voulu obtenir justice mais en dehors des informations fournies à la police, elle ne savait pas trop ce qu’elle pouvait faire d’autre.[208]
À Tangara, dans la province de Ngozi, où Daniel Harindintwari, 20 ans, a été « tué pour un simple vélo », un administratif local a déclaré à Human Rights Watch et à l’APRODH que lorsque les policiers sont arrivés sur les lieux pour évacuer le corps de Harindintwari et emmener deux autres victimes dans un centre de santé tout proche, ils n’ont pas pris la peine d’interroger les habitants de la localité. Pourtant, ces habitants ont rapidement donné à Human Rights Watch et à l’APRODH le nom des meneurs présumés. Ils se seraient peut-être montrés plus réticents à fournir ces informations à la police mais celle-ci n’a apparemment jamais demandé ces renseignements.[209] Le frère de Harindintwari a confié à Human Rights Watch et à l’APRODH: « Je pense que les policiers savaient qui a tué Daniel mais ils ont été soudoyés pour ne pas les arrêter. »[210]
Après avoir interviewé des habitants de la localité en juillet 2009, Human Rights Watch et l’APRODH ont rencontré l’officier de police judiciaire de Tangara et l’ont informé que certains témoins étaient prêts à identifier les meneurs. L’officier de police judiciaire a promis d’assurer un suivi en contactant ces témoins, mais ne l’a pas fait. En février 2010, Human Rights Watch a téléphoné à l’officier de police judiciaire pour lui demander si l’enquête avait avancé. Il a répondu que l’affaire était « trop ancienne ».[211]
Human Rights Watch et l’APRODH ont identifié plusieurs raisons pour lesquelles les agents de l’État se mettent en défaut d’enquêter et de poursuivre les actes de vindicte populaire.
Protection de personnalités locales influentes
Lorsque des administratifs à la base, des soldats ou des militants du parti au pouvoir sont directement impliqués ou complices d’actes de justice populaire, la « solidarité négative »—un arrangement non officiel consistant à se couvrir mutuellement pour des comportements répréhensibles[212]—peut provoquer chez les policiers une certaine réticence à arrêter ceux qui détiennent le pouvoir à l’échelle locale. Il en va de même avec des personnalités influentes non officielles, telles que des petits entrepreneurs. Ici, la corruption peut également être un facteur.
Ce fut notamment le cas lors des lynchages à caractère politique perpétrés par des membres du CNDD-FDD à Makamba et à Ngozi (voir plus haut), où la police n’a arrêté aucun suspect. Dans le meurtre des voleurs présumés d’un vélo à Kinyinya, analysé plus haut dans l’étude de cas 3, le refus des autorités administratives de partager leurs informations avec la police—et la réticence ultérieure de celle-ci à mener une enquête approfondie—ont également pu être influencés par l’éventuelle implication de personnalités locales importantes, dont un chef de colline, un nyumbakumi et des membres d’un comité de sécurité de jeunes.
À Gisuru, selon des responsables locaux, l’officier de police judiciaire François Niyongiko a ordonné la libération sans inculpation d’au moins quatre suspects de lynchage à la mi-2009. Deux d’entre eux étaient des personnalités locales influentes—un nyumbakumi et un mushingantahe ; selon un autre officier de police, ils ont été libérés bien qu’ils aient avoué avoir participé au meurtre de Pascal Gasindi, un présumé voleur, en juin 2009.[213]
Niyongiko aurait également fourni aux responsables judiciaires provinciaux des informations inexactes qui ont débouché sur la libération de deux hommes soupçonnés d’avoir incité une foule à tuer Athanase Ciza en février 2009.[214]Selon des habitants de Gisuru et des sources judiciaires, Ciza était en train de boire abondamment dans un bar un jour lorsqu’il a été recruté par deux membres de sa famille étendue pour assassiner Léonard Samakere, un autre membre de sa famille étendue avec qui ils avaient un conflit personnel lié à la terre.[215] Des habitants ont déclaré avoir entendu dire que les trois hommes étaient allés chez Samakere tard le soir, Ciza en tête. Ils ont dit que Samakere avait toutefois vu les agresseurs s’approcher et qu’il avait donné un coup de lance dans la jambe de Ciza.[216]
Ciza aurait commencé à courir, et ses complices, voyant apparemment une occasion de cacher leur rôle dans la tentative de meurtre, auraient crié « Au voleur ! Au voleur ! » Des voisins sont sortis de leurs maisons et ont uni leurs forces pour capturer et tuer Ciza. Selon un habitant :
Ciza a commencé à courir et est tombé dans le ravin. La population pensait que c’était un voleur. Ciza a dit : ‘Non, c’est moi, Ciza, laissez-moi expliquer.’ Mais alors [un de ses complices] est arrivé et a dit : ‘Non, c’est un voleur, tuez-le.’ Ils voulaient le tuer pour qu’il ne parle pas. [L’autre complice] a ensuite asséné le premier coup avec une machette.[217]
Ni l’OPJ ni l’administrateur communal, interrogés par Human Rights Watch, n’ont fait allusion à cette version des événements ; ils ont présenté le meurtre comme une simple affaire de justice populaire, mais les habitants de Gisuru ont révélé que les responsables savaient ce qui s’était passé et cherchaient à couvrir les deux auteurs parce qu’ils étaient fortunés et influents.[218] Les deux hommes ont en fait été arrêtés mais ils ont été libérés par le parquet car l’OPJ avait versé trop peu d’informations au dossier. La corruption, analysée plus loin, peut aussi avoir joué un rôle : un membre de la famille de Ciza a déclaré : « Je pense qu’ils ont corrompu le magistrat ou la police pour obtenir leur libération, parce qu’ils ont de l’argent. Ma famille est très pauvre et nous ne pouvons rien y faire. »[219]
Un nouveau magistrat a repris le dossier en juillet 2009 et a confié à Human Rights Watch qu’il était au courant du rôle réellement joué par les deux auteurs du meurtre.[220]Il a assumé un rôle plus actif que la police et son prédécesseur au niveau de l’enquête, et l’un des suspects a été à nouveau arrêté et inculpé en décembre 2009. Au moment de la rédaction du présent rapport, il était en attente d’un procès pour meurtre.[221]
Capitulation face à la pression publique
Dans plusieurs cas, Human Rights Watch et l’APRODH ont constaté que des individus soupçonnés de participation à des actes de vindicte populaire avaient été arrêtés, pour être ensuite relâchés sans inculpation par des policiers incapables de résister à la pression publique.
Dans la commune de Mubimbi, à Bujumbura Rural, Salvator Bitwi a été battu à mort par une foule en colère—agissant à l’instigation de responsables locaux, comme noté plus haut—après avoir été pris en flagrant délit de vol sur la colline toute proche de Kababaza. Il a été capturé et frappé à coups de bâtons tout le long du chemin menant de Kababaza à Burenza, la colline d’où il venait. Arrivé chez lui, on l’a mis en présence de son père, qui apparemment ne l’aurait pas défendu. Des voisins se sont ajoutés aux autres pour le battre et Bitwi est finalement décédé.[222]
Le chef de colline, qui était arrivé pendant le passage à tabac et qui a été incapable de l’arrêter, a noté le nom de 64 personnes qui étaient présentes et semblaient être impliquées. Il a remis cette liste à la police, qui lui demandé d’amener les suspects pour interrogatoire. Comme il l’a expliqué à Human Rights Watch :
Le lendemain, je suis allé au [poste de police communal] avec les 64 personnes. Mais près de 150 personnes ont suivi. La première personne à être interrogée a dit : ‘Oui, nous l’avons battu, parce qu’il vole et qu’il est toujours libéré. Nous pensons que vous êtes derrière ça, alors nous avons dû le punir nous-mêmes.’ Les six premiers à être interrogés ont tous dit pratiquement la même chose.
L’OPJ a décidé d’arrêter les six premiers et de les mettre au cachot. Mais les autres ont refusé de partir, disant qu’eux aussi alors devraient être arrêtés. Finalement, ils sont partis mais ils sont revenus le lendemain. Ils ont organisé une sorte de manifestation, disant que tous devraient être arrêtés puisqu’ils l’avaient tous tabassé. Tout le monde voyait qu’il y avait un genre de soulèvement populaire et que la situation risquait de dégénérer.
Le conseiller de l’administrateur communal, le curé de la paroisse de Mubimbi et l’OPJ ont essayé de calmer les gens. Mais tous les trois, ils ont finalement pris une décision et l’OPJ a été obligé de libérer les six détenus.[223]
La police a confirmé qu’elle avait arrêté six suspects qui ont avoué le meurtre.[224] Un officier a déclaré que les policiers locaux, débordés, avaient appelé le commissaire provincial de police et que c’était lui qui avait donné l’ordre de relâcher les six suspects. Comme l’a expliqué l’officier : « La police avait la preuve qu’ils étaient responsables mais elle les a quand même libérés pour préserver de bonnes relations avec la population. »[225] La police a signalé à Human Rights Watch qu’une enquête était encore en cours, mais les suspects n’avaient toujours pas été réarrêtés en décembre.[226] La corruption est peut-être un facteur ici aussi : un officier de police a confié à Human Rights Watch que le commissaire provincial de police avait accepté des pots-de-vin. En fait, ce commissaire a été dégradé en novembre 2009 suite à des accusations répétées de corruption.[227]
À Kinyinya, où Jean-Marie Ndireguheka et Cayega ont été battus à mort le 13 mai pour avoir volé un vélo (voir plus haut, Étude de cas 3), un officier de police a expliqué : « Nous avons arrêté deux chefs de secteur, mais environ 500 personnes sont arrivées pour protester devant la commune, pour les faire libérer, et nous avons dû les libérer. »[228]
La pression publique peut prendre des formes dangereuses. Un gouverneur a confié à Human Rights Watch que les policiers avaient souvent peur d’ouvrir des enquêtes sur des affaires de justice populaire parce qu’ils craignaient d’être tués.[229] De même, des responsables de l’administration au niveau de la colline—soit ceux qui sont le plus susceptibles de disposer d’informations sur les auteurs d’actes de vindicte populaire—sont souvent effrayés de les dénoncer. Un officier de police a expliqué que cette attitude était provoquée par la « peur d’être considéré comme un complice du malfaiteur. »[230]
« La police estimait que c’était justifié »
De nombreux policiers et autres représentants des autorités partagent le même point de vue implicite, et parfois explicite, selon lequel la justice populaire est un moyen acceptable de réagir à la criminalité. Les rapports de police sur la sécurité comprennent parfois des commentaires utilisant un langage neutre du genre : « Le voleur cherchait à s’échapper mais il a été attrapé et tué par la population. » Cette façon de s’exprimer semble indiquer que la police voit en la justice populaire une alternative plus ou moins acceptable aux arrestations effectuées par la police. Cette attitude a parfois été appuyée par des déclarations publiques prononcées en haut lieu, par exemple lorsque le porte-parole de la police Pierre Channel Ntarabaganyi a félicité la population de Ruyigi pour avoir tué deux présumés voleurs (voir plus haut, Étude de cas 2).
Un chef de poste de la commune de Mutaho, à Gitega, a exprimé ouvertement cette opinion devant les chercheurs de Human Rights Watch et de l’APRODH qui étaient en visite à Mutaho pour enquêter sur trois meurtres et un violent passage à tabac qui avaient eu lieu en l’espace de quatre mois, faisant de Mutaho l’une des pires communes en matière de justice populaire. Le 24 avril 2009, François Gahungu, surnommé « Layilayi », a été pris en train de voler des bananes. Il était armé d’une machette. Le chef de poste Édouard Nahimana a expliqué à Human Rights Watch et à l’APRODH que deux hommes l’avaient attrapé et « immobilisé » en lui assénant plusieurs coups ; ils ont ensuite appelé leurs voisins, lesquels sont arrivés et l’ont battu à mort. Bien que le passage à tabac se soit poursuivi bien après que Layilayi eut été immobilisé, Nahimana a qualifié le meurtre d’acte d’ « autodéfense ». Nahimana a interrogé des témoins qui ont avoué le meurtre mais il n’a pas estimé nécessaire de les arrêter. Il a expliqué : « Il n’y avait pas lieu d’ouvrir une enquête. C’est la population qui l’a fait. Les gens l’ont dit eux-mêmes, ‘Nous avons tué Layilayi’. Ils l’ont dit ouvertement. Ils ont dit qu’ils s’étaient défendus. L’affaire est clôturée. »[231]
La famille de Layilayi a appris sa mort le lendemain matin. Selon l’un de ses proches : « Nous nous sommes rendus à l’hôpital et avons constaté qu’il avait déjà été enterré. Nous avons demandé pourquoi les autorités l’avaient enterré sans en informer sa famille. Le chef de poste a déclaré qu’il avait été enterré comme ça parce que c’était un voleur. Nous avons demandé qu’il soit enterré dignement mais le chef de poste a refusé. Il nous a fait peur et nous a chassés. »[232] Des proches ont signalé que plusieurs hommes avaient été arrêtés en rapport avec le meurtre, mais qu’ils avaient versé des pots-de-vin et avaient été libérés le même jour ou le lendemain. Aucune enquête complémentaire n’a été ouverte et les proches n’ont trouvé aucun responsable intéressé à recevoir leur plainte. « Tous les dirigeants de Mutaho étaient unis contre nous », a déploré l’un d’eux.[233]
Le chef de poste de Mutaho a déclaré à Human Rights Watch et à l’APRODH que tout citoyen qui prenait quelqu’un en flagrant délit de vol la nuit avait raison de tuer cette personne, ajoutant : « Si quelqu’un venait chez moi la nuit pour voler, je le tuerais. »[234]Ce genre d’attitude s’insinue dans l’esprit de la population. Des habitants d’Itaba, où des membres d’un groupe ont tué un voleur présumé du nom de Nyandwi, semblaient estimer qu’il était parfaitement justifié de tuer les voleurs la nuit, mais peut-être pas pendant la journée :
Nous avons tabassé le type pour obtenir des informations sur le lieu où se trouvaient les autres bandits. Nous ne voulions pas le tuer. Nous voulions seulement les noms des bandits avec lesquels il était. Mais nous ne le regrettons pas. C’était un voleur et un tueur. Il méritait son sort. [...] Nous en avons trouvé un autre, [mais] nous ne l’avons pas passé à tabac parce que ... il faisait déjà jour. C’est interdit pour nous de punir les gens pendant la journée.[235]
En septembre 2008, dans le quartier de Cibitoke à Bujumbura, des habitants ont capturé un homme qui avait volé un téléphone portable et ils lui ont coupé le tendon d’Achille avec une machette, le laissant handicapé à vie. Un responsable local a expliqué à Human Rights Watch : « La police est arrivée et a emmené [la victime] à l’hôpital. Les gens qui l’avaient blessé ont dit aux policiers qu’ils avaient fait cela parce que c’était un voleur. Tout le monde savait qui l’avait fait. La police n’a arrêté personne parce qu’elle estimait que c’était justifié. »[236] Deux autres actes de vindicte populaire ont eu lieu dans la même rue en 2009, et aucun des deux n’a débouché sur une enquête ou des arrestations.
Le commissaire provincial de la police de Ruyigi avait l’impression que les enquêtes lacunaires menées dans la foulée du meurtre des voleurs présumés d’un vélo, Cayega et Ndireguheka, décrits plus haut dans l’Étude de cas 3, étaient le résultat d’une attitude analogue. Il a fait remarquer : « L’administration locale soutient et défend ce type de comportement en disant que ‘ces gens sont des voleurs qualifiés’ ... Elle a dit qu’elle ne pouvait pas intervenir quand la population a tué ces personnes. Elle a soutenu la population qui se faisait justice. »[237]
Un officier de police haut gradé de Ngozi a confié à Human Rights Watch que là aussi, certains responsables de l’administration acceptaient la justice populaire, y voyant une réaction raisonnable face au vol, et qu’ils ne prenaient pas de mesures pour la décourager.[238]
Un officier de l’armée de Muyinga a signalé à Human Rights Watch : « Ici les administrateurs sont fiers quand des bandits sont tués. Ils en parlent lors des réunions sur la sécurité que nous organisons tous les mercredis. »[239]
L’absence de plainte
Les familles de victimes—ou les victimes qui survivent à la vindicte populaire—se montrent souvent peu disposées à porter plainte auprès de la police ou des procureurs. Certaines ont le sentiment qu’à cause de l’activité criminelle de leurs proches (ou de la leur), elles n’ont pas droit à la justice. Les présumés malfaiteurs qui survivent à la vindicte populaire ont l’impression qu’ils compromettent leur propre dossier s’ils déposent une plainte contre ceux qui les ont maltraités.
La police est tenue par la loi de mener des enquêtes, qu’une plainte officielle ait été déposée ou non, mais elle se met souvent en défaut de le faire.[240] Cette négligence survient dans tous types d’affaires, pas seulement celles liées à la justice populaire. Mais parce que dans les cas de justice populaire, il est plus probable que les victimes et les familles ne portent pas plainte, cette lacune générale dans les procédures policières est davantage marquée et contribue à un taux particulièrement élevé d’impunité dans cette catégorie d’affaires.
Par exemple, à Kanyosha (Bujumbura Rural), un jeune homme surnommé « Bau »[241] a été tué la nuit du 26 juin 2009. L’homme qui possédait la propriété où le meurtre a eu lieu a été arrêté et a passé une semaine au cachot, mais il a été libéré au motif que les proches n’étaient pas venus déposer une plainte au poste de police. Le chef de poste de Kanyosha a déclaré à Human Rights Watch : « La famille de la victime n’est pas venue porter plainte. Nous ne pouvons pas mener d’enquête s’il n’y a pas plainte. »[242]
Des entretiens avec les proches des victimes illustrent la difficulté à porter plainte. Audifax Ndayizeye a été tué à Buterere (Bujumbura Mairie), en septembre 2009. Combattant FNL démobilisé, il était soupçonné des fréquents vols commis dans son quartier. Après qu’un voisin eut été tué au cours d’un vol à main armée le 17 septembre, les habitants ont allégué que Ndayizeye était responsable. Quatre voisins se sont rendus chez lui le lendemain, l’ont ligoté, battu à mort dans une clairière voisine et ont mis le feu à son cadavre.[243] La police et les autorités locales ont laissé le corps calciné exposé pendant un jour entier. Un frère de la victime qui vit de l’autre côté de la ville a expliqué que lorsqu’il était arrivé le lendemain pour établir ce qui s’était passé, « des chiens étaient déjà en train de manger le corps.[244]
L’épouse de Ndayizeye a signalé qu’après le meurtre, elle continuait à être harcelée et menacée par des voisins. Elle a expliqué : « Ils pensent que j’ai des choses que mon mari a volées. » Même si elle connaissait le nom des personnes qui avaient « arrêté » son mari, pris l’initiative du passage à tabac et acheté l’essence pour brûler son corps, elle avait peur de les dénoncer à la police. Alors que plusieurs policiers étaient arrivés pendant le passage à tabac, la police n’a ouvert aucune enquête indépendante.[245]
À Gisuru, en province de Ruyigi, la pression populaire, conjuguée à l’absence de plainte officielle, a été utilisée pour justifier l’inaction des autorités. En janvier 2009, Dominique Harutimana a été « arrêté » chez lui par un groupe de voisins, accusé d’avoir planifié des vols à main armée, et battu à mort. Un officier de police a déclaré : « Personne n’a porté plainte. Nous voulions saisir d’office mais dans le cadre de la bonne collaboration avec la population, l’administrateur [communal] ne nous a pas autorisés à le faire. [...] L’administration estimait que la population devait éliminer un danger dans la société. »[246]
Human Rights Watch et l’APRODH ont demandé au père de Harutimana s’il avait envisagé de déposer une plainte. Il a répondu : « La police n’a mené aucune enquête pour établir qui l’a tué et je n’ai pas vraiment essayé de suivre l’affaire parce que tout le monde ici disait que c’était un voleur. Je ne suis qu’un petit paysan ; je n’ai pas la force de résister à toute la communauté. [...] C’est la justice qui travaille ; je ne peux rien faire. »[247]
À Mutaho, en province de Gitega, Pierre Nsengiyumva, 20 ans, a été tué en juin 2009 après avoir apparemment tenté d’entrer par effraction dans une maison. La police n’a jamais pris la peine d’informer son épouse de sa mort ; elle l’a apprise par des voisins. Elle a confié à Human Rights Watch et à l’APRODH : « J’avais peur d’aller à la police. Les gens me disaient que si j’allais à la police, j’aurais encore plus de problèmes. À cause de ces menaces, j’ai eu peur de porter plainte. S’ils ne m’avaient pas effrayée, je serais allée voir ce qui était arrivé à mon mari. »[248] Le chef de poste Édouard Nduwimana, cité plus haut, a annoncé à Human Rights Watch et à l’APRODH qu’il savait qui avait tué Nsengiyumva mais qu’il n’avait pris aucune mesure contre eux.[249]
Parfois, des familles ont déposé une plainte au niveau communal, mais quand elles ont rencontré des difficultés à ce stade, au lieu de porter l’affaire devant des instances supérieures, elles ont renoncé à défendre leur cause. Emmanuel Ngenzebuhoro, un travailleur domestique de 19 ans, rendait visite à son père à Butaganzwa, dans la province de Ruyigi, lorsqu’il a été attrapé par une foule de gens qui le soupçonnaient d’avoir volé 60 kilos de haricots. Ngenzebuhoro a été battu à mort ; son corps a été jeté dans la rivière et n’a jamais été repêché.
Un soldat qui avait tenté d’arrêter le passage à tabac a fait une déposition à la police, débouchant sur cinq arrestations. Mais les suspects ont été libérés sans être inculpés trois jours plus tard. Le père de Ngenzebuhoro a déclaré à Human Rights Watch : « Je ne sais pas pourquoi ils ont été libérés ; ils ont probablement soudoyé la police. La police n’a pas expliqué pourquoi elle les avait libérés. »[250] Le soldat qui avait témoigné a été muté à un autre poste peu de temps après, et aucune autorité n’a pris la peine de le localiser. Le père de Ngenzebuhoro a dit avec amertume : « Mon neveu m’a suggéré de porter l’affaire à Ruyigi—mais j’ai peur que si je donne suite au dossier, ces gens viennent m’éliminer. »[251]
La « résolution à l’amiable »
Dans certains cas, les victimes qui ont survécu à des actes de vindicte populaire ne se présentent pas à la police pour dénoncer leurs agresseurs car elles passent un accord tacite ou explicite avec ceux contre qui elles ont commis l’infraction initiale. Ainsi, à Kanyosha (Bujumbura Rural), des habitants ont tranché la partie supérieure de l’oreille de M.X. après que ce dernier eut été pris en train de voler une chèvre. Alors que l’acte perpétré contre M.X. était beaucoup plus grave que le vol non armé qu’il avait commis, M.X., craignant d’être arrêté ou tué, a refusé de porter plainte, et la police n’a jamais ouvert d’enquête pour établir qui l’avait agressé. (Les auteurs de cet acte ont également tué le complice de M.X., Jean-Marie Nyandwi.[252]) En échange de son silence, M.X. n’a pas été accusé d’avoir volé la chèvre.[253]
À Gihosha (Bujumbura), un homme a été passé à tabac par une foule parce qu’il avait été pris en train de courir dans la rue à 3h du matin. Les coups portés étaient si violents que la victime a dû être hospitalisée. La police a arrêté cinq suspects, mais un officier de police judiciaire de Gihosha les a libérés après qu’ils eurent accepté de payer les factures d’hôpital de la victime.[254] Interrogé par Human Rights Watch à propos de cette décision, l’OPJ a reconnu qu’elle violait la loi.[255]
L’obligation d’enquêter
Aux termes du droit international, les autorités burundaises ont l’obligation d’ouvrir des enquêtes et d’engager des poursuites dans les cas d’infractions pénales, qu’elles le fassent par l’entremise de la police ou d’une autre agence de l’État.
Le fait que la police n’ouvre pas de dossier et ne mène pas d’enquête sur des infractions qui prive des personnes de leurs droits humains élémentaires viole les obligations qui incombent au Burundi au regard du Pacte international relatif aux droits civils et politiques (PIDCP).[256] Le Comité des droits de l’homme de l’ONU, qui contrôle le respect du PIDCP par les États qui en sont parties, a déclaré que les gouvernements devaient veiller à ce que les victimes disposent de « recours accessibles et utiles » pour faire valoir les droits découlant du traité.[257] Cette obligation s’applique même lorsque ces violations sont commises par des personnes privées.[258] Selon le Comité des droits de l’homme : « Le fait pour un État partie de ne pas mener d’enquête sur des violations présumées pourrait en soi donner lieu à une violation distincte du Pacte. La cessation d’une violation continue est un élément essentiel du droit à un recours utile. »[259]
Les Principes fondamentaux et directives concernant le droit à un recours et à réparation, adoptés par l’Assemblée générale de l’ONU en 2005, appellent les États à « enquêter de manière efficace, rapide, exhaustive et impartiale sur les violations et [à] prendre, le cas échéant, des mesures contre les personnes qui en seraient responsables [...] et [à] assurer à ceux qui affirment être victimes d’une violation des droits de l’homme [...] l’accès effectif à la justice, dans des conditions d’égalité, comme il est précisé [...], quelle que soit, en définitive, la partie responsable de la violation. »[260]En conséquence, le gouvernement est tenu d’enquêter et d’assurer un accès effectif à la justice pour les infractions concernant le droit à la vie, la protection contre la torture et les traitements inhumains, ainsi que la protection de la personne, de son domicile et de sa famille contre des atteintes injustes et un traitement discriminatoire.[261]
Le fait de ne pas mener d’enquête sur des infractions graves viole également la loi burundaise. La loi créant la Police Nationale du Burundi énonce les obligations de la police en matière d’enquête sur les infractions, d’arrestation des auteurs de ces infractions, et de protection des personnes et de leurs biens.[262] Le Code de procédure pénale exige que la police judiciaire ouvre des enquêtes sur les infractions, qu’une plainte ait été déposée ou non.[263]
VIII. La réaction du gouvernement burundais
Le phénomène de justice populaire a provoqué une réaction mitigée du gouvernement burundais. Bien que des responsables aient parfois condamné les lynchages, aucune réponse cohérente de l’État n’a été mise au point pour s’attaquer à ce qui constitue une cause majeure de meurtre au Burundi.
Le rôle que jouent les responsables de la police et de l’administration locale lorsqu’ils arrêtent ou tentent d’arrêter certains actes de justice populaire est souvent positif et ne devrait pas être passé sous silence. Human Rights Watch et l’APRODH ont recueilli de nombreux témoignages faisant état de cas où des agents de l´État avaient tenté de stopper des foules qui avaient l’intention d’infliger un châtiment, mettant de ce fait souvent sérieusement en péril leur propre sécurité. Claude Nahimana, un jeune homme qui a été sauvagement battu par une foule de chauffeurs de taxi-moto qui le soupçonnaient d’avoir volé une moto, a fait remarquer à Human Rights Watch : « Je n’en serais jamais sorti vivant si la police n’avait pas été là. »[264] À bien des endroits, entre autres à Bujumbura Rural, Muyinga et Ruyigi, des policiers et des responsables de l’administration ont eux-mêmes été la proie de violences en essayant d’arrêter des attaques visant des malfaiteurs présumés.[265]Des soldats de la FDN ont également essayé d’intervenir dans ce type d’agressions.[266]
À Itaba, dans la province de Gitega, un chef de colline a raconté à Human Rights Watch qu’il avait protégé deux voleurs présumés d’une foule qui avait tué un autre membre de leur bande. Il a expliqué :
La population avait des couteaux et des machettes. Ils ont poignardé un voleur et l’ont laissé pour mort. Un autre voleur est venu chercher refuge chez moi vers 3h du matin. Il a dit que les gens voulaient le tuer. Je l’ai laissé entrer. Une heure plus tard, la foule est arrivée devant chez moi [alors qu’elle était en route pour trouver] un autre voleur. Il était recherché par la foule. Ils sont allés chez lui. Ils voulaient le tuer.
J’ai dit que les gens n’avaient pas le droit de le tuer. Je l’ai emmené chez moi et j’ai dit : ‘Il faudra laisser l’administration traiter cette affaire.’ J’ai téléphoné à la police. À six heures du matin, elle est venue avec l’administrateur communal et a emmené les deux voleurs au cachot.[267]
Un policier de Ruyigi a décrit les difficultés non négligeables rencontrées par la police lorsqu’elle est confrontée à la vindicte populaire. Le 28 avril 2009, dans la commune de Nyabitsinda, Omer Cimpaye a été tué près d’un marché rempli de gens en colère après qu’il eut poignardé un de ses amis au cours de ce qui semble avoir été une dispute concernant une dette. Comme l’a expliqué le policier :
Nous avons essayé d’emmener l’auteur de cet acte au poste de police pour le protéger, mais la population a suivi et l’a frappé à coups de tiges de canne à sucre. Même nous, nous avons été frappés. Finalement, à hauteur du marché, il est mort. [...] Nous avons été pourchassés par tous les gens du marché quand on a essayé de sauver le criminel. Tout le monde voulait le tuer. Nous n’étions que deux policiers. La population était bien décidée à ce qu’il soit tué.
Les chefs de colline qui se trouvaient sur le marché ont essayé de nous aider, mais la population est parvenue à nous l’enlever. Les gens disaient : ‘Si nous laissons les policiers l’emmener, ils lui sauveront la vie.’ Il a été frappé à la tête et a commencé à perdre du sang. Ce sont des hommes jeunes et forts qui l’ont frappé et tué.
Nous ne pouvions arrêter personne. Il y avait une telle tension que nous avons presque dû utiliser nos armes. Après la mort de [Cimpaye], la population s’est dispersée. ... Nous étions débordés et craignions pour notre sécurité. Nous étions blessés nous-mêmes ; le chef de poste saignait. Nous nous battions contre une population qui nous en voulait parce qu’elle disait que nous voulions lui sauver la vie.
Nous n’avons pas pu identifier les gens qui ont fait ça, ni arrêter des proches de l’une des victimes qui, à notre avis, étaient peut-être impliqués. C’était difficile de cibler quelqu’un parce presque tout le marché était impliqué, et aussi parce que cela aurait créé des tensions.
À ce moment-là, il n’y avait que trois policiers pour toute la zone – maintenant il y en a huit. Ce n’est pas suffisant, même avec huit. La zone est vaste. Nous n’avons ni véhicule, ni radio. Même le poste de la commune n’a ni radio, ni voiture.[268]
Le récit du policier illustre d’une part les efforts positifs déployés par certains agents de l’État pour arrêter les lynchages et d’autre part, les défis auxquels ils sont confrontés, ainsi que les compromis qu’ils font pour éviter les « tensions ». Comme écrit précédemment, les membres de la famille de Cimpaye ont indiqué que les policiers savaient qui avait commis le meurtre et ils ont protesté contre le fait que la police n’avait pas mené d’enquête. Dans les cas analysés par Human Rights Watch et l’APRODH, les enquêtes ont été l’exception ; l’inaction la règle.
Réagissant après coup à des lynchages, certains responsables de la police ou de l’administration ont organisé des « sensibilisations », c’est-à-dire des réunions d’éducation du public visant à apprendre à la population locale qu’elle ne peut pas se livrer à ce type de comportement.[269]Leur efficacité semble varier. Une femme de Tangara a signalé à Human Rights Watch avec une apparente conviction qu’après une réunion de ce type : « Nous avons décidé que plus jamais la population ne rendra justice elle-même ici. »[270]Par contre, après que des voleurs présumés d’un vélo eurent été tués à Kinyinya, le gouverneur de Ruyigi a déclaré à Human Rights Watch : « La population a dit que justice avait été faite—que c’étaient des voleurs. J’ai essayé de les sensibiliser, mais [...] la population a dit qu’elle ne regrettait rien. »[271]
L’éducation du public peut constituer l’un des volets d’une stratégie multiaxiale d’approche de la justice populaire. Néanmoins, elle ne devrait pas consister uniquement en conférences dispensées à la population. L’organisation internationale non gouvernementale DanChurchAid a réalisé un travail de recherche en 2007 pour déterminer quelles approches pourraient déboucher sur le changement d’attitude nécessaire pour que le public soit convaincu de restituer les armes légères en sa possession. Les participants des groupes de consultation de l’ONG ont souligné que la communication interpersonnelle, éventuellement avec des volontaires formés choisis parmi les « dirigeants de groupes de religieux, de démobilisés, de jeunes ou de femmes », pourrait s’avérer efficace pour relayer un message en faveur du désarmement. La radio a été considérée comme un moyen important pour appuyer les messages diffusés par les dirigeants des communautés, tandis que le théâtre, les feuilletons radiophoniques et les projections de films suivies de débats ont également été jugées efficaces. Il est intéressant de constater que « les participants n’ont pas estimé que les affiches ou les brochures étaient d’une grande utilité pour promouvoir un changement de comportement. »[272]Ce travail de recherche devrait être pris en compte au moment de planifier une stratégie nationale visant à s’attaquer à la justice populaire.
Le Ministère de la Justice, avec l’assistance du BINUB et d’autres partenaires, a commencé à élaborer un nouveau Code de procédure pénale en 2006, après que l’ancien code, promulgué en 1999, se fut révélé en contradiction avec une constitution et une loi sur la police toutes deux révisées. Mais en février 2010, la réforme du code n’avait pas encore été finalisée. Le Chef de Cabinet Onésphore Baroreraho a annoncé que la révision serait probablement terminée, et le projet de code présenté au Conseil des Ministres et ensuite au Parlement, au cours des prochains mois. Entre-temps, selon Baroreraho, le Ministère de la Justice prévoit de diffuser, à partir de 2010 à une date non précisée, une série d’émissions radio visant à sensibiliser le public aux procédures pénales.
Même une campagne bien planifiée de sensibilisation du public est peu susceptible d’aboutir à un changement durable. Pour qu’elle soit efficace, au moins deux autres changements clés doivent être opérés. Premièrement, les auteurs d’actes de justice populaire ne doivent plus jouir d’une impunité pour leurs crimes, en particulier lorsqu’il s’agit d’agents de l’État. Deuxièmement, le gouvernement doit s’attaquer aux causes sous-jacentes de la justice populaire, notamment le grave manque de confiance en la police et en l’appareil judiciaire. Le gouvernement doit veiller à ce que la police assure une présence suffisante dans les zones enregistrant un taux de criminalité élevé et que la police et les procureurs mènent sans délai des enquêtes proactives sur les infractions commises. Il doit par ailleurs lancer de sérieuses investigations sur les accusations de corruption, améliorer la transparence en ce qui concerne l’utilisation des ressources, et garantir aux victimes et témoins un meilleur accès à la justice.
IX. Les acteurs internationaux et la société civile burundaise
Les parties prenantes internationales n’ont pas prêté grande attention au phénomène de justice populaire au Burundi. La seule exception notable est la section des droits de l’homme de la mission de l’ONU au Burundi, le BINUB. Les observateurs des droits humains du BINUB suivent les cas de justice populaire depuis 2004, recueillant systématiquement des données sur ce type d’incidents depuis 2008, et ils ont porté un certain nombre de cas à la connaissance de Human Rights Watch.
Tant le BINUB que les bailleurs de fonds bilatéraux procurent des financements importants à la police et au secteur de la justice—les deux secteurs dont les défaillances risquent le plus d’encourager l’application d’une justice populaire. Mais aucun bailleur de fonds bilatéral ne s’est concentré sur le problème de justice populaire en lui-même. Les donateurs et autres parties prenantes devraient reconnaître que la justice populaire est en soi un grave problème de droits humains, surtout lorsqu’il y a implication ou complicité de fonctionnaires de l’État. Ils devraient également reconnaître que la justice populaire est un indicateur par procuration du fait que les systèmes de police et de justice demeurent inaccessibles à la vaste majorité des Burundais, en particulier ceux qui résident dans des zones rurales pauvres et des quartiers urbains marginalisés. Percevoir la justice populaire sous cet angle pourrait aider les bailleurs de fonds à cibler leurs interventions et à évaluer les progrès opérés en matière de police et de justice au Burundi. Les donateurs et autres parties prenantes, en particulier ceux qui sont membres de « groupes sectoriels » sur la justice et la sécurité, devraient mettre au point une double réponse coordonnée au problème de justice populaire : premièrement, en encourageant l’adoption de mesures immédiates visant à mettre fin à l’impunité pour les actes de justice populaire ; et deuxièmement, en contribuant à des réformes structurelles qui s’attaqueront aux faiblesses sous-jacentes des secteurs de la police et de la justice.
Les bailleurs de fonds ont financé des campagnes de sensibilisation et de conscientisation sur divers sujets liés entre autres aux droits humains, à la violence basée sur le genre, au désarmement et à la participation politique. Une campagne analogue ayant pour but de décourager les actes de vindicte populaire—destinée aux administratifs à la base ainsi qu’aux responsables de la police et de la justice—constituerait une action opportune.
La police
Les Pays-Bas sont le principal bailleur de fonds de la Police Nationale du Burundi. En avril 2009, le gouvernement néerlandais a signé un accord de coopération de huit ans avec la police. Il prévoit des formations, du matériel d’entretien pour les radios, des infrastructures, ainsi que des moyens de transport, y compris des véhicules pour les commissariats de police provinciaux et des vélos pour les postes de police communaux (moyen de transport qui peut s’avérer utile au Burundi, compte tenu du manque de routes accessibles aux véhicules à moteur et du prix élevé de l’essence, en supposant que les policiers, en particulier les officiers de police judiciaire qui enquêtent sur les infractions, soient disposés à les utiliser). L’accord comprend également un soutien à l’Inspection du Ministère de la Sécurité Publique, y compris la fourniture de son matériel de transport et de communication. Il prévoit par ailleurs certaines conditions d’attribution liées au respect des droits humains : le versement ininterrompu de fonds est subordonné à un contrôle et à une évaluation par des experts indépendants, ainsi qu’à un dialogue permanent entre les Pays-Bas et le Burundi sur des sujets incluant la neutralité politique de la police, le professionnalisme, l’obligation de rendre des comptes aux autorités civiles et le respect des droits humains. Bien que l’attention accordée aux droits humains soit louable, ce dialogue devrait également porter sur les mesures prises par la police pour s’attaquer à l’absence généralisée de protection offerte à la population.
La Belgique et la France offrent aussi des formations destinées à la police. La Belgique dispense pour l’instant une série de modules de formation d’une semaine auxquels tous les agents de police participent. Les modules réalisés à ce jour concernaient les droits humains, le contrôle des foules et l’usage de la force, et un module sur la sécurité en période électorale est actuellement organisé conjointement avec les Pays-Bas. La Belgique organise également pour l’instant un cours de formation intensive de six mois à l’intention des officiers de police judiciaire, qui porte notamment sur les techniques d’enquête, et la France aussi offre une formation au corps des officiers.
Les Pays-Bas ont financé un conseiller de la police qui travaille au sein de la police nationale, et les Belges ont fourni une assistance technique, par exemple, sous la forme de l’audit de police 2008. La section du BINUB sur la réforme du secteur de la sécurité fournit également plusieurs conseillers à la police. Le gouvernement égyptien a invité des policiers à se rendre au Caire pour une formation, et le gouvernement suisse a financé une organisation belge, RCN-Justice et Démocratie, pour organiser une formation sur les techniques d’enquête à l’intention des officiers de police judiciaire.
Par le truchement du Fonds de consolidation de la paix, l’ONU a fourni à la police 6,9 millions de dollars. Ces fonds ont été utilisés pour des véhicules, des uniformes, du matériel de communication, des documents sur l’éthique au sein de la police, des formations tant sur les droits humains que sur les aspects logistiques, ainsi que pour un recensement de la police, réalisé conjointement avec le Centre international pour la justice transitionnelle. La création d’un numéro de téléphone d’urgence (« ligne verte ») est envisagé par le projet mais n’a pas encore vu le jour.
Le secteur judiciaire
Le secteur judiciaire reçoit des financements importants du Ministère britannique du développement international (Department for International Development, ou DFID), du gouvernement belge et du BINUB. Les bailleurs de fonds ont financé la formation de magistrats, la construction de tribunaux et la fourniture de véhicules au secteur judiciaire. La Coopération technique belge a fourni du personnel chargé de travailler en qualité de conseillers techniques au sein du Ministère de la Justice. Le BINUB a financé un projet visant à réduire la surpopulation carcérale, à financer des équipes de juristes et de militants des droits humains qui travaillent dans les prisons pour identifier les cas où les détenus ont droit à une mise en liberté conditionnelle. Le Fonds de consolidation de la paix a contribué à la mise en place d’un Tribunal Anti-corruption et d’un Parquet Anti-corruption.
Au cours d’entretiens avec Human Rights Watch, plusieurs représentants d’organisations donatrices ont fait remarquer que le Ministère de la justice mettait du temps à autoriser la mise en œuvre des initiatives financées par les bailleurs de fonds. Ainsi, les bailleurs étaient disposés à financer une série de formations pour les magistrats. Cependant, le Ministère de la Justice ne voulait pas accepter les formations si les bailleurs de fonds ne versaient pas aux participants un per diem qui excédait largement leur salaire habituel. Au moment où sont écrites ces lignes, ce problème n’est toujours pas résolu.[273]
Les lacunes dans le soutien des bailleurs de fonds
Le financement de la police et du secteur judiciaire par les bailleurs de fonds n’a toutefois pas fortement contribué à pallier les déficiences de ces institutions qui encouragent les actes de justice populaire. Comme indiqué précédemment, peu de policiers ou de magistrats ont été poursuivis pour corruption. Les policiers soupçonnés d’accepter des pots-de-vin sont beaucoup plus souvent mutés dans une autre juridiction. Les bailleurs de fonds du secteur judiciaire sont conscients du niveau élevé de corruption mais ils n’ont pas identifié les mesures qui leur permettraient d’user de leur influence pour exercer un contrôle plus étroit.
Les bailleurs de fonds ne participent que dans une moindre mesure à l’appui ou à la formation des administrateurs locaux, notamment ceux qui sont les plus susceptibles d’être impliqués en tant qu’auteurs dans des actes de justice populaire, tels que les nyumbakumis et les chefs de colline.
La société civile burundaise, les médias et les ONG internationales
Peu d’ONG internationales œuvrant dans le secteur judiciaire au Burundi se sont directement penchées sur le problème de la justice populaire, mais un certain nombre d’ONG travaillent effectivement dans le secteur de la justice, ce qui pourrait contribuer à réduire les cas de justice populaire et l’impunité. Avocats Sans Frontières, une association belge qui fournit une assistance juridique aux victimes de torture, entre autres, s’est occupée de plusieurs affaires de justice populaire dans lesquelles des agents de l’État étaient impliqués. RCN-Justice et Démocratie s’emploie à former la police aussi bien que le public au sujet du droit pénal et des procédures pénales. Deux autres ONG, Global Rights et ACCORD, offrent des consultations juridiques aux habitants des zones rurales.
Les organisations burundaises de défense des droits humains, dont l’APRODH et la Ligue Iteka, ont vivement condamné la justice populaire, et tous les principaux médias écrits et stations de radio burundais, y compris la radio nationale, ont régulièrement diffusé des reportages sur ce type de meurtres. Bien que la plupart des reportages soient critiques à l’égard de la justice populaire, ces informations ne se sont pas toujours avérées utiles. L’Agence Burundaise de Presse, relatant un meurtre par lynchage, a indiqué qu’après qu’un jeune homme qui se droguait eut tué deux voisins : « Les voisins en colère n’avaient pas d’autres choix pour sauver la situation si ce n’est de lyncher le meurtrier. Ils l’ont [im]mobilisé, ligoté et matraqué jusqu’à ce qu’il rende l’âme ».[274] Toutefois en règle générale, les informations diffusées par les médias ont commencé à contribuer à mettre davantage en évidence à l’échelle nationale le problème de la justice populaire. Si les journalistes et les rédacteurs en chef veillent à ce que dans tous les cas, leurs informations promeuvent l’État de droit et condamnent la justice populaire—tout en encourageant un débat sain sur ses causes et possibles solutions—ils pourraient être en mesure de jouer un rôle important en réduisant la fréquence de la justice populaire et en se dressant contre l’impunité et la complicité des agents de l’État qui la perpétuent.
Annexe : Cas de « justice » populaire ayant entraîné la mort, 2009[275]
|
Location |
Date |
Victime |
Infraction qu’aurait commise la victime |
Rôle des agents de l’État |
Suivi policier / judiciaire[276] |
Province de Bubanza | ||||||
1 |
Mpanda |
21 juillet |
Nestor Yamuremye |
Vol |
Le chef de colline aurait été présent et n’aurait rien fait pour empêcher le meurtre. |
8 arrestations, dont le chef de secteur et le chef de colline ; le chef de secteur a été libéré mais 7 suspects restent en détention préventive. |
Province de Bujumbura Mairie | ||||||
2-3 |
Buterere |
6 mai |
Eric et Donat |
Tentative de cambriolage |
La police a tenté en vain d’empêcher les lynchages. |
Enquête mais pas d’arrestations |
4 |
Buterere |
17 septembre |
Audifax Ndayizeye |
Vol et assassinat |
La police était présente mais n’est pas intervenue, et a laissé le corps être dévoré par des chiens. |
Pas d’enquête ni d’arrestations |
5 |
Cibitoke |
10 février |
Homme, nom inconnu |
Vol de moto ; meurtre (a lancé une grenade dans la foule qui le poursuivait et a tué un passant) |
|
Pas d’enquête ni d’arrestations |
6 |
Cibitoke |
11 juin |
Jeune homme, nom inconnu |
Vol à main armée |
|
Pas d’enquête ni d’arrestations |
7 |
Cibitoke |
18 septembre |
« King Kong » |
Vol d’appareils ménagers ; membre d’un groupe armé |
|
Pas d’enquête ni d’arrestations |
8 |
Cibitoke |
21 décembre |
Eric Niyonzima |
Vol d’un téléviseur et d’autres appareils ménagers |
|
Aucune arrestation |
9-10 |
Kanyosha |
11 juillet |
Boniface et Hakizimana |
Se promener dans un quartier avec des AK-47 dans un sac |
|
Aucune arrestation |
Province de Bujumbura Rural | ||||||
11 |
Isale |
26 février |
Jacques Nkeshimana |
Vol d’un moto |
|
Pas d’enquête ni d’arrestations |
12 |
Kanyosha |
25 avril |
Jean Marie Nyandwi |
Vol d’une chèvre |
|
Des complices présumés, également passés à tabac, ont fourni à la police l’identité des auteurs, mais la police n’a pas ouvert d’enquête et n’a procédé à aucune arrestation. |
13 |
Kanyosha |
4 juin |
Nestor Nduwayezu |
Tentative d’assassinat sur un membre important des FNL |
|
Aucune arrestation |
14 |
Kanyosha |
25 juin |
Herve Ntahonkuriye, alias “Bau”[277] |
Tentative de cambriolage |
|
La police a arrêté un suspect mais l’a libéré parce que « personne n’a porté plainte.» |
15 |
Mubimbi |
11 juillet |
Salvator Bitwi |
Soupçonné d’avoir « préparé un vol à main armée » ; aurait commis des vols à main armée et des viols antérieurement |
|
La police a arrêté six suspects mais les a libérés à cause de la pression populaire et d’éventuels pots-de-vin. Le commissaire de police qui a ordonné la libération des suspects a par la suite été rétrogradé. L’affaire a été transmise à la procureure, qui a cité à comparaître les mêmes suspects, mais ils ne se sont pas présentés dans son bureau. La procureure a signalé qu’elle ne pouvait pas aller les arrêter car elle n’avait pas d’essence. |
16-18 |
Muhuta |
22 novembre |
3 personnes |
Assassinat |
|
Suspects arrêtés ; suivi inconnu |
Province de Bururi | ||||||
19 |
Rumonge |
6 mai |
Jean Ndikumana |
Empoisonnement d’un enfant (probablement une accusation de « sorcellerie » |
|
La police a arrêté 9 suspects, actuellement en détention préventive. |
20 |
Rumonge |
29 août |
Homme, nom inconnu |
Vol d’appareils ménagers |
Un chef de secteur est passé près de la victime mourante et n’a rien fait pour lui sauver la vie. |
Le chef de secteur a été interrogé mais pas arrêté ; la police dit que d’autres auteurs présumés se sont enfuis et que l’enquête se poursuit. |
Province de Cibitoke | ||||||
21 |
Buganda |
22 janvier |
Ismaïl Mvuyekure |
Tentative de vol à main armée avec une bande de cinq voleurs |
|
Aucune arrestation |
22 |
Mabayi |
10 juillet |
Homme, nom inconnu |
Vol de farine de manioc |
|
Aucune arrestation |
23 |
Murwi |
1er août |
Jean Claude Ntaconayigize alias « Rukara » |
Viol |
|
Aucune arrestation |
Province de Gitega | ||||||
24 |
Buraza |
21 juillet |
Cyprien Habonimana |
Vol d’argent et d’appareils ménagers |
Un membre du conseil de colline aurait participé au lynchage. |
Enquête en cours ; trois personnes arrêtées (membre du conseil de colline non inclus) mais libérées. |
25 |
Giheta |
10 septembre |
Jean Bukuru |
Participation à une bande armée (la victime, un Mutwa, a été soupçonnée à tort de faire partie d’une bande armée dirigée par Cédric Mazoya) |
|
Trois suspects arrêtés et en détention préventive |
26 |
Itaba |
27 janvier |
Nyandwi |
Vol d’argent, de bière, de haricots et de poules |
Le chef de colline a protégé deux complices, empêchant qu’ils soient tués. |
Pas d’enquête ni d’arrestations |
27 |
Mutaho |
24 avril |
François Gahungu, alias « Layilayi » |
Vol de bananes |
Le chef de colline a essayé en vain d’empêcher le lynchage; le chef de poste a refusé que des funérailles dignes aient lieu. |
La police a arrêté trois suspects mais les a libérés 1 ou 2 jours plus tard, après qu’ils eurent apparemment versé un pot-de-vin. |
28 |
Mutaho |
10 mai |
Homme, nom inconnu |
Vol de manioc dans un champ |
|
Pas d’enquête ni d’arrestations |
29 |
Mutaho |
12 juin |
Pierre Nsengiyumva |
Tentative de cambriolage |
|
Pas d’enquête ni d’arrestations |
30-31 |
Ryansoro |
Inconnue |
Nyandwi et son fils |
Participation à une bande armée (les victimes étaient soupçonnées d’appartenir à un groupe armé dirigé par Cédric Mazoya) |
|
La police a arrêté plusieurs suspects ; actuellement en attente d’un procès. |
Province de Karusi | ||||||
32 |
Gihogazi |
17 janvier |
Bukuru |
Dette |
|
La police a arrêté un suspect mais l’a libéré quelques jours plus tard ; pas d’enquête complémentaire. |
Province de Kirundo | ||||||
33 |
Busoni |
14 août |
Miburo |
Vol de bananes |
|
La police a arrêté trois suspects, actuellement en détention préventive. |
34 |
Vumbi |
22 novembre |
Jeune homme |
Incendie criminel |
|
Pas d’enquête ni d’arrestations |
Province de Makamba | ||||||
35 |
Makamba |
12 février |
Ndikunkiko |
Vol de bananes |
|
Aucune arrestation |
Province de Muramvya | ||||||
36-37 |
Bukeye |
1er avril |
Niyokindi et Ndimurwanko |
Participation à une bande armée |
|
Aucune arrestation |
38 |
Kiganda |
29 juillet |
Homme, nom inconnu |
Participation à une bande armée |
|
Aucune arrestation |
Province de Muyinga | ||||||
39 |
Buhinyuza |
14 juin |
Nzeyimana |
Soupçonné de vol parce qu’il a traversé pendant la nuit une colline où personne ne le connaissait |
Le chef de colline aurait mené la foule qui a ligoté et battu à mort la victime. |
La police a arrêté cinq suspects mais les a libérés ; selon le parquet, l’enquête se poursuit. Le chef de colline a fui la région. |
40 |
Gashoho |
26 juillet |
Melchior Ntirandekura |
Vol à main armée et viol |
|
Aucune arrestation |
41 |
Gashoho |
1er août |
Simon Ruberankiko |
Vol de bananes |
|
Aucune arrestation |
42 |
Gasorwe |
16 septembre |
Tabu Bigirindavyi |
Banditisme |
|
La police a arrêté 4 suspects ; 2 ont été libérés et 2 sont toujours en prison. Le dossier est toujours ouvert au parquet. |
43-44 |
Gasorwe |
1er octobre |
Mbasha et un homme inconnu |
Vol à main armée |
|
La police a arrêté 4 suspects mais tous ont été libérés. |
45 |
Giteranyi |
15 juin |
Homme, nom inconnu |
Vol à main armée |
|
Aucune arrestation |
46 |
Giteranyi |
Aux alentours du 21 juin |
Nzeyimana |
Jet de grenades lors d’une cérémonie de mariage |
Des responsables locaux ont tenté d’intervenir pour empêcher le lynchage. |
Pas d’enquête ni d’arrestations |
Province de Ngozi | ||||||
47 |
Gashikanwa |
17 septembre |
Homme, nom inconnu |
A tendu une embuscade à un cycliste |
|
Pas d’enquête ni d’arrestations |
48 |
Kiremba |
16 août |
Léonard Ngendakumana |
Vol de bananes |
|
Pas d’enquête ni d’arrestations |
49 |
Marangara |
12 août |
Gervais Nzeyimana |
Vol, meurtre |
|
Pas d’enquête ni d’arrestations |
50 |
Ngozi |
17 mai |
Mamert Hakizimana |
Participation à une bande armée |
|
Pas connu |
51 |
Ngozi |
18 septembre |
Homme, nom inconnu |
Vol à main armée |
|
Aucune arrestation |
52-54 |
Nyamurenza |
23 février |
Gervais Nzitunga et deux autres hommes |
Vol à main armée, meurtre |
La police a organisé de 50 à 100 habitants pour attraper les voleurs, sur la base d’un renseignement donné par un indicateur. |
Aucune arrestation, malgré la présence de policiers au moment du meurtre |
55 |
Nyamurenza |
2 décembre |
Marthe Nyabenda |
Vol de maïs dans un champ |
|
Un suspect arrêté ; suivi non connu |
56 |
Ruhororo |
24 septembre |
Dieudonné |
Banditisme |
Chef de secteur soupçonné au départ de complicité, mais libéré par la suite. |
Deux personnes, dont le chef de secteur, ont été arrêtées mais libérées ensuite par la police. Le parquet a repris l’enquête et indiqué que plusieurs suspects ont fui, mais l’enquête se poursuit. |
57 |
Tangara |
Février |
Daniel Harindintwari |
Vol d’une bicyclette |
|
Pas d’enquête ni d’arrestations. En août 2009, Human Rights Watch et l’APRODH ont signalé à la police que les habitants de la localité pouvaient citer le nom des auteurs, mais la police n’a pris aucune mesure pour y donner suite. En février 2010, la police a déclaré à Human Rights Watch qu’elle ne pouvait rien faire d’autre car il s’agissait d’une « vieille affaire. » |
Province de Rutana | ||||||
58 |
Bukemba |
10 septembre |
Paul Ndayiragije |
Vol de 11 chèvres |
|
Pas connu |
Province de Ruyigi | ||||||
59 |
Butaganzwa |
4 juin |
Juvenal Karorero |
Adultère |
|
La police a arrêté six suspects, mais tous ont été libérés par le procureur. |
60 |
Butaganzwa |
15 juin |
Emmanuel Ngenzebuhoro |
Vol de haricots |
|
La police a arrêté six suspects, mais tous ont été libérés après qu’un soldat qui les avait identifiés eut été muté à un autre poste. |
61 |
Bweru |
21 juillet |
Mucanda |
Vol d’une bicyclette |
|
Quatre suspects ont été arrêtés et remis en liberté sous caution par le parquet ; l’affaire est toujours en cours. |
62 |
Gisuru |
20 janvier |
Dominique Harutimana |
Planification d’un vol à main armée |
|
Pas d’enquête ni d’arrestations, alors que ce sont les personnes qui avaient passé à tabac Harutimana qui l’ont emmené au poste de police et qu’elles étaient connues de la police. |
63 |
Gisuru |
Février |
Athanase Ciza |
Vol ou assassinat |
|
Deux suspects ont été arrêtés mais libérés par la suite à cause d’une manipulation des éléments du dossier par la police. Le parquet a ré-arrêté un suspect ; l’affaire est toujours en cours. |
64 |
Gisuru |
20 juin |
Pascal Gasindi |
Vol d’appareils ménagers |
Le chef de colline et un nyumbakumi auraient participé au passage à tabac |
La police a arrêté les deux suspects mais elle les aurait libérés en dépit de leurs aveux. |
65-66 |
Gisuru |
6 septembre |
Oscar Barasokoroza et Antoine Nzeyimana |
Vol d’argent |
La police et les responsables de l’administration ont choisi d’utiliser un véhicule de la commune pour poursuivre d’autres suspects plutôt que d’évacuer les victimes blessées par la foule, les laissant mourir. |
Pas d’enquête ni d’arrestations. Le porte-parole de la police a remercié la population pour avoir tué les suspects. Un magistrat aurait confié les mandats d’arrêt à une victime pour qu’elle les remette elle-même aux suspects. |
67 |
Gisuru |
17 novembre |
Emmanuel Ndikumana |
Vol d’argent, assassinat |
Les policiers ont tenté d’intervenir pour le protéger mais ont été frappés par des gens qui se trouvaient dans la foule. |
Aucune arrestation |
68 |
Gisuru |
20 novembre |
Daniel Ngenzirambona (soupçonné d’être le complice de Ndikumana, plus haut) |
Vol d’argent, assassinat |
|
Aucune arrestation |
69-70 |
Kinyinya |
13 mai |
Jean-Marie Ndireguheka et Cayega |
Vol d’une bicyclette |
Le chef de colline a autorisé une bande de jeunes à pourchasser les voleurs. Les responsables locaux ont tenté au départ d’étouffer l’affaire. |
Un suspect est en détention préventive ; d’autres suspects ont été libérés par la police, après avoir apparemment versé des pots-de-vin. |
71 |
Nyabitsinda |
11 février |
Gérard Misago |
Assassinat |
La police était présente ; rôle peu clair |
Pas d’enquête ni d’arrestations |
72 |
Nyabitsinda |
28 avril |
Omer Cimpaye |
Assassinat |
La police a tenté d’intervenir pour empêcher le lynchage. |
Pas d’enquête ni d’arrestations, bien que la police ait été présente et, selon la famille de la victime, ait pu identifier les auteurs. |
73 |
Nyabitsinda |
10 août |
Jean Bunuku |
Incendie criminel |
|
La police a arrêté sept suspects, qui sont toujours en détention préventive. |
74 |
Ruyigi |
25 août |
Gratien Masabarakiza |
Vol de pommes de terre |
Un membre du conseil de colline aurait participé au meurtre. |
La police a arrêté trois suspects, qui ont été remis en liberté provisoire ; l’affaire est toujours en cours. |
75 |
Ruyigi |
8 septembre |
Berchmas Ndikumana |
Cambriolage |
|
Un suspect arrêté et en détention préventive |
Remerciements
Le présent rapport a été rédigé par Neela Ghoshal, chercheuse sur le Burundi à Human Rights Watch. Il est le résultat des travaux de recherche effectués sur le terrain par Neela Ghoshal et les observateurs des droits humains de l’APRODH basés dans les provinces du Burundi. Lionel Nubwacu a apporté son concours sur le plan des recherches et de la logistique, et a traduit les interviews à partir du kirundi. Acquiline Nsabimana a fourni une assistance complémentaire pour les travaux de recherche.
Ce rapport a été revu par Rona Peligal, directrice adjointe à la Division Afrique de Human Rights Watch. Il a été révisé par James Ross, directeur du Bureau juridique et politique, et Andrew Mawson, directeur adjoint au Bureau du programme de Human Rights Watch. À l’APRODH, il a été révisé par Félix Haburiyakira.
Rachel Nicholson, assistante à la Division Afrique, Anna Lopriore, responsable création et éditrice photo, Grace Choi, directrice des publications et Fitzroy Hepkins, responsable du courrier, ont apporté leur concours à la production du rapport. Françoise Denayer a traduit le présent rapport en français. La relecture de la traduction française a été assurée par Peter Huvos, éditeur du site Web en français.
La photographe indépendante Martina Bacigalupo a pris toutes les photographies apparaissant dans le présent rapport.
Human Rights Watch et l’APRODH tiennent à remercier les nombreuses victimes et proches de victimes qui ont partagé leurs histoires avec nous. Nous voudrions également remercier les habitants qui ont accepté de discuter ouvertement de leur attitude par rapport à la justice populaire, ainsi que les dizaines de responsables de la police, de l’administration et de la justice qui ont parlé avec nous sans détour des défis auxquels ils sont confrontés dans l’exercice de leur mission. Nous remercions les innombrables agents de l’administration qui ont coopéré avec nous, ainsi que la Police Nationale du Burundi qui a facilité nos recherches sur le terrain.
Human Rights Watch voudrait exprimer toute sa gratitude à ICCO pour leur financement de nos travaux au Burundi.
[1] Au Burundi, la colline est la plus petite unité administrative, comptant environ 10 000 habitants.
[2] Le terme « justice populaire » est utilisé au Burundi pour désigner les violences exercées par une foule sur un criminel ou supposé tel. Les termes « lynchage » et « vindicte populaire » sont également utilisés pour qualifier ces mêmes actes.
[3] Bert Ingalaere, « Living Together Again: The Expectation of Transitional Justice in Burundi—A View from Below », document de travail de l’Institut de politique et de gestion du développement, Université d’Anvers juin 2009 ; présentation de Bert Ingelaere, chercheur à l’Université d’Anvers, Bujumbura, 16 décembre 2009, à laquelle a assisté une chercheuse de Human Rights Watch.
[4] Assumpta Naniwe-Kaburahe, « The institution of bashingantahe in Burundi », dans Luc Huyse et Mark Salter, eds. Traditional Justice and Reconciliation after Armed Conflict: Learning from African Experiences (Suède : International IDEA), 2008, pp. 160 et 170. La loi qui reconnaît les bashingantahe est la Loi no. 1/004 du 14 janvier 1987 relative à l’organisation des compétences judiciaires.
[5] Loi No. 1/020 du 31 décembre 2004 portant création, organisation, missions, composition, et fonctionnement de la Police Nationale, art. 27.
[6]Ibid., arts. 19-26.
[7] Entretien de Human Rights Watch avec BS, habitant de Buraza, province de Gitega, 26 août 2009.
[8] Entretien de Human Rights Watch avec BH, habitant de Buraza, province de Gitega, 26 août 2009. À maintes reprises, les chercheurs de Human Rights Watch et de l’APRODH ont demandé aux habitants d’estimer le nombre de personnes présentes ou ayant participé à une attaque donnée contre des présumés malfaiteurs. Compte tenu des difficultés rencontrées par un observateur non formé pour estimer la taille d’une foule, du niveau d’instruction peu élevé de la plupart des Burundais et du fait que la plupart des lynchages ont lieu la nuit, les chercheurs reconnaissent que ces estimations ne doivent pas nécessairement être prises au pied de la lettre. Elles permettent toutefois de se faire une idée générale de la taille d’une foule, c’est-à-dire de savoir si elle comptait probablement une poignée de personnes, ou des dizaines, des centaines, voire des milliers d’attaquants.
[9] Entretien de Human Rights Watch avec l’époux de Léocadie Irankunda, Buraza, province de Gitega, 8 décembre 2009.
[10] Entretiens de Human Rights Watch avec Léocadie Irankunda, Bukirasazi, province de Gitega, 26 août 2009, et Buraza, province de Gitega, 8 décembre 2009.
[11] Entretien de Human Rights Watch avec un fonctionnaire de Buraza (anonymat préservé), Buraza, province de Gitega, 26 août 2009.
[12] Entretien de Human Rights Watch avec le magistrat Terence Nahabakomeye, Gitega, 26 août 2009.
[13] Entretiens de Human Rights Watch avec Léocadie Irankunda et son époux, Buraza, province de Gitega, 8 décembre 2009.
[14]Ibid.
[15] Entretien de Human Rights Watch avec le commissaire provincial de la police Eustache Ntagahoraho, Gitega, 26 août 2009.
[16] Entretiens de Human Rights Watch avec Léocadie Irankunda et son époux, Buraza, province de Gitega, 8 décembre 2009.
[17] Centre d’Alerte et de Prévention des Conflits (CENAP), Défis à la paix durable : Autoportrait du Burundi (Bujumbura : CENAP 2008), http://www.interpeace.org/images/pdf/burundi_country_note_26_nov_%202008.pdf (consulté le 25 février 2010), p. 28.
[18] DanChurchAid et le Conseil National des Églises du Burundi, « Rapid Assessment of the Impact and Perceptions of Small Arms in the Burundi interior », 2007, http://www.smallarmssurvey.org/files/portal/spotlight/country/afr_pdf/africa-burundi-2007-1-Forbes-DCA-SALW.pdf (consulté le 25 février 2010), pp. 8, 14.
[19] CENAP, Centre international pour la justice transitionnelle et Police Nationale du Burundi, « Les relations entre la Police et la Société Civile au Burundi : Rapport de l’atelier du 16 au 17 février 2009 à Bujumbura », 2009.
[20] Entretiens de Human Rights Watch avec un officier de police, Bujumbura, 3 juin 2009, et avec un responsable du BINUB, Bujumbura, 20 décembre 2009.
[21] Le Burundi est classé 168e sur 180 pays évalués par Transparency International en 2008. Transparency International, « Corruption Perceptions Index 2009 », http://www.transparency.org/policy_research/surveys_indices/cpi/2009/cpi_2009_table (consulté le 21 novembre 2009). La grille évalue la perception que le public a de l’importance de la corruption et elle classe les pays de 1 (perçu par ses citoyens comme étant le moins corrompu) à 180 (perçu par ses citoyens comme étant le plus corrompu).
[22] Entretien de Human Rights Watch avec le président de l’OLUCOME Gabriel Rufyiri, Bujumbura, 3 septembre 2009.
[23] Voir CENAP, Défis à la paix durable, pp. 28-35. Cette croyance n’est pas l’apanage des Burundais des zones rurales : une étude de 2008 financée par la Banque mondiale a révélé que seuls 3 pour cent des fonctionnaires estiment que le système judiciaire est « pleinement satisfaisant ». Ceci est dû en partie à la corruption : 13 pour cent des personnes interrogées par la Banque mondiale ont admis avoir, au moins à une occasion, payé des pots-au-vin à un juge ou un greffier. CENAP, Défis à la paix durable, pp. 30, 34 ; Ministère à la Présidence chargé de la Bonne Gouvernance, de la Privatisation, de l’Inspection Générale de l’État et de l’Administration Locale, « Étude diagnostique sur la gouvernance et la corruption au Burundi : Rapport d’enquête », Bujumbura, mai 2008.
[24] Entretiens de Human Rights Watch avec l’administrateur communal François-Xavier Nduwamungu, commune de Nyamurenza, province de Ngozi, 24 juillet 2009, et avec Jean Bosco Makera, conseiller principal du gouverneur, et Donatien Ntiyankundiye, commissaire provincial de la PNB, Ngozi, 3 août 2009.
[25] Dans les communes d’Isale, de Mubimbi et de Kanyosha, toutes trois situées à Bujumbura Rural, des habitants et des responsables ont fait allusion à la justice rendue par les FNL comme étant un facteur lié aux actes de justice populaire qui se produisent aujourd’hui. Entretien de Human Rights Watch avec l’administrateur communal par intérim Hyacinthe Kuwahuraho, commune d’Isale, province de Bujumbura Rural, 19 août 2009. Selon un responsable de Mubimbi, un groupe d’hommes, comprenant plusieurs ex-combattants des FNL, semble s’être investi de la responsabilité de rendre la justice dans au moins une colline ; il les a décrits comme ayant instauré une « administration parallèle ». En juillet 2009, ils ont tué un voleur présumé, Salvator Bitwi, dans un incident décrit plus loin. Des parties de la commune d’Itaba (province de Gitega) suivent également ce modèle ; entretien de Human Rights Watch avec l’administrateur communal Évariste Nzeyimana, commune d’Itaba, province de Gitega, 26 août 2009.
[26] Entretien de Human Rights Watch avec un habitant anonyme de la colline Bikwa, Kanyosha, Bujumbura Rural, 20 août 2009.
[27] Entretien de Human Rights Watch avec B.A., Kanyosha, Bujumbura Rural, 20 juillet 2009.
[28] Voir Human Rights Watch, Ils me tabassaient tous les matins : Exactions de la police au Burundi, avril 2008, http://www.hrw.org/fr/reports/2008/04/29/ils-me-tabassaient-tous-les-matins-0.
[29] Peter Uvin, Life after Violence: A People’s Story of Burundi (Londres : Zed Books, 2009), pp. 46-47.
[30] « La PNB ne connaîtra aucun problème d’effectifs à court ou à moyen terme. La répartition de cet effectif, toutefois, ne répond pas toujours à des critères objectifs ni ne contribue à la mise en œuvre d’une police de proximité. » Ministère de la Sécurité Publique, « Audit de la Police Nationale du Burundi, Octobre-novembre 2008 », résultats d’un audit réalisé par une équipe de la Police fédérale belge, publiés le 23 janvier 2009, p. 11. Voir également p. 20.
[31] Ministère de la Sécurité Publique, « Audit de la Police Nationale du Burundi, Octobre-novembre 2008 », p. 20.
[32] Entretien de Human Rights Watch avec Fabien Ndayishimiye, directeur général de la Police Nationale du Burundi, Bujumbura, 22 décembre 2009.
[33] Entretien de Human Rights Watch avec un représentant d’une agence d’aide bilatérale, Bujumbura, 12 décembre 2009.
[34] Entretien de Human Rights Watch/APRODH avec le Chef de la police de Nyamurenza Paul Aaron Nahishakiye, commune de Nyamurenza, province de Ngozi, 24 juillet 2009 ; entretien de Human Rights Watch avec Jean Bosco Makera, conseiller principal du Gouverneur de Ngozi, province de Ngozi, 3 août 2009 ; entretien de Human Rights Watch avec le conseiller de Gashoho pour les affaires sociales Daniel Manirakiza, commune de Gashoho, province de Muyinga, 5 août 2009 ; entretien de Human Rights Watch/APRODH avec Égide Ndikuriyo, administrateur communal, commune de Gisuru, province de Ruyigi, 9 juillet 2009.
[35] Entretien de Human Rights Watch avec des habitants d’Isale, Bujumbura Rural, 19 août 2009.
[36] Entretien de Human Rights Watch avec A.R., Bujumbura, 17 juillet 2009.
[37] Entretien de Human Rights Watch avec B.A., Bujumbura Rural, 20 juillet 2009.
[38] Un responsable local a expliqué à Human Rights Watch que l’absence d’électricité à Cibitoke attire les malfaiteurs d’autres quartiers. Entretien de Human Rights Watch, Cibitoke, Bujumbura, 30 juin 2009.
[39] Entretien de Human Rights Watch avec un jeune homme, Cibitoke, Bujumbura, 13 octobre 2009.
[40] Entretien de Human Rights Watch avec une femme, Cibitoke, Bujumbura, 2 juillet 2007.
[41] Entretien de Human Rights Watch/APRODH avec un responsable local, Buterere, Bujumbura, 18 août 2009.
[42] Le fait que les technologies de la communication ne soient pas utilisées ne signifie pas pour autant qu’elles n’existent pas : la police possède au moins 1 200 radios, suffisamment pour s’assurer d’en avoir quelques-unes dans chaque commune mais beaucoup sont cassées ou restent dans des entrepôts. Ministère de la Sécurité Publique, « Audit de la Police Nationale du Burundi, Octobre-novembre 2008 », résultats d’un audit réalisé par une équipe de la Police fédérale belge, publiés le 23 janvier 2009, p. 50 ; entretiens de Human Rights Watch avec un diplomate européen, Bujumbura, 17 décembre 2009, et avec un représentant d’une agence d’aide bilatérale, Bujumbura, 18 décembre 2009.
[43] Ministère de la Sécurité Publique, « Audit de la Police Nationale du Burundi, Octobre-novembre 2008 », pp. 50-51.
[44] Commentaires d’officiers de police lors de l’atelier du BINUB sur les droits humains auquel a assisté Human Rights Watch, Bujumbura, 22-23 décembre 2009.
[45] OLUCOME, « Rapport du 1er semestre 2009 adopté par l’Assemblée Générale du 30 août 2009 à l’Hôtel
NOVOTEL », http://www.olucome.bi/download/Rapport_premier_semestre_2009.pdf, p. 18.
[46] Entretien de Human Rights Watch avec un administrateur communal, Bujumbura, 30 juin 2009.
[47] CENAP, Défis à la paix durable, p. 86.
[48]Ibid., p. 93.
[49] Entretien de Human Rights Watch avec S.O., commune de Cibitoke, Bujumbura, 13 octobre 2009.
[50] Émission de Radio Publique Africaine, 3 juin 2009.
[51] Entretien de Human Rights Watch avec Jean Bosco Makera, conseiller principal du Gouverneur de Ngozi, 3 août 2009.
[52] Entretien de Human Rights Watch avec un représentant d’une agence d’aide humanitaire bilatérale, Bujumbura, 18 décembre 2009.
[53] « La PNB reçoit un don lui permettant d’être une police de proximité », Agence Burundaise de Presse, 20 septembre 2008.
[54] Entretien de Human Rights Watch, Bujumbura, 20 décembre 2009.
[55] Commentaire d’un représentant du BINUB lors d’un atelier du BINUB sur les droits humains, Bujumbura, 22-23 décembre 2009, auquel a assisté une chercheuse de Human Rights Watch.
[56] Entretien de Human Rights Watch avec un représentant d’une agence d’aide bilatérale, Bujumbura, 18 décembre 2009.
[57] Les changements de personnel signifient également que les policiers qui bénéficient de formations financées par les bailleurs de fonds sont souvent mutés à un poste ou dans un service où leur formation devient inutile. Entretien de Human Rights Watch avec un représentant d’une agence d’aide bilatérale, Bujumbura, 18 décembre 2009.
[58] Entretien de Human Rights Watch avec Jean-Claude Bigirimana, officier de police judiciaire, Isale, province de Bujumbura Rural, 19 août 2009 ; et entretien téléphonique de Human Rights Watch avec Prudent Ngendakumana, officier de police judiciaire pour la commune de Gisuru, 25 août 2009.
[59] Entretien de Human Rights Watch, Tangara, province de Ngozi, 23 juillet 2009.
[60] Émission de Radio Nationale, 18 juin 2009.
[61] Entretien de Human Rights Watch avec le Premier Vice-président de la République, Yves Sahinguvu, Bujumbura, 24 août 2009.
[62]Entretien de Human Rights Watch avec le Chef de cabinet du Ministère de la Justice, Onésphore Baroreraho, Bujumbura, 1er février 2010.
[63]Entretien de Human Rights Watch avec un magistrat du parquet de Gitega (anonymat préservé), Gitega, 27 août 2009.
[64] Entretien avec une réfugiée de retour chez elle, citée par Peter Uvin, Life after Violence: A People’s Story of Burundi (Londres : Zed Books), 2009, p. 155.
[65] Entretiens de Human Rights Watch/APRODH avec des habitants de Kizingwe-Bihara, commune de Kanyosha, Bujumbura, 13 août 2009.
[66] La mise en liberté provisoire de suspects est un élément normal de la procédure pénale et est codifiée dans le code de procédure pénale du Burundi. Néanmoins, Human Rights Watch et l’APRODH ont souvent entendu les gens se plaindre du fait que la plupart des suspects qui étaient libérés « provisoirement » ne comparaissaient jamais devant un tribunal par la suite. Entretiens de Human Rights Watch/APRODH, Gisuru, province de Ruyigi , 8 décembre 2009.
[67] Les fréquentes évasions de cachot et de prison contribuent également au sentiment que les suspects échappent facilement à la justice. Les centres de détention sont surpeuplés et mal entretenus, contribuant à de fréquentes évasions de prisonniers. En 2009, environ 150 nouveaux détenus sont arrivés chaque mois, créant des conditions de vie difficiles et un désordre généralisé dans les prisons ; entretien de Human Rights Watch avec un employé du Ministère de la Justice, Bujumbura, 3 septembre 2009. Dans un certain nombre de cas, la police a été accusée d’avoir facilité les évasions, après avoir touché des pots-de-vin ou parce qu’elle avait des liens personnels ou des allégeances envers un suspect déterminé. Les prisons de Ngozi et de Ruyigi se sont rendues particulièrement célèbres en 2009 pour leurs évasions—la fréquence de celles-ci pouvant être mise en corrélation avec le nombre de cas de justice populaire dans ces provinces.
[68] Entretien de Human Rights Watch/APRODH avec un fonctionnaire de l’administration, province de Muyinga, 6 août 2009.
[69]Entretien de Human Rights Watch avec Gabriel Rufyiri, président de l’OLUCOME, Bujumbura, 3 septembre 2009. Des observateurs des droits humains du BINUB ont également recueilli des informations sur des pots-de-vin payés par des suspects à des officiers de police ; courrier électronique d’un responsable du BINUB à Human Rights Watch, 21 mai 2009.
[70]Entretien de Human Rights Watch avec un administrateur communal (anonymat préservé), Bujumbura, 30 juin 2009.
[71] Entretiens de Human Rights Watch avec des habitants, Gashoho, province de Muyinga, 5 août 2009.
[72] Entretien de Human Rights Watch/APRODH avec Philbert Uwimana, conseiller de l’administrateur communal, Giteranyi, province de Muyinga, 6 août 2009.
[73] « Le phénomène de corruption persiste en province Muyinga », Agence Burundaise de Presse, 20 février 2009.
[74] Entretien de Human Rights Watch/APRODH avec Eliphaz Ntakarutimana, conseiller technique communal (administratif et social), Gisuru, province de Ruyigi, 25 août 2009.
[75] Entretien de Human Rights Watch avec Louis Nkurikiye, commissaire de la PNB en charge de l’information et de la communication, Bujumbura, 4 septembre 2009.
[76] Ibid.
[77] Voir, par exemple, Ministère à la Présidence chargé de la Bonne Gouvernance, de la Privatisation, de l’Inspection Générale de l’État et de l’Administration Locale, « Etude diagnostique sur la gouvernance et la corruption au Burundi, Rapport d’enquête », Bujumbura, mai 2008, pp.42-45.
[78] Entretiens de Human Rights Watch avec un officier de police, Ruyigi, 8 juillet 2009 ; avec J.S., frère d’une victime, Gisuru, Ruyigi, 9 juillet 2009 ; et avec Évariste Nzeyimana, administrateur communal, Itaba, province de Gitega, 26 août 2009.
[79] « Arrestation d’un magistrat du parquet de la République à Kirundo », Agence Burundaise de Presse, 28 mai 2009.
[80] Entretien de Human Rights Watch/APRODH avec un officier de police, Kinyinya, province de Ruyigi, 8 juillet 2009.
[81] Entretiens de Human Rights Watch avec un responsable du Ministère de la Justice ; automne 2009. Un responsable du BINUB et un représentant d’une organisation donatrice ont également signalé à Human Rights Watch qu’ils avaient reçu des informations dignes de foi à propos de la corruption au sein du Ministère de la Justice. Les noms des fonctionnaires et autres informations permettant de les identifier ne sont pas révélés en raison des dangers inhérents à la dénonciation de la corruption au sein de l’appareil judiciaire au Burundi. En 2008, le militant syndical Juvénal Rududura a été arrêté et détenu pendant neuf mois après avoir déclaré publiquement que les juges versaient des pots-de-vin en échange de postes. Il a été remis en liberté provisoire en 2009 mais son dossier n’était toujours pas refermé au moment où ont été écrites ces lignes. En avril 2009, un militant anti-corruption, Ernest Manirumva, a été assassiné ; les autorités judiciaires ont recueilli des éléments de preuve indiquant que des officiers de police auraient joué un rôle dans ce meurtre.
[82] Entretien de Human Rights Watch avec le Chef de Cabinet du Ministère de la Justice, Onésphore Baroreraho, Bujumbura, 1er février 2010.
[83] Les médias burundais ont rapporté de nombreux cas de ce genre. Ainsi en novembre 2009, un parlementaire aurait ordonné à la police de libérer un homme accusé d’avoir violé un enfant. Émissions de Radio Publique Africaine, 17 et 18 novembre 2009, résumées dans les communiqués de presse quotidiens des 17 et 18 novembre 2009 de l’Organisation des Médias d’Afrique Centrale.
[84] Entretien de Human Rights Watch avec B.A., Bujumbura, 21 juillet 2009.
[85] Entretiens de Human Rights Watch avec l’administrateur communal Marin Hitimana, l’officier de police judiciaire Élie Nimubona, le chef de poste Gédéon Ndayemeye, et des proches de la victime, Ntega, province de Kirundo, 23-24 octobre 2008.
[86] Entretien de Human Rights Watch avec le porte-parole de la PNB Pierre Chanel Ntarabaganyi, Bujumbura, 27 novembre 2009.
[87] Le manque de connaissance de la procédure pénale en dépit de certains efforts déployés par des responsables locaux pour « sensibiliser » le public à la loi pourrait, en partie, être dû au taux d’alphabétisation extrêmement bas enregistré au Burundi. L’association de la société civile Observatoire d’Action Gouvernementale (OAG) estimait à 49% le taux d’alphabétisation au Burundi en 2006 ; OAG, « Évaluation de l’engagement dans la mise en œuvre de l’éducation pour tous », septembre 2007, cité dans CENAP, Défis à la paix durable, p. 99. En 2007, l’UNICEF estimait à 59% le taux d’alphabétisation des adultes. UNICEF, « Burundi : Statistiques », http://www.unicef.org/french/infobycountry/burundi_statistics.html (consulté le 26 janvier 2010). Le CENAP laisse entendre que l’analphabétisme est la cause fondamentale du manque de compréhension de la loi ; CENAP, Défis à la paix durable, p. 99.
[88] Entretien de Human Rights Watch avec le Gouverneur Pierre Bambasi, province de Muyinga, 5 août 2009.
[89] Entretien de Human Rights Watch avec l’administrateur communal François-Xavier Nduwamungu, Nyamurenza, province de Ngozi, 24 juillet 2009.
[90] Entretien de Human Rights Watch avec Louis Nkurikiye, commissaire de police en charge de l’information et de la communication, Bujumbura, 4 septembre 2009.
[91] Ministère de la Sécurité Publique et RCN-Justice et Démocratie, « Cours de déontologie destiné aux officiers de police judiciaire ; Session de recyclage Juillet-Septembre 2005 », 2005.
[92] Parfois, les organisations non gouvernementales comblent le vide ; par exemple, l’organisation burundaise de défense des droits humains, l’APRODH, assure le transport de victimes de viol aux audiences des tribunaux. Le gouverneur de Muyinga, Pierre Bambasi, a laissé entendre que les administrateurs communaux, qui sont tous équipés d’un véhicule, devraient assurer le transport des témoins pour rencontrer les responsables de la police et de la justice. Il a fait remarquer que puisque les administrateurs communaux étaient les chefs des « comités de sécurité » récemment mis en place, cela devrait être l’une de leurs responsabilités. Entretien de Human Rights Watch avec le Gouverneur de Muyinga Pierre Bambasi, province de Muyinga, 5 août 2009.
[93] Entretien de Human Rights Watch/APRODH avec l’administrateur communal Égide Ndikuriyo, Gisuru, province de Ruyigi, 9 juillet 2009.
[94] Entretien de Human Rights Watch avec le Commissaire de police de Ngozi Donatien Ntiyankundiye, province de Ngozi, 3 août 2009.
[95] Entretien de Human Rights Watch avec Jean Bosco Makera, conseiller principal du gouverneur de Ngozi, province de Ngozi, 3 août 2009. À Kanyosha également, un responsable a fait remarquer que « les gens ont peur de venir et de se retrouver face à face avec la personne qu’ils accusent ».Entretien de Human Rights Watch/APRODH avec l’administrateur communal Abraham Aoudou Bampoye, Kanyosha, Bujumbura, 13 août 2009.
[96] Entretien de Human Rights Watch avec l’officier de police judiciaire Bucumi, Tangara, province de Ngozi, 23 juillet 2009.
[97] Commentaire fait par une fonctionnaire du BINUB en charge des droits humains lors d’une réunion au Haut-Commissariat aux droits de l’homme, Bujumbura, 31 août 2009.
[98] Entretien de Human Rights Watch avec le Gouverneur de Muyinga Pierre Bambasi, province de Muyinga, 5 août 2009. Bambasi a déclaré qu’avant la guerre, les rumeurs constantes de sorcellerie débouchaient à l’occasion sur des actes de justice populaire au Burundi mais ceux qu’on appelait les « faiseurs de pluie » qui étaient souvent victimes de cette violence risquaient beaucoup plus d’être simplement passés à tabac que tués.
[99] Voir, par exemple, « La sorcellerie et les bandits armés responsables de cinq personnes tuées à Muyinga et à Ngozi », Agence Burundaise de Presse, 11 novembre 2009.
[100] Contrairement à certains pays où les accusations de sorcellerie visent les femmes de manière disproportionnée, les personnes soupçonnées de sorcellerie au Burundi comprennent des hommes autant que des femmes.
[101] L’étude de 2008 du CENAP a également identifié des cas de violence basée sur une réelle croyance dans des actes de sorcellerie ainsi que des cas où les « accusations de sorcellerie ont servi d’alibi pour se débarrasser d’un voisin ». CENAP, Défis à la paix durable, p. 102.
[102] D’autres ont toutefois contesté ce point de vue et rappelé les meurtres de présumés criminels commis pendant la période précédant la guerre civile ; entretien de Human Rights Watch avec T.U., habitant de Bujumbura, 29 novembre 2009. En raison de l’absence de statistiques relatives à la justice populaire, il est difficile de vérifier si une augmentation a effectivement eu lieu.
[103] Entretien de Human Rights Watch avec le Gouverneur Pierre Bambasi, province de Muyinga, 5 août 2009.
[104] Base de données interne de Transcultural Psycho-Social Organization (TPO), citée par le CENAP, Défis à la paix durable, p. 105.
[105] CENAP, Défis à la paix durable, pp. 112-113. Une série de groupes de consultation dirigés par le CENAP ont montré qu’une forte proportion de Burundais était disposée à recourir à la violence pour résoudre les problèmes de conflits fonciers, familiaux ou liés à la propriété, une tendance que le CENAP a attribuée en partie à la guerre.
[106] L’Indice du développement humain 2009 des Nations Unies, avec des données de 2007, classe le Burundi 174e sur 182 pays. Voir Programme des Nations Unies pour le Développement (PNUD), Rapport sur le développement humain 2009 – Burundi (New York : PNUD 2009) http://hdrstats.undp.org/fr/countries/country_fact_sheets/cty_fs_BDI.html (consulté le 5 janvier 2009). L’indice fait remarquer que le prix de marché des denrées alimentaires de base a considérablement augmenté, et dans certains cas doublé, entre septembre 2006 et juillet 2008. L’Indice de faim dans le monde a mis en évidence une progression considérable de la faim au Burundi, qui enregistrait le deuxième taux de faim le plus élevé au monde en 2007; International Food Policy Research Institute, 2009 Global Hunger Index: The Challenge of Hunger: Focus on Financial Inequality and Gender Inequality (Washington D.C. : IFPRI, 2009), http://www.ifpri.org/sites/default/files/publications/ghi09.pdf (consulté le 5 janvier 2009). Voir également CENAP, Défis à la paix durable, p. 53.
[107] Présentation de Bert Ingelaere, chercheur à l’Université d’Anvers, Bujumbura, 16 décembre 2009, à laquelle a assisté une chercheuse de Human Rights Watch.
[108] Entretien de Human Rights Watch/APRODH avec Anatole Kabavamwo, chef de zone Nyaruganda, commune de Nyabitsinda, province de Ruyigi, 8 juillet 2009.
[109] Entretien de Human Rights Watch avec le chef de poste Émile Cimpaye, Cibitoke, Bujumbura, 11 août 2009.
[110] Voir, par exemple, Commission des droits de l’homme de l’ONU, « Premier rapport sur la situation des droits de l'homme au Burundi présenté par le Rapporteur spécial, M. Paulo Sérgio Pinheiro, conformément à la résolution 1995/90 de la Commission », 14 novembre 1995, http://www.unhchr.ch/Huridocda/Huridoca.nsf/da0a46f6cf68ac62c125699100383d60/9f5a5219a4a907f2802566a200588e7e?OpenDocument (consulté le 5 janvier 2009).
[111] Entretien de Human Rights Watch avec le chef de la colline Burenza Apollinaire Nsengiyumva, Bujumbura, 20 août 2009.
[112] Entretien de Human Rights Watch avec Philippe Ciza, conseiller principal du gouverneur de Bujumbura Rural, Bujumbura, 1er septembre 2009. Ciza a ajouté qu’au Burundi précolonial, il existait une tradition selon laquelle les voleurs de bétail étaient tués par les communautés locales. Cependant, a-t-il expliqué, cette tradition a été « maîtrisée » et n’a refait surface que récemment.
[113] Entretien de Human Rights Watch avec Louis Nkurikiye, commissaire de la PNB en charge de l’information et de la communication, Bujumbura, 4 septembre 2009.
[114] « Burundi : deux policiers soupçonnés de vol lapidés par la population », Agence France-Presse, 7 septembre 2009.
[115] Entretien de Human Rights Watch/APRODH avec Y.S., Gisuru, province de Ruyigi, 10 décembre 2009.
[116] Entretien de Human Rights Watch/APRODH avec U.A., Gisuru, province de Ruyigi 10 décembre 2009.
[117] Les combattants démobilisés ne devraient jouer aucun rôle dans ces opérations de sécurité mais ils sont souvent utilisés, illégalement, pour fournir un appui à la police, en particulier pour effectuer des arrestations à caractère politique. Voir Human Rights Watch, La quête du pouvoir : Violences et répression politiques au Burundi, mai 2009, http://www.hrw.org/fr/reports/2009/06/03/la-qu-te-du-pouvoir-0, p. 23.
[118] Entretien de l’APRODH avec Donatien Manirakiza, Ruyigi, octobre 2009.
[119] Entretien de Human Rights Watch/APRODH avec Donatien Manirakiza, Gisuru, province de Ruyigi, 10 décembre 2009.
[120] Loi No. 1/015 du 20 juillet 1999 portant réforme du code de procédure pénale, art 58 ; Loi No. 1/020 du 31 décembre 2004 portant création, organisation, missions, composition et fonctionnement de la Police Nationale.
[121] Entretiens de l’APRODH avec le chef de poste de Gisuru, Guy Majambere, et le secrétaire communal, Silas Havyarimana, Gisuru, 15 décembre 2009.
[122] Entretien téléphonique de Human Rights Watch avec Bigirimana, 14 décembre 2009.
[123] Entretiens de Human Rights Watch/APRODH avec Y.S., U.A. et G.G., Gisuru, Ruyigi, 10 décembre 2009.
[124] Entretien de Human Rights Watch avec le procureur de Ruyigi, Nicodème Gahimbare, Ruyigi, 11 décembre 2009.
[125] Entretien de Human Rights Watch/APRODH avec Donatien Manirakiza, Gisuru, province de Ruyigi, 10 décembre 2009.
[126] « Burundi: deux policiers soupçonnés de vol lapidés par la population », Agence France-Presse, 7 septembre 2009.
[127] Entretien de Human Rights Watch avec Pierre Channel Ntarabaganyi, Bujumbura, décembre 2009.
[128] Entretien de Human Rights Watch avec un responsable judiciaire (anonymat préservé), Ruyigi, décembre 2009.
[129] Discours prononcé début 2009 et cité par l’Agence Burundaise de Presse. Human Rights Watch n’a pas été en mesure de trouver le texte complet du discours.
[130] Entretien de Human Rights Watch avec S.O., habitant de la commune de Cibitoke, Bujumbura, 13 octobre 2009 ; Jean-Marie Vianney Kavumbagu, « Deux présumés voleurs de motos brûlés vifs en pleine capitale », Ligue des Droits de la personne dans la région des Grands Lacs, 15 février 2005, http://www.ldgl.org/spip.php?article314 (consulté le 21 décembre 2009).
[131] Entretien de Human Rights Watch avec E.H., Cibitoke, Bujumbura, 13 octobre 2009.
[132] Entretien de Human Rights Watch/APRODH avec un secrétaire communal, Buhinyuza, province de Muyinga, 6 août 2009. Aucun des responsables interrogés par Human Rights Watch et l’APRODH à propos de cette affaire n’était au courant d’une quelconque activité criminelle attribuée à Nzeyimana.
[133] Entretien de Human Rights Watch/APRODH avec l’officier de police judiciaire Fidèle Nifasha, Buhinyuza, province de Muyinga, 6 août 2009.
[134] Entretien de Human Rights Watch/APRODH avec le commissaire de la police judiciaire Thacien Manirakiza, province de Muyinga, 5 août 2009.
[135] Entretien de l’APRODH avec des responsables judiciaires de Muyinga, 11 août 2009.
[136] Courrier électronique d’un responsable du BINUB à Human Rights Watch, 7 janvier 2009.
[137] Entretien de Human Rights Watch avec un représentant d’une ONG internationale travaillant à Ruyigi, Bujumbura, 12 juillet 2009.
[138] Entretien de l’APRODH avec Célestin Karenzo, Bujumbura, 18 août 2009.
[139] Entretiens de Human Rights Watch avec Léocadie Irankunda, Bukirasazi, province de Gitega, et avec le magistrat Terence Nahabakomeye, Gitega, 26 août 2009.
[140] Entretien de Human Rights Watch avec Jonas Harerimana, Mwumba, province de Ngozi, 23 juillet 2009. Harerimana n’a pas mentionné si son père était présent.
[141] Entretien de Human Rights Watch/APRODH avec S.C., Mwumba, province de Ngozi, 4 août 2009.
[142] Entretien de Human Rights Watch/APRODH avec le chef de poste Jérôme Buregeya, Mwumba, province de Ngozi, 4 août 2009.
[143] Entretiens de Human Rights Watch/APRODH avec des proches et des voisins de Masabarikiza, Ruyigi, 8 décembre 2009 ; entretien de Human Rights Watch avec le procureur de Ruyigi Nicodème Gahimbere, Ruyigi, 11 décembre 2009.
[144] Entretiens de Human Rights Watch/APRODH avec des membres de la famille de Masabarakiza, Ruyigi, 8 décembre 2009.
[145] Entretiens de Human Rights Watch/APRODH avec des suspects, commune de Gisuru, province de Ruyigi, 9 juillet 2009.
[146] Entretiens de Human Rights Watch/APRODH avec des habitants de la commune de Kinyinya, province de Ruyigi, 25 août 2009.
[147] Entretien de Human Rights Watch avec le gouverneur de Ruyigi Cyriaque Nshimirimana, Bujumbura, 12 juillet 2009.
[148] Entretien de Human Rights Watch/APRODH avec E.N., habitant de la colline Rubenga, commune de Giteranyi, province de Muyinga, 6 août 2009.
[149] Courrier électronique d’un responsable du BINUB à Human Rights Watch, 4 août 2009.
[150] Entretien de Human Rights Watch/APRODH avec le procureur de Bubanza Marc Manirakiza, Bubanza, 22 janvier 2010.
[151] Courrier électronique d’un responsable du BINUB à Human Rights Watch, 28 juillet 2009.
[152] Entretien de Human Rights Watch avec le commissaire provincial de la PNB Eustache Ntagahoraho, Gitega, 26 août 2009.
[153] Un responsable de la police a affirmé que les FDN n’avaient joué aucun rôle dans le passage à tabac mais les victimes ont déclaré qu’elles avaient été battues à la fois par des soldats et par des civils. Courrier électronique d’un responsable du BINUB à Human Rights Watch, 28 novembre 2007 ; entretiens de Human Rights Watch avec des détenus et avec le Sous-Commissaire provincial de la police judiciaire Athanase Nyankanzi, Makamba, 14 décembre 2007.
[154] Ce comportement a une origine historique : pendant la guerre, alors qu’ils assuraient des administrations parallèles, tant les FNL que le CNDD-FDD ont occasionnellement réglé des comptes personnels ou politiques en accusant des personnes d’un crime et en les faisant exécuter. Entretien de Human Rights Watch avec Philippe Ciza, conseiller spécial du gouverneur de Bujumbura Rural, Bujumbura, 1er septembre 2009.
[155] Human Rights Watch a décrit ces cas dans son analyse de la violence politique au Burundi, La quête du pouvoir : Violences et répression politiques au Burundi, mai 2009, http://www.hrw.org/fr/reports/2009/06/03/la-qu-te-du-pouvoir-0, pp. 42-47.
[156] Entretiens de Human Rights Watch avec l’administrateur communal Nestor Ntakarutimana et le chef de poste Jérôme Maniraho, Kayogoro, province de Makamba, 16 décembre 2008. Voir Human Rights Watch, La quête du pouvoir : Violences et répression politiques au Burundi, mai 2009, http://www.hrw.org/fr/reports/2009/06/03/la-qu-te-du-pouvoir-0, pp. 42-44.
[157] Entretiens de Human Rights Watch avec des victimes, Nyamurenza, province de Ngozi, 21 janvier 2009. Voir Human Rights Watch, La quête du pouvoir : Violences et répression politiques au Burundi, mai 2009, http://www.hrw.org/fr/reports/2009/06/03/la-qu-te-du-pouvoir-0, pp. 45-47.
[158] Entretien de Human Rights Watch avec l’administrateur communal François-Xavier Nduwamungu, Nyamurenza, province de Ngozi, 24 juillet 2009.
[159] Dans certaines communautés et collines, ces groupes sont politisés : ils sont composés de bandes de jeunes du parti au pouvoir qui sont utilisées pour arrêter ou intimider les membres de l’opposition. Dans les recherches effectuées par Human Rights Watch et l’APRODH sur la justice populaire, les chercheurs n’ont pas rencontré de cas où la justice populaire avait été le fait de ces groupes partisans, à l’exception des cas cités dans la section précédente et d’un cas survenu dans la province de Karusi où un voleur présumé a été passé à tabac par des membres de la ligue des jeunes du CNDD-FDD, Imbonerakure.
[160] Entretien de Human Rights Watch avec le père de Dominique Harutimana, Gisuru, province de Ruyigi, 9 juillet 2009.
[161] Entretien de Human Rights Watch avec un témoin, Gisuru, province de Ruyigi, 9 juillet 2009.
[162] Entretien de Human Rights Watch avec l’officier de police judiciaire François Niyongiko, Gisuru, 9 juillet 2009.
[163] Entretien de Human Rights Watch/APRODH avec la sœur de la victime, Gisuru, 10 décembre 2009.
[164] Manirambona appartenait à l’ethnie twa, un groupe qui, au Burundi, est accusé de vols de manière disproportionnée. À plusieurs occasions en 2009, des Batwas ont été roués de coups par des gens qui les soupçonnaient de vol. Entretien de Human Rights Watch/APRODH avec Bucumi, officier de police judiciaire de Tangara, Tangara, province de Ngozi, 23 juillet 2009.
[165] Entretien de Human Rights Watch/APRODH avec Bucumi, officier de police judiciaire de Tangara, Tangara, province de Ngozi, 23 juillet 2009.
[166] Entretien de Human Rights Watch/APRODH avec un chef de zone, Tangara, province de Ngozi, 23 juillet 2009.
[167] Entretien de Human Rights Watch avec l’administrateur communal François-Xavier Nduwamungu, Nyamurenza, province de Ngozi, 24 juillet 2009.
[168] Entretien de Human Rights Watch avec l’administrateur communal François-Xavier Nduwamungu, Nyamurenza, province de Ngozi, 24 juillet 2009 ; entretien de Human Rights Watch/APRODH avec des habitants de Nyamurenza, 4 août 2009.
[169] Entretien de Human Rights Watch avec le chef de colline de Burenza Apollinaire Nsengiyumva, Bujumbura, 20 août 2009.
[170] Entretien de Human Rights Watch avec le secrétaire communal Désiré Misigaro, Mubimbi, Bujumbura Rural, 19 août 2009.
[171] Entretien de Human Rights Watch/APRODH avec S.N., Nyabitsinda, province de Ruyigi, 8 juillet 2009.
[172] Entretien de Human Rights Watch/APRODH avec Nestor Manirakiza, conseiller de l’administrateur communal, Giheta, Gitega, 11 décembre 2009.
[173] Mazoya a été capturé par la police le 26 janvier 2010. Selon le journal burundais en ligne « Net Press », après sa capture, une foule s’est amassée devant la prison où il était détenu, criant « Tuez-le ! » Il a par la suite été abattu par la police dans des circonstances douteuses. La police a déclaré qu’après avoir été arrêté, Mazoya avait promis de la mener à une cache d’armes. C’est alors qu’il a cherché à s’évader et que, toujours selon la police, les policiers l’ont abattu. Tant les journalistes burundais que les observateurs des droits humains de l’ONU ont émis la possibilité que Mazoya ait été exécuté intentionnellement afin de l’empêcher de révéler l’étendue de la complicité policière dans les activités illégales de sa bande. Réunion avec des observateurs des droits humains de l’ONU et des responsables du gouvernement à laquelle a assisté une chercheuse de Human Rights Watch, 1er février 2010.
[174] Minority Rights Group International a noté que « ce groupe est encore composé majoritairement de sans terre et compte parmi les peuples les plus pauvres dans ce qui est un pays très pauvre. Dans les témoignages recueillis par MRG au Burundi en 2007, les Batwas se plaignaient des nombreuses difficultés qu’ils rencontraient en rapport avec les droits fonciers, que ce soit en raison de l’absence de titre de propriété, de pratiques discriminatoires liées à l’attribution des terres par les autorités, ou de la non-reconnaissance de leurs droits historiques à la terre… Les Batwas se sont également plaints au MRG de la discrimination existant dans les services sociaux, tout spécialement dans le domaine de la santé et de l’éducation ». Minority Rights Group International, Répertoire mondial des minorités et peuples indigènes, http://www.minorityrights.org/?lid=4703 (consulté le 23 janvier 2010) ; voir également Minority Rights Group International,The Batwa Pygmies of the Great Lakes Region , 2000, http://www.minorityrights.org/1056/reports/batwa-pygmies-of-the-great-lakes-region.html (consulté le 23 janvier 2010).
[175] Voir, par exemple, « Le principal déstabilisateur de la sécurité dans le Sud du pays enfin capturé ! », Net Press (Burundi), 27 janvier 2010.
[176] « Mazoya sème la terreur au centre du pays », quotidien Iwacu, 20 décembre 2009, http://www.iwacu-burundi.org/index.php?option=com_content&view=article&id=365:mazoya-seme-la-terreur-au-centre-du-pays&catid=40:quotidien.
[177] Entretiens de Human Rights Watch/APRODH avec des habitants de Giheta, 11 décembre 2009.
[178] Entretien de Human Rights Watch/APRODH avec Robat Ntakarutimana, Giheta, province de Gitega, 11 décembre 2009.
[179] Entretiens de Human Rights Watch/APRODH avec des victimes et des témoins, Giheta, province de Gitega, 11 décembre 2009.
[180] Entretien de Human Rights Watch/APRODH avec la mère de la victime, Giheta, province de Gitega, 11 décembre 2009.
[181] Courrier électronique d’un responsable du BINUB à Human Rights Watch, 2 septembre 2009.
[182] Entretien de Human Rights Watch avec un officier de police, Gashoho, province de Muyinga, 5 août 2009.
[183] Courrier électronique d’un responsable du BINUB à Human Rights Watch, 11 septembre 2009.
[184]Loi no. 1/05 du 22 avril 2009 portant révision du code pénal, art. 481-482.
[185] Entretien de Human Rights Watch/APRODH avec l’officier de police judiciaire Gilbert Nintereste, Kinyinya, province de Ruyigi, 25 août 2009.
[186] Selon un habitant, « il y a des jeunes à qui l’administration locale demande d’agir en l’absence de la police—un groupe de jeunes hommes forts qui arrêtent les gens et les emmènent à la police. Cela arrive fréquemment ». Entretiensde Human Rights Watch/APRODH, Kinyinya, 25 août 2009.
[187] Entretien de Human Rights Watch/APRODH avec la mère de Jean-Marie Ndireguheka, Kinyinya, province de Ruyigi, 9 décembre 2009.
[188] Entretien de Human Rights Watch/APRODH avec la mère de Cayega, Kinyinya, 25 août 2009.
[189] Entretiens de Human Rights Watc h/APRODH avec des habitants, Kinyinya, province de Ruyigi, 25 août 2009.
[190] Entretien de Human Rights Watch avec le Gouverneur de Ruyigi Cyriaque Nshimirimana, Bujumbura, 12 juillet 2009.
[191] Entretien de Human Rights Watch, Ruyigi, 11 décembre 2009.
[192] Entretien de Human Rights Watch avec un officier de police (anonymat préservé), Kinyinya, 8 juillet 2009.
[193] Entretien de Human Rights Watch avec Didace Ntamirukiro, Ruyigi, 10 juillet 2009.
[194] Entretien de Human Rights Watch avec l’officier de police judiciaire Gilbert Ninteretse, Kinyinya, 25 août 2009.
[195] Entretien de Human Rights Watch/APRODH avec l’administrateur communal Rémy Nsengiyumva, Kinyinya, 25 août 2009.
[196] Entretien de Human Rights Watch/APRODH avec le chef de colline de Muvumu Sylvestre Baragahorana, Kinyinya, 25 août 2009.
[197] Entretien de Human Rights Watch/APRODH avec un habitant, Kinyinya, 25 août 2009.
[198] Entretien de Human Rights Watch/APRODH avec le père de la victime, Kinyinya, 25 août 2009.
[199] Entretien de Human Rights Watch/APRODH avec un habitant, Kinyinya, province de Ruyigi, 25 août 2009.
[200] Entretien de Human Rights Watch/APRODH avec l’officier de police judiciaire Gilbert Ninteretse, Kinyinya, 25 août 2009.
[201] Entretien de Human Rights Watch avec la mère de la victime, Kinyinya, 9 décembre 2009.
[202] Entretien de Human Rights Watch/APRODH avec la mère de la victime, Kinyinya, 25 août 2009.
[203] Entretien de Human Rights Watch/APRODH avec Merida Ndikumana, Nyabitsinda, province de Ruyigi, 8 juillet 2009.
[204] Entretien de Human Rights Watch avec un proche de la victime, Gitega, 7 décembre 2009.
[205] Entretien de Human Rights Watch/APRODH avec l’officier de police judiciaire Élie Nimubona, Gitobe, province de Kirundo, 7 août 2009. Ce même officier de police judiciaire a fourni à Human Rights Watch et à des responsables judiciaires des informations qui se sont révélées fausses à propos d’une affaire de justice populaire survenue dans la commune de Ntega en octobre 2009.
[206] Entretien de Human Rights Watch/APRODH avec Melchiade Maniratunga, chef de la colline Tonga, Gitobe, province de Kirundo, 7 août 2009.
[207] Entretiens de Human Rights Watch/APRODH avec des habitants de la colline Tonga, Gitobe, 7 août 2009.
[208] Entretien de Human Rights Watch/APRODH avec Jocelyne Nshimirimana, Vumbi, province de Kirundo, 7 août 2009.
[209] Entretiens de Human Rights Watch/APRODH avec le chef de zone et avec un proche de la victime du lynchage, Tangara, province de Ngozi, 23 juillet 2009.
[210] Entretien de Human Rights Watch/APRODH avec le frère de la victime du lynchage, Tangara, province de Ngozi, 23 juillet 2009.
[211] Entretien téléphonique de Human Rights Watch avec l’officier de police judiciaire de Tangara, Bucumi, février 2010.
[212] Les citoyens et responsables burundais parlent souvent de « solidarité négative » pour expliquer la pratique des fonctionnaires de l’État—ou parfois des civils—consistant à se couvrir mutuellement lorsque des actes criminels ou tout au moins discutables sont commis.
[213] Entretiens de Human Rights Watch/APRODH avec un administratif à la base et un officier de police, Gisuru, province de Ruyigi, 25 août 2009, et avec un responsable judiciaire, Ruyigi, 26 août 2009.
[214] Ibid.
[215] Entretien de Human Rights Watch/APRODH avec des habitants, Gisuru, province de Ruyigi, 9 juillet 2009, et avec un responsable judiciaire, Ruyigi, juillet 2009.
[216] Entretien de Human Rights Watch/APRODH avec des habitants, commune de Gisuru, province de Ruyigi, 9 juillet 2009.
[217] Entretien de Human Rights Watch/APRODH avec un habitant, Gisuru, 9 juillet 2009.
[218] Entretien de Human Rights Watch/APRODH avec des habitants, Gisuru, 9 juillet 2009.
[219] Entretien de Human Rights Watch/APRODH avec un proche de la victime, Gisuru, 9 juillet 2009.
[220] Entretien de Human Rights Watch avec le magistrat Parfait Ngendakumana, Ruyigi, 10 juillet 2009.
[221] Entretiens de l’APRODH avec des responsables judiciaires, Ruyigi, janvier 2010.
[222] Entretien de Human Rights Watch avec le Secrétaire communal Désiré Misigaro, Mubimbi, province de Bujumbura Rural, 19 août 2009.
[223] Entretien de Human Rights Watch avec Apollinaire Nsengiyumva, chef de la colline Burenza, Bujumbura, 20 août 2009.
[224] Entretien de Human Rights Watch avec l’officier de police judiciaire Jean-Marie Niyongabo, Mubimbi, province de Bujumbura Rural, 19 août 2009.
[225] Entretien de Human Rights Watch avec le secrétaire communal Désiré Misigaro, Mubimbi, province de Bujumbura Rural, 19 août 2009.
[226] Entretiens de Human Rights Watch avec le secrétaire communal Désiré Misigaro et l’officier de police judiciaire Jean-Marie Niyongabo, commune de Mubimbi, province de Bujumbura Rural, 19 août 2009, et avec le chef de la colline Burenza, Apollinaire Nsengiyumva, Bujumbura, 20 août 2009.
[227] Entretien de Human Rights Watch avec un officier de police, Bujumbura, 23 décembre 2009.
[228] Entretien de Human Rights Watch/APRODH avec un officier de police, Kinyinya, province de Ruyigi, 8 juillet 2009.
[229] Entretien de Human Rights Watch avec le Gouverneur Cyriaque Nshimirimana, Ruyigi, 26 août 2009.
[230] Entretien de Human Rights Watch avec Louis Nkurikiye, commissaire de la PNB en charge de l’information et de la communication, Bujumbura, 4 septembre 2009.
[231] Entretien de Human Rights Watch/APRODH avec le chef de poste Édouard Nahimana, Mutaho, province de Gitega, 27 août 2009.
[232] Entretien de Human Rights Watch/APRODH avec des proches de Layilayi, Mutaho, province de Gitega, 27 août 2009.
[233] Ibid.
[234] Entretien de Human Rights Watch/APRODH avec le chef de poste Édouard Nahimana, Mutaho, 27 août 2009.
[235] Entretien de Human Rights Watch avec des auteurs d’actes de justice populaire, Itaba, province de Gitega 26 août 2009. En raison des difficultés rencontrées par la police pour assurer la sécurité publique la nuit, comme expliqué plus haut—et peut-être aussi à cause du passé, lorsque, dans certaines zones, les groupes rebelles prenaient le contrôle de la sécurité à la nuit tombée—bon nombre d’habitants de zones enregistrant de nombreux cas de justice populaire ont déclaré à Human Rights Watch et à l’APRODH qu’ils jugeaient nécessaire de se charger eux-mêmes de la sécurité la nuit.
[236] Entretien de Human Rights Watch avec un responsable local (anonymat préservé), Bujumbura, 10 août 2009.
[237] Entretien de Human Rights Watch avec le Commissaire provincial de la PNB Louis Ndayihimbaze, Ruyigi, 10 juillet 2009.
[238] Entretien de Human Rights Watch avec un officier supérieur de la police, Ngozi, 22 juillet 2009.
[239] Entretien de Human Rights Watch avec un officier supérieur de l’armée, Muyinga, 5 août 2009.
[240] Selon un avocat burundais expérimenté, les articles 1-5 du Code de procédure pénale—loi actuellement en cours de réforme, dû en partie à son manque de clarté au sujet du rôle de la police judiciaire—devraient être interprétés comme imposant à la police l’obligation d’enquêter sur toutes les infractions. La police peut suspendre des enquêtes en l’absence de preuves indiquant qu’une infraction a été commise. Néanmoins, si des éléments de preuve semblent indiquer qu’une infraction a été commise, la police doit consigner les preuves et transmettre le dossier au parquet. Le parquet dispose de pouvoirs plus étendus pour déterminer s’il convient d’engager des poursuites. Entretien de Human Rights Watch, 2 février 2010. Voir également Loi No. 1/015 du 20 juillet 1999 portant réforme du code de procédure pénale, art 1-5.
[241] Le chef de poste et le secrétaire communal ont fourni à Human Rights Watch deux noms différents pour la victime : Hervé Ntahonkuriye et Simon Baboneyo. Human Rights Watch n’a pas été en mesure d’établir avec certitude l’identité de la victime.
[242] Entretien de Human Rights Watch avec le chef de poste Léopold Magenge, Kanyosha, Bujumbura Rural, 20 août 2009.
[243] Entretiens de Human Rights Watch avec l’épouse et des voisins d’Audifax Ndayizeye, Buterere, Bujumbura, 12 octobre 2009.
[244] Entretien de Human Rights Watch avec le frère d’Audifax Ndayizeye, Bujumbura, 19 novembre 2009.
[245] Entretien de Human Rights Watch avec l’épouse d’Audifax Ndayizeye, Buterere, Bujumbura, 12 octobre 2009.
[246] Entretien de Human Rights Watch/APRODH avec François Niyongiko, officier de police judiciaire, Gisuru, province de Ruyigi, 9 juillet 2009, et avec un responsable du gouvernement, Bujumbura, 12 juillet 2009. Niyongiko a par la suite été muté à un autre poste suite à des accusations de corruption.
[247] Entretien de Human Rights Watch/APRODH avec le père de Dominique Harutimana, Gisuru, province de Ruyigi, 9 juillet 2009.
[248] Entretien de Human Rights Watch/APRODH avec l’épouse de Pierre Nsengiyumva, Mutaho, province de Gitega, 27 août 2009.
[249] Entretien de Human Rights Watch/APRODH avec le chef de poste Édouard Nahimana, commune de Mutaho, province de Gitega, 27 août 2009.
[250] Entretien de Human Rights Watch avec le père d’Emmanuel Ngenzebuhoro, Butaganzwa, province de Ruyigi, 7 décembre 2009.
[251] Entretiens de Human Rights Watch avec le père d’Emmanuel Ngenzebuhoro et avec un voisin, F.F., Butaganzwa, province de Ruyigi, 7 décembre 2009.
[252] Entretien de Human Rights Watch avec B.W., Kanyosha, province de Bujumbura Rural, 20 août 2009.
[253] Entretiens de Human Rights Watch avec le secrétaire communal Ferdinand Nkunzimana, avec M.X., et avec des habitants, Kanyosha, province de Bujumbura Rural, 20 août 2009.
[254] Entretien de Human Rights Watch avec l’officier de police judiciaire Claude Manirakiza, Gihosha, Bujumbura, 1er septembre 2009.
[255] Ibid.
[256] Pacte international relatif aux droits civils et politiques (PIDCP), adopté le 16 décembre 1966, Rés. A.G. 2200A (XXI), 21 U.N. GAOR Supp. (No. 16) at 52, Doc. ONU A/6316 (1966), 999 U.N.T.S. 171, entré en vigueur le 23 mars 1976. Le Burundi a ratifié le PIDCP en 1990.
[257] Comité des droits de l’homme de l’ONU, Observation générale N° 31 sur l’article 2 du Pacte : La nature de l’obligation juridique générale imposée aux États parties au Pacte, Doc. ONU CCPR/C/74/CRP.4/Rev.6 (2004), para. 15.
[258] Selon le Comité des droits de l’homme de l’ONU: « [L]es États parties ne pourront pleinement s’acquitter de leurs obligations positives de garantir les droits reconnus dans le Pacte que si les individus sont protégés par l’État non seulement contre les violations de ces droits par ses agents, mais aussi contre des actes commis par des personnes privées, physiques ou morales, qui entraveraient l’exercice des droits énoncés dans le Pacte dans la mesure où ils se prêtent à une application entre personnes privées, physiques ou morales. », Observation générale N° 31, para. 8.
[259] Ibid., para. 15.
[260]Principes fondamentaux et directives concernant le droit à un recours et à réparation des victimes de violations flagrantes du droit international des droits de l’homme et de violations graves du droit international humanitaire, Rés. A.G. 60/147, Doc. ONU A/RES/60/147 (16 décembre 2005), principes 3(b)-(c).
[261] PIDCP, art. 6, 7, 17.
[262]Loi N° 1/020 du 31 décembre 2004 portant création, organisation, missions, composition, et fonctionnement de la Police Nationale, art. 18, 27.
[263] Loi N° 1/015 du 20 juillet 1999 portant réforme du code de procédure pénale, art 1-5 ; voir également plus haut, note de bas de page 239.
[264] Entretien de Human Rights Watch avec C.N., Bujumbura, 12 octobre 2009.
[265] Entretien de Human Rights Watch avec Philbert Uwimana, conseiller de l’administrateur communal, Giteranyi, province de Muyinga, 6 août 2009 ; et avec Gédéon Mpitabavuma, chef de la collineRweza, Bujumbura Rural, 8 octobre 2009 ; entretiens de Human Rights Watch/APRODH avec des habitants de Butaganzwa, province de Ruyigi, 8 juillet 2009.
[266] Entretiens de Human Rights Watch/APRODH avec S.D., C.I. et F.F., témoins du meurtre d’Emmanuel Ngenzebuhoro, Butaganzwa, province de Ruyigi, 7 juillet 2009 et 7 décembre 2009.
[267] Entretien de Human Rights Watch avec le chef de colline Sygesbert Simbagoye, Itaba, province de Gitega, 26 août 2009.
[268] Entretien de Human Rights Watch/APRODH avec un policier, Nyabitsinda, province de Ruyigi, 8 juillet 2009.
[269] Entretien de Human Rights Watch avec un chef de zone, Tangara, province de Ngozi, 23 juillet 2009.
[270] Entretien de Human Rights Watch avec un habitant de la localité, colline Kananira, Tangara, province de Ngozi, 23 juillet 2009.
[271] Entretien de Human Rights Watch avec le gouverneur de Ruyigi Cyriaque Nshimirimana, Bujumbura, 12 juillet 2009.
[272] DanChurchAid et le Conseil National des Églises du Burundi, « Rapid Assessment of the Impact and Perceptions of Small Arms in the Burundi interior », 2007, http://www.smallarmssurvey.org/files/portal/spotlight/country/afr_pdf/africa-burundi-2007-1-Forbes-DCA-SALW.pdf (consulté le 25 février 2010).
[273] Entretien de Human Rights Watch avec un représentant d’une agence donatrice, Bujumbura, 24 janvier 2010.
[274]« Lynchage d’un assassin devenu fou sous l’effet d’une grande dose de cannabis », Agence Burundaise de Presse, 12 février 2009.
[275] Human Rights Watch et l’APRODH estiment qu’il s’agit d’une liste assez complète de tous les meurtres par lynchage qui ont eu lieu au Burundi en 2009 (à l’exclusion de ceux basés sur des accusations de sorcellerie), mais il est toujours possible que nous soyons passés à côté de quelques cas. Cette liste repose sur des informations émanant des autorités de l’État, du personnel de l’ONU, d’ONG locales et de journalistes travaillant dans toutes les provinces du Burundi.
[276] Dans certains cas, Human Rights Watch et l’APRODH n’ont pas été en mesure d’établir avec certitude si des enquêtes de police avaient eu lieu, ou nous avons reçu des informations contradictoires de la police et d’autres sources ; dans ces cas, nous avons uniquement pu établir s’il y avait eu ou non des arrestations.
[277] Selon l’une des sources, le nom de la victime était « Simon Bamboneyo » plutôt qu’ « Hervé Ntahonkuriye ». Il n’a pas été possible d’établir avec certitude le nom de la victime.